À l’occasion de la Première des Boréades à Dijon, Barrie Kosky encore peu connu en France a accepté de nous recevoir. On lui doit en effet dans notre pays un beau Castor et Pollux de Rameau vu en septembre et octobre 2014 à Dijon et à Lille. Il mettra en scène la saison prochaine Le Prince Igor à l’Opéra-Bastille.
Wanderer s’est intéressé depuis longtemps au travail de cet artiste singulier, d’une fulgurante intelligence, infatigable créateur qui s’intéresse aussi bien au Baroque qu’à l’opérette, et qui a proposé une des mises en scènes les plus virtuoses de Meistersinger von Nürnberg au Festival de Bayreuth. Nous lui avons dédié un Focus l’automne dernier en consacrant plusieurs de nos articles à ses productions (voir ci-dessous).
Intendant de la Komische Oper de Berlin depuis 2012, il en a fait en quelques années l’un des théâtres les plus inventifs d’Europe, qui enchaîne les succès.
Alors nous avons essayé d’approfondir la connaissance de l’artiste et de l’homme, en évoquant aussi bien sa formation en Australie, ses origines juives, sa conception du théâtre et les formes qu’il privilégie, mais aussi quelques projets significatifs. Ce fut l’occasion d’une longue et sympathique conversation à bâtons rompus, vive, souvent amusante, où le lecteur, nous l’espérons, touchera du doigt l’art du metteur en scène, souvent décrié à l’opéra, mais en même temps découvrira l’un des artistes les plus polymorphes de la scène européenne, dont la disponibilité, l’esprit de tolérance et l’humanité frappent et séduisent immédiatement.
 Votre formation initiale en philosophie, en histoire de la musique et en allemand ne vous prédisposait pas a priori au théâtre. Comment êtes-vous tombé dedans ?
Votre formation initiale en philosophie, en histoire de la musique et en allemand ne vous prédisposait pas a priori au théâtre. Comment êtes-vous tombé dedans ?
Oh, ça a été relativement organique, et merveilleux quand je regarde les choses rétrospectivement. Comme vous le savez, ma grand-mère était hongroise, ma mère anglaise et mon père australien, et je suis allé très jeune au théâtre. Mes parents n’étaient pas des artistes, ils faisaient partie de cette bourgeoisie cultivée: c’étaient des « bêtes à abonnements »! Mon père aimait l’opéra, et nous y allions avec ma grand-mère, ma mère le théâtre parlé, et j’allais donc avec elle voir du théâtre « sérieux » mais aussi du Musical car elle adorait ça, sans oublier les marionnettes, et la danse ; en fait j’allais tout voir et j’avais accès au spectre entier du spectacle vivant.
J’ai vu des choses incroyables quand j’étais très jeune, Peter Brook, Merce Cunningham, Steven Berkoff, Tadeusz Kantor, Pina Bausch, qui faisaient des tournées en Australie, et beaucoup d’opéras et de musicals… j’ai dû voir à peu près 200 opéras pendant ma jeunesse. Et donc avant même de commencer j’étais déjà totalement infecté (rires). La grande bouffe si j’ose dire !
Et donc il fallait que ça sorte d’une manière ou d’une autre. Alors j’ai pensé faire l’acteur, j’ai fait beaucoup de théâtre en étant enfant, puis du théâtre à l’école et un jour, j’avais quinze ans, un de mes profs m’a dit « tu devrais mettre en scène un spectacle, choisis une pièce dans la bibliothèque ». Je ne sais pourquoi mon école avait dans ses rayons le Woyzeck de Büchner, et c’est ça que j’ai choisi (j’ai découvert Berg plus tard), je l’ai lu, petites scènes, faisable avec des jeunes, j’ai aussi inséré de la musique dans cette mise en scène, Bartók quatuor à cordes, Lieder d’Hugo Wolf, Kurt Weill etc… Et je me suis dit que ça n’était que du bonheur, que c'était ça que je voulais !
Voilà le début et la fin de mes études de mise en scène !
J’ai donc découvert la mise en scène à quinze ans: pas assez bon pour faire l’acteur, bon au piano mais pas assez pour une carrière de soliste, j’ai compris que c'était ma route, et de plus la philosophie, les arts et tout le reste je pouvais les mettre dans une mise en scène.
À l’université j’ai fait une dizaine de mises en scène aussi bien de théâtre que d’opéra, j’y ai fondé une compagnie d’opéra, nous y avons monté l’Orfeo de Monteverdi et La Calisto de Cavalli, puis cinq Shakespeare, et lors de ma dernière année d’université j’ai fait une double mise en scène de Lulu, la pièce de Wedekind et de Don Giovanni dans les mêmes décors qui a été vue dans un Festival, et du coup, j’ai été aspiré par le monde professionnel. Une longue histoire, pour laquelle je n’ai aucune formation simplement parce que la mise en scène cela ne s’étudie pas, cela se pratique.
Pouvez-vous préciser ? Il y a des écoles où l'on apprend la mise en scène…
On peut étudier l’art de l’acteur, la technique du danseur, mais la mise en scène on doit la pratiquer : on peut ou on ne peut pas. Chaque metteur en scène a un langage particulier, et pas seulement sur scène : il a un langage avec lequel il communique avec les autres et cela ne s’apprend pas. Aucun de mes collègues n’a appris cela. Il peut y avoir de merveilleux metteurs en scène qui ont étudié, mais ils avaient d’abord le talent nécessaire, de toute manière. Ils auraient porté de toute manière, et dans n’importe quelle circonstance leur talent sur la scène. Que peut dire un professeur à un élève metteur en scène ? Ce que je dis à mes assistants, que la meilleure chose à faire, c’est de s’asseoir en salle pendant une répétition et d'écouter comment on parle à un acteur, à un chanteur d’opéra et de voir ce qu’est le travail, ce qu’est la structure. Et puis après il faut aller en province et travailler dans un petit théâtre pendant cinq ou six ans. Il y a tant de jeunes metteurs en scène intéressants qui se brûlent très vite dans de grandes maisons parce que c’est trop tôt. Harry Kupfer ((L'un des plus grands metteurs en scène "historiques" de l'Allemagne d'aujourd'hui, ancien directeur artistique de la Komische Oper entre 1981 et 2002))m’a dit un jour qu’il n’a jamais étudié dans la DDR((La RDA, République Démocratique Allemande, l'ex-Allemagne de l'Est)) de l’époque, mais qu’il a d’abord travaillé comme assistant auprès d’un vieux routier, aux pieds duquel il a tout appris et notamment tous les aspects techniques et pratiques, puis il s’en est allé dans la province profonde pour travailler et trouver son langage. Le théâtre est un Verbe, c’est une chose à faire, a doing thing.
En observant votre travail, on note quelques éléments presque permanents comme la concentration de l’espace la plupart du temps dans une sorte de « boite », une attention de tous les instants au jeu de l’acteur, et toujours un moment d’humour ou de sourire. Existe-t-il un style Kosky ? Et si oui comment le définiriez-vous ?
Style n’est pas un terme que j’aime, il a pour moi une connotation négative. Je dirais plutôt un langage. Vous savez que je travaille avec cinq décorateurs différents ; je ne peux travailler avec une seule équipe, non parce que je fais beaucoup de productions mais parce que je ne le veux pas. Je travaille avec des créateurs de costumes et décors fantastiques, mais qui ont des esthétiques différentes, ce qui me permet de choisir ceux qui conviennent le mieux à une œuvre et être ainsi entre eux une sorte de fil rouge.
Mais vous avez tout à fait raison, beaucoup de mes productions ont cette « box » ou un cadre. Dans Les Boréades vous en avez deux dans une autre position.
Je peux me représenter que dans mon enfance il y avait de nombreuses boites, la première c’est un cliché mais il est vrai: ma mère avait une boite où elle mettait les frusques et costumes de théâtre que nous utilisions ma sœur et moi. Quand nous avons fait en famille Casse-Noisette de Tchaïkovski que j’adorais, avec plein de costumes chinois, arabes ou russes du deuxième acte, tout était rangé dans cette boite.
Je pense aussi que ce doit être une métaphore inconsciente de l’émigration des juifs, toujours prêts à l’exil et qui doivent avoir leurs affaires toujours déjà empaquetées dans des armoires ((Comme dans le décor d’Anatevka, NdR)). C’est aussi une métaphore de l’exil…
La troisième chose qui remonte aussi à l’enfance, c’est que nous avions une piscine et un petit sauna dans le jardin, une « box » là aussi, et cette boite fut le lieu de mes premières émotions érotiques. Dans mon enfance sans doute théâtre, érotisme, exil, tout devait être réductible à l’idée de boite, où les choses sont compressées et doivent surgir brutalement, comme le diable dans sa boite ((Jack in the box, NdR)). Mais il y a aussi des mises en scènes où je n’ai pas vraiment de boites ou d'espaces contraints, mais vous avez raison, j’ai souvent cette idée. Ceci étant, je ne me pose pas la question au départ (« Ah ! il me faut ma boite ») même si c’est quelquefois dicté par l’œuvre, comme le Rosenkavalier que je commence à préparer avec Vladimir Jurowski pour Munich en 2021 où l’on passe d’une boite à l’autre, mais c'est l'oeuvre qui veut ça…en revanche, ce n’est pas le cas dans Candide, par exemple.
J’ai été très influencé par L’Espace vide de Peter Brook ((Peter Brook, L’Espace vide, écrits sur le théâtre, Paris, Seuil, Coll.Points)), je l’ai lu très tôt quand j’étais ado, mais j’ai été aussi très influencé dans ma jeunesse par Lindsay Kemp dans son Flowers, inspiré de Genet ((Notre Dame des Fleurs, NdR)). À la même époque, j’ai vu aussi un spectacle de Steven Berkoff inspiré de Poe; c’était la première fois que je voyais une scène vide, avec seulement une lumière : on se dit que c’est là où commence l’aventure et on se demande quel est le travail. J’ai appris en 25 ans de théâtre qu’il ne faut pas préconcevoir. J’ai une direction, j’ai mes idées, et il faut ensuite faire sortir les choses par l’âme, le corps et la voix : tout doit sortir du panier.
Mais certains chanteurs ne sont pas préparés à ça…
Je ne travaille pas avec eux (rires). J’ai ce luxe de pouvoir choisir de travailler avec qui j’aimerais ou j’aime travailler ; cela veut dire qu’il y a des chanteurs à la voix merveilleuse, mais qui ne sont pas pour moi. Il y a de merveilleux chanteurs qui ne veulent pas répéter, qui restent seulement une semaine… Très peu pour moi.
Et l’humour ?
Il y a d’abord une grande tradition d’humour juif qui vient de mes grands-parents et de ma famille, il y a ensuite la tradition australienne : c’est un pays d’immigrés venus d’Angleterre et vous connaissez l’humour anglais. Et cet humour est retravaillé en Australie, très particulier, mélange d’ironie et de sarcasme…
Alors le mélange d’humour juif et australien, c’est ce que je pratique. Bien sûr je ne me dis pas à l’avance qu’il faut que je fasse de l’esprit, mais j’ai toujours Shakespeare en tête, avec ses énormes problèmes d’interprétation. Dans toutes ses tragédies, c’est plein d’humour : Richard III est si joyeux ! Au milieu de Macbeth on trouve le moyen de parler d’urine ! Et Le Roi Lear, plein de traits d’esprit ! j’essaie de trouver la comédie dans la tragédie et la tragédie dans la comédie.
Quelle est votre relation au livret ?
Essentielle. Il faut commencer par le texte. Le travail en répétition est sur le texte ! Le texte ! Et les meilleurs chefs d’orchestre seront de mon avis : « S’il te plaît ne chante pas les notes, chante le texte ! » Il y a tant de jeunes chanteurs qui arrivent en scène et qui ne font que du beau son. Ce ne sont que magnifiques vocalises destinées au travail en studio. Mais à l'opéra, il y a du texte. Alors le travail en répétition est de le faire émerger, de le faire vivre avec les notes et la musique. Quelquefois on s’ennuie à écouter des chanteurs et alors on leur demande, « mais quel est le mot important dans cette phrase ? ». Quelquefois ils oublient, ils pensent à la partition, au diaphragme. C’est important, mais le meilleur chanteur de tous les temps n’avait peut-être pas la plus belle voix. J’adore Chaliapine et si vous l’écoutez, vous l’entendez crier, parler, comme du théâtre parlé avec des notes, et c’est génial. Il y a des chanteurs, comme Michael Volle ((Son Hans Sachs des Meistersinger de Bayreuth)), qui ont une voix merveilleuse, mais surtout une incroyable compréhension du texte. Il fait partie de ces chanteurs d’exception dont on comprend chaque mot, qui pensent sur le texte, et qui expriment en chantant ce qu’ils pensent et sentent sur le texte. La phrase musicale n’est pas une abstraction sans motif : elle vient parce que derrière il y a un texte qui l’allume, qui la résout. Je dois dire que dans Les Boréades, j’ai trouvé Mathias Vidal à ce titre sensationnel, un vrai cadeau pour un metteur en scène.
En bref, il faut travailler en répétition avec le texte, pas avec les notes, et ça veut dire aussi savoir comment lire une partition, mais trop de metteurs en scène ne lisent pas les partitions et c’est un problème…mais c’est une autre histoire.
Vous avez un très large répertoire, vous avez mis en scène des dizaines et des dizaines d’œuvres, du baroque à l’opérette. Y-a-t-il des œuvres que vous ne voulez pas mettre en scène, que vous ne ferez jamais ?
Aida ! J’aime cette musique, j’aime la dernière scène avec sa musique à couper le souffle. Mais je suis incapable de mettre ça en scène.
Et puis Traviata, je ne suis pas très enthousiaste de la fin de Traviata. Ça m’irrite. C’est un scandale, je sais. J’aime sa musique, mais le Verdi de Macbeth, Rigoletto, Falstaff ou Otello me plaît plus. Cette Violetta avec sa pitié complaisante est un caractère qui m’irrite. Je trouve Aida avec ces choses égyptiennes (même si on n’a rien d’égyptien en scène) une œuvre assez ennuyeuse. Rigoletto ne m’ennuie jamais, ni Falstaff.
Je dirais aussi Tannhäuser. Je ne peux entrer dans cette œuvre. Je trouve l’histoire problématique. La seule chose qui me plaît en Tannhäuser est que Theodor Herzl l'a écouté à la Staatsoper de Vienne et que le soir même ça lui a donné l’idée de Der Judenstaat. Que l’idée de sionisme soit née de Tannhäuser m’intéresse beaucoup (rires)! J’ai essayé de penser au concept d’un Tannhäuser autour de Theodor Herzl (rires), mais ça ne tient pas cinq minutes.
Fidelio est un opéra qu’on ne devrait faire qu’en concert. C’était une expérience de Beethoven, mais ça ne fonctionne pas, on n’a pas besoin d’une mise en scène pour un opéra d’idées.
Enfin j‘exclus aussi presque tout le répertoire de Bel Canto. C’est un répertoire pour chanteurs et fétichistes de la voix. Ça ne m’intéresse pas. C’est beau, oui, mais après deux minutes je m’ennuie : les livrets sont faibles, les histoires sont faibles et le langage musical ne me passionne pas du tout.
Et d’où vient votre intérêt pour l’opérette, un genre qui en France est mort malheureusement ?

Oui malheureusement ! Alors que c’est en France que l’opérette est née!
À Berlin depuis 2012 nous avons non seulement une renaissance de ces opérettes berlinoises jazzy des années vingt, mais à Berlin le snobisme anti-opérette est mort: j’ai vu plein de spectateurs à Bayreuth qui sont venus vers moi en disant « Oh ! j’ai vu Die Perlen von Cleopatra... Oh! j’ai vu Ball im Savoy ! », cela signifie qu’on va à Bayreuth comme à l’opérette : plus de snobisme, il y a des spectateurs réguliers et ce n’est pas un hasard.
Mais en France, je ne pense même pas que ce soit du snobisme, le genre a disparu, n’existe plus, c’est tout.
C’est tout simplement tragique.
Un exemple : cette année on fête le deux-centième anniversaire d’Offenbach, Où est la production phare de l’Opéra de Paris ? Qui fait Rheinixen ((Les fées du Rhin, quand même représentées à Tours au début de la saison - NdR))? Où est le Festival Offenbach ? Un auteur qui s’est identifié avec la culture française ! Où sont les célébrations ? Il a écrit quarante pièces ! Et je ne parle même pas des autres compositeurs français d’opérettes.
En Allemagne il en va tout autrement. Parce que l’opérette a toujours été présente. Après la guerre sous d’autres formes, aujourd’hui aussi Dieu merci, elle n’a jamais complètement disparu.
Pour moi sans doute une fois de plus les choses viennent de l’enfance et notamment de ma grand-mère hongroise. J’ai très tôt entendu l’enregistrement de Gräfin Mariza de Kalmán ((Comtesse Maritza)) et j’en suis tombé amoureux et puis aussi Lehár. Ma grand-mère aimait Wagner, Bach, et l’opérette : typique culture européenne d’une dame de la bourgeoisie.
Au départ je n’ai pas fait d’opérette, personne ne m’en a demandées et surtout je ne savais rien de l’histoire berlinoise de l’opérette. En 2008, quand on m’a demandé si je voulais devenir Intendant de la Komische Oper, j’avais déjà fait des productions, mais je ne savais rien de l’histoire de ce théâtre, alors j’ai commencé à me plonger dans son passé, notamment avant Felsenstein ((Metteur en scène viennois qui a fondé la Komische Oper en 1947 et l'a dirigée jusqu’à sa mort en 1975)). Et je découvre le Metropol Theater. Je ne savais pas qui était Fritzi Massary ((Née en 1892, morte en 1969, elle fut l’une des plus grandes chanteuses d’opérette du siècle, et notamment dans les années vingt à Vienne et surtout à Berlin, créatrice des Perlen der Cleopatra d’Oscar Straus qui triomphe actuellement à la Komische Oper depuis la recréation en 2017 dans une production délirante de Barrie Kosky)), qui était Paul Abraham, bien sûr je connaissais le nom d’Oscar Straus. Et je découvre que Le Pays du Sourire de Lehár y a été créé en 1929. Alors je me suis dit qu’il fallait retrouver les partitions de ces œuvres. Qui les joue aujourd’hui ? Bien sûr on joue Strauss et Lehár, mais Paul Abraham? Et les opérettes inconnue de Kalmán? J’ai trouvé là un trésor. Un trésor que fut la République de Weimar, ces quinze toutes petites années : quand on pense ce qui s’est passé alors dans tous les arts, opéra, littérature, arts libéraux, cinéma ! Et l’opérette ne fait pas exception: c’était une incroyable créativité, des succès à répétition. Et bien sûr, 90% de ces hommes et de ces femmes étaient des juifs.
Ce fut pour moi comme une explosion nucléaire ! Et alors, comme par exemple René Jakobs a retrouvé plein d’opéras baroques, nous avons fait ce travail pour l’opérette. Nous avons essayé de retrouver un style, non comme dans les années soixante avec Gedda, magnifiquement chanté, mais stylistiquement à côté de la plaque. Plus de jazz, plus d’ironie, plus d’esprit juif. Il fallait s'y replonger, car on ne peut se représenter l’importance de la culture de l’opérette à Vienne, à Berlin ou à Budapest dans ces années-là.
Pour moi, le théâtre musical est comme un arbre, ou mieux comme un jardin qui a pris naissance notamment chez Offenbach, et c’était – c’est ma théorie – une forme d’art juive. Le père d’Offenbach était Kantor dans une synagogue et les mélodies d’Offenbach viennent de cette culture et de ces formes : la barcarolle des Contes d’Hoffmann, c’est pure musique de synagogue. Tout vient de là, et reste profondément attaché à la culture juive. Puis évidemment cette musique d’Offenbach communique avec la musique et la culture françaises d’un côté et allemandes de l’autre et à l’époque des opérettes berlinoises cet esprit né d'Offenbach se combine avec le jazz pour créer une nouvelle musique urbaine ((Kosky use de l’adjectif anglais « metropolitan »)), marquée par la culture juive, (pas seulement, mais presque toujours).
Puis après-guerre, ces formes ont été les parents du Musical américain parce que Gerschwin, Harold Arlen, Rodgers & Hammerstein ont tous entendu cette musique et connaissaient Kalmán, Lehár, Abraham, cela signifie que le Musical lui-même vient de ce jardin, qui est composé de plantes européennes.
Sans les juifs exilés venus d’Allemagne à Hollywood, sans l'expressionnisme allemand, pas de film noir, et le Musical explose, mélange du jazz des noirs et de la musique des juifs : tout cela me passionne et je dois dire aussi qu’à Berlin, avec ces opérettes, on entend une voix très importante de la ville, ce « berliner Luft » ((cet "air berlinois", par référence à l'air très célèbre extrait de Frau Luna de Paul Lincke, la première grande opérette berlinoise (1899), sorte d'hymne de Berlin)) qui souffle: et cet air, c’est vraiment Fritzi Massary, Ball in Savoy, Perlen der Cleopatra et tout le reste.
Cette année, enfin, Offenbach entre à Salzbourg, à côté de Mozart, Wagner et des autres ((Barrie Kosky y met en scène Orphée aux Enfers, sous la direction d’Enrique Mazzola)).
Je dois dire aussi qu’aussi bien dans le cas d’Offenbach que de l’opérette berlinoise, c’est incroyable ce que ce genre musical a pu porter à la scène, avec des figures de femmes exceptionnelles, avec la question du genre, avec l’érotisme: l’opérette avait 50 ou 60 ans d’avance sur le théâtre parlé ou l’opéra. À l’époque de Gerolstein ou de la belle Hélène que voyait-on à l’opéra? Des femmes sacrifiées, mourantes, de simples projections des désirs masculins. Donnez-moi un caractère dans l’opéra français en 1858 aussi fort que l’Eurydice d’Offenbach! Donnez-moi un caractère dans l’opéra allemand des années vingt qui soit aussi fort que les rôles portés par Fritzi Massary ! L’opérette à cette époque, c’était l’avant-garde.

Vous avez déjà évoqué l’importance de vos origines juives dans votre formation personnelle et dans votre travail. Pourriez-vous nous en dire plus ?

C’est une longue d’histoire et la judéité est un vaste paysage contrasté. J’ai grandi dans un contexte juif libéral. J’étais dans une école juive, mais mes parents ont été très clairs : "tu apprends un peu d’hébreu, tu fais ta Bar Mitzvah, et après tu es libre de décider". Par chance je n’étais pas dans une famille orthodoxe alors qu’il y avait une forte communauté juive orthodoxe à Melbourne. J’étais de toute manière très intéressé.
Après, pendant l’adolescence, j’ai eu ma période où j’ai dit « non, je ne veux pas être juif !». J’étais dans une école chrétienne anglaise où il y avait des étudiants juifs, mais je voulais être du côté de ces jeunes australiens blonds et chrétiens. J’étais dans un chœur et je voulais chanter le Requiem de Fauré et tout le reste.
A vingt ans j’ai fait ma première visite en Pologne à Cracovie et Varsovie, puis en Hongrie à Budapest voir les maisons de mes grands-parents et là j’ai commencé à m’y intéresser, et notamment un immense intérêt pour le vaudeville en yiddish, ces expériences des années vingt. De plus ma famille polonaise, mon autre grand-mère, était totalement impliquée là-dedans, compositeurs, librettistes et clowns. Donc cet intérêt pour le théâtre yiddish a abouti à la fondation d’un théâtre en yiddish en Australie. Ces thèmes sur l’exil, sur les Golems, c’était pour moi des thèmes culturels structurants pour raconter l’errance juive dans le passé. J’ai fait deux mises en scènes sur le thème du Golem que je trouve incroyable, plus riche que Frankenstein, en lien avec Adam, avec les hommes, avec cette merveilleuse histoire des lettres qui signifient vérité (emet) ou mort si on enlève le e (met) : vérité et mort dans un même mot, ça m’a influencé pour toujours.
Je suis donc lié à l’histoire de mes grands-parents, un mélange de culture juive religieuse, et d’athéisme. Je suis passionné de culture religieuse et j’ai mis en scène à Vienne quand je dirigeais le Schauspielhaus((Entre 2001 et 2005, il est co-directeur du Wiener Schauspielhaus)), de nombreux textes sur ces questions. C’est à la fois mon identité et mon travail. Je trouve que le Talmud est si beau, ces trois ou quatre lignes de texte avec autour toutes les possibilités interprétatives riches de plusieurs siècles qui vont s’accumulant autour. C’est une merveilleuse métaphore, non seulement pour le théâtre, mais aussi pour la vie.
J’ai toujours remarqué dans votre théâtre une forte instance sur les valeurs de l’humanité, de la tolérance. Est-ce que votre théâtre est politique ?
Tout théâtre est politique, mais tout théâtre n’est pas humaniste. Je suis assez profondément influencé par l’école de théâtre de la DDR, et je sais que les Ruth Berghaus, Harry Kupfer, Götz Friedrich étaient très importants et ont eu une énorme influence. Mais je ne suis pas un enfant de la DDR, ni un enfant de Brecht, bien que je l’aime beaucoup. C’est amusant parce que dans deux ans je fais deux Brecht, un pour la Komische Oper (Mahagonny) et un pour le Berliner Ensemble (l’Opéra de Quat’sous). Pour moi à l’opéra, le premier lien entre le chanteur et le spectateur est un lien émotionnel. Cela doit être ainsi parce que c’est de la musique, c’est du son et c’est physique : le son va directement dans les oreilles et dans le corps, c’est quelque chose de viscéral ; je ne peux parler que de moi, quand je suis dans une fantastique représentation, d'abord je sens, et je pense après. Le processus de la pensée vient après le processus émotionnel. Je trouve très problématique que les spectateurs doivent s’asseoir dans une salle d’opéra, faite de musique et de chant, pour penser. Sur le moment apprendre quelque chose, c’est impossible : c’est après que ça se passe, même juste après, mais toujours après. C’est d’abord l’émotion qui prime. On doit mettre sur scène un miroir de la vie, quelquefois amusant, quelquefois tragique, joyeux, nostalgique, mélancolique, quelquefois on danse et d’autres fois tout va mal. C’est ce que j’essaie de mettre dans chaque mise en scène, ce spectre total de notre vie ou de nos émotions. Je n’aime pas m’asseoir dans un théâtre pour ne voir qu’un thème ou qu’une émotion. Je n’ai pas envie qu’un metteur en scène m’assène pendant trois heures « le monde va mal, tout va mal, tout est terrible, la vie c’est de la m…, on ne peut se fier à rien, nous sommes foutus ». Ce n’est qu’un message de metteur en scène et c’est insupportable. Je suis… disons… un optimiste cynique !

C’est un peu le sens de vos Meistersinger ?
Oui, cette fin est totalement polysémique, mais beaucoup y ont vu une fin simpliste du type : l’art résiste et survit à tout. Ils n’ont vu que Wagner dirigeant son orchestre, mais la dernière image est toute autre. L’orchestre s’en va et disparaît, et Wagner demeure seul à la barre du tribunal et continue à diriger seul dans un espace vide. Ce n’est pas du tout «la musique qui triomphe », c’est ce qu’il pense à ce moment mais la dernière image dit bien autre chose. C’est profond, amusant, ironique, amer et tragique, tout ensemble.
Ce n’est pas la conscience de celui qui philosophe, c’est juste ce que je fais. Il y a des metteurs en scène que j’apprécie beaucoup, mais faire comme ils font, je ne peux pas. Quand je vois l’univers des images de Castellucci, c’est un grand artiste de théâtre, mais c’est le langage de Castellucci, et pas le mien. De même pour Tcherniakov, Warlikowski ou Herheim…
A Salzbourg on me demande comment je vais faire Orphée aux Enfers : je réponds, c’est Orphée aux Enfers, et pas Wozzeck, on ne va pas trois heures voir Orphée aux Enfers pour faire de la métaphysique, on n’y va pas non plus pour en sortir après trois heures en disant « Oh ! c’est l’opéra de ma vie ! ». Ce n’est simplement pas le but du jeu. On doit savoir ce qu’on attend d’une œuvre et ce qu’elle peut offrir.
Venons-en répertoire baroque.
Vous avez fait beaucoup de baroque, depuis vos débuts. Vous avez aussi commencé votre mandat à la Komische Oper par la trilogie de Monteverdi. Que signifie pour vous le répertoire baroque ?
Spontanément, je vous réponds : des figures de femmes fantastiques et fortes, ce qu’on ne trouve pas au XIXe siècle, ou seulement à la fin. Dans de nombreux cas, un mélange entre comédie et tragédie, chez Monteverdi, chez Cavalli, chez Rameau et en troisième lieu, c’est un champ entièrement ouvert à l’interprétation.
C’est totalement et merveilleusement flexible, « on fait avec dix, vingt, quarante musiciens ? Avec un mezzo ou un contre-ténor ? » Cette flexibilité rappelle d’ailleurs celle de l’opérette, écrite pour des chanteurs précis, adaptables à toutes les conditions possibles, conçue sur le moment et loin, très loin de l’académisme .
Enfin, il y a des histoires fabuleuses, et surtout un travail de mise en scène et de composition souvent d’une concision extrême. Écoutons ce que Monteverdi fait quand Orphée perd Eurydice, ces deux notes, simples, sur Ohimè, sont pour moi avec l’accord de Tristan, les deux moments les plus importants dans l’opéra. Monteverdi a compris que la forme musicale est profondément liée à notre univers émotionnel. Monteverdi a compris l’alchimie de l’opéra ; on n’a pas besoin toujours de dix minutes d’un air pour exprimer une émotion. On doit simplement comprendre que la musique apporte une solution à d’autres choses. Dans cette merveilleuse simplicité de la trilogie monteverdienne, il y a déjà toute l’histoire de l’opéra.
Et Les Boréades, dans ce contexte ?

Les Boréades est une œuvre particulière qui n’a pas la force dramatique de Castor et Pollux ou de Dardanus , ni la sophistication de Platée. C’est une œuvre abstraite, l’intrigue est si mince ! Il ne se passe quasiment rien jusqu’au cinquième acte, à partir de l’enlèvement d’Alphise. Sinon on chante et on danse et rien de plus. C’est une œuvre difficile… Nous avons cherché à rendre cette abstraction mélancolique.
Les Boréades est le travail d’un octogénaire et c’est l'une des partitions les plus radicales de l’ère baroque, par l’invention mélodique, par la concentration du drame à la fin, par la mélancolie : le dernier duo d’Alphise et Abaris est une merveille, un Tristan et Isolde baroque. C’est passionnant, peut-être Rameau sentait-il que ce serait son dernier opéra ? Il y illustre sa grande joie de vivre mais c’est une œuvre qui a des ombres, de très jolies ombres. Il faut mettre en scène cela sans prétention, d’une manière simple, presque une méditation. Certaines scènes ont plus de violence, mais ce n’est pas l’esprit de la pièce.
On devrait jouer plus souvent Les Boréades, parce que c’est une des œuvres les plus importantes de l’âge baroque. Et c’est une grande joie de travailler en équipe avec Emmanuelle Haïm.
Parlons un peu de la Komische Oper. Vous avez décidé de laisser le poste d’intendant et de rester metteur en scène en résidence ? Quels en sont les motifs ?
D’abord, je n’ai jamais pensé rester Intendant toute ma vie. La Komische Oper est ma maison artistique, mais je ne peux maintenir plus longtemps (cela fera 10 ans) la combinaison de mon travail artistique, dans la maison et en dehors, et de mon travail administratif. Mon temps est limité. La Komische Oper est le chapitre artistique le plus important de mon carnet de vie, mais pas le carnet tout entier. Ensuite sont venues deux offres très importantes, celle de diriger Amsterdam, une maison fantastique grâce au travail de trente ans de Pierre Audi, mais c’était maintenant, en 2019. Impossible de quitter la Komische Oper, ma famille, avant dix ans d’exercice. Dommage qu’ils ne m’aient pas contacté pour 2022 ! Ensuite est venue l’offre de Munich, un très grand honneur parce qu’en ce moment je pense que Munich est sans conteste la plus grande maison d’opéra au monde. Ce que Bachler et Petrenko font là, ça n’est pas comparable avec un autre théâtre. Alors c’était très tentant ! De plus, Klaus Bachler trouvait intéressant de voir deux artistes, Vladimir Jurowski que j’aime beaucoup et moi, prendre la suite du couple qu’il forme avec Kirill Petrenko. Alors j’ai réfléchi pendant une année et j’ai refusé: je ne veux pas être un intendant professionnel pour le reste de ma vie. Et je pense que Munich n’a pas besoin de moi. Ils ont les meilleurs chanteurs du monde parce qu’ils ont de l’argent, ils remplissent à 99%, ils ont un orchestre merveilleux qui va le rester sous l’impulsion de Vladimir Jurowski, et de toute manière j’y ai travaillé et j’y ai des projets. Alors qu’est-ce que j’y ferais ? De plus il y a des choses que j’ai sacrifiées ces dix dernières années, j’aimerais refaire du théâtre parlé, j’ai des projets de films que j’aimerais concrétiser. Et si je reste intendant à la Komische Oper, je le fais à 100%, jamais à 70% : il faut toujours être plein gaz.
Alors je me suis dit, je laisse la Komische Oper. Mais il y avait cette question des travaux ((La Komische Oper va entrer dans une période de cinq ans de travaux après 2022)) : quel intendant accepterait de reprendre un théâtre en travaux ? Impensable… et de toute façon ce sera un moment étrange, avec d’autres concepts. Alors je reste encore un peu. On fera le musical et l’opérette au Schiller Theater ((Le théâtre où s’était installée la Staatsoper de Berlin pendant ses propres travaux – 7 ans)), et pour le reste, nous avons des projets pour la ville, et notamment à Tempelhof ((L’ex-aéroport qui a laissé des espaces superbes disponibles)). Donc je reste metteur en scène en résidence, avec les responsabilités artistiques afférentes, je ferai des choses ailleurs, mais franchement, dix comme intendant, ça suffit.
Le théâtre doit changer, les gens plus jeunes doivent pouvoir venir, avec d’autres visions, d’autres concepts, d’autres impulsions. Le temps que j'y ai passé était fantastique, mais il faut partir. Elle est finie l’époque des Castorf, Peymann, Friedrich qui régnaient trente ans sur une institution, comme sur un trône. C'est fini parce que ce n’est pas sain... Vraiment, ce n’est pas sain !
On a l’impression, quand on vient à la Komische Oper, qu’il y a un « esprit » dans ce théâtre, dès qu’on entre. On s’y sent bien, accueilli… on y sent un « esprit de troupe » qui n’irrigue pas seulement les forces artistiques, mais aussi tout le personnel.
C’est une dramaturgie très consciente de notre équipe, depuis le début. L’aventure, la relation avec mon spectateur commence au moment même où il a décidé de venir à la Komische Oper. Cela veut dire accueil, que vous soyez sur internet, au téléphone ou à la caisse. Notre esprit commence là, mais doit continuer au vestiaire, puis au bar, ou quand on vous vend un programme, et puis dans la fosse, et puis sur la scène et en coulisse. Cela signifie culture de l’accueil et surtout culture de la générosité. Certains intendants croient que le job, c’est la scène, les chanteurs et le chef. Non ! la responsabilité est globale ! Il y a dans notre public nos femmes de ménage, qui assistent quelquefois aux répétitions… chacun est une part de la réussite de la maison. C’est une extension de ce que j’estime une nécessité, créer un esprit de famille.
Je ne suis pas Berlioz, mais je crois à l’Esprit du théâtre… Ce théâtre est la continuation de l’esprit de Felsenstein, qui a imposé le premier ces exigences, et de celui du Metropol Theater : chez nous, les fantômes sont très heureux.
Pour conclure, venons-en au futur : la saison prochaine, vous faites Le Prince Igor à l’Opéra-Bastille, Bastille est un immense vaisseau qui ne ressemble en rien à la Komische Oper, Le Prince Igor est une œuvre épique ? Expliquez-nous ce choix…
Tout d’abord, j’aime beaucoup travailler avec Philippe Jordan, je crois que c’était son idée après avoir fait ensemble Meistersinger; ensuite, je n’ai jamais travaillé à Paris, même si j’y ai vu de nombreuses représentations pour savoir comment y gérer l'espace… Enfin, la décision de faire Le Prince Igor vient de ce que cet opéra appartient à ces œuvres que je fais une fois par saison ou tous les deux ans, qui sont un peu des défis. Si on ne fait que les grands chefs d’œuvres Parsifal, Wozzeck ou Figaro, on laisse de côté des œuvres sensationnelles, et ici la musique de Borodine est extraordinaire. Bien sûr l’œuvre est difficile à monter et représente un défi, mais j’aime prendre des risques. C’est une œuvre qui est traversée par la mélancolie, très pessimiste, comme souvent le répertoire russe, que j’adore par ailleurs. On a une superbe distribution et c’est l’œuvre parfaite pour Bastille.
La prochaine saison il y a Les Indes Galantes aussi, à Bastille je crois… Quel défi pour l’acoustique !
J’ai d’autres projets en France, avec Pierre Audi à Aix-en-Provence, deux très beaux projets dont je ne peux rien dire encore.

D’autres projets ? Notamment à la Komische Oper ?
Oui, l’an prochain nous faisons Die Bassariden de Henze avec Vladimir Jurowski et surtout, il faut absolument venir pour notre festival Jaromir Weinberger ((Jaromir Weinberger, né à Prague en 1896 , il s’exila à Londres, en France puis aux USA pour fuir le nazisme et mourut à St Petersburg, Floride, en 1967)) une très grande redécouverte de l’auteur de Schwanda, der Dudelsackspieler ((Schwanda, le joueur de cornemuse, créé au théâtre National de Prague en 1927. Le succès fut mondial, y compris au MET en 1931, mais la carrière de l’œuvre fut interrompue par le nazisme et reprit çà et là après-guerre. L’œuvre a été jouée à Wexford et aussi à Palerme il y a quelques années)), un succès mondial. C’est Weinberger qui composa Frühlingstürme, la dernière opérette créée pendant la République de Weimar en 1933, à la veille de l’arrivée des nazis, pour Richard Tauber qui lui avait demandé une opérette. C’est pendant cette série de représentations qu’une des soirées fut interrompue par deux nazis, qui hurlèrent à Tauber « Toi le juif, fous le camp d’Allemagne !»… Il s’agit d’une histoire d’espionnage à la Hitchcock transformée en opérette ! Frühlingstrürme connut 20 représentations et ne fut plus jamais repris. Et nous le faisons, pour la première fois depuis 1933 !
D’autres projets sur les trois prochaines saisons, notamment en 2021 un projet géant autour de Stravinski, un projet de six heures avec toutes ces pièces en un acte comme Oedipus Rex, Le Rossignol, Les Noces, Renard… J’aime ces formes radicales de Stravinski qui mélangent les genres, chant, danse… Et nous avons les forces pour faire ça à la Komische Oper. Je vais travailler aussi avec Philippe Jordan à Vienne, et je suis très heureux désormais de pouvoir dans 99% des cas choisir les œuvres que je veux faire. Mais c’est fantastique d’avoir en ce moment tant de metteurs en scènes avec des écritures variées qui montrent que l’opéra n’est pas mort.Il y a des pays où c’est difficile, mais beaucoup de théâtre allemands sont pleins, la Monnaie a une fantastique programmation, Serge Dorny fait un travail sensationnel à Lyon : et ces salles sont pleines de jeunes. Non décidément, l’Opéra n’est pas mort.
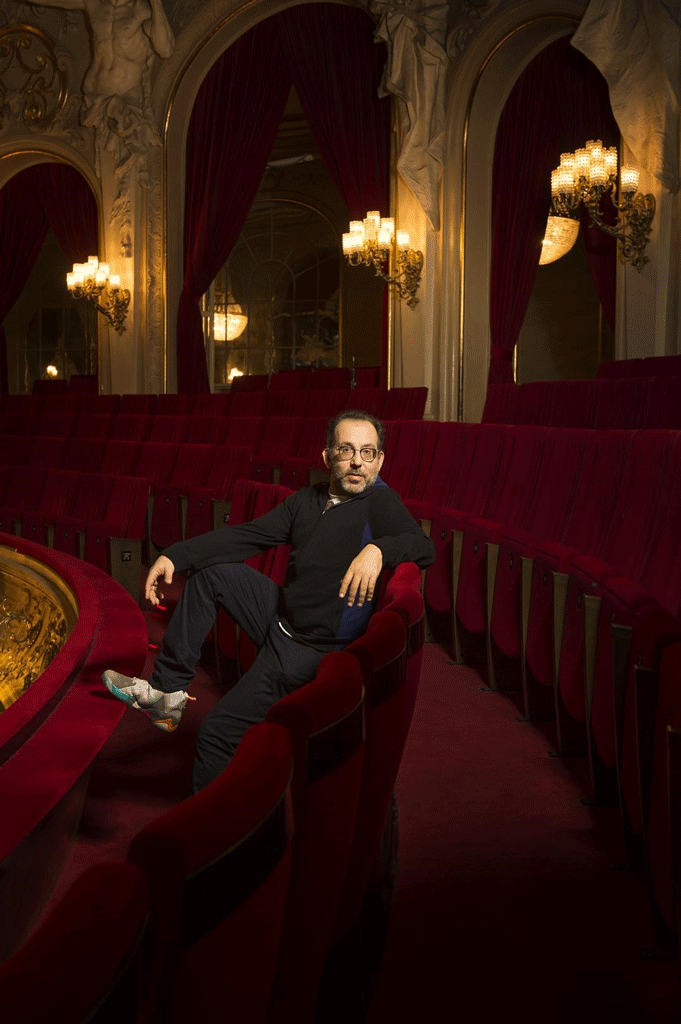
Liens vers les comptes-rendus de spectacles de Barrie Kosky dans Le Blog du Wanderer:
Ball im Savoy (Komische Oper)
Castor et Pollux (Lille)
Die Zauberflöte (Komische Oper)
L'Ange de Feu (Munich)
© Iko Freese - drama-berlin.de (Die Perlen der Cleopatra/Anatevka)
© Gilles Abegg (Les Boréades)
