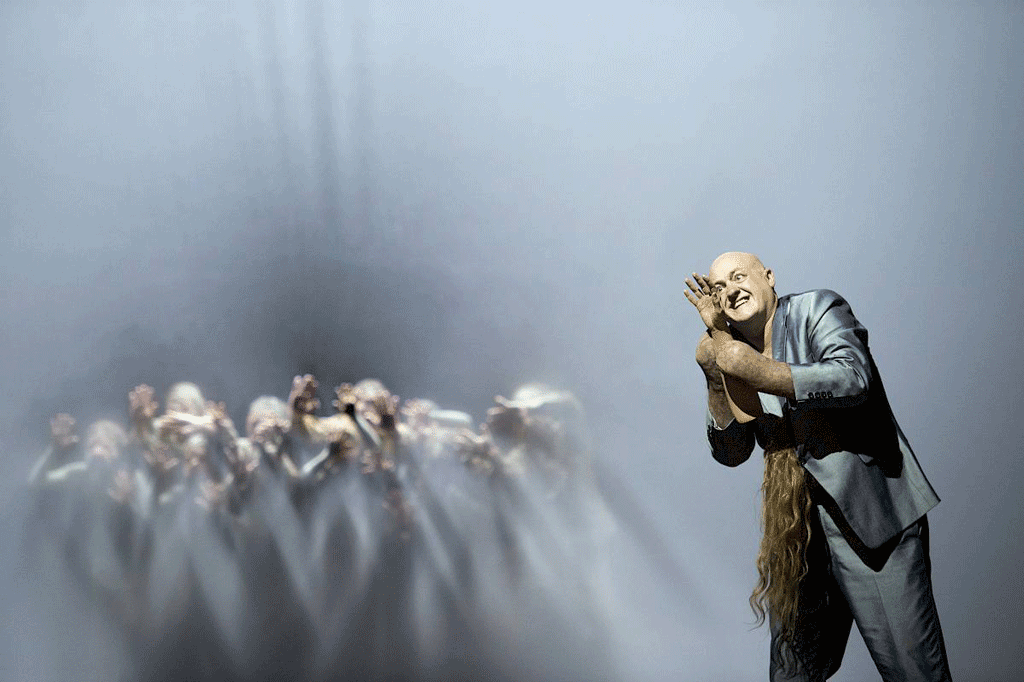
Un concept qui laisse au départ perplexe
L’Elysium, ce jardin d’Eden artificiel offert par Alviano Salvago à la ville de Gênes est pour Barrie Kosky et son décorateur Rufus Didwiszus un jardin de sculptures, des sculptures antiques ou de la Renaissance, des Aphrodite sortant du bain, L’enlèvement des Sabines de Giambologna, des têtes apolliniennes : il faudrait faire l’inventaire de toutes ces œuvres et sans doute trouverait-on ce qui les réunit. Il est clair que L’enlèvement des Sabines est un peu l’emblème de ce qu’est l’Elysium, le lieu de stupre de l’aristocratie génoise qui enlève les jeunes filles pour en faire usage dans une grotte dissimulée, alors qu’Alviano n’y met jamais les pieds, lui, la laideur personnifiée, que Kosky, par un raccourci très fort, prive de mains à la place desquelles il a deux moignons.
Ce sont ces mains qui manquent et qui vont faire l’histoire que Kosky veut raconter, ces mains qui empêchent de toucher de caresser et donc d’aimer, ces mains sans lesquelles les sculptures de l’Elysium n’existeraient pas. La souffrance du manque, la frustration, construisent le personnage d’Alviano dont on va visiter les méandres psychologiques.
Tout le premier acte du coup semble assez pauvre : les personnages se mettent en place, et d’abord, la clique des aristocrates (en costumes contemporains de Klaus Bruns, parce que l’œuvre nous parle encore aujourd'hui directement, d'autant plus encore ces derniers mois) qui par leurs mouvements composent à leur tour des groupes, comme des sculptures vivantes, et l’on joue à cache-cache entre les statues, on tourne, on disparaît, on réapparait aussitôt, comme dans un labyrinthe de marbre. L’impression qui ressort est celle d’un jeu sans but, duquel Alviano est exclu.
Barrie Kosky aime ces ambiances closes où les personnages (souvent nombreux) évoluent. Ce n’est pas le metteur en scène des espaces et des machines scéniques, c’est le metteur en scène qui concentre les choses autour d’un ou deux caractères et qui entre alors dans les univers mentaux. Ici le début est un peu labyrinthique parce que les personnages semblent tourner dans un espace clos sans entrevoir de solution, sans construire de trame, ce qui laisse spectateur en attente.
À cause de son infirmité, art et amour sont interdits à Alviano qui n’a pour lui que la richesse en compensation : le jardin des statues est le jardin de l’art, comme si s’exposait ce que la main de l’homme fait de mieux ; il est exclu des jeux d’amour, et des complots d’amour : le podestat s’inquiète des rapts successifs qui privent Gênes de jeunes filles, et lui semble ailleurs, pourtant concerné au premier chef, parce que tout se déroule sur son île, à la fois paradis de l’Art (un paradis très artificiel de glyptothèque) et enfer de stupre.
Les jeux d’amour se font aussi en dehors de lui, Tamare amoureux de Carlotta qui est la fille du Podestat, et en même temps une artiste (peintre dans le livret, ici sculptrice) est repoussé, et c’est là qu’à la fin de l’acte I : Alviano entre dans le jeu d’amour. Carlotta s’intéresse à lui non comme modèle physique mais parce qu’il a une âme que la jeune femme veut peindre. Comme tout artiste, elle ne cherche pas un modèle physique, mais elle veut voir « derrière les yeux », elle veut voir d’un modèle son âme, dans un mouvement mystérieux très hoffmannien. Et Alviano devient alors sa proie. Mais Art et amour se mêlent pour Alviano. Et ce sera sa perte.
Un travail rédical concerté
Le travail de Barrie Kosky et Vladimir Jurowski est assez radical et résolu. Comme on me faisait souvent aux XVIIIe et XIXe, chef et metteur en scène n’ont pas hésité à couper fortement l’œuvre, pour en donner une version locale qui correspondît aux choix esthétiques et dramaturgiques décidés ensemble. Les coupures sont telles qu’il ne peut y avoir eu décision unilatérale : c’est sans doute tous les deux qui sont à l’origine de la suppression de personnages (Pietro, Martuccia), et des scènes où ils apparaissent, ou même des quatre premières scènes de l’acte III, au total plus de 30 minutes de musique. Il y a derrière une volonté de couper dans la luxuriance de la musique (l’orchestration apparaît moins charnue) et de la trame pour donner une cohérence à leur option dramaturgique.
S’agissant d’un opéra encore très rarement donné, il y a trois attitudes possibles :
- Ou bien justement parce que c’est une œuvre encore mal connue, on la présente dans son intégralité.
- Ou bien et pour les mêmes raisons, on la coupe, parce que de toute manière personne ou presque ne s’en apercevra, sinon les professionnels, les fans ou les archéologues…
- Enfin parce que l’œuvre aux mains de ses interprètes, n’est jamais sacrale, mais sert un propos ou une lecture.
Il n’en reste pas moins que l’option radicale choisie n’est pas totalement convaincante. Mais il faut faire avec ce qu’on a… Il semble donc, tout en constatant les coupures, plus constructif de réfléchir au propos que les deux artistes ont voulu transmettre de cette œuvre. Et ce propos est clair : il s’agit d’amaigrir une œuvre assez débordante, d’en éliminer les couleurs post-romantiques, pour essayer d’en transmettre une vision plus univoque, plus concentrée, presque plus hiératique et plus structurellement noire aussi.
Cette idée de concentration autour d’une idée-force correspond d’ailleurs assez clairement à ce que Kosky présente dans ses travaux : il fait un choix radical, qui lui semble le mieux correspondre à sa vision de l’œuvre. Et ici, c’ est clair : il s’agit de mettre la focale sur Alviano Salvago, faisant des autres personnages, Carlotta et Tamare compris, des satellites, jusqu’à l’abstraction. Option radicalement opposée à celle de Bieito à la Komische Oper, qui faisait clairement de Tamare le personnage essentiel.
Et ces choix sont chacun justifiés : le livret de Schreker n’indique pas clairement de personnage principal : on pense Salvago, mais ce pourrait être Tamare, sans parler de Carlotta, ce personnage étrange de femme-artiste très neuf, presque révolutionnaire pour l’époque. Ainsi disparaissent quelque peu le Podestat ou le duc Adorno, dont le statut reste « entre deux eaux », et dont on arrive bien peu à dégager l’importance dans cette vision si concentrée qui cherche à se débarrasser de l'anecdotique – et même l'Elysium de ce point de vue perd de sa pertinence : Kosky ne cherche pas à s'attarder sur les viols des jeunes filles ou sur un quelconque aspect "moral".

Au départ, au milieu de ce jardin de statues, on se dit que l’enjeu est l’art, et aussi l’artiste, puisque l’Élysium semble dédié à la beauté « représentée », « idéalisée », mais peu à peu on voit que l’enjeu se déplace vers les personnages et du deuxième acte au magnifique troisième acte, on se consacre de plus en plus sur le drame intérieur d’Alviano, avec une rigueur décisive, qui donne à l’œuvre une autre couleur, tragique, dont toute luxuriance est absente, voire sacrifiée dans un espace de plus en plus abstrait.
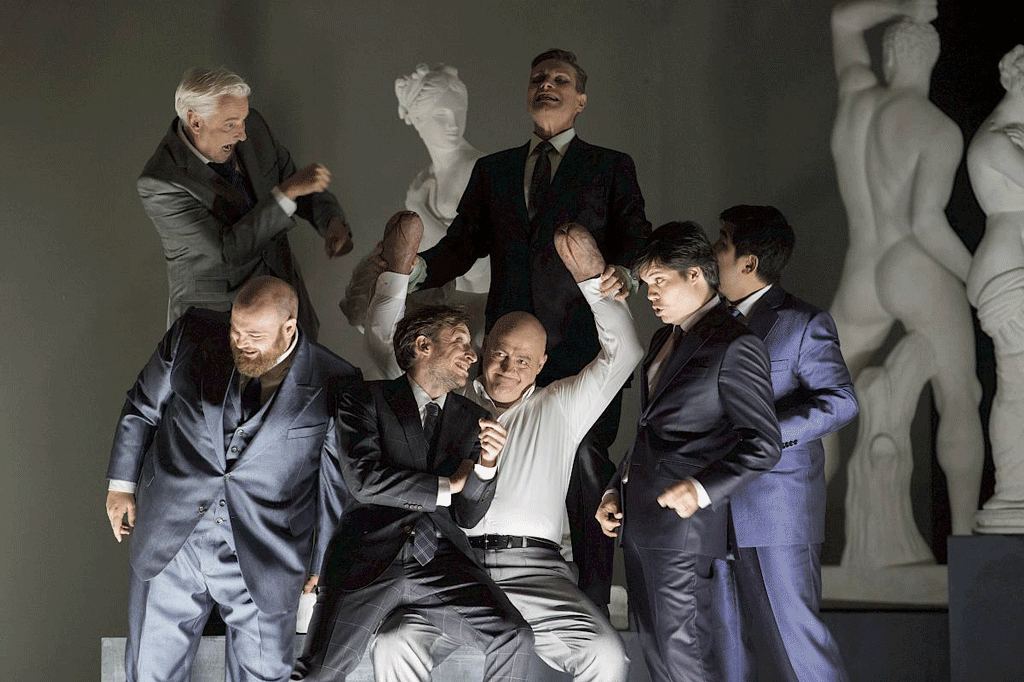
Ainsi, Kosky nous montre un premier acte volontairement plus « faible », plus conforme, une sorte de jeu où l’on met en place l’intrigue, mais où l’enjeu « politique » est sacrifié : les groupes de nobles concernés deviennent un peu des marionnettes, composant eux aussi des groupes « vivants » au milieu de toutes ces statues. Kosky veut montrer où sont les « utilités » et où sont les « enjeux », d’où cette impression d’un jeu superficiel, d’une mise en place un peu obligée où l’essentiel est volontairement rejeté à plus tard. Kosky ne veut pas se perdre dans les méandres, il crée des raccourcis qui vont à « son » » essentiel. C’est ainsi qu’on ne comprend pas d’emblée pourquoi la laideur d’Alviano est réduite à l’existence de deux moignons à la place des mains. Il faudra attendre le deuxième acte.
Procédant de la sorte, il évite de faire de l’œuvre une sorte de produit de l’expressionnisme, ou même de sous-produit d’un vérisme anecdotique : Gênes, la Renaissance, l’Elysium sont des ambiances fugaces qui n’apparaissent pas en tant que telles : la concentration sur le propos est telle que peu à peu la scène se vide de tout élément inutile pour ne plus laisser en place que ceux nécessaires à la compréhension qui vont en fait couvrir l’essentiel de l’acte II, presque réduit au dialogue Carlotta – Alviano, et surtout le troisième, complètement centré autour d’Alviano : le monde, le couple, le héros tragique : voilà comment se construit la mise en scène de Kosky.
C’est le troisième acte qui donnera la clef du parcours voulu par le metteur en scène, dont on saisit alors tous les partis pris..

Le pivot de la lecture
Le centre du propos est le début du monologue de la scène de l’atelier de Carlotta :
Ich kannt' eine Frau,
sie lernte malen
gleich mir an Antwerpens
Schule – die malte Hände.
Feine, schlanke, mit
zartem blauen Geäder ((Je connus une femme,
qui apprit à peindre
comme moi à l'École d'Anvers
– elle peignait des mains fines, minces avec
de délicates veines bleues)).
Tout va donc se jouer sur le symbole des mains.
Cette scène, réduite dans un espace vide à l’artiste (derrière son tour, les mains dans la glaise) et à son modèle sur son piédestal qui tourne comme s’il figurait lui-même la glaise à façonner devient celle qui va donner sens au reste : Carlotta cherche l’œuvre d’art et cherche à établir avec son modèle une relation qui puisse lui permettre de trouver la voie de la création, et Alviano se met à simplement et banalement aimer sa créatrice, parce qu’elle l’a regardé.

Ainsi Kosly fait à Alviano des moignons pour que Carlotta puisse, comme l’artiste dont elle parle, « faire des mains fines, minces, aux délicates veines », ces mains qui vont sortir du tour, qui vont s’inscrire dans une scène fascinante en projection, en allusion claire au Nosferatu de Murnau, ces mains qui un instant, comme une prothèse, vont donner à Alviano une nouvelle identité, une existence, ces mains qui sont l’âme du personnage exprimée par l’artiste. L’idée est profonde, et la scène constitue le moment le plus tendu, le plus intense, et sans doute le plus réussi de la représentation.
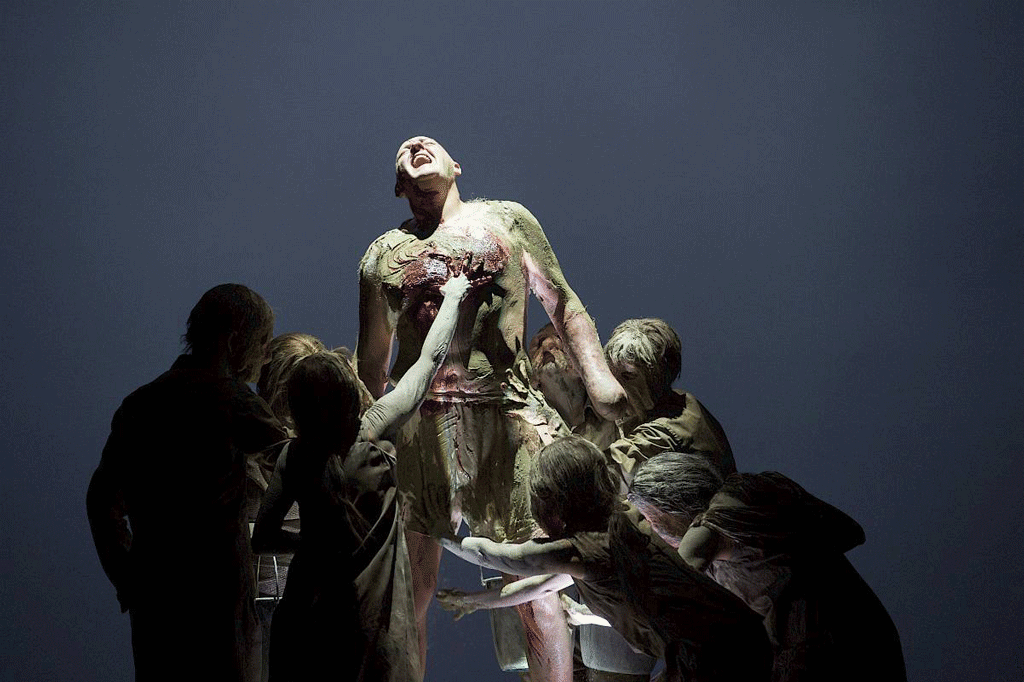
Ce climax passé, le troisième acte va laisser le personnage d’Alviano seul, désemparé, démuni et au bord de la folie. Le désir de l’artiste Carlotta cherchait l’âme, le désir de la femme Carlotta va chercher le corps, non d’Alviano mais de Tamare, et Alviano sur son tour de potier va continuer de tourner et de servir de pâte à sculpter (autre image fascinante et terrible), corps dénudé et chosifié, fait de sang et de boue. C’est cette situation de détresse absolue, ce désert de l’âme, qui, comme le reflet dans le conte d’Hoffmann, lui a été soustraite et a laissé au monde un corps, une matière, brute et désolée que va traiter Kosky (qui a coupé les scènes du début, trop dispersives) montrant ainsi dans son travail scénique le parcours d’Alviano de personnage à chose, laissant son phénoménal interprète John Daszak s’épuiser jusqu’au râle et au silence. Et c’est ce chemin du stigmatisé qui est montré ici, jusqu’à l’abstraction et la négation. Dans cet étonnant et surprenant troisième acte, les autres acteurs deviennent une sorte de masse inhumaine face à un homme qui devient chose, et une fois de plus se joue la tragédie de l’autre face aux autres (un peu comme le juif de ses Meistersinger), et la destruction de toute humanité, de toute psychè.

L’artiste est vu comme vampire qui vide le modèle. On pense à un tableau comme Le Vampire de Munch qui eût pu figurer Carlotta et Alviano. Ce seul troisième acte vaut le voyage parce qu’il donne sens au reste, et les statues du premier acte, anecdotiques si l’on veut, font alors sens, parce que ce trop-plein de reproductions sonne creux en retour, sonne jeu superficiel face à l’enjeu que Carlotta réussit à soustraire à son modèle. On comprend alors la volonté de Kosky d’en faire une sorte de film noir, un vrai film de vampire, d’où Nosferatu.
Vladimir Jurowski suit dans la fosse parfaitement le cheminement de Kosky sur la scène. Le chef russe est trop subtil, et trop intellectuel, pour ne pas avoir volontairement travaillé sa direction dans un sens très surprenant, mais qui obtient un triomphe au baisser de rideau.
Dans l’espace relativement réduit de la salle de Zurich, l’orchestre apparaît souvent très sinon trop présent. Jurowski pousse le jeu et le son de l’orchestre, très fort, presque envahissant, en mettant notamment dans le premier acte en relief non les cordes chatoyantes qu’on a l’habitude d’entendre, mais bois et cuivres, donnant une couleur très différente à la musique, comme s’il avait volontairement déséquilibré l’orchestre et en quelque sorte « trafiqué » la partition. C’est évidemment ce qu’on appelle une « lecture » aussi radicale que la mise en scène. Le début laisse à ce titre perplexe, qui met en relief ce qui n’est pas cordes, en laissant une impression dramatique, une intensité rare qui écrase, et qui ne donne pas du tout l’impression habituelle de conte de fée mystérieux, proche par certains aspects de la Turandot de Puccini, mais met immédiatement au centre quelque chose de tragique et tendu d’un côté, mais rutilant et presque superficiel de l’autre. Il joue sur les deux niveaux et c’est fascinant.
Et peu à peu son approche évolue : la musique se fait notamment dans le duo avec Carlotta, plus intimiste, plus raffinée, vaguement straussienne, avec quelque chose d’un miel dont l’amertume ne se révélera que plus tard…un travail retenu mais toujours d’une très grande limpidité, sans céder au pathos (ce serait si facile…).
Ce qui frappe c’est justement une approche musicale qui devient sensiblement moins « envahissante », avec quelquefois des couleurs debussystes, d’une rare délicatesse qui tranche avec ce qu’on entendait au premier acte. Il y a là une richesse de timbres exceptionnelle qui rend justice à la partition et à la composition (en dépit des coupures) comme rarement on a pu entendre, et qui montre aussi l’écriture de Schreker, qui s’enracine dans un travail très original sur le son et les couleurs. Il fait émerger notamment au troisième acte tous les aspects intimes et tragiques de cette musique, sans jamais que le son n’envahisse (c’était donc bien que le premier acte était volontairement fort), un travail d’orfèvrerie orchestrale qui fait découvrir d’une autre manière une musique encore mal ciblée et difficilement qualifiable. Une grande performance.
Comme presque toujours à Zurich, le chœur (direction Janko Kastelic) est particulièrement intense (chœur d’hommes !) et la distribution n’a pas de point vraiment faible. Dans l'ensemble, les rôles de complément sont parfaitement tenus, jusqu’aux élèves du studio (comme Ildo Song ou Ruben Drole). Il est vrai que la distribution est nombreuse (au moins une quinzaine de rôles dont une dizaine de parties épisodiques) d’où émergent notamment Paul Curievici, ou les membres de la troupe Iain Milne et Oliver Widmer.
Christopher Purves est le duc Antoniotto Adorno (et le capitaneo di Giustizia) une interprétation souveraine et intense (très beau succès final) notamment dans sa scène avec Tamare (Acte II) , mais limitée par une mise en scène qui marginalise le personnage, tout comme le Podestà de Albert Pesendorfer, puissant, mais au rôle limité.

Il en est de même pour le Tamare de Thomas Johannes Mayer, qui débutait dans le rôle. Comme toujours, le style est parfaitement dominé, la diction, les inflexions et les accents, mais la mise en scène limite le personnage à celui d’un méchant, amoureux, mais sans plus et sans rien de la subtilité qu’on peut y mettre (cf le sublime personnage de la mise ne scène de Bieito, plus approfondi qu’Alviano). Ainsi le Tamare de Kosky se développe dans une psychologie assez fruste et directe, sans méandres ni complexité, et c’est dommage car le chant toujours intelligent de Mayer perd en profondeur, mais la présence vocale et la technique restent stupéfiantes.
Catherine Naglestad est plus convaincante dans le personnage voulu par Kosky que celui qu’elle interprétait à Munich avec Warlikowski. Elle développe deux faces, celle de l’artiste « amoureuse » de son modèle dans le premier et deuxième acte, et la femme fatale froide et distante, au troisième (avec un changement de costume signifiant). La voix puissante n’a pas de mal à incarner les deux visions. Pendant tout le deuxième acte, elle arrive à donner à son chant de la subtilité, à accentuer et à colorer voire à insinuer. Le personnage voulu par Kosky n’est pas du tout érotisé, mais plutôt toujours distant et sur la réserve, c’est d’ailleurs un personnage comme Alviano marqué par la maladie (de cœur).

Au troisième acte, dans sa robe de mousseline, il y a la froideur glaciale, et l’expression érotique, seuls quelques moments traduisent le désir (dans une image magnifique où Tamare tient Carlotta et où Alviano cherche à s’immiscer). C’est une notable performance.
Notable, voire fantastique performance également celle de John Daszak, qui passe de personnage à modèle (joli mouvement où sa tête s’insère dans le bras d’une statue au premier acte) puis à bête de foire. C’est le cas que Kosky veut « traiter », et il lui impose une performance très dure mais exceptionnelle. Le chanteur britannique va jusqu’au bout de ses possibilités vocales, avec une force impressionnante. Devenu modèle sur un tour de potier pendant l’essentiel de l’acte III, il devient en même temps un spectacle, une sorte de "Pharmakos" que tous se mettent à haïr (il est rendu responsable des méfaits de l’Elysium), une bête que ses halètements semblent éloigner de l’humanité et de la conscience jusqu’à la folie et au silence final que le public totalement saisi prolonge à mesure que le noir se fait : Daszak est proprement hallucinant, avec un chant un peu détaché, presque désincarné et terriblement lacérant. Fabuleux.
Ce n’est peut-être pas la production la plus immédiatement convaincante de Barrie Kosky, mais si la première partie (Actes I et II) surprend et laisse quelquefois perplexe, le troisième acte qui constitue la deuxième partie est simplement prodigieux. Un travail musical et scénique à discuter, mais très loin de la médiocrité et loin du contresens aussi.

