À la fin de la représentation, un des chanteurs invite le public à prolonger la leçon de l’opéra en versant leur obole dans une urne destinée à une communauté de Neukölln (un des quartiers de la diversité berlinoise) aidant les déshérités et les réfugiés. Et le public très généreusement s’exécute. Pouvait-il en être autrement après l'ode à l'humanisme que ce Candide constitue ?

La Komische Oper est un théâtre particulier, au public très différent des deux autres opéras berlinois, et deux soirs de suite j’ai pu vérifier sa bonne humeur et sa disponibilité, un lieu où l’on se sent immédiatement à l’aise, avec un personnel d’accueil souriant et disponible, et une chaleur communicative. Toute visite à Berlin devrait compter comme étape ce lieu si particulier, si « berlinois » justement, qui plonge dans le cœur vibrant de cette ville. Et
pour fêter le centenaire de Leonard Bernstein, quelle meilleure idée que de proposer une nouvelle production de Candide pour la fin de l’année ?
La longue liste de tous ceux qui sont intervenus sur la partition que donne la fiche de distribution de la production en dit long sur les diverses modifications ((Y compris post mortem parce que les dernières révisions remontent à 1999)) après la première de 1956 à Broadway qui fut un échec. C’est une œuvre hybride s’il en fut, entre le musical, l’opérette et l’opéra, et le metteur en scène doit jouer sur plusieurs claviers, en respectant et la musique de Bernstein, et l’esprit du conte de Voltaire.
La décoratrice de Kosky, Rebecca Ringst, a décidé de limiter au minimum le décor, jouant sur l’espace vide et les lumières (d’Alessandro Carletti) souvent sculptées dans les brumes des fumigènes donnant souvent un air ouaté à l’ensemble : ainsi apparaissent et disparaissent une classe (scène désopilante où Pangloss enseigne à Paquette les joies de l’amour), une prison, une scène de Pole-Dance, un échafaud (pour l’autodafé) mais la scène est souvent vide et laissée à la troupe nombreuses, aux danses et aux mouvements impeccablement réglés. On a joué sur le pittoresque des centaines de costumes (Klaus Bruns), sur les alternances d’ambiances contemporaines et XVIIIème, sur des images qui rappellent l’univers de la BD (la perruque gigantesque de Voltaire par exemple) et sur la confrontation de plusieurs mondes. David Verdier dans ce site a résumé avec bonheur les univers contrastés de cette œuvre lorsqu’il a rendu compte de la production toulousaine.
Barrie Kosky choisit donc pour ce voyage d’apprentissage une apparente simplicité, pour mieux rendre compte de l’unité de l’œuvre, tout en préservant l’hétérogénéité des styles, sans jamais rien couper, avec une nette différence entre la première partie, plus vive, plus variée, et la seconde, plus « philosophique », peut-être aussi moins colorée. Le livret choisit de proposer les principaux épisodes du roman de Voltaire, paradis (Thunder Ten Tronck), puis la chute (Candide chassé du paradis) et enfin le repli final sur le jardin. Ainsi se succèdent l’épisode bulgare, puis Paris Vienne et Lisbonne (le fameux tremblement de terre), et l’Espagne. En deuxième partie l’essentiel se passe en Amérique du Sud (Montevideo, Paraguay, Eldorado, Surinam, retour en mer vers Marseille, puis Venise et enfin le retour au jardin…
Kosky essaie de rendre l’univers de Bernstein, en proposant un style hybride qui prend beaucoup au Musical, mais sans le brillant ni le côté superficiel, car il entend aussi servir le message voltairien notamment dans la deuxième partie, où lui-même souligne avoir opéré à chaque épisode un retour à Voltaire, notamment par le truchement du récitant, un Voltaire et un Pangloss à la couleur discrètement viennoise de Franz Hawlata le bavarois qui montre une fois de plus sa science du mot et de l’expression. La voix n’étant plus ce qu’elle était, il reste la perfection du dire, de la couleur, de l’ironie : Hawlata se montre ici un véritable maître. Unifié par le personnage de Hawlata, et par l’univers scénique créé, divers et néanmoins homogène, Kosky peut ainsi se permettre de mêler les questions qui nous assaillent, l’intolérance qui devient structurelle aujourd’hui, au niveau civil comme religieux, la peur de l’autre, l’immigration (magnifique scène sur la mer que la petite troupe affronte sur des Zodiac, vêtue de gilets de sauvetage). Toute l’ironie de cet optimisme béat contredit au jour le jour par les guerres sauvages, la pauvreté, la prostitution débouche évidemment sur l’amertume (Cunégonde n’est plus celle qui fut rêvée au début). Cunégonde, abandonnée dans la ville vit sa vie de fille des rues et chante son air célèbre « Glitter and be Gay » sur une scène de bar à stripteaseuses, une sorte de « Pole Dance » dans une ambiance de cabaret un peu louche.
Kosky, dont la ligne de conduite est de produire un théâtre servant toujours l’humanisme, l’ouverture et la tolérance, donc un peu à rebours de ce que nous vivons actuellement, prend dans Candide ce qui malheureusement reste d’actualité, la guerre, l’intolérance religieuse, l’inquisition et ses horreurs, les jésuites à la conquête des continents colonisés, tous épisodes voltairiens adaptables à des exemples contemporains, et il procède par signes, par touches, sans jamais laisser de côté un sourire même amer. Il en résulte un travail particulièrement rigoureux, d’une précision exceptionnelle, mais en même temps enchanteur, de cet univers enchanteur qu’on trouve dans les contes (Candide est, paraît-il un conte), comme l’épisode des moutons de l’Eldorado. Mais Voltaire écrit un conte philosophique où la philosophie demeure malmenée ne plaide pas en faveur l’optimisme de Pangloss, devant un monde qui ne cesse d’exposer ses injustices et ses déchirements. Les personnages un peu cabossés (voir la vieille femme !) qui constituent peu à peu « la petite société » (une société de la diversité, dirait-on aujourd’hui) se retrouvent finalement dans la montagne à vouloir « travailler leur jardin ».
Mais le livret reste ici trop elliptique pour expliquer la célèbre fin de Candide, ici un peu banalisée, comme pour conclure au plus vite. Voltaire en réalité va bien plus loin. La fin de Candide élimine les ambitions et les illusions du monde, se détourne des ombres de la caverne vers la réalité du jardin « qui rapporta beaucoup ». C’est lorsqu’on trouve satisfaction en une vie paisible et réglée que la « terre rapporte ». Voltaire exalte la valeur travail « Le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui le vice et le besoin » et l’idée que le bonheur social améliore la productivité (« la petite terre rapporta beaucoup »), une idée que la gouvernance économique semble avoir oublié, ou refusé de nos jours.
Cet aspect qui conclut le fameux chapitre XXX de Candide assez prémonitoire, n’est pas abordé par le livret de Bernstein. Mais Candide est écrit aussi en référence au maccarthysme, où la question morale et politique restait plus sensible peut-être que la question économique florissante dans le contexte des années cinquante.

Il y a dans ce travail outre une incontestable poésie, une vitalité qui va sans doute aussi au-delà du conte voltairien, au-delà du roman picaresque ou d’apprentissage.
Ce qui continue de frapper chez Kosky, c’est cette légèreté avec laquelle il aborde les questions les plus rudes dans chacune de ses productions, prenant au piège du sourire toute velléité intolérante, toute volonté de rejet. Quel que soit le titre qu’il aborde, Kosky a une vision, propose un regard qui n’est jamais répétitif, toujours plongé dans la réalité du monde, et pourtant faisant toujours rêver parce que cette vision reste ouverte, jamais noire : Barrie Kosky tout en restant réaliste croit aux forces d’un esprit positif : il y a quelque chose d'un Pangloss sensible et tendre dans son regard.
Au service d’une vision qui pourrait bien devenir aujourd’hui une référence en matière de mise en scène de cette œuvre au total assez problématique, et une référence tout court en matière de théâtre musical, une troupe comme toujours homogène et complètement engagée dans le projet. Nous avons déjà dit combien Hawlata mettait dans son rôle d’ironie et de distance gentille, donnant à son texte une couleur humaine unique, laissant toujours l’espace au sourire, mais aussi à la distance : Hawlata réussit à donner à son rôle la couleur du récit de Voltaire, les accents de l’ironie, et cette uniformité d’où semble absente toute émotion, un côté imperturbable quelle que soit la situation. Étonnant et admirable d’intelligence.
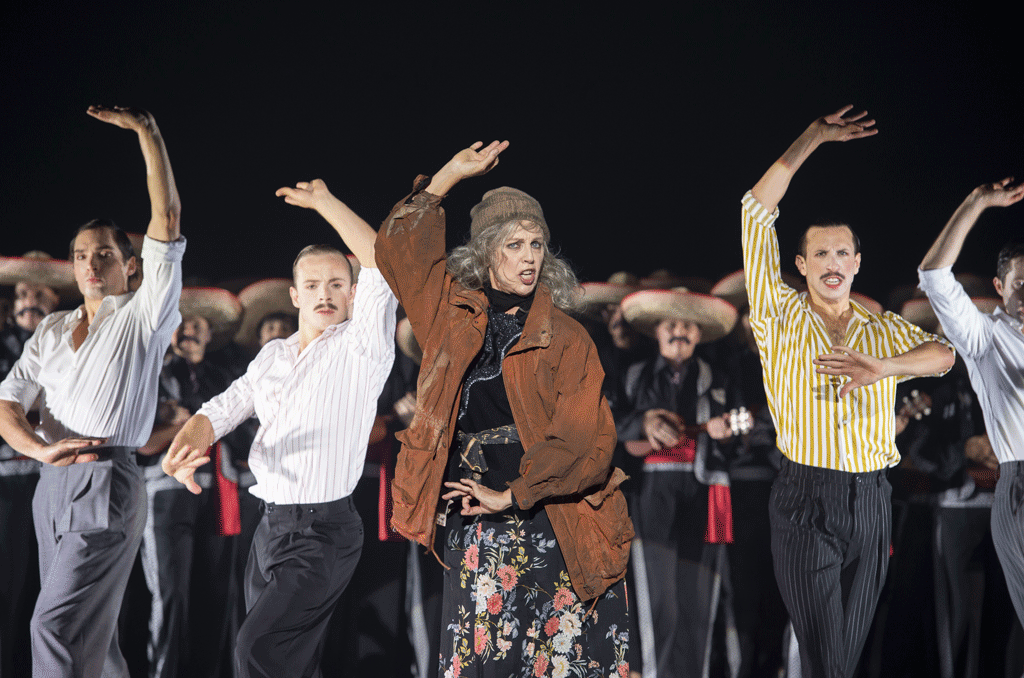
L’autre vedette invitée dans l’aventure est Anne Sofie van Otter, littéralement prodigieuse. Elle nous avait déjà stupéfiés dans la Muse un peu clochardisée des Contes d’Hoffmann dans la vision de Marthaler à Madrid. Elle repropose un personnage de marginale, vigoureux, chantant, parlant, et dansant. Certes la voix n’est sans doute plus aussi fraîche, mais la science de la parole, cette manière de sculpter le mot qui vient aussi d’une carrière de liederiste hors pair, fait qu’elle est un spectacle à elle-seule, imposant le silence et la concentration, mais aussi à d’autres moments provoquant rires et hurlements de la salle. Une composition immense, sensible et délirante aussi. Quels moments !

Mais au-delà de ces deux très grands artistes, les solistes réunis sont vraiment à la hauteur de l’enjeu : Allan Clayton est un Candide notable, d’abord par la présence et l’engagement scéniques : son apparition en Lederhose au milieu des danseurs en marquis XVIIIème est à la fois désopilante et donne l’image immédiate de son décalage, voire de son côté d’éternel enfant avec un engagement impressionnant dans la danse et le mouvement notamment au tout début (avant la « chute »). Sa présence vocale est forte : il a la couleur, le style, la technique, la poésie, parfaitement à son aise après un mois de représentations (la première a eu lieu le 24 novembre 2018), c’est une voix claire, avec un phrasé impeccable (nécessaire dans une œuvre qui navigue entre musical, opérette et opéra), sans aucune scorie. Son « Candide’s lament » est vraiment particulièrement émouvant, où la musique se rapproche tant de West Side Story.
Nicole Chevalier est Cunégonde. Elle se sort des redoutables problèmes de « glitter and be gay », aigus, rythmes, temps et contretemps avec honneur et panache. La mise en scène lui demande des mouvements qui ne l’aident pas. Elle n’a pas le brillant de certaines Cunégonde au disque, mais les exigences de la scène sont telles qu’elle est vraiment convaincante. C’est un soprano lyrique qui fut en troupe à la Komische Oper et qui aujourd’hui commence une vraie carrière internationale (elle sera cet été Elettra dans l’Idomeneo salzbourgeois) et la voix a du corps, le personnage de l’abattage, et comme souvent les chanteurs américains, elle est précise et douée d’une diction très claire.
Il faudrait aussi citer tous les autres qui contribuent à garder le niveau de la production au sommet, Dominik Köninger en Maximilian et dans d’autres rôles multiples ce soir (qui sera le lendemain Silvius dans Die Perlen der Cleopatra), Maria Fiselier en Paquette si fraîche, et la composition exceptionnelle de Tom Erik Lie, un des piliers de la troupe, dans la scène de Martin, où il donne une interprétation d’une intensité telle que ce pourrait être la plus forte scène de la soirée.
Mais tous sont à citer aussi bien aussi Ivan Turšić, Emil Lawecki (Cacambo), Matthias Spenke Carsten Lau , Adrian Strooper . Un festival pour une troupe inventive et exceptionnelle.
Le chœur lui aussi particulièrement bien préparé par David Cavelius, très présent avec une précision et un phrasé impeccables, est sans doute l’une des formations les plus engagées en scène qui puissent aujourd’hui exister.
L’orchestre de la Komische Oper sous la direction de Jordan De Souza montre encore une fois sa ductilité et sa qualité dans les répertoires les plus divers. Nous avions déjà remarqué ce jeune chef canadien dans une direction très sensible de l’Eugène Onéguine de Tchaïkovski dans la production splendide de Kosky, il donne là à voir une autre facette de ses qualités, très rythmé, très rigoureux, très précis, avec une respiration en complète osmose avec la scène. Dirigeant avec une vitalité et une énergie impressionnantes, mais ne négligeant jamais les détails d’une musique aux rythmes si divers qui vont de la gavotte au fandango il fait respirer toutes les facettes de cette musique : remarquable chef qui a sans nul doute un avenir.
Il reste au lecteur de programmer une virée berlinoise, où ce Candide est immanquable (Une représentation par mois en janvier, février, mars, avril, juin).
