 La Flûte enchantée est sans doute de tous les opéras de Mozart celui que la tradition a le plus galvaudé en le cantonnant à un jeu de pistes maçonniques englué dans un humanisme béat et larmoyant. On ne compte plus les mises en scène inutiles qui brodent à l'envi autour d'images d'Épinal montrant l'oiseleur emplumé, le prince et sa flûte de Pan, la princesse et sa marâtre hurlante… Il fallait à ce chef d'œuvre toute l'imagination et la fantaisie d'un Barrie Kosky pour le sortir enfin de l'ornière et retrouver de l'intérêt, comme le signalait déjà Wanderer qui reportait une représentation de la Komische Oper ((http://blogduwanderer.com/komische-oper-berlin-2016–2017-die-zauberflote-de-w-a-mozart-le-29-octobre-2016-dir-mus-henrik-nanasi-ms-en-scene-suzanne-andrade-et-barrie-kosky-animations-paul-barritt)). Cet amoureux du Berlin des années folles a su imprimer à "sa" Komische Oper dans bien des productions un style mêlant vaudeville et comédie musicale. Pour ce projet, il s'est associé au Collectif 1927 de Suzanne Andrade et Paul Barritt pour recréer une Flûte projetée sur une scène d'opéra transformée en immense écran de projection en deux dimensions. 1927, il faut le rappeler, est l'année de naissance du cinéma parlant avec la première du Chanteur de jazz de Al Jolson – un film qui précipite d'un coup des décennies d'inventions et de fantaisie au rayon nostalgie. Adieu donc ces gestes exagérés, ces grimaces d'acteurs lointains héritiers de Pierrot et Colombine, sur fond de piano métallique. En faisant ressurgir pour un soir cet univers d'images tremblantes entrecoupées de cartons explicatifs, Barrie Kosky et ses compères vont au-delà du simple habillage passéiste et vintage : ils réinventent l'œuvre en puisant dans les codes du cinéma muet et du conte pour (grands) enfants.
La Flûte enchantée est sans doute de tous les opéras de Mozart celui que la tradition a le plus galvaudé en le cantonnant à un jeu de pistes maçonniques englué dans un humanisme béat et larmoyant. On ne compte plus les mises en scène inutiles qui brodent à l'envi autour d'images d'Épinal montrant l'oiseleur emplumé, le prince et sa flûte de Pan, la princesse et sa marâtre hurlante… Il fallait à ce chef d'œuvre toute l'imagination et la fantaisie d'un Barrie Kosky pour le sortir enfin de l'ornière et retrouver de l'intérêt, comme le signalait déjà Wanderer qui reportait une représentation de la Komische Oper ((http://blogduwanderer.com/komische-oper-berlin-2016–2017-die-zauberflote-de-w-a-mozart-le-29-octobre-2016-dir-mus-henrik-nanasi-ms-en-scene-suzanne-andrade-et-barrie-kosky-animations-paul-barritt)). Cet amoureux du Berlin des années folles a su imprimer à "sa" Komische Oper dans bien des productions un style mêlant vaudeville et comédie musicale. Pour ce projet, il s'est associé au Collectif 1927 de Suzanne Andrade et Paul Barritt pour recréer une Flûte projetée sur une scène d'opéra transformée en immense écran de projection en deux dimensions. 1927, il faut le rappeler, est l'année de naissance du cinéma parlant avec la première du Chanteur de jazz de Al Jolson – un film qui précipite d'un coup des décennies d'inventions et de fantaisie au rayon nostalgie. Adieu donc ces gestes exagérés, ces grimaces d'acteurs lointains héritiers de Pierrot et Colombine, sur fond de piano métallique. En faisant ressurgir pour un soir cet univers d'images tremblantes entrecoupées de cartons explicatifs, Barrie Kosky et ses compères vont au-delà du simple habillage passéiste et vintage : ils réinventent l'œuvre en puisant dans les codes du cinéma muet et du conte pour (grands) enfants.
On est frappé par le caractère inclassable d'une entreprise sans équivalent. Ni mise en scène, ni ciné-concert, ni mise en espace, on devrait inventer une catégorie pour parler de mise en scène à l'intérieur d'une image animée. Avec une méticulosité des détails et des idées tout simplement prodigieuse, les chanteurs évoluent dans un espace très réduit au pied de ce qu'il faut bien appeler un décor et la plupart du temps, accrochés à‑même l'écran vertical, apparaissant et disparaissant par un jeu subtil de cases pivotantes. Il faut à ces acteurs-chanteurs une maîtrise étourdissante des placements car seule une parfaite mémorisation des gestes permet aux images de trouver un sens et garantir l'effet escompté.
Pour saisir l'acuité du parti-pris, il faut prendre en compte les allusions du livret de Schikaneder à la règle du silence, règle fondamentale de l'initiation maçonnique – ainsi, Papageno rendu muet par les trois Dames ou bien soumis au silence lors dans la scène des épreuves avec Tamino. Barrie Kosky associe ces éléments avec cette forme de rituel que représente pour des enfants la projection d'un film qui exige d'eux une concentration silencieuse. Il va plus loin en remplaçant par exemple toutes les scènes dialoguées par des intertitres (ou "cartons") avec des répliques animées, avec un accompagnement au pianoforte jouant des extraits des Fantaisies K 396 et K 475 en ré et ut mineur.
Sur l'écran défilent un Papageno en fantôme de Buster Keaton avec canotier "Pork pie" et chat noir Mistigri, Pamina en Louise Brooks, Monostatos en Nosferatu-Murnau, Sarastro mi-Camille Flammarion mi-George Méliès, une Papagena de music-hall et trois dames berlinoises avec fourrures et chapeaux cloche. En guise de flûte, une étonnante fée-Pamina en forme de libellule qui laisse tomber dans son sillage une pluie de notes autour de Tamino changé en chanteur des Comedian Harmonists. Kosky fait de sa Flûte à la fois une allégorie qui tient du conte orphique et du retour à l'enfance. On croise l'effroi et le monstrueux avec une Reine de la nuit changée en immense araignée telle la sculpture "Maman" de Louise Bourgeois ((https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/guia-educadores/maman‑2/)), des chiens-loups tenus en laisse par un Monostatos qui se glisse sous les draps de Pamina. On passe en un tournemain de la frayeur à la légèreté avec la boisson aux éléphants roses de Papageno qui voit apparaître dans Ein Mädchen oder Weibchen un Dumbo en porte-jarretelles dans un verre à cocktail.
 Le monde de la Reine de la Nuit et de Sarastro représentent une forme de parentalité en négatif fait peser une menace directe sur le couple Pamina-Tamino : d'un côté, la mère possessive en métaphore des forces obscures et dévorantes de la nature ; de l'autre, l'autorité paternelle en représentant de l'ordre rationnel et scientiste. L'araignée déploie ses pattes comme des barreaux de prison autour de sa fille, tandis que Monostatos la menace avec sa meute terrifiante. Une ressemblance étonnante fait de ces deux personnages des monstres aux têtes difformes, juchées sur des corps squelettiques. Face à eux, c'est un Sarastro changé en penseur matérialiste qui ne perçoit du réel que la relation mécaniste qui relie une cause à son effet. Inventeur d'une armée de singes mécaniques et d'énormes éléphants de la pensée rationnelle (merci Descartes), son pouvoir est également représenté par une tête immense à l'intérieur de laquelle s'agitent des rouages et des mots-symboles : Travail, Sagesse, Art, Science etc. On pense aux créatures de la Planète sauvage de René Laloux et Roland Topor, un bestiaire et des créatures issues du cerveau d'un savant fou et totalitaire. Il y a du Chaplin des Temps Modernes dans la candeur avec laquelle Papageno cherche à s'emparer des poulets rôtis qui sortent de l'immense machine industrielle. C'est ce même Chaplin qui revient à l'esprit dans la scène où Pamina et Tamino s'échangent des mots d'amour en forme de happy end, à l'issue d'un voyage au centre de la Terre aux allures d'exploration de l'Enfer de Dante.
Le monde de la Reine de la Nuit et de Sarastro représentent une forme de parentalité en négatif fait peser une menace directe sur le couple Pamina-Tamino : d'un côté, la mère possessive en métaphore des forces obscures et dévorantes de la nature ; de l'autre, l'autorité paternelle en représentant de l'ordre rationnel et scientiste. L'araignée déploie ses pattes comme des barreaux de prison autour de sa fille, tandis que Monostatos la menace avec sa meute terrifiante. Une ressemblance étonnante fait de ces deux personnages des monstres aux têtes difformes, juchées sur des corps squelettiques. Face à eux, c'est un Sarastro changé en penseur matérialiste qui ne perçoit du réel que la relation mécaniste qui relie une cause à son effet. Inventeur d'une armée de singes mécaniques et d'énormes éléphants de la pensée rationnelle (merci Descartes), son pouvoir est également représenté par une tête immense à l'intérieur de laquelle s'agitent des rouages et des mots-symboles : Travail, Sagesse, Art, Science etc. On pense aux créatures de la Planète sauvage de René Laloux et Roland Topor, un bestiaire et des créatures issues du cerveau d'un savant fou et totalitaire. Il y a du Chaplin des Temps Modernes dans la candeur avec laquelle Papageno cherche à s'emparer des poulets rôtis qui sortent de l'immense machine industrielle. C'est ce même Chaplin qui revient à l'esprit dans la scène où Pamina et Tamino s'échangent des mots d'amour en forme de happy end, à l'issue d'un voyage au centre de la Terre aux allures d'exploration de l'Enfer de Dante.
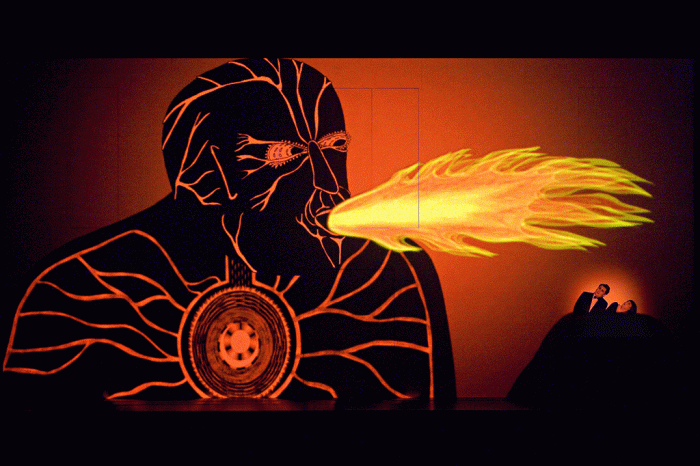
Le plaisir des oreilles est – hélas – aux antipodes de la fascination visuelle, avec en premier lieu la pulsation morne et anecdotique de Kevin John Edusei qui ne parvient pas vraiment à discipliner un orchestre de la Komische Oper qui multiplie les scories et les approximations. Les décalages entre fosse et plateau sont particulièrement patents dans les interventions du chœur Arnold Schoenberg, en moyenne forme ce soir-là. Deux casts alternent durant les représentations données à Favart ce mois de novembre. Parmi les rôles principaux ce soir-là, on retient la Pamina assez droite de Kim-Lillian Strebel qui compense par la projection les détails qu'elle laisse en chemin, tout comme le tonnant et vibrant Sarastro d'Andreas Bauer. On trouve ensuite le Papageno agité de Richard Sveda et le timbre vipérin du Monostatos d'Ivan Turšić. Si Adrian Strooper appuie excessivement les changements de registres de son Tamino, il demeure très cohérent dans le jeu d'acteur et l'abattage. On aura entendu ailleurs des Dames moins dépareillées ou une Reine de la Nuit avec plus de saveur que la pâle Olga Pudova. Qu'importe – la scène donne largement de quoi se réjouir, débordant d'inventions sans aucun temps mort. Plus qu'un succès, l'invention d'un genre.


J'ai vu mercredi dernier cette production qu'avait vivement conseillée Wanderer en effet. J'ai lu sur de nombreux sites des comptes rendus quasi tous positifs de cette Flûte à nulle autre pareille. Mais c'est dans votre article que je retrouve le mieux les impressions que j'ai éprouvées et les références culturelles que j'ai cru percevoir. Mise en scène époustouflante d'inventivité et de précision dramaturgique. Déception sur le plan musical. "L'invention d'un genre" sans doute , mais qui sans desservir l’œuvre, n'exalte pas Mozart.