
Dissimulé sous un tas de corbeaux morts, Macbeth apparaît peu à peu dans un univers noir(costumes pour l'essentiel noirs de Klaus Bruns), éclairé par la lumière d’un long luminaire qui va tout au long de la représentation isoler l’espace de jeu et le couple Macbeth/Lady , seul dans cette obscurité oppressante , d’où vont émerger peu à peu quelques personnages ou les sorcières, des corps nus, d’hommes, de femmes et d’hermaphrodites, des corps en transformation, des corps instables, reflets des peurs de l’homme et toujours en mouvement par le jeu d’admirables éclairages et vidéos.
Voilà l’ambiance de ce Macbeth, éminemment concentrée, et fondée sur le monde mental de Macbeth, en proie à des montées d’images scandées par des halètements bruyants qui se manifestent aux moments clés de l’œuvre.

C’est d’abord un univers psychologique insupportable qui est ici imposé. Comme à son habitude, Barrie Kosky installe la trame dans un cadre unique, de Klaus Grünberg, qui signe aussi les éclairages blafards, très réussis : seuls, de faibles lumignons qui délimitent l’espace jusqu'au point de fuite, en perspective, au long duquel, dans l’obscurité, le chœur se dissimule.
La subtilité de ce travail réside en deux points :
– D’une part l’isolement du couple et sa centralité fait des autres personnages, même les plus importants (Banco par exemple) des « utilités », pour ne pas dire des comparses ou des outils, ils sortent de l’ombre et puis y retournent laissant au milieu deux chaises, deux êtres et quelques corbeaux. On assiste à du théâtre de chambre virtuose.
– D’autre part, la volonté de concentrer l’action autour du couple pratiquement toujours en scène ne fait pas de l’histoire un fantasme ou un rêve. Son effroyable logique reste une réalité, comme si les deux vivaient deux vies parallèles, ce qui se passe réellement et ce qu’ils en voient dans un mental ravagé par la violence et l’ambition.
C’est ce jeu permanent qui fascine et qui créé une tension difficilement supportable à ce spectacle : la présence des corbeaux aux côtés des deux personnages renvoie presque à un univers hitchcockien et en tous cas à l’odeur de charogne que Kosky, avec une étonnante économie de moyens, réussit à créer sur la scène.

Une autre image frappante, l’image de fête donnée simplement par des serpentins lancés de l’ombre sur le couple, qui finit par en être prisonnier : enserrés dans des serpentins, les deux semblent prisonniers dérisoires d’une fausse fête et des faux semblants qu’ils ont créés.
Ce qui marque les mises en scène de Kosky, c’est un espace unique où toute la trame est concentrée et où les mouvements se gèrent d’une manière virtuose, y compris avec un nombre conséquent de personnages (voire ses Meistersinger à Bayreuth). Ici l’espace est réduit au minimum, et il n’y a rien sur scène sinon un halo de lumière et deux chaises où se concentre l’essentiel de l’action.
Ensuite, Kosky est particulièrement attentif à concentrer le regard non sur un décor spectaculaire, mais sur les personnages, grâce à un travail d’acteur éminent, détaillé, où chaque mouvement et geste est millimétré. Le travail sur les deux personnages est d’une précision rare, où Lady Macbeth est la dominante et Macbeth le dominé, elle toujours droite et raide et lui toujours en mouvement et toujours torturé, et chaque mouvement des mains incroyablement tendu (scène du somnambulisme) chaque mouvement du corps impressionnant (Macbeth et ses transes). Kosky montre aussi le fonctionnement couple à travers leur relation physique, leur désir mutuel, leurs étreintes : les monstres savent aussi aimer.
Cette concentration du regard et de la trame sur un espace aussi réduit, émergeant d’une obscurité lourde, crée une incroyable tension. Même quand les chœurs sont en scène, ce qui pourrait créer une respiration, ils sont tellement compacts qu’ils créent un étouffement supplémentaire. Le monde est noir étouffant, sans solution, sans but, sans perspective et face au couple, tout n’est rien qu’utilité et figuration.
Le travail de Barrie Kosky s’était naguère construit en étroite collaboration avec Teodor Currentzis, comprenant aussi les rythmes et les respirations musicales, les silences, les ruptures en étroite liaison avec le plateau, et la reprise du spectacle avec le jeune chef Francesco Lanzillotta, qui commence à être appelé dans les grands théâtres européens (il dirige à Francfort, les 7 et 9 novembre, Il Corsaro, œuvre rarement donnée de Verdi, créée un an après Macbeth) est loin de déparer.
La relative exiguïté de la salle rend le son de l’orchestre très présent, voire un peu fort. C’est souvent le cas, au-delà de cette soirée. Mais si l’approche reste un peu rude, un peu rêche (en pleine cohérence avec la mise en scène de Kosky d’ailleurs), et manque peut-être d’une petite touche de raffinement, on doit noter à la fois l’impeccable suivi des chanteurs, le souci de clarté, la volonté de bien mettre en valeur l’écriture de Verdi par une lecture limpide de la partition, et surtout une respiration et un rythme implacable, parfaitement en phase avec le plateau, et totalement maîtrisé. Ce Verdi est tendu, dramatique, sombre et ne laisse guère d’issue. Et Lanzillotta sait donner cette couleur râpeuse à l’ensemble. Il dirige un Macbeth sans issue, une impasse et le son qu’il produit répond à cette option. Il y a une sorte de raideur dans le rendu qui éclaire parfaitement le propos.
Le chœur, toujours invisible est très présent, préparé par Christian Günther, et en même temps sait aussi utiliser par la modulation sa situation presque toujours fantomatique : il est particulièrement impressionnant dans Patria oppressa. Et dans les morceaux plus épiques (chœur final) il reste très au point et sans aucun décalage avec l’orchestre.
La distribution comprend des rôles de complément dignes d’intérêt, notamment le Malcolm du jeune Leonardo Sanchez, à la voix claire et bien posée, le médecin de Wojciech Raziak, au joli phrasé et au timbre chaleureux, mais aussi la jeune Justyna Bluj dans la dame de compagnie de Lady Macbeth.
En ce qui concerne les protagonistes elle est conforme à celle de la première en 2016, à l’exception du Macduff de David Junghoon Kim, au joli timbre, mais qui n’a pas la délicatesse voulue dans son air « Ah, la paterna mano », il manque d’élégance dans un chant qui reste néanmoins honorable. La difficulté de l’air est qu’il doit immédiatement installer le personnage et captiver. Il n’est malheureusement pas captivant.

Vraiment intéressant en revanche pour le phrasé, la délicatesse, la douceur de la voix et le timbre, le Banquo de Wenwei Zhang qui donne une image très noble du personnage. A cela s’ajoute la clarté de la diction, les accents et la couleur. En même temps sa présence fugace émergeant de l’ombre et y retournant ajoute au drame : les personnages positifs sont des ombres dans cette mise en scène.
Tatiana Serjan est Lady Macbeth, puissante, décidée, imposante même. Son apparition en blanc dans la scène dite du somnambulisme (« Una macchia è qui tuttora ! »), assise sur une chaise, sous le regard dubitatif d’un corbeau qui la scrute est une des images décisives de la soirée. Le chant est expressif (« la luce langue »…), la voix puissante, avec des accents à donner le frisson : c’est par l’accent que sa vérité est criante, plus que par le chant pur, dont les rares accidents servent l’incarnation. Dans l’acte I, la lettre est lue en « off » par un montage vocal, mais l’air d’entrée a la couleur décidée voulue, tout comme le « Brindisi » (« Si colmi il calice »)..
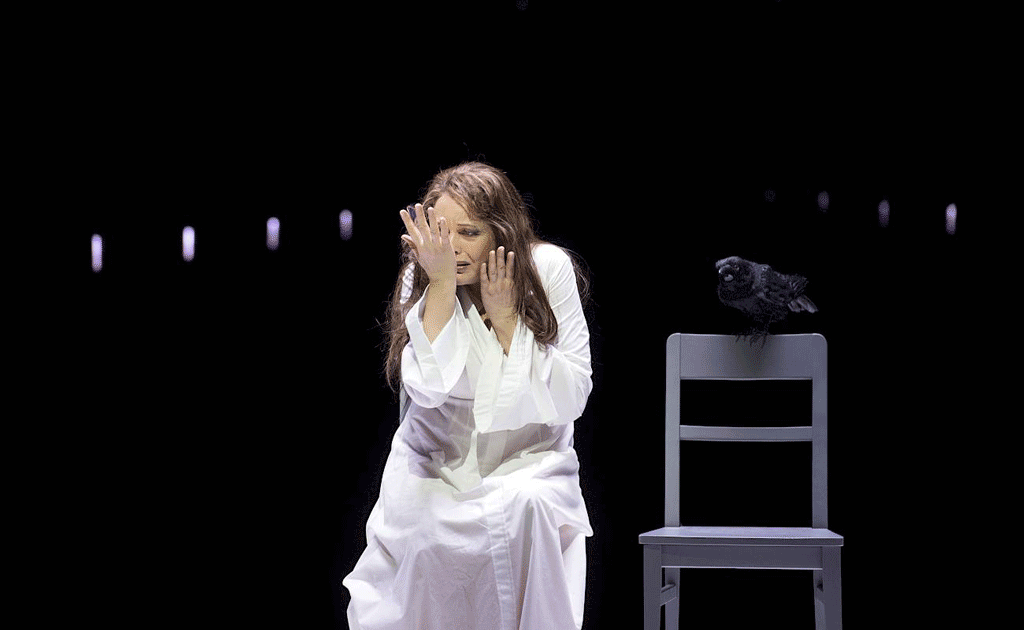
Si dans l’essentiel du registre, cette Lady Macbeth impose sa voix sans contestation, le suraigu un peu difficile, et un peu détimbré colle tellement avec cette vision d'où toute beauté sonore est exclue, que l'on ne peut que saluer la performance. Il est clair que dans « Una macchia è qui tuttora ! » elle est fascinante à voir, elle arrive à rendre sa voix inexpressive et blanche, à la limite laide, ce que Verdi voulait et le contre ré bémol final se perdant dans une voix blanche devient presque fantomatique.
La performance est somptueuse et imposante. Elle forme un couple animal avec Markus Brück.
Magnifique Macbeth que celui de Markus Brück. Il est très difficile, depuis Cappuccilli ou Bruson de trouver un Macbeth du moment. La mise en scène donne au couple une puissance fascinante et maladive, faite de cruauté, d’amour (ils se touchent avec une soif notable) et au personnage à la fois brutalité et désespérance. L’expressivité, les accents, la clarté du discours en font un Macbeth tantôt vocalement raffiné, tantôt rude, toujours très contrôlé. Le timbre n’a ni la beauté ni le charme ni la chaleur de certains barytons. Mais le chant a une présence inouïe, une justesse rare : il est glaçant et pitoyable. Son air final est bouleversant et son jeu est complètement habité : ses mouvements convulsifs, son regard halluciné quand les sorcières le couvrent de leurs mains sont des moments particulièrement prenants. Il occupe l’espace et il est incarnation pure. La fabuleuse image finale au milieu des corbeaux et des plumes qui le couvrent pendant qu’il bredouille ou grommelle est sans doute une autre image emblématique de cette production, il s’est emparé du personnage comme rarement on a pu le voir : tout à fait exceptionnel.
Guettez les prochaines reprises et précipitez-vous car c’est sans doute la plus forte production du Macbeth de Verdi qu’on puisse voir aujourd’hui sur une scène, elle se place immédiatement à côté de la légendaire production de Strehler.

