
De Frank Castorf, le spectateur ne peut s’attendre à un Don Juan linéaire joué dans la succession des actes et des scènes. Castorf ne transforme pas l’œuvre, il en extrait les signifiances, il en tisse les rapports avec les textes et les auteurs du temps ou d’autres temps, il en fait le centre d’un univers, prenant du texte ce qu’il pense en être le propos essentiel, dans l’ordre qu’il choisit et en l’occurrence choisissant les personnages qu’il va suivre. Ainsi, pas de Sganarelle, mais deux Don Juan, l’un, aristocrate encore jeune épuisé de plaisir (Franz Pätzold) l’autre plus vigoureux et massif, assez sganarellien et encore apte à jouir (Aurel Manthei). Il se concentre aussi sur Pierrot (Marcel Heuperman), très secondaire chez Molière et assez central dans le spectacle dont il prend lui aussi beaucoup de Sganarelle. Ainsi Sganarelle qui n’est pas sur scène se retrouve au moins dans deux personnages.

La pièce est réduite à huit personnages (Don Juan‑2‑, Elvire, La Ramée, Charlotte, Mathurine, Pierrot, Don Louis). Exit Don Carlos, Sganarelle, Francisque (Le pauvre), Monsieur Dimanche, spectre et statue du Commandeur et tout le reste des rôles de complément. Cela n’empêche aucunement et la scène du pauvre, et celle de Monsieur Dimanche d’exister, mais insérées dans le récit, dans la course à l’abîme construite à la mode Castorf sur une durée de 4h30 là où l’original dure environ deux heures. Si l’on doit chercher un centre de gravité, ce sera le face à face Pierrot/Charlotte, le couple face à Don Juan ; mais ici les femmes ne sont pas désirables, elles exaltent une féminité caricaturale : il est d’ailleurs quelquefois fort difficile (volontairement) évidemment de distinguer Elvire des paysannes, dans ce voyage sans but que parcourt Don Juan, revenu de tout, et dans l’absolue incapacité de vouloir quelque chose, d’être au monde, en l’affrontant.
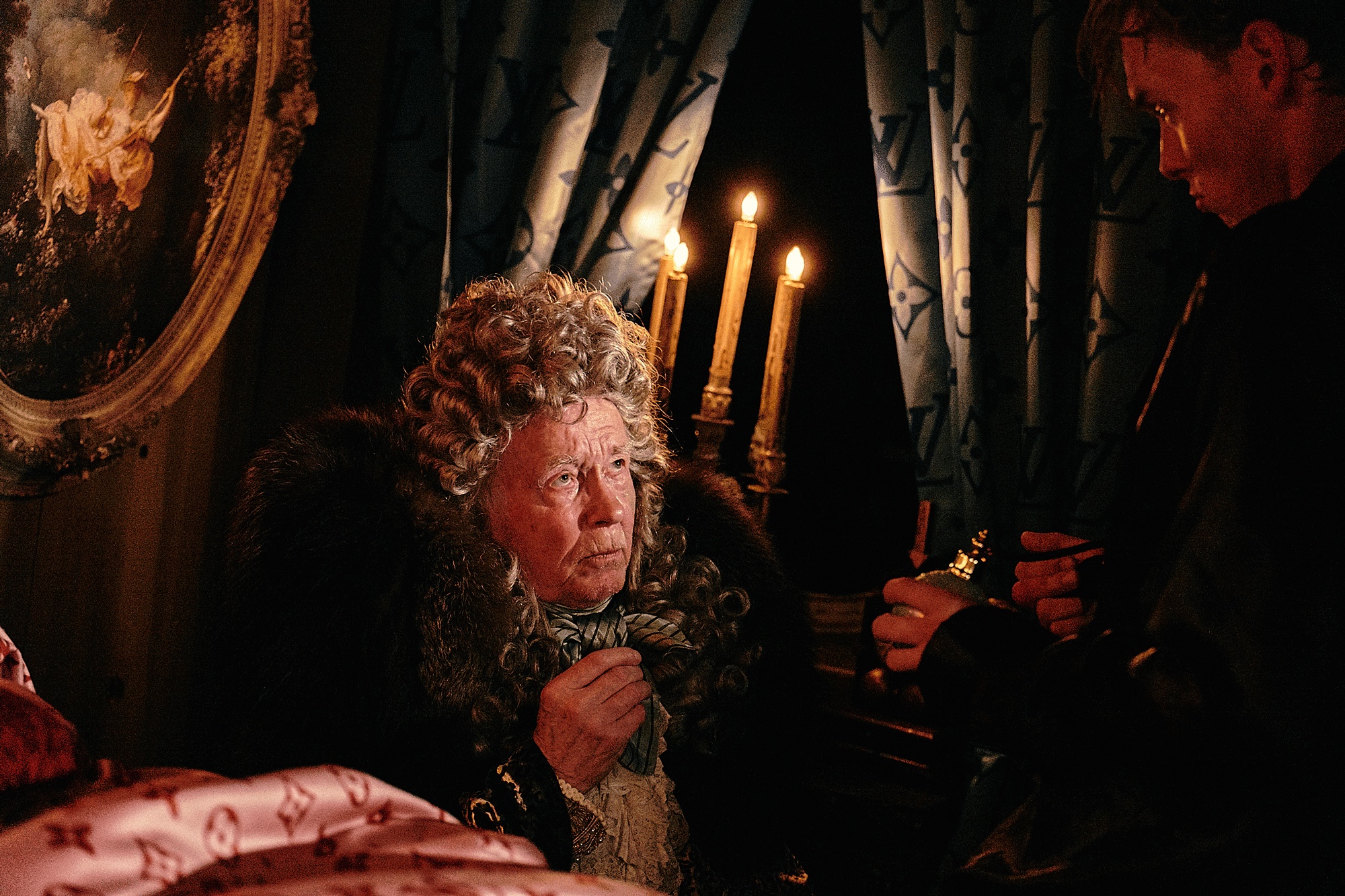
Ainsi Don Louis, le père (magnifique Jürgen Stossinger) est-il présent, celui qui tance le fils, mais qui en même temps croit seulement aux apparences, dans un monde où apparence vaut vérité et forme vaut substance. Évidemment, Castorf qui plonge sans cesse dans l’histoire ne cesse de tisser les liens qui nous unissent à ce monde-là.
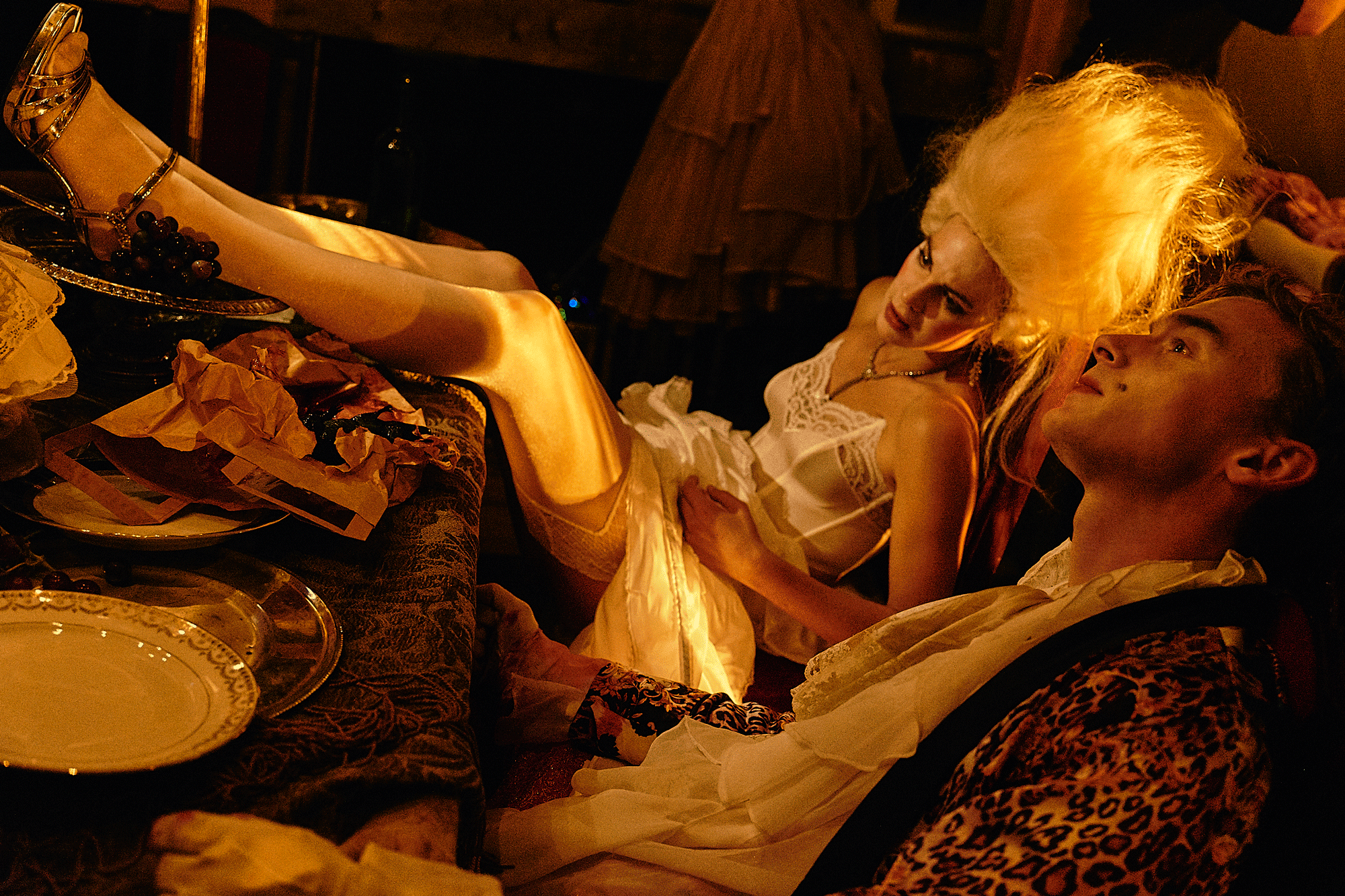
Comme au nom de Castorf le public attend toujours une dissection aux relents violents et provocateurs, certains ont trouvé ce Don Juan trop sage. Mais la provocation n’est évidemment pas le propos. Le propos, c’est le bal de Dieu, du sexe et de la mort. Un dernier tango en quelque sorte qui n’aurait (presque) pas de fin.
Et pour ce dernier tango, Castorf appelle des textes que le mythe a interpellé, Georges Bataille, Heiner Müller, Blaise Pascal et Alexandre Pouchkine, qui en matière de Don Juanisme s’y entendait au point d’en être mort.
Le programme de salle constitue d’ailleurs une des anthologies les plus intelligentes sur Don Juan, que tout professeur de lettres devrait posséder. Il faudrait que ce spectacle vienne à Paris et que ce programme soit traduit : il éclaire de manière définitive l’entreprise de Castorf de mettre à nu le mythe mais aussi la notion de donjuanisme.

Il s’agit d’une mise à nu au figuré d’un mythe écorché et sanglant, mais aussi au propre puisque les deux acteurs qui jouent Don Juan, qui changent régulièrement d’allure et de costumes, sont nus pendant un long moment de la première partie, une nudité presque animale qui expose le corps à la fange, aux excréments, et qui n’a rien d’érotique. Elle remet Don Juan au rang d’une humanité ordinaire dans un monde où c’est seulement l’habit qui fait le moine. Sans habit, seulement les jambes revêtues d’un collant couleur chair, Don Juan est une chose fragile, qui n’a plus rien du fantasme qu’il projette auprès des autres. D’ailleurs face à cette nudité, les femmes – par la vertu de la géniale Adriana Braga, sont sur-habillées, avec des perruques monumentales à la mode Marie-Antoinette, en femmes carnavalesques qui tranchent. La nudité en revanche ravale au rang d’humain, au sens zoologique du terme, elle débarrasse de tout substrat culturel. Le roi est nu, et Don Juan n’existe plus : cette nudité exhibe des corps qui sont tous deux sans défense et très différents chacun, Franz Pätzold, maigre, presque adolescent, porcelaine fragile, et Aurel Manthei, plus adulte, plus massif, un corps de grès brut. Don Juan ne fonctionne que par l’apparence et les vêtements dont on l’habille, tantôt en costume bleu, moderne, tantôt en séducteur années 20, tantôt en déclinaison de marquis XVIIIème, caricature vaguement fellinienne de Casanova, est ce qu’on en fait et ce qu’on projette sur lui, dans ce décor multiforme d’Aleksandar Denić, tantôt entrée de bordel ou de bouge, tantôt intérieur étouffant, avec lit tendu de tentures Vuitton (comme dans Die Kabale der Scheinheiligen) et table massive, le tout éclairé à la chandelle, tantôt espace de bain, tantôt étable à chèvres, tantôt enfin scène de théâtre à la mode du Molière de Boulgakov vu par Castorf la saison dernière, où se jouent certaines scènes, entre théâtre et réalité.
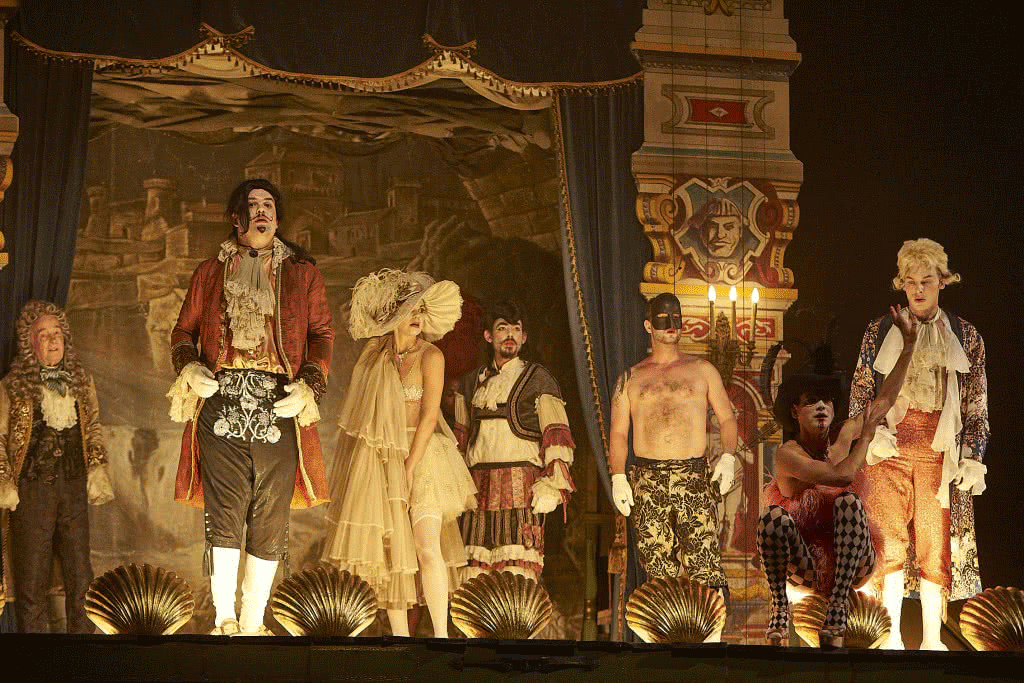
C’est bien une ambiance de fin de règne que Castorf et Denić installent, une fin de règne qui fait le point sur le monde dont la clé pourrait bien être le divertissement pascalien : l’homme cherche les femmes, la chasse ou le pouvoir parce qu’il veut tromper la mort. Une mort qui ne cesse dans cette mise en scène de jouer à cache-cache, une mort oppressante.
« De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n’est pas qu’il y ait en effet du bonheur, ni qu’on s’imagine que la vraie béatitude soit d’avoir l’argent qu’on peut gagner ou dans le lièvre qu’on court, on n’en voudrait pas s’il était offert. Ce n’est pas cet usage mol et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu’on recherche ni les dangers de la guerre ni la peine des emplois, mais c’est le tracas qui nous détourne d’y penser et nous divertit. »((Pascal Pensées, n°139 Edition Brunschvicg))
En liant ce texte fondamental pour la lecture du monde classique et de notre monde au mythe de Don Juan, Castorf montre d’une part la modernité et d’autre part la cohérence de la pensée classique, de la pensée tragique oserais dire. Il y a dans ce travail une tragédie fondamentale qui fait du monde une aporie.
C’est aussi pourquoi, même en les détournant, tous les motifs du mythe sont là. Y compris le commandeur, réduit à trois femmes en plumes et paillettes qui sortent dans une musique obsédante avec chacune une chèvre (on pense à Fricka, même si chez Wagner ce sont des boucs), personnages fantomatiques qui gardent un peu de l’aspect irrationnel du Commandeur, en le transformant une image surréaliste d’une fin sans fin qui est l’un des moments les plus sublimes de la soirée.
Comme toujours, le propos de Castorf est servi par des comédiens exceptionnels : Castorf travaille ici avec une troupe qui lui est étrangère, mais qui prend part à ce travail avec un engagement étonnant, jouant sur le langage (comme dans le Boulgakov, on y entend aussi du français, et il y a d’ailleurs un acteur français, Julien Feuillet, qui joue La Ramée, dans un rôle plus important que dans l’original moliéresque.).
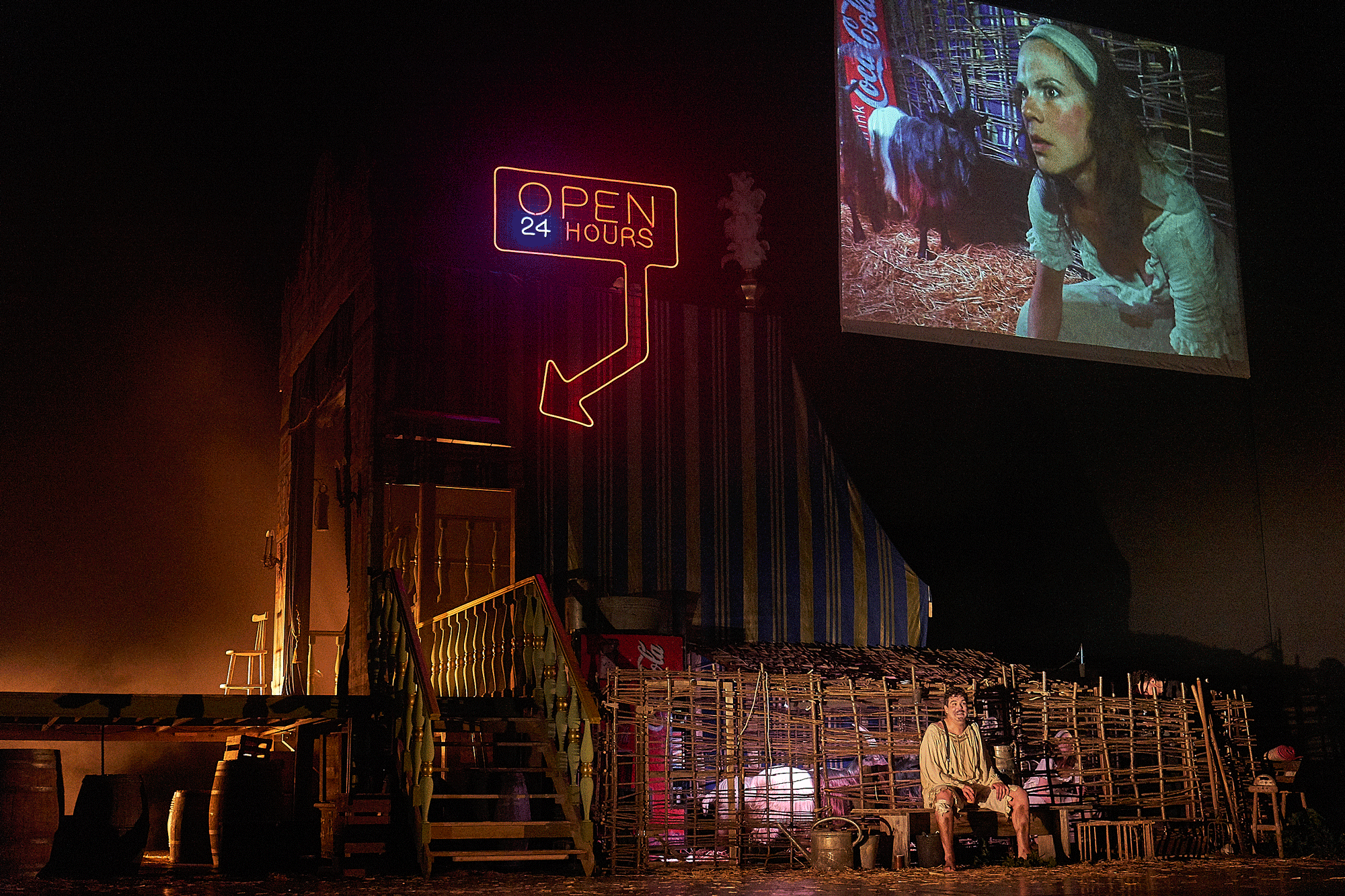
Le Pierrot de Marcel Heuperman jeune acteur de 24 ans est aussi exceptionnel, avec l’immense monologue à l’accent vaguement berlinois de sa première partie, qu’il mène avec une énergie peu commune : il s'engage dans un jeu épuisant où il forme une sorte de pendant aux deux Don Juan en agitation permanente.

Les trois femmes sont très en relief, Bibiana Beglau (Elvira), délaissée et desérotisée, même lorsqu’elle laisse voir sa poitrine, Nora Buzalka (Charlotte) qui forme couple avec le Pierrot de Marcel Heuperman et une sculpturale Mathurine (Farah O’ Briant ) par qui est chantée une merveilleuse chanson créole, toutes trois habillées comme au carnaval ou à la revue par une Adriana Braga-Peretzki particulièrement inspirée. Quant aux deux Don Juan, Franz Pätzold, qui fait penser quelquefois à Alexander Scheer, acteur fétiche de Castorf, et le plus rude Aurel Manthei, forment une sorte de couple de Janus bi-face exceptionnel, doubles et opposés. Le jeu des vidéos est peut-être à la fois moins utilisé dans le déroulement théâtral même, et plus esthétisé, avec une recherche dans la forme et une utilisation des éclairages et des couleurs qui renvoient au cinéma – mais ça n’est jamais du cinéma.
Ce qui est en revanche du cinéma c’est la scène finale de la Dolce Vita de Fellini où Mastroianni au loin cherche à communiquer avec une jeune femme à l’autre bout de la plage, nous confirmant la lecture amère et poétique de Castorf, une vita dolce/amara où la nostalgie reste ce qu’elle était . Et ce Don Juan a quelque chose de fellinien dans la monstruosité triste, dans des ambiances proches quelquefois du Casanova qui dit un peu la même chose : La chair est triste hélas, et j’ai lu tous les livres.
La dolce vita sur cette scène , ce sont les seuls vrais êtres de cette revue un peu macabre, les trois chèvres Onyx, Saphyr et Rubina, ces animaux qui sont en scène les seuls à être eux-mêmes, hors des apparences et du théâtre, et qui vivent l’hic et nunc de la vie.

