Sans vouloir m’immiscer dans le grand débat mené dans ces colonnes entre Guy Cherqui et Maurizio Jacobi sur la mise en scène, on peut simplement rappeler en préambule que le cinéma est, comme le théâtre et l’opéra, déjà mort plus d’une fois. Art mort-né dès le début (il n’est alors qu’attraction de foire), il est décédé avec le parlant, la couleur, avec la fin des nababs Hollywoodiens, l’avènement de la vidéo, la fin de la pellicule, le tout numérique, la 3D… Godard l’a enterré plus d’une fois pour curieusement lui redonner vie de nombreuses fois, y compris là où on ne l’attendait plus (voir son jeu avec la 3D dans Adieu au Langage (2014) qui lui a, enfin !, permis de résoudre le conflit du champ/contre-champ Hawksien résumable à : « On ne devrait pas filmer une femme et un homme de la même façon » (comme dans His Girls Friday, 1940). La 3D avec ses deux caméras le permet : le couple d’Adieu au Langage est filmé avec une caméra à droite et une caméra à gauche. L’ensemble est brouillé, invisible, jusqu’à la réunion des deux protagonistes dans le même champ mais on peut suivre l’homme ou la femme en fermant l’un des deux yeux. L’éternel clin d’œil malin de Godard, qui réactualise, au passage, la question de la vision en salle (le DVD rend invisible cette scène). Question remise sur le tapis avec Le Livre d’Image (2018) pour lequel Godard invente la non-sortie en salle puisque le film est montré à la télévision et dans des lieux improbables (théâtre, chambre d’hôtel…), la monstration étant elle-même mise en scène. Preuve qu’on peut encore jouer, à presque 90 ans, et toujours de manière pertinente avec ces concepts.
C’est donc avec cet art à la fois mort et irréductible, cette technique d’enregistrement du réel, poétisé ou non, qu’on produit toujours des images. Sans vouloir ressortir à tout crin l’ami Debord, reste que l’image, animée ou non, dans ses rapports avec le son ou non, fascine et contamine aussi les planches.
Bayreuth, l'usine à rêves
Bayreuth cherche à attirer les cinéastes et ce fut une réussite avec le Lohengrin d’Herzog en 1991. Herzog fasciné par les contes, les histoires, la folie aussi, y compris comme matériau (voir ses rapports avec Klaus Kinski) ne pouvait qu’être séduit par Lohengrin. C’est un succès théâtral (les décors, la neige, l’atmosphère de rêve, l’apparition finale de l’héritier rabougri et dont s’inspire la dernière production de Bayreuth (2018) de Yuval Sharon, Neo Rauch et Rosa Loy, mais peu cinématographique. Il y manque quelque chose de consubstantiel au cinéma qu’on attend et qu’on ne trouve pas.

Le Lohengrin de Werner Herzog est accessible en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=libGLa-U-H8
Dans les cartons de l’usine à rêve de Bayreuth, on nous a raconté, doit-on le croire ? (on restera toujours du côté de la légende comme dans The Man who Shot Liberty Valance (1962) de John Ford, mise en scène de la fin du monde mythique, chaotique qui annonçait, et sur laquelle se fonde, le monde de la Loi), que Lars Von Trier avait été pressenti pour une mise en scène et avait même travaillé sur des écrans transparents amovibles sur lesquels il aurait pu projeter les images d’un film résonnant avec le plateau. Curieusement, si le projet aurait pu nous exciter davantage que le très bon Lohengrin d’Herzog, on sent tout ce que cela a, malgré tout, de décevant par le côté hybride qui devait mêler scène et projection mais nous laisse, a priori, dans des territoires labourés par des vidéastes.
Pourtant, le projet pouvait être pertinent parce que Lars Von Trier est un brechtien convaincu, qui, comme Fassbinder, a su créer des œuvres cinématographiques tirant parti des ressources du théâtre sans en faire du théâtre filmé. On pense pour l’un aux Larmes amères de Petra Von Kant (1972), écrit pour la scène et pourtant œuvre de cinéma (on se rappelle ce qu’en disait Alain Bergala lors d’un séminaire : multiplicité et duplicité des personnages rendues par une mise en scène en apparence statique mais dans laquelle chaque plan a un angle différent), pour l’autre à Dogville (2003), aux décors tracés à la craie sur le sol du studio, permettant une mise à nue des rapports sociaux dans un espace fermé sur lui-même, ici un petit village isolé. On aime à penser que Melancholia (2011) de Trier, fortement rythmé par le Tristan de Wagner dérive sans doute du projet avorté de Bayreuth, à commencer par un décor qui n'est pas sans rappeler l'acte I du Tristan de Christoph Marthaler .

On retrouve dans ce film une certaine morbidité, un goût voire une attirance irrésistible pour la nuit et la mort. Cela reste un film de cinéma, travaillé en profondeur mais de loin par l’opéra.

Melancholia de Lars Von Trier, bande-annonce
https://www.youtube.com/watch?v=wzD0U841LRM
On pourrait en tirer une première remarque : on peut faire assez aisément du cinéma avec du théâtre et de l’opéra, l’inverse n’est pas forcément vrai.
Opéra et cinéma : du film-opéra au film dans l'opéra
Le mariage accompli de l’opéra et du cinéma est pour moi le Don Giovanni (1979) de Joseph Losey (avec la collaboration de Rolf Liebermann). Et ce malgré l’affreux doublage parce que Losey tire justement parti de tout ce qui appartient à la thématique du double, de l’artifice. Il réussit le pari de faire œuvre théâtrale, avec un départ sur la scène du Teatro Olimpico de Vicenza, dans les faux décors magnifiques de Palladio et d’extraire l’opéra pour l’introduire, lui donner de l’air, dans les espaces sociaux fractionnés des villas Palladiennes. C’est cet espace et ce temps fractionné, troué dira Deleuze, qui définit aussi le cinéma. Losey joue sur ces séparations, ces espaces de jeux et de représentations à étages, ces machines à produire et à jouir que sont les constructions Palladiennes, et l’opéra de Mozart.

Don Giovanni de Joseph Losey, bande-annonce
https://www.youtube.com/watch?v=ayuIB7GJH2c
L’autre succès, pour les mêmes raisons est La Flûte Enchantée (1975) de Ingmar Bergman, dont le cadre écrin est le théâtre baroque de Drottningholm. Bergman en grand cinéaste du montage joue avec l’illusion du décor naturel mais a fait reconstruire à l’identique le théâtre en studio par commodité et pour ne pas abîmer le lieu.
Bergman part d’un constat simple : l’opéra (mais aussi le cinéma), c’est entendre et voir. Dans un certain lieu. D’où l’Ouverture, plans sur le théâtre et ses abords, rythmée par des plans cut sur le public (y compris ses fidèles acteurs et amis Erland Josephson ou Sven Nykvist, directeur de la photographie : tous deux ayant été pendant de longues années les doubles de l’ego bergmanien et les garants de son image). Le montage est évidemment affaire de musique. Tout cela, c’est du rêve (yeux écarquillés de la jeune fille rousse dont les mines commenteront l’action tout le long du film) et donc du cinéma : on rentre petit à petit dans les plans, de plus en plus fouillés et malins à mesure que Bergman multiplie les angles, de ce qui n’était au début, que des plans plus ou moins frontaux de la scène. Bergman joue avec cela, se fait oublier et fait oublier la « captation » théâtrale pour entrer dans ses plans psychologiques et/ou joueurs. Comme chez Losey, on est dans un fractionnement de l’espace et du temps qui cherche à recréer l’illusion d’une découpe en numéros dans un espace clos. Les deux utilisent un langage cinématographique très fin, propre à leur média mais restent dans un champ qui se veut reflet du théâtre. Losey comme Bergman « habillent » leurs personnages comme on les souhaite dans un champ traditionnel, à peine modernisé pour Bergman. Modernité et tradition.

La Flûte Enchantée de Bergman, Ouverture.
https://www.dailymotion.com/video/x1kl24
Bergman, comme le soulignait David Verdier est plus avant-gardiste dans L’Heure du Loup (1968), dans lequel s’intrique une scène, commentée d’ailleurs, de La Flûte Enchantée. Petit théâtre d’ombre angoissant. La portée et la vision sont autres.
Bergman filme à de nombreuses reprises le théâtre. Pourtant lorsqu’il s’agit d’énoncer son mystère, dans Le Rite (1969), il choisit de ne pas filmer la représentation, qui est ici, au sens propre et figuré, un objet de délit. Magie et mystère de la représentation, infilmable (on pense à Brian Large…), hors tentative d’en faire, avant tout, un vrai film de cinéma. D’où les réussites de Losey et Bergman, moins celle de Fréderic Mitterrand pour Madama Butterfly (1995), intéressante uniquement lors de l’irruption du réel des images d’archives cassant le rythme de la représentation/reconstitution (vers 1h41, pendant l’attente de Butterfly).
Madama Butterfly de Frédéric Mitterrand
Notons pour le cas Bergman, qu’en Suède, le cinéaste (peu flatteur pour ses compatriotes) reste peu connu, hormis pour Fanny & Alexandre (1982). Une certaine génération ayant connu la diffusion télévisée de Scènes de la vie conjugale (1973) a aussi été marquée par ce film puisque l’année de la diffusion coïncide avec un des pics de divorces du pays… Bergman, en Suède, reste LE metteur en scène de théâtre et c’est assez curieux (vraiment ?) de noter qu’il n’a pas filmé, ni même enregistré de captations de ces spectacles. Les champs pour lui étaient bien distincts y compris dans son emploi du temps : année consacrée au théâtre, l’été aux films.
"Dans le théâtre épique, le cinéma prend une grande importance. Pourtant il convient de l’employer conformément à sa nature artistique ou scientifique, exactement comme s’il était présenté seul."
Bertolt Brecht, Extrait d’un ABC du théâtre épique – Le Cinéma ((Bertolt Brecht, Écrits sur le théâtre, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade p. 202))
Le cinéma vampirise la scène en utilisant son matériel (acteurs, et direction d’acteurs, scénario) mais n’est pas dans son essence pure du théâtre filmé. C’est ce que La Nouvelle Vague hurlera en descendant dans la rue. De même, la scène et notamment l’Opéra se nourrit du cinéma. D’abord timidement, en ayant recours à des vidéastes (dont le summum pourrait être un Bill Viola pour le Tristan und Isolde de Sellars en 2005) puis sous forme de scansion. On se souvient des cris d’orfraies pour le Parsifal dit des pissotières de Warlikowski à L'Opéra-Bastille en 2008. Que de cris avant le prélude du troisième acte qui se voyait lui-même ouvrir par un extrait d’Allemagne année zéro de Roberto Rossellini (1948). Le petit Edmund, au bout de son voyage contre-initiatique, abattu par les déconvenues d’une vie dans une idéologie mortifère, et, surtout ayant fait l’expérience dans sa courte vie de valeurs s’inversant sans cesse, s’élevait dans les étages d’un immeuble en ruine de Berlin pour en finir avec son existence. L’image avait du sens et respectait même les plus obtus wagnériens puisque la subtile musique attendait la fin des images pour s’exhaler de la fosse. Je me souviendrai longtemps de la bronca et des « On est venu pour Wagner ! », violemment beuglés.
La séquence ici venait imposer une distance tout en faisant sens avec l’errance de Parsifal, poser l’idée des fondements de la communauté (sur quelles bases), jouait avec le thème de la désolation, des âmes et des villes, des héros ou antihéros, des combats et d’une jeunesse déboussolée et sacrifiée. Mais la mise à distance était sans doute trop forte. L’écran, la citation directe, voilà qui arrache le spectateur à l’état de veille active (difficile de s’endormir, ou de se laisser bercer par les Godard les plus éloignés des films disons… traditionnels, Histoire(s) du Cinéma (1988), Livre d’Image)
Salomé, mise en scène Krzysztof Warlikowski
Ce qui est étonnant c’est de retrouver le même Warlikowski, un peu plus de dix ans après, user des mêmes procédés mais de manière plus subtile dans Salomé.
Pour que le théâtre demeure théâtre, il n’est pas nécessaire d’en bannir le cinéma, il suffit de le faire intervenir de manière théâtrale.
Bertolt Brecht, Sur la musique de cinéma ((Bertolt Brecht, Écrits sur le théâtre Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade p.716))
Salomé mis en scène par Krzysztof Warlikowski, bande-annonce
https://www.youtube.com/watch?v=DHEco1z_CrI
On avait été désarçonné par cette pré-ouverture, pantomime étrange sur fond de l’enregistrement des Kindertotenlieder chantés par Kathleen Ferrier, pendant laquelle Hérode grimé en juif de foire un peu à la Chaplin, faisait les poches d’un curé chantant, accompagné d’un travesti. La pantomime finie, Hérode arrachait son masque et l’opéra Salomé, tel qu’on le connait, pouvait commencer. D’autres scènes dans la production de Warlikowski nous choquaient, remuaient des souvenirs sans qu’on puisse les préciser. Quel sens donner à tout cela ? Pourquoi ces scènes dans les scènes ressortent-elles ?

En voyant Monsieur Klein de Joseph Losey, on s’aperçoit que Warlikowski a copié/collé la pantomime (y compris sa bande-son anachronique)… qui était-elle-même un spectacle dans le film. Nous ne sommes plus dans la citation directe (emprunt projeté sur un écran sur la scène) mais dans la recréation scénique. C’est plus subtil, plus doux mais pas moins puissant. Nous sommes bel et bien dans un jeu d’écho, de mise en abyme. Monsieur Klein, « bon français de souche » rachetant des objets d’art à bas prix (loi du marché et opportunité) se voit suspecter de judaïté en période pré-rafle du Vel d’Hiv. Klein, en pleine reconquête de son identité, chasse un double se faisant passer pour lui mais c’est la quête du double qui prend le dessus sur tous ses autres projets. Le thème du double, creuset de Losey depuis The Servant (1963), est d’ailleurs fécond. Le double attire car, selon la tradition, les vrais doubles ne peuvent se rencontrer sans poser de problèmes (de La Maison Dorée de Samarkand d’Hugo Pratt en 1986 à David Lynch en particulier dans Twin Peaks et Lost Highway, 1997).
Ci-dessous la pantomime de Monsieur Klein de Joseph Losey :
La scène du film nous montre un ex-gagnant, ayant compris qu’il pouvait tout perdre, regardant un spectacle de music-hall devant un public n’ayant visiblement pas à souffrir des rigueurs de l’occupation. La bourgeoisie française s’amuse en compagnie des SS devant un spectacle ridiculisant les juifs avec travestis et, sans doute aussi, des juifs sur scène. Un comble mais que voulez-vous, the show must go on. Ou encore, tout ceci : c’est pour rire. Reste que pour Klein, il y a cassure, du moqueur on passe au moqué. Du moins dans sa tête (contre écho de la visite médicale qui ouvre le film dans laquelle les « patients » sont examinés physiquement pour déceler des traces corporelles d’une éventuelle judéité qui pourraient les empêcher d’obtenir un certificat).
Warlikowski ouvre donc sa Salomé par cette histoire dans l’histoire, des histoires dans l’Histoire, du théâtre dans le cinéma (et donc l’inverse), des doubles démultipliés, des procédés dissimulés. Notons que la scène fonctionne au théâtre sans forcément y voir la référence à Losey. Inconnue, elle gagne en étrangeté, comme si son origine initiale était perceptible. Reconnue, elle gagne en profondeur.
Le cinéma obéit aux mêmes lois que les arts graphiques. Il est de nature statique et doit être traité comme une succession de tableaux.
Bertolt Brecht, Extrait d’un ABC du théâtre épique – Le cinéma ((Bertolt Brecht, Écrits sur le théâtre, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade p. 202))
D’autres images cinématographiques nous sont proposées dans Salomé, notamment dans le décor, avec ce salon plein d’ouvrages, ce cocon culturel dans lequel se retranche cette communauté avant l’assaut final. C’est, bien sûr, pour l’action, le Château de Neuschwanstein de Ludwig ou le Crépuscule des Dieux (1973) mais aussi et surtout, l’appartement de Violence et Passion (Gruppo di famiglia in un interno, 1974) du même Visconti et la bibliothèque du plus viscontien des films non signés par Visconti, Le Jardin des Finzi-Contini (Il giardino dei Finzi-Contini)(1970) de Vittorio De Sica. On retrouve ce même enfermement, cette atmosphère confinée de culture-faux rempart, conscient dans Le Jardin des Finzi-Contini, inconscient dans Violence et Passion (Gruppo di famiglia in un interno).
Le Jardin des Finzi-Contini illustre deux attitudes opposées de la communauté juive : les grands bourgeois Finzi Contini, conscients de la tournure de l’histoire, choisissent d’attendre leur fin dans leur monde clos de culture tandis que la famille petit bourgeoise du héros, Giorgio, tente de s’accommoder, voire d’accepter de bon cœur les mesures mussoliniennes. Giorgio parvient à fuir tandis qu’une autre possibilité s’incarne dans le personnage de Malnate, communiste, qui a opté pour la lutte. On remarquera que, sur le plan de l’intrigue amoureuse, Malnate possède Micol et non Giorgio (dans Salomé aussi, cette histoire de possession est centrale). C’est bel et bien ce que l’on observe dans la mise en scène de Warlikowski, centrée sur ceux qui choisissent de rester (de jouer, de lire…, de rester entre eux) mais qui par moment montre ceux qui vont et viennent et tentent leur survie (des valises se remplissent, on voit des allers-retours avec un dehors hors champ, des armes…).
Le jardin des Finzi-Contini, de Vittorio De Sica (film complet)
https://www.youtube.com/watch?v=PxSPu25xbQw
À 39–41 min, le spectateur est invité par le biais du regard du personnage principal à une visite de l’intérieur de la maison-bunker culturel.
Dans Violence et Passion, toujours avec Helmut Berger déjà présent dans le Jardin, nous sommes encore dans un espace clos, autre bunker culturel, qui protège du monde extérieur. Visconti joue d’ailleurs avec ses propres pratiques et références : le lieu qu’il montre est un palais aux fenêtres closes, filmé dans un studio de Cinecitta, ville dans la ville. D’ailleurs le film est inspiré d’une aventure, en son palais, de l’érudit Mario Praz et racontée dans La Casa della Vita (1958).

Le vieux professeur joué par Burt Lancaster, connaisseur des conversations pieces anglaises, (comme Mario Praz, dont on peut visiter non pas, hélas, le palazzo Ricci de la via Giulia mais son dernier appartement au Palazzo Primoli et admirer sa collection), ne vit que pour ses toiles, reclus dans un appartement palais confiné. Une noble romaine jouée par Silvana Mangano fait irruption dans son espace et sa vie en le poussant par tous les moyens à lui louer un étage de son palais. Ce qu’il finit par faire de guerre lasse. Cette irruption fera rentrer le bruit, et le monde dans sa vie. La Mangano, mariée à un riche industriel, a une fille aux amis turbulents et soixante-huitards qui secouent la vie du palais. Dans leur sillage, le jeune et troublant Konrad (Helmut Berger, encore !), peut-être d’origine plus modeste mais vif et qui perçoit instinctivement les étincelles des essences de l’art, va agir sur la psyché du Professeur. Une curieuse relation mi filiale mi amoureuse se noue (on pense aux liens Herode/Herodiade/Salomé avec la Mangano qui pousse la jeunesse chez le Professeur pour obtenir ce qu’elle souhaite). Ce lien fait rentrer de manière compassionnelle le Professeur dans les enjeux historiques du monde qu’il refusait de voir, obsédé qu’il était par ses tableaux. Un complot se trame, des affrontements politiques se font jour, il y a des trahisons et Berger n’est pas clair. Tabassé, il sera recueilli et protégé par le professeur, prenant cette fois parti, qui le cache dans une pièce secrète ayant accueilli des juifs en fuite pendant la guerre ((respectivement à 51’30 et1’01, tabassage et chambre secrète)).
Gruppo di famiglia in un interno (Violence et passion, Luchino Visconti, 1974):
https://www.youtube.com/watch?v=6Qx_tjZj-Tw
Là encore, les liens avec la mise en scène de Warlikowski sont ténus. Un même espace clos dans un monde bouillonnant, les tensions familiales et amoureuses hors cadre((1’12 scène d’orgie & danse de mort qui rappelle la danse des 7 voiles chez Warlikowski)), l’irruption de l’Histoire, les choix à faire, conscients ou non, forcés par la mise en marche de l’Histoire ou non. Avec comme clé, l’empathie compassionnelle qui passe par la culture pour aller vers l’humain.
Autre point, l’irruption de l’hystérie incarnée chez Warlikowski par Salomé et qu’on retrouve comme prélevée des Damnés (1969) de l’éternel Visconti. Que ce soit chez Helmut Berger, fils taré à la sexualité déviante (toujours Hérode) ou dans le personnage de la baronne incestueuse Von Essenbeck, jouée par Ingrid Thulin. C’est bel et bien à un Crépuscule des Dieux auquel on assiste. Le titre italien, comme dans Violence et Passion, est plus clair La Caduta degli Dei (avec d’ailleurs comme musique la symphonie n°8 de Bruckner, Apocalyptique).
La caduta degli Dei (Les Damnés, Luchino Visconti, 1969):
https://www.youtube.com/watch?v=xrz6sQukxeQ
Avec les Damnés, Visconti, aristocrate marxiste, relit toujours l’Histoire, ici les arrangements de la haute bourgeoisie industrielle allemande avec les nazis, les remaniements familiaux, les trahisons, les déportations… Au cœur de ces manigances, l’héritier, inattendu !, des Essenbeck sera le perturbé Martin (Helmut Berger) promu SS par le cousin manipulateur. Martin, pédophile et harceleur d’une petite fille juive((À 31´ la petite fille bourgeoise en danger sous la table rappelle la Salomé de Warlikowski, sous la table elle aussi mais en version enfant gâtée boudeuse (la Salomé de Warlikowski intègre les deux versants des deux personnages). De 1h01à 1h03 : Innocence d’une petite fille juive achetée à l’aide de jouets. De 1h08 à 1h10 : Complaisances achetées à l’aide de colliers qui rappellent les offres d’Hérode à Salomé.)), manipulé de loin, prend le pouvoir familial et donne du poison aux perdants de l’affaire, les pourtant précautionneux et truands Sophie von Essenbeck et son mari arriviste Bruckmann (Dirk Bogarde)((2h29 jusqu’à la fin : Un mariage, 2 suicides, une orgie et le sacre de la folie nazie)).
Là encore on retrouve ce que l’on voit sur la scène de Warlikowski même si les personnages sont un peu brouillés, comme des souvenirs mal fixés dans la mémoire.

Autre emprunt cinématographique, la Danse des sept voiles, ici en Danse de Mort chorégraphiée, nous fait penser aux aristocrates de La Règle du Jeu (1939), ombres d’eux-mêmes (c’est l’image finale) dans la période troublée pré 40, en goguette, entre eux, dans un château isolé, La Colinière, et se donnant en spectacle en costumes de morts sur la musique du piano mécanique qui joue la danse macabre de Saint-Saëns.
La Règle du Jeu de Renoir, Danse Macabre :
On peut se demander si Warlikowski ne joue pas aussi sur la thématique de Lili Marleen (1981) de Fassbinder qui montre une imbrication d’histoires et de thématiques tout sauf univoques à l’image de la chanson, antimilitariste mais prisée des soldats de l’Axe comme des Alliés.
Lili Marleen de Fassbinder, bande-annonce :
L’histoire principale nous montre la montée en puissance d’une chanson, de son interprète (Willie, interprétée par Hanna Schygulla) et de son amant, le compositeur juif, Robert Mendelssohn (que certains veulent d’ailleurs voir inspiré par Rolf Liebermann), leurs aléas, leurs compromissions, leurs combats…
Plus ambiguë, une histoire annexe des réseaux juifs, dirigés par le père de Robert (joué par Mel Ferrer) qui visent à aider leurs coreligionnaires, dans lesquels trempe, un temps, la chanteuse Willie.
Le regard de Fassbinder, jamais univoque, n’est guère tendre envers cette hyper classe que l’on retrouve, avant comme après, toujours dans ses richesses et privilèges((dans presque tous ses films, Fassbinder traite des rapports dominants/dominés, notamment dans les couples, y compris dans des exemples de minorités censées être plus précautionneuses sur le sujet : les gays dans Le Droit du plus fort (1975), où l’éduqué désargenté domine le prolétaire devenu riche, les femmes et les immigrés avec Tous les autres s’appellent Ali (1974), où la femme âgée domine l’ouvrier immigré, les femmes entre elles dans Les larmes amères de Petra von Kant dans lequel il ne se prive pas de rajouter le désir d’être dominée, incarnée par Irm Irmgard)). La période de combat est pleine de faux-semblants et de traitrises, une fois les « meilleurs » (les amis, les riches) sauvés dans l’épisode des échanges sur le pont frontière avec Aaron joué par Gottfried John. Il y a un côté « après moi le déluge » qui baigne aussi la mise en scène de Warlikowski. C’est en tout cas cet ensemble de réseaux occultes qui peut irriguer les scènes de va-et-vient des personnages annexes. Les petites mains agissent, les puissants vaquent dans leurs luxueux appartements à peine affectés par les tumultes extérieurs qui restent de l’ordre de la contingence (hors champ ou, ici, agitation de coulisses). Chez Fassbinder, une des dernières scènes nous montre un concert de Robert avec au premier rang, tout le réseau, toujours riche, toujours puissant, comme avant. Comme chez Visconti, c’est la leçon du Guépard de Lampedusa (prix Strega en 1958 devant… La Casa della Vita !) : il faut que tout change pour que rien ne change.
De là aussi, sans doute, l’impression que toutes les simagrées de la Salomé, ne sont que du cinéma, un jeu de dupe, un amusement noir. Que passées les passions, tout le monde va se relever, sans changement (c’est ce qui se passe sur la scène à la fin). C’est aussi le danger des représentations, purification des passions et/ou éducation au marxisme brechtien mais qui n’entraînent pour autant pas de réactions ou actions hors de champs bien balisés voire désamorcés de la politique traditionnelle. C’est peut-être d’ailleurs le sens du semi échec de Brecht. Ses techniques restent opérantes mais uniquement dans le champ scénique.
Dernier masque, difficile à lever. Au moment du baisser de rideau, une action rapide, confuse de ces protagonistes annexes se produit. Ces personnages troubles, allant et venant sans cesse, affairés vers l’extérieur reviennent armés, le corps baigné de sang et se menaçant avec des armes. L’allusion est peu claire mais nous fait penser à ces thrillers policiers américano-hong kongais, pleins de trahisons, de luttes de clans, d’influence et de pouvoirs, hommes de main travaillant pour des hommes prospères et en vue. Un peu plus précis sont les souvenirs de Reservoir Dogs (1992), film éminemment musical, et théâtral, jouant sur plusieurs tableaux. Un braquage qui tournait mal avec des malfrats qui ne se connaissaient pas les uns les autres et portaient des noms de couleurs, pour éviter tout recoupement mais qui n’évitaient pas le risque de l’infiltration, Mr Orange (Tim Roth) est un flic.
Tarantino d’ailleurs revisitait lui-même le film noir Le Quatrième Homme de Phil Karlson (1952). Dans celui-ci les malfrats portaient des masques et ne pouvaient s’identifier entre eux qu’à l’aide de cartes déchirées (et non par des couleurs). Et le flic infiltré s’avère être… le chef de la bande, réussissant le coup triple du « perfect crime », du coffrage de bandes tout en touchant le magot de l’assurance pour résolution d’affaire. Sans compter la vengeance personnelle de sa réhabilitation par la police qui l’avait « débarquée ». Duplicité démultipliée. C’est le jeu de miroir aussi auquel on assiste dans Salomé.
Après une séance de torture sanglante et de découpage d’oreille (la tête décapitée de Jean Baptiste) par Mr Blonde (Michael Madsen), Mr White (Harvey Keitel), abusé par son amitié et un trop plein de compassion, prend la défense d’Orange. Une impasse mexicaine, chère à John Woo et Tarantino, se met en place pendant laquelle plusieurs tireurs se tiennent en respect comme dans la scène finale de la Salomé de Warlikowski.
Reservoir Dogs de Tarantino, scène finale :
On retrouve ici ce que Warlikowski veut sans doute voir dans l’opéra : avoir foi ou non en l’un des siens (querelle des juifs dans Salomé) et, peut-être, l’ouverture d’une nouvelle voie : la Révélation de Saint Jean Baptiste annonçant Jésus, chez Tarantino la compassion de White, tuant les siens, ses collègues truands, pour défendre le flic Orange et en cela, rappelant les doctrines chrétiennes, le tout filmé avec une belle attitude de Pieta, sanglante, même si le film s’achève dans l’aveu de la méprise et donc dans la vengeance. Là encore, c’est le sens de Salomé : Hérode se méprend sur l’innocence de la jeune Salomé qui œuvre avant tout pour se venger du refus de l’amour de Jean Baptiste.
Autre trait Tarantinien, la caisse qui contient la tête qui n’est jamais montrée. On pense à la valise de Pulp Fiction (1994) dont le contenu doré n’est jamais à l’image. Une des interprétations les plus séduisantes est qu’elle contiendrait l’âme du chef de gang Marsellus Wallace, ce qui expliquerait les allusions religieuses voire mystiques et les miracles qui n’affectent pas de la même manière les deux truands, Vincent Vega (John Travolta) et Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) en mission de récupération. Jules Winnfield, qui accepte la révélation et se consacre au bien après l’exécution de sa mission, sera sauvé et non Vincent Vega, qui finira assassiné… dans les toilettes (lieu Warlikowskien) ! Encore une fois, une révélation, une communauté scindée, un choix moral.

Toujours dans le même thème, la querelle des juifs pendant laquelle Warlikowski installe son chœur de personnages comme sur la Cène. On pense évidemment à celle de Léonard de Vinci mais aussi à la copie qu’en fait Buñuel dans Viridiana (1961, Palme d’Or). Viridiana, comme les juifs de Salomé, est à un moment de vérité alors qu’ex-none devenue héritière, elle éprouve sa foi en s’occupant d’une armée de pauvres qui vont mettre à bout sa patience et ses croyances. Lors d’une scène de banquet qui tourne mal, Buñuel arrête l’image de sa troupe vibrionnante et la fige en pastiche de la Cène de Vinci à Milan.
Viridiana de Bunuel (S)Cène).
On le voit, les emprunts, possibles, en tout cas masqués, sont multiples et travaillent comme résurgences d’un passé culturel et historique, s’agencent comme des souvenirs à la fois brouillés et brouillons mais forts. On remarque que Warlikowski avance caché, sans écran-citations, que tout fonctionne comme une mise en scène de ses propres souvenirs de spectateur, de cette histoire à la fois proche et lointaine (il est né en 1962) et aussi de l’Histoire, mise en scène par le cinéma qui est souvent le médiateur, ou dans le meilleur des cas, le révélateur, d’une réalité hors d’atteinte. Il nous semble que Warlikowski n’est pas dupe des impossibilités de l’art à transformer, ou révolutionner le réel. Il n’œuvre et n’est effectif que dans la représentation, dans la production et le recyclage d’images. Peut-être est-ce comme cela qu’il faut prendre l’impasse mexicaine finale : le coup de feu, l’étincelle n’aura pas lieu. On reste dans le statu quo, l’image tournant en boucle sans résolution.
On conclura que les recherches cinématographiques sur la Salomé de Warlikowski sont encore à faire tant il nous semble apparaître de rapports également avec Portier de Nuit (1974) de Liliana Cavani (que nous n’avons pas vu). Rapports troubles dominants/dominés, juifs/SS, masochisme, danse macabre et tête coupée, Bogarde et Rampling (comme dans Les Damnés). Un beau programme.
Portier de Nuit de Cavani, danse et tête coupée offerte :
https://www.youtube.com/watch?v=Wk3iUpDnRcU
Le cas Frank Castorf
Le Ring castorfien et Coppola
Autre metteur en scène de théâtre cinéphile, Frank Castorf. On ne reviendra pas sur le choc du Ring de Bayreuth, ni sur les fines analyses du duo de tête Verdier/Cherqui, l’entrée du livre concernant le cinéma étant bien garnie. On se contentera d’ajouter quelques graviers à l’édifice suite à la vision du Apocalypse Now Redux de Coppola.
Selon certains, ce qui se passe avec le pétrole est encore étranger à l’humain, il faut d’abord y introduire une histoire d’amour ou quelque autre conflit « purement humain ».
Bertolt Brecht, La lutte contre le formalisme en littérature ((Bertolt Brecht, Écrits sur le théâtre, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p 289.))
Il nous semble que Castorf, qui connaît son Brecht sur les bout des doigts, n’a pas manqué de bondir sur ce genre de phrase concernant le capitalisme et le pétrole et qu’elle a sans doute alimenté (en fuel) son Ring, notamment Walküre et la lovestory des Wälsungen, sans parler des prémisses de l’amour de Brunnhilde pour Siegfried.
Ainsi, il n’est guère étonnant que sa mise en scène se soit basée, le plus ouvertement, sur There Will be blood, (que nous n’avons pas vu) et donc sur l’histoire du pétrole. En revanche, il nous semble pertinent de penser que Castorf a voulu jouer sur les codes populaires de la musique de Wagner, incarnée pour le commun des mortels, de notre époque, par la Chevauchée des Walkyries comme bande son d’Apocalypse Now (scène du bombardement héliporté). C’est en tant qu’élément constitutif de l’imagerie populaire que Castorf traite Wagner.
En ce sens, il va puiser, nous semble-t-il, d’autres images d’Épinal dans le Roman Partagé qu’est Apocalypse Now pour revenir à sa source, désormais inconnue à la plupart, le Ring.
En voici un relevé non exhaustif.
Dès l’ouverture, les images verticales de feu (bombes au napalm) en surimpression se manifestent sur scène par le baril de feu de Walküre. Idem pour les visages de pierre des statues de dieux qui apparaissent régulièrement en surimpression dans le film((2mn20 après le début par exemple)) et nous évoquent le Mont Rushmore Marxiste de Castorf (avec ici un double détournement, l’inversion du bloc est/ouest et l’inversion profane/divin)
Apocalypse Now de Coppola, Ouverture :
La musique des Doors, « The End » (« This is the end, my only friend, the end »), qui circule dans le film, rappelle évidemment le Crépuscule des Dieux, la mort attendue de Siegfried. Coppola dans son film substitue à la musique de Wagner celle de son époque, The Doors, mais n’oublie pas de signer la provenance en réutilisant plus tard la musique de la Walkyrie. L’opéra balaye l’œuvre populaire de Coppola (hyper présente dans la série des Parrains, surtout le III, le plus théâtral((pour preuve le traitement du son étouffé et/ou réverbéré comme sur une scène alors que les personnages sont en plein air : le film comme une pièce scénique jouée en décors naturels)) et opératique avec la représentation de Cavalleria Rusticana à Palerme). Castorf joue avec cela en réintroduisant Coppola à l’opéra.
Comme par petites touches avec, par exemple, le chapeau de Kilgore (Robert Duvall), lieutenant-colonel de la Cavalerie héliportée, qui ressemble à celui d’un des dieux (Froh ?) dans Rheingold (rappelons sa phrase devenue culte, sentant le souffre et… le pétrole : « I love the smell of napalm in the morning »). L’arrivée de Froh et Donner chez Castorf sonne d’ailleurs comme l’arrivée de la cavalerie. À la rescousse, deux figures archétypales du cinéma : la cavalerie et le malfrat (toute la divine bande nous fait penser aux gangsters de Scorsese et Coppola). Deux figures de héros ou de antihéros (on pourrait d’ailleurs gloser longtemps pour savoir lequel incarne le héros positif), deux incarnations de la liberté, du cinéma classique de Ford au nouvel Hollywood.
Le personnage « Chef » de La Nouvelle Orleans, simple cuistot embarqué par erreur dans la guerre, tout au long du fleuve, fait un apprentissage de l’horreur (leitmotiv du film et du Ring de Castorf) : c’est peut-être une des figures incarnées sur scène par Patric Seibert, l’untermensch, l’humanité ballotée à son insu dans des conflits de géants qui le dépassent.
Même destin, mais en plus actif, pour le surfeur Lance, pourtant peu guerrier au départ, qui sombre dans la folie peu à peu et se peinturlure le visage et le corps de couleurs de guerre. Seibert faisait la même chose en noir ((à ce sujet, la peinture noire avec laquelle les personnages se griment revient souvent dans le Ring. Les curieuses barbes peintes en noir des Géants restaient un peu énigmatiques mais elles me font penser aux moustaches peintes de Groucho Marx, autre figure populaire du cinéma. Les Marx Brothers, anarchistes en diable, voilà une référence tout à fait plausible de Castorf. De même les géants amoureux et, surtout, lubriques (cf. le Dragon à visage humain de Siegfried) font penser à la sexualité débridée de Groucho.)).
Le show des filles de Playboy au cœur de la jungle fait penser à l’atmosphère de revue qui parcourt le Ring et notamment aux scènes avec l’Oiseau qui partagent le même caractère incongru (la parure immense de l’Oiseau sur l’Alexanderplatz).
Apocalypse Now, scène des Playboy bunnies :
Le conducteur du bateau George Phillips (Albert Hall) qui transporte l’expédition de Willard, est tué par une lance qui le transperce. C’est l’annonce du massacre final et de la fin de Siegfried dans le livret. De même, l’image de Coppola semble tirée tout droit des lithographies du Ring de Franz Stassen et du Nibelungen (1924) de Fritz Lang. Ce genre d’image-mise en abyme excite Castorf.
Apocalypse Now, lance fatale :
Le pont frontière qui annonce l’arrivée au Cambodge, zone où s’est retiré Kurtz, ressemble beaucoup au « biergarten » de Walküre : structure en bois dans l’obscurité, lieu d’affrontement, éclairage en guirlande lumineuse. Chez Castorf aussi, ce lieu est la frontière entre les hommes et les Dieux, avec comme médiatrices les Walkyries.
Apocalypse Now, le pont-frontière :
Le domaine de Kurtz, Héraklès en voie d’auto-apothéose, est un lieu qui flirte avec le sacré, le paganisme, le vaudou. On y sacrifie des animaux (ce que faisaient les Nornes castorfiennes), on accroche des crânes en décoration… C’est tout à fait l’ambiance que l’on retrouve dans le prologue de Crépuscule des Dieux.
Apocalypse Now, arrivée au bout de l’enfer :
Enfin, on peut se demander s’il n’y pas correspondance entre Hagen et Willard. Willard, comme Hagen, est le tueur halluciné et programmé du guerrier Kurtz-Siegfried. Une fois le « job » fait, il reprend sa route, hagard, sur son esquif fantôme. C’est la vidéo finale du personnage de Hagen vu par Castorf. A ce titre, cela fait d’autant plus sens de terminer l’aventure de ce personnage par des images sur un écran, comme un ultime renvoi d’ascenseur vers le livre d’images de Coppola (le même procédé se retrouve dans Bajazet, comme on le verra).
En somme, Castorf picore plusieurs images et thèmes chez Coppola, qui lui-même les tire de Wagner, comme dans une mise en abîme. Contrairement à Warlikowski, tout ici est teinté d’ironie. Ce sont de petites touches et retouches, du matériau brut pris ailleurs qu’il faut recoudre ou réagencer. Et toujours mettre du populaire dans du « culturel », comme pour faire communiquer deux vases a priori irréconciliables tout en montrant leur même origine. Chez Warlikowski, on retrouve la même dichotomie théâtre/cinéphilie mais sur un versant plus sérieux, disons moins goguenard.
Force du mythe : du Ring à Bajazet
Il semble qu’il y ait chez Castorf une véritable fascination pour la culture populaire de l’écran, voire des écrans. À ce titre, son utilisation de la vidéo (Andreas Deinert et Jens Crull, impériaux) est éclairante. Miroir aux alouettes (le cadrage isole et est un choix volontaire d’une action scénique globale multiple), ou miroir des âmes (la camera précise un jeu plus fin des visages, des gestes plus facilement dissous sur une scène), la caméra braquée sur les corps de Castorf est constitutive de son travail. En cela encore, c’est un bon Brechtien, même si ce dernier n’envisageait, rapport à la technologie de son époque, que la projection. Là encore, on renverra aux plus éminents propos de Verdier et Cherqui sur le Ring.
Il est remarquable que son Bajazet soit en grand partie vu par l’intermédiaire de la vidéo. Des corps soustraits à la scène dont la vie réelle s’anime à l’écran. N’est-ce pas une métaphore de nos vies étalées sur les écrans via les réseaux sociaux, disséquées en continu et vendues par les analystes du Big Data ? En ce sens, voici toute la modernité de l’impudeur Racinienne réactualisée dans la mise en scène de notre époque.
Ces corps soustraits à notre espace-temps rappellent aussi une autre référence majeure de notre époque, Twin Peaks, œuvre monde de David Lynch, contamination télévisuelle d’un cinéaste visionnaire, ayant changé le monde de la télévision en pervertissant le concept de série et donné le cap à toute la production qui a suivi depuis le début des années 90.
Comme Star Wars (space opera, lui aussi relecture de Wagner, d’Akira Kurosawa et de Fritz Lang) ayant redéfini tout un pan de la culture populaire à partir de 1977, Twin Peaks a remodelé le monde, sa perception du monde et de l’adolescence, redéfini ses peurs, créé des personnages devenus quasi mythiques.
Le monde manichéen de Twin Peaks, critique d’une Amérique policée bien-pensante en apparence et troublée par ses pulsions, s’est, peu à peu constitué en cosmogonie (on pense à certains bienveillants qui avaient conseillé à George Lucas de créer une religion basée sur la Force, la philosophie des Jedi !) en informant durablement toute une génération.
La créature Twin Peaks était prévue pour échapper à ses co-createurs (Lynch et son scénariste Frost, n’étant pas derrière, ni à la manœuvre de tous les épisodes des premières saisons et carrément en retrait sur la seconde). Certains épisodes avaient donc des fonction de remises sur les rails, d’autres de blocages (dernier épisode de la mal aimée saison 2 à la fin duquel le héros Dale Cooper fut bloqué dans la Red Room jusqu’à la saison 3… 25 ans plus tard).
Comme pour Apocalypse Now de Coppola et ce dès le tournage (et y compris dans ses propres multiples tentatives de re-signer des montages, le dernier datant de…2019), on est bien dans la créature hors contrôle. Twin Peaks acquiert un statut d’icône, voire de mythe populaire fondement d’une nouvelle culture et dont les bases semblent oubliées (se souvient-on des allusions au Magicien d’Oz (1939) dans Wild At Heart (1990), de The Last Picture Show (1971) de Peter Bogdavitch pour Twin Peaks, The Straight Story (1999) entre autres références, plus obscures, de David Lynch). Castorf, comme Lynch, réutilise les mythes populaires véhiculées par des images, comme d’autres références picturales ou textuelles.
Dans Twin Peaks, plusieurs espace-temps coexistent, celui du Bien, la White Lodge, celui du mal, la Dark Lodge et la célèbre Red Room, dont on ne sait exactement si elle est une antichambre, ou un purgatoire. Certains peuvent voyager entre ces mondes, infecter les corps, échanger leur place.
Il nous semble que Castorf joue avec ces concepts dans Bajazet, notamment avec les espaces clos qui coupent le spectateur du monde de la scène. On passe dans un autre espace-temps puisque filtrés par la vidéo. La cuisine, lieu de détente et des petits arrangements, des moqueries aussi, fait penser à la Red Room où les créatures négatives y mangent d’ailleurs un étrange plat, la Garmonbozia, sorte de maïs au beurre à l’écran, censée être une représentation de la souffrance et de la douleur volée aux humains((plusieurs personnages régurgitent la substance dans la saison 3, Bajazet, lui, crache une purée de carotte en disant son texte face au miroir)). C’est du moins ce qu’indiquent les personnages dans le film Twin Peaks : Fire Walk With Me((Philip Jeffries (David Bowie) décrivant son passage dans la dark room dit à ses collègues du FBI : « Ecoutez… je suis allé à l’une de leur réunions… au-dessus d’une épicerie » (Twin Peaks, Fire Walk With Me). Dans Bajazet et dans le Ring de Castorf aussi il est question d’une épicerie, lieu de vie et de trafic plus ou moins ordinaire)). Les « méchants » de Bajazet, dans leur annexe, s’y repaissent et laissent apparaître leur vrai moi, d’autres comme Roxane, s’y dévoilent totalement.`


Ces espaces clos rappellent physiquement les Lodges, Lynchiennes, même attirance pour les draperies (bleu dans le décor Denić, rouge chez Lynch), les coussins, les sièges, les lampes. Ce sont les endroits magiques où l’on se révèle. Notons que les Lodges dans la série sont passées d’espace du rêve (dans la première saison) à des endroits de plus en plus importants, dans lesquels de plus en plus d’événements se produisent. Jusqu’à clore la série dedans pour 25 ans… Dans la saison 3, de nombreuses séquences se passent entièrement dans les Lodges. C’est ce qu’on observe aussi avec le Bajazet : l’espace de représentation scénique se soustrait à nos yeux pour de longues scènes qu’on oserait presque qualifier de séquences.
C’est ailleurs que ça se passe et il faut le voir par l’intermédiaire d’un écran. Ce qui se passe sur scène est court-circuité, parasité par les écrans, la musique et les sons qui comme chez Lynch jouent comme dilatation ou contraction de ce que l’on perçoit.


C’est là qu’Atalide se déclare devant le miroir, que Roxane se met à nu, que l’entente sur les magouilles d’Acomat et Osmin se fait le plus visiblement.
Chez Lynch cette porte scénaristique ouverte avec Twin Peaks se répercute dans ses films suivants, comme les motifs Castorfiens se suivent d’une mise en scène à l’autre. La résolution des actions du monde ne peut s’effectuer que dans un autre espace-temps qui fonctionne en miroir. Les soupçons de jalousie du personnage et sa vengeance s’incarneront par un double dans Lost Highway. Dans Inland Empire (2006), c’est bien un envers et un endroit du cinéma (même thème dans Mulholland Drive, 2001) auquel on assiste avec un passage flou par une porte spatio-temporelle dans un studio (la prison dans Lost Highway). Les deux faces d’un même monde se révèlent ainsi : Hollywood et la traite des blanches dans les pays de l’Est (on retrouve les revers thématiques du Ring, les rapports causes-conséquences).
Ces retournements, ces passages d’un univers à l’autre, d’un texte à l’autre, ces personnages doubles sinon troubles voilà ce qui intéresse Castorf.
Les techniques brechtiennes de lecture du texte par un autre personnage (voire son doublage dans Bajazet) rappellent aussi les manipulations des créatures maléfiques qui infectent les corps des personnages de Twin Peaks. Atalide et Roxane, jouets d’Acomat et Osmin, comme les personnage coquilles vides des personnages doubles dans la saison 3 (Diane, Dougie Jones, Bad Coop, voire… Sarah Palmer). À défaut de jouer avec des effets spéciaux, Castorf double régulièrement les personnages, comme une ombre et ses marionnettes. Lynch joue énormément avec cela dans la saison 3, avec beaucoup d’ironie et toujours de manière très visible (effets spéciaux volontairement cheap).
D’autres parallèles peuvent être faits, Amurat est le personnage absent toujours présent comme Laura Palmer. Il faudra attendre 2 saisons et le film Twin Peaks, Fire Walk With Me, "prequel," pour voir Laura Palmer agissante ou la saison 3, de tous les retours, se terminant par un Dale Cooper ramenant la petite Laura, vieillie, chez elle, ou plutôt chez ses parents.
Autre avatar de Laura, Roxane. Fille bien née, promise à un bel avenir mais malmenée et amenée, aussi, à se révéler toute autre, dans des lieux de plaisirs clos (cf. les scènes d’orgies dans le One Eye Jack, à la fois proche et lointain puisque situé au Canada, cet alter America). Chez Castorf, la Turquie est lieu de tous les fantasmes.
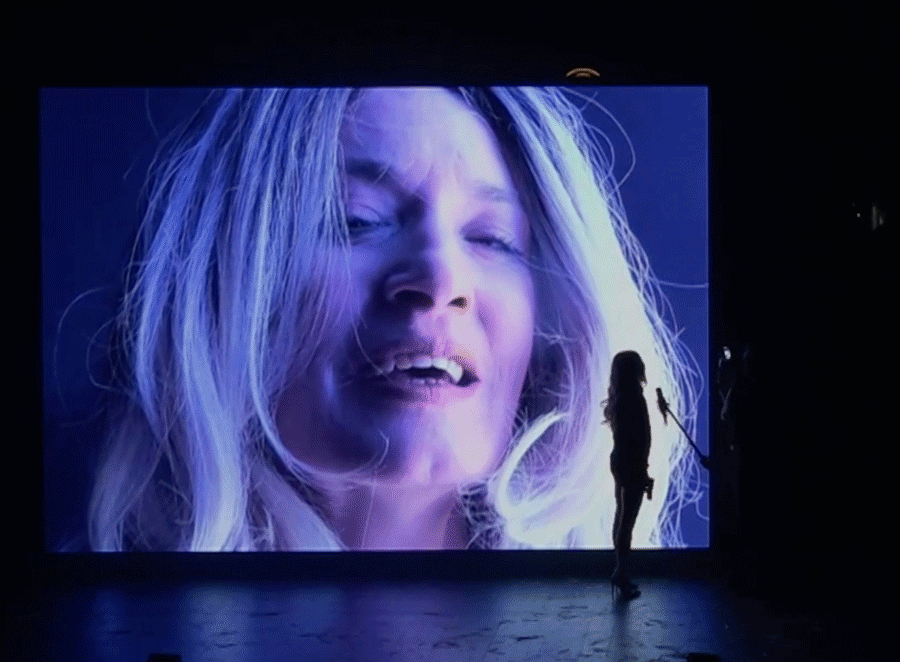
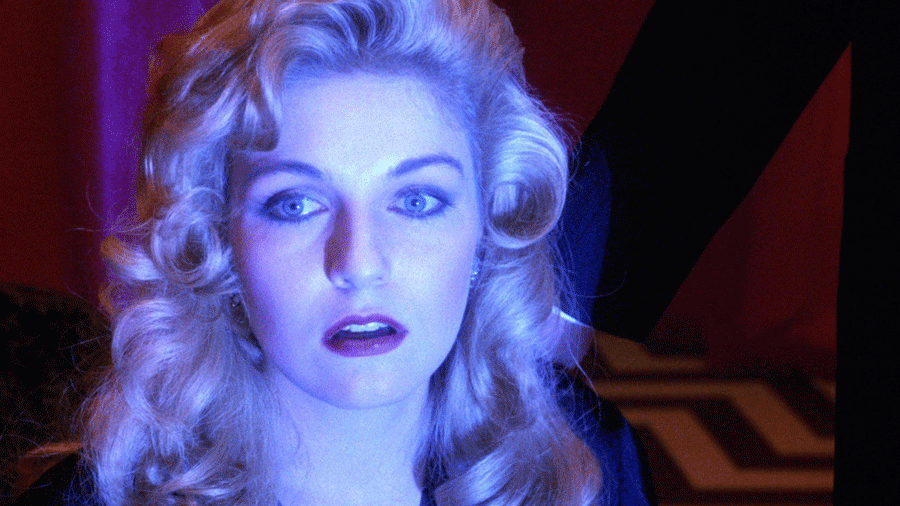
Meanwhile scene de Twin Peaks saison deux (Les jeux de lumières et de musique rappellent ceux de Bajazet lors du dernier monologue de Roxane/Balibar. Les cris, eux, nous évoquent ceux de Bajazet, hors de lui-même et ensanglanté).
Le One Eyed Jack, lieu de prostitution, de pédophilie voire d’inceste (le père de Laura est lié à ce business), nous fait penser à la tente Burqa de Bajazet et aux images de La Grande Odalisque d’Ingres, inspiration visuelle, ainsi qu’au néon Babylon 0–24 (écho du Bang Bang Bar, tenu par les frères bandits Renault). Rappelons que le One Eyed Jack porte une enseigne à l’œil lumineux comme le Sultan de Véronèse qui surplombe la scène…
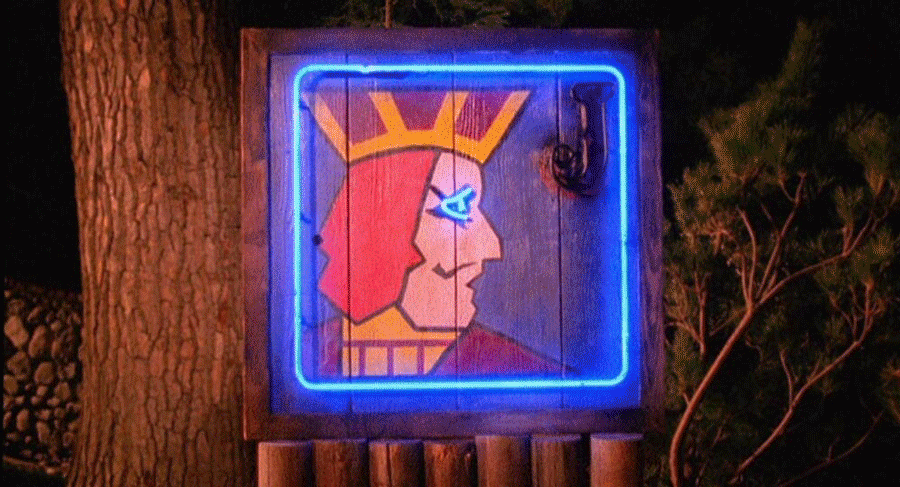



Bajazet, c’est BOB. Physiquement d’abord : cheveux longs gris filasses, traits outrés, yeux exorbités. Chez Lynch aussi il est l’incarnation de la déchirure. Quelque chose, une entité, en dehors du réel, prenant corps dans le monde, prenant des corps dans le monde, celui de Leland Palmer (le père de Laura) puis de Dale Cooper. Bajazet/Bob est le Double. Chez Castorf, Bajazet est toujours Autre, incarnation d’Artaud, l’en dehors de Racine, par les textes, mais aussi, physiquement, par sa diction, qui l’isole du reste de la troupe.
On se souvient de l’acte de naissance de BOB, révélé dans la saison 3, qui apparaissait auparavant comme une des figures du mal absolu et qui proviendrait finalement de causes floues mais tendant à se préciser dans le fameux épisode 8, épisode hors cadre : bombe atomique, mutation génétique, voix de la radio qui pénètre dans les corps, et les orifices, mal (mâle ?) se répandant dans la bouche féminine d’une adolescente amoureuse (on pense aux paroles venimeuses d’Osmin et Acomat doublant celles des filles).
Twin Peaks saison 3, épisode 8. Explosion, destruction, création. La source du mal ? Nouvel ordre du monde ?
https://www.youtube.com/watch?v=4IKUeIEdRMY
Twin Peaks saison 3, épisode 8. Quelque chose qui passe par le souffle et la voix. Organique et électrique :
Le Mal reste mal défini et les symboles se multiplient. Lynch réanime son propre mythe en se souvenant sans doute d’Hécate mais brouillant les pistes, inventant une déesse babylonienne Jowday ou Joody…
Pierre Chuvin dans sa Chronique des derniers païens ((Pierre Chuvin, Chronique des derniers païens, Les Belles Lettres, Fayard, 2009, chapitre « La Dernière Ronde des Dieux », p. 206, reprenant l’interprétation et traduction de Tardieu dans La Gnose valentinienne et les Oracles Chaldéiques)) décrit Hécate ainsi :
« De son flanc droit « déborde abondamment le liquide innombrable qui remplit d’âme l’univers » et la source de la vertu est à son flanc gauche ».


D’ailleurs, à l’image de la naissance de BOB chez Lynch correspond le texte d’Artaud : « C’est par le ventre qu’il faut que le silence commence ».
Mais Hécate, la déesse des carrefours qui relie les enfers, le ciel et la terre, déesse de l’ombre, qui suscite les cauchemars, les terreurs nocturnes (Bajazet baigne exclusivement dans une ambiance nocturne. La Turquie enténébrée), ainsi que les spectres et les fantômes est bien plus active aujourd’hui dans les psychés sous la forme Lynchienne de Judy, proto mère de BOB, incarnation du cauchemar moderne.
Laura Palmer dans Twin Peaks, Fire Walk with me : « I’m gone. Long gone. Like turkey in the corn”:


D’autres figures mythologiques féminines et divines abondent, comme la Venus (notamment de Milo dans un des couloirs de la Red Room), dont on trouve souvent les images chez Lynch, qui en bon cinéphile se souvient de la Venus de Medicis qui surplombe l’attente trahie de la Gertrud (1964) adultère de Dreyer.
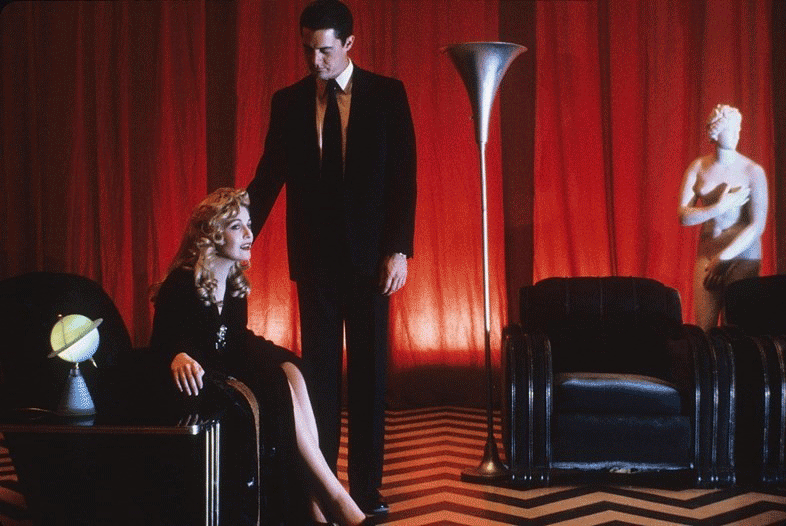
Gertrud de Carl Dreyer (1964):
En tout cas, le mal, qui s’incarnait jusqu’alors assez facilement dans des figures masculines (le père Leland, Bob), dans la saison 3, prend des formes féminines (Judy créatrice de Bob, la mère Sarah Palmer, Médée moderne, prêtresse d’Hécate alcoolique, hôte d’une créature curieuse et maléfique, peut-être la même d’ailleurs). Ainsi on a bien chez Bajazet ce quatuor du mal, de l’infection sur la scène de Castorf. Des créatures habitées, à la psyché travaillée dans d’autres espaces-temps plus propices à leur épanouissement.
Entre les deux, les miroirs, par lesquels chez Lynch comme chez Alice, on peut basculer d’un monde à l’autre (monologue d’Atalide).
C’est bel et bien toute une démonologie moderne que Castorf puise pour nous parler du Mal et des rapports sexuels, d’amours tordues et des rapports compliqués hommes/femmes. En cela il nous rappelle le Godard, Brechtien convaincu depuis les films collectifs du groupe Dziga Vertov, de Notre Musique (2004). Dans ce film, construit en trois parties inspirées de la Divine Comédie, Godard filme un retour à Sarajevo, ville qu’il a souvent filmée, épicentre des conflits européens dont il a beaucoup parlé et qu’il met en rapport avec un exposé, pour les Rencontres Européennes du Livre !, sur le champ/contre champ. Rappelant le célèbre et problématique champ contre champ homme/femme, Cary Grant/Rosalind Russell de Hawks dans His Girl Friday, il montre le conflit israélo palestinien en opposant des images d’arrivées de juifs sur la terre promise et le départ forcé des palestiniens. À ce copieux mélange (documentaires, film dans le film, images d’archives) s’intègrent aussi des extrait des Démons… de Dostoievski !
Notre musique de Godard
Dialectique du champ/contre-champ : homme/femme, texte/image, Israel/Palestine fiction/documentaire etc…
Pour Castorf, comme pour Godard, rien n’est univoque, tout doit être mêlé, mis en rapport pour être questionné. C’est en tout cas chez les deux auteurs, le même agencement rapports hommes/femmes, jeux de pouvoirs et d’influence, dans une région instable politiquement et soumise à des changements profonds liés à des problématiques métaphysiques voire religieuses. Que le texte des Démons de Dostoïevski, dont les deux raffolent, ressurgisse n’est une fois de plus pas un hasard.
Fassbinder, encore.
Fassbinder fasciné par les mélodrames de son compatriote exilé en Amérique, Douglas Sirk, a comme lui fait une radiographie de l’Allemagne par ses films qui sont une analyse psycho-sociale de son pays et de son peuple. Les techniques et le rendu ne sont pas les mêmes mais c’est la même intention chez Godard pour qui le cinéma se doit d’être un microscope du réel. On trouve beaucoup de Fassbinder chez Castorf et particulièrement des allusions aux Larmes amères de Petra von Kant, déjà évoqué plus haut, dans Bajazet. L’image principale venant des multiples changements de costumes et de perruques qui rappellent ceux du trio de Petra von Kant. On sent dans Petra von Kant, film à l’esthétique et aux costumes très particuliers, une certaine fascination pour le travestissement et les changements de tenue ce qui correspond tout à fait au travail protéiforme d’Adriana Braga Peretzki pour Castorf.


Dans le film, Petra (Margit Carstensen) styliste renommée, jet-setteuse brêmoise, se change sans cesse, perruque comprises, ce qui souligne (outre la multiplicité des plans) ses errements sentimentaux, ses passades, son passage de la femme admirée et aimée à l’amoureuse éconduite. Idem pour la jeune modèle Karin (Hanna Schygulla), oie blanche timide devenue cygne éclatant et cynique, amoureuse de Petra puis, parvenue et éduquée, la délaissant pour d’autres horizons. On retrouve l’esthétique du changement du duo sur la scène de Bajazet. Les larmes amères de Petra von Kant offrent aussi une analyse des rapports amant aimé, dominant dominé avec le personnage triangulaire de Marlene (Irm Hermann), l’exploitée/dominée volontaire qui travaille en sous-main pour Petra. Elle est le véritable centre productif de Petra, comme l’est le duo politique masculin de Bajazet, véritable alliance de faux servants. Ironie suprême, comme dans Bajazet, où le gagnant, inattendu, est Osmin, la cheville ouvrière/cerveau exploité quittera Petra lorsque celle-ci, abandonnée par sa créature, lui promet (enfin ?) amour, attention, partage.
Autre image témoin de l’emprunt, un mur de l’appartement-prison de Petra est décoré par une reproduction géante de Midas et Bacchus de Poussin quand la tente Burqa l’était par La Grande Odalisque d’Ingres.

« Le cinéma est une sorte de cafeteria, un self-service, un asile de nuit pour les « sans domicile fixes » de l’esprit. »
Bertolt Brecht, Du théâtre considéré comme un sport ((Bertolt Brecht, Nature et Avenir du Théâtre, Ecrits sur le théâtre, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p 47))
Enfin, ultime trace signature des emprunts de Castorf à Lynch : la vidéo finale qui, comme le souligne Guy Cherqui, nous évoque Miami Vice (1984), la série policière cheap qui surfait sur l’atmosphère de truands, malfrats, flics infiltrés (toujours la tromperie etc..) du Scarface (1983) de Brian de Palma, film qui était lui-même un remake, actualisé mais plein de références au Scarface de Hawks (1932). Le Scarface de Palma est LA référence cinématographique de la culture banlieue et donc populaire. En ce sens, elle est plus riche pour Castorf, comme un miroir à plusieurs facettes.
Elle renvoie également à la thématique des frères qui court dans Twin Peaks (les faussement respectables Horne, les carrément magouilleurs Renault et entre les deux, les inévitables mafieux de Las Vegas, les… Mitchum).

Miami Vice, générique :
L’achronie n’est pas le côtoiement indifférent mais plutôt une interpénétration des époques selon le modèle d’un trépied, une perspective de structures se rajeunissant. On peut les étirer comme un accordéon, la distance est grande alors d’un bout à l’autre, mais on peut aussi les emboîter les unes dans les autres comme des poupées russes, alors les cloisons séparant les époques sont très proches les unes des autres. Les gens des autres siècles entendent geindre notre gramophone et, à travers les cloisons temporelles, nous les voyons tendre leur mains vers de si appétissantes agapes.
Elisabeth Lenk (exorde de Médée de Christa Wolf).
Comment faire sens aujourd’hui avec l’intrigue de Bajazet ? En le replaçant dans un contexte contemporain et avec les lumières d’aujourd’hui. Les Acomat et les Osmin du jour sont les gangsters de l’hyper classe à mi-chemin entre les arrangements politiques et les exécutions sommaires (toute référence avec des situations vécues au moyen Orient…).
Par ailleurs, les vêtements griffés/imprimés de luxe portés par les personnages de Bajazet évoquent tout autant l’hyper classe (celle de Petra Von Kant), avide de grandes marques mais aussi, et l’antithèse sinon la diffraction sied à Castorf, que les classes populaires se ruinant pour porter des vêtements hors de prix tout comme les immigrés clandestins vendant dans les rues des contrefaçons singeant les imprimés les plus connus dans des déclinaisons toujours plus ubuesques les unes que les autres (c’est ce que l’on voit sur scène). Acomat et Osmin sont aussi les visages d’une population immigrée, reléguée en banlieue, parias n’ayant sans doute pas beaucoup d’autre choix que la voie des magouilles, petits arrangements avec la légalité, banditisme.
La prohibition et l’immigration italienne de Chicago en 1929 (Scarface, Hawks) – les immigrants Cuba/Miami en 1980 (Scarface, de Palma), les révolutions et insurrections en cours dans le bassin méditerranéen et les agitations autour de la Turquie et leur corollaire de réfugiés et d’immigrés, voilà la réactualisation Brechtienne que souligne Castorf.
Il le fait sous la forme de court clip, comme Lynch conclut chaque épisode de sa saison 3. Conclusion musicale, elle permet à Lynch de saluer les spectateurs, de recycler et de mettre en scène ses collaborateurs musicaux passés (Julee Cruise, Nine Inch Nails…) et ses nouvelles marottes, comme Chromatics, groupe de l’Oregon formé en 2001. Il ne nous paraît pas fortuit que Castorf conclue son Bajazet ainsi, avec la même chanson, « Shadow » (2015), que dans l’épisode 12 de la saison 3.
Shadow, take me down
Shadow, take me down with you
For the last time (x4)
You're in the water
I'm standing on the shore
Still thinking that I hear your voice
Can you hear me ? (x4)
For the last time (x4)
At night I'm driving in your car
Pretending that we'll leave this town
We're watching all the street lights fade
And now you're just a stranger's dream
I took your picture from the frame
And now you're nothing like you seem
Your shadow fell like last night's rain
For the last time (x4)
Outre les paroles qui font allusion à l’action, Osmin ombre d’Acoman pour la dernière fois va le tuer sur l’eau. La musique de Chromatics surfe totalement sur les productions pop à claviers des années 80 et rappelle donc l’atmosphère du Scarface de de Palma portée par les compositions de Giorgio Moroder (sur un thème piqué à la cold song de Purcell dans King Arthur) et de Debby Harry de Blondie (on soulignera, en plus, la parenté de look entre Debby Harry et la chanteuse de Chromatics). En cela Castorf termine bel et bien sur un Éternel Retour.
Castorf puise donc constamment dans les mythes modernes, véhiculés par les écrans omniprésents de notre société comme il réalimente sans cesse ses propres mises en scène, réutilisant ses éléments de décors (les crocodiles par exemple), s’auto-citant, déviant ses images pour leur donner une nouvelle forme ou un nouveau visage, comme Lynch ((par exemple, Twin Peaks, Fire walk with me, film prequel mal aimé que même les fans de la série n’appréciaient pas et sur lequel, ironie du sort, Lynch va bâtir précisément sa saison 3, acclamée jusqu’aux Cahiers du Cinéma et à laquelle ils ont décerné le titre de film de l’année, en s’attachant à expliquer et développer chacun des détails qui avaient agacé dans le film à l’époque. Exercice de style ? Rattrapage aux branches ? Profondeur ? Ironie ? 25 ans d’avance ? Multiplicité des symboles et significations en tout cas, sens aigus des arrangements sons/images et une mythologie renouvelée et vivante.)). Ils partagent le même goût pour des associations thématiques et culturelles de bazar (témoin leur fascination pour les écrans, notamment de télévision((la neige de l’écran ouvre Twin Peaks, Fire Walk With Me, une télévision est l’autel vaudou des Nornes dans Götterdammerung)), une profonde réflexion sur leur média. En refusant de lever le voile trop vite sur certaines pistes interprétatives, ils gardent tout leur sel et leur puissance d’essences artistiques.



En guise de conclusion…
On le voit par ces exemples, Warlikowski et Castorf se nourrissent davantage du cinéma que, disons, Herzog pour son Lohengrin à Bayreuth. Que Warlikowski pour sa Salomé prenne comme point d’appui une cinéphilie pointue revisitant 50 ans de l’histoire de la communauté juive au cinéma ou que Castorf alimente son copieux et débordant Bajazet d’ambiances et atmosphères Lynchiennes((nous avons d’ailleurs trop peu évoqué le traitement musical qui lui aussi lorgne souvent vers cette musique populaire déviante, envoutante et nauséeuse qu’on retrouve dans presque tous les films de David Lynch)), entre autres !, on sent chez chacun une irrésistible attirance pour les images et projets cinématographiques divers. Matériel riche, traité au même titre que les textes, mythique, c’est-à-dire sans doute un peu compassé (déjà…) mais utile comme source éclairante (Warlikowski) et sans doute plus vivifiante que l’écrit (Castorf), le cinéma nous apparait comme indispensable et presque central chez ces deux metteurs en scène. On le sent même prendre une ampleur considérable, notamment chez Castorf, avec une puissance d’incarnation de l’image filmée qui reste étonnante. Plus que la nudité de Balibar ou la performance hallucinante et épuisante de Jean-Damien Barbin, ce qui nous restera de Bajazet sera sans doute ce monologue en gros plan, devant le corps (de profil !) de Balibar rendu minuscule par la taille de l’image aux couleurs changeantes. La scène et la performance magnifiées par l’écran.
On sent d’ailleurs qu’on atteint à la fois le summum et les limites de la vidéo live dans une mise en scène comme Bajazet. On s’attend presque à voir se soustraire complètement les acteurs de la scène. L’idée est séduisante et un peu folle. Le suspens est total. Attendons.
Picorage malin et tourbillon abyssal profond pour Castorf, larges emprunts hautement référencés pour Warlikowski, le cinéma au théâtre reste une boîte de Pandore féconde. Longue vie à lui.
La captation de Bajazet de Castorf, mise à disposition pendant le confinement, l’est encore ici :
