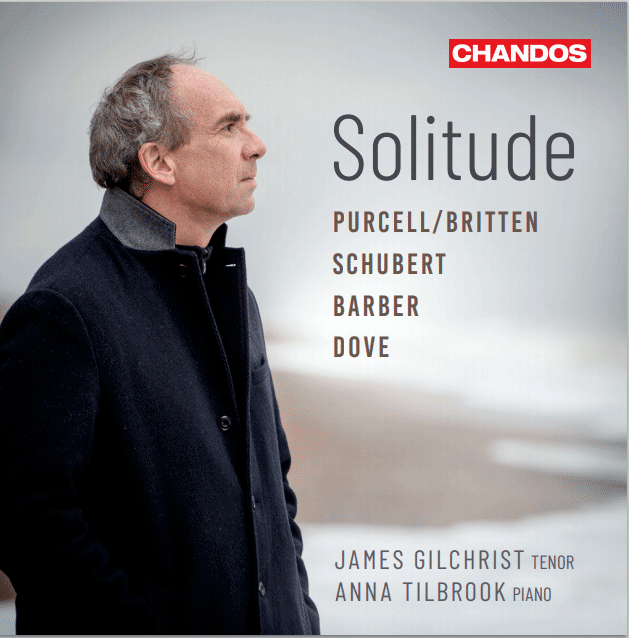
Loin des projecteurs braqués sur les scènes d’opéra, loin du battage médiatique dont s’entourent certains chanteurs solistes, il est une voie autre, qui permet de faire carrière différemment, avec des ambitions peut-être plus élevées à défaut d’être toujours aussi lucratives. Il est des artistes qui ne tiennent à pas à se présenter au public sous le masque d’un personnage joué sur scène, et qui se vouent presque exclusivement au concert et au récital.
Le ténor britannique James Gilchrist est de ceux-là. C’est très rarement qu’il participe à des représentations d’opéra, et s’il a enregistré divers œuvres lyriques anglaises sous la direction du regretté Richard Hickox (Albert Herring et Owen Wingrave de Britten, notamment), il en a peu incarné de rôles sur scène. Sa biographie annonce que, la saison prochaine, il sera de la production de Peter Grimes à l’affiche au printemps 2021 à Madrid, production d’autant plus attendue qu’elle sera signée par Deborah Warner, qui avait monté sur place un Billy Budd d’anthologie ; mais en cherchant un peu plus loin, on découvre qu’il y incarnera simplement le révérend Adams, rôle très secondaire qu’il a déjà tenu à plusieurs reprises en concert sous la direction d’Edward Gardner, mais aussi sur scène à Bergen et à Oslo. En concert, James Gilchrist semble le plus souvent se consacrer à la musique baroque : il fut en 2000 du « Pèlerinage Bach » de Sir John Eliot Gardiner et, sans le coronavirus, le public du Théâtre des Champs-Elysées aurait dû entendre en mars son Evangéliste dans une Passion selon saint Jean dirigée par Mazaaki Suzuki. Et quand il ne pratique pas l’oratorio, c’est la mélodie qui l’occupe en priorité, genre où sa voix est (enfin ?) seule, ou du moins dialogue en tête à tête avec l’instrument. Depuis une vingtaine d’années, il fait équipe avec la pianiste Anna Tillbrook, avec laquelle il propose chez Chandos un programme d’une totale cohérence, autour du thème de la solitude.
Quel âge a James Gilchrist ? Difficile de le dire, le seul point de repère fourni dans sa biographie étant la date qui sépare sa vie d’avant, dans laquelle il fut médecin, et sa vie d’aujourd’hui, puisqu’il a décidé en 1996 de se consacrer exclusivement à la musique. Quoi qu’il en soit, sa voix est saine, et les œuvres qu’il a choisi de réunir n’exigent aucun héroïsme hors de propos : sans se borner au chuchotement, l’évocation de la solitude se prêterait sans doute mal à une démonstration de force vocale. La qualité d’articulation du texte est ici la vertu essentielle, qu’il soit en allemand ou, comme c’est majoritairement le cas, en anglais. Le choix des œuvres donne aussi à Anna Tilbrook l’occasion de déployer un art discret mais certain, avec une belle versatilité qui lui permet de se révéler aussi convaincante chez Schubert que chez des compositeurs plus proches de nous.
Le parcours couvre plusieurs siècles, du XVIIe au nôtre, même si le Purcell célébrissime qui ouvre le programme apparaît sous les habits que Benjamin Britten lui a confectionnés au milieu du XXe siècle. On a désormais pris l’habitude d’entendre O solitude accaparé par les contre-ténors accompagnés par des formations variées d’instruments anciens. Rupture totale avec ce style d’interprétation, puisqu’il faut ici réaccoutumer l’oreille au son du piano – même si Britten s’est montré remarquablement sobre dans sa manière de soutenir la voix, par rapport à d’autres exercices d’harmonisation auxquels il a pu se livrer au cours de sa carrière – et à un timbre moins éthéré, bien plus incarné que celui de la majorité des contre-ténors, surtout d’école britannique. Solitude moins idyllique, moins extatique, donc, avec une tout autre intensité dans l’expression. Dans un livret où les textes sont proposés en anglais seul, ou avec traduction anglaise pour le texte en allemand, Chandos a eu le bon goût de proposer en regard du poème mis en musique par Purcell l’original français de Saint-Amand (1617), qui s’ouvre assez platement sur le vers « O que j’ayme la solitude ! ».
La voix de James Gilchrist passe ensuite à l’allemand, pour un des lieder les plus longs de Schubert. Avec une durée de vingt minutes, soit près du double du Pâtre sur le rocher, Die Einsamkeit est un cas à part dans la production schubertienne. On pourrait d’ailleurs y voir un recueil plutôt qu’un poème continu, car le texte dû à Mayrhofer propose une promenade à travers diverses humeurs successives, un peu à la manière de Haendel dans L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato. Le protagoniste de ce poème narratif demande à connaître tour à tour la solitude, l’activité, la compagnie des hommes, le bonheur, la morosité, désirs introduits par la formule « Gib mir die Fülle der … », pour s’apercevoir à chaque fois que le sentiment exploré le laisse insatisfait, et revenir finalement à la « consécration de la solitude », en choisissant la vie d’un ermite. Evidemment, cela suppose de la part du chanteur une aptitude quasi théâtrale à l’investissement dans chacun des vœux énoncés, et l’on ne saurait aucunement reprocher au ténor de rester à distance des émotions évoquées par le texte. Signalons que Gundula Janowitz au sommet de son art a laissé de Die Einsamkeit une version mémorable, en conclusion d’un liederabend donné au Mozarteum de Salzbourg en août 1972 (CD Orfeo).
La troisième pièce au programme est la plus récente, et bien que rien ne le signale, on peut se demander s’il ne s’agit pas d’une première au disque. Même s’ils n’étaient pas les premiers à enregistrer Under Alter’d Skies, James Gilchrist et Anna Tilbrook en ont assuré la toute première interprétation, en novembre 2017 au Wigmore Hall. Ce cycle avait été commandé par la salle de concert londonienne au compositeur britannique Jonathan Dove, qui a fêté l’an dernier ses 60 ans, quelques mois avant la création à Bonn de son dernier opéra, Marx in London. De Dove, le public français connaît surtout Le Monstre du labyrinthe, opéra participatif donné dans plusieurs villes de France, mais c’est d’abord avec l’opéra Flight (Glyndebourne 1998) que Jonathan Dove a pu accéder à une célébrité internationale. Under Alter’d Skies réunit sept extraits d’In Memoriam (1850), cette centaine de fragments poétiques rassemblés pendant une vingtaine d’années par Alfred Tennyson qui y exhala sa douleur d’avoir perdu son meilleur ami, Arthur Hallam, fauché dans la fleur de l’âge. Pour dépeindre la solitude de celui qui se dit « veuf » de son meilleur ami, Dove fait le choix de la simplicité, loin de toute grandiloquence victorienne, avec une mise en musique qui colle au texte au sens où elle respecte le débit parlé, sur une tessiture limitée, et s’autorise très rarement à développer davantage un mot par des mélismes illustratifs, par exemple, cependant que le piano multiplie les volutes proches des minimalistes américains ou opte lui aussi pour un dépouillement. Par son refus de tout effet intempestif, et par le naturel de son interprétation, ce recueil peut toucher l’auditeur.
On remonte doublement dans le temps avec la dernière œuvre, puisque les Hermit Songs de Samuel Barber datent de 1953 et utilisent des textes datant du Moyen Age mis en anglais moderne par divers poètes (dont W.H. Auden). Conçues pour Leontyne Price qui les créa et les enregistra avec le compositeur au piano (deux versions sous le label RCA, l’une en live, l’autre en studio), ces mélodies changent bien sûr complètement de physionomie dès lors qu’elles sont confiées à une voix de ténor. Malgré l’éloge final de la solitude, la notion d’érémitisme est ici toute relative, puisqu’il s’agit de notes marginales dues à des moines qui vivaient certes loin du monde, mais en communauté. L’inspiration de ces dix textes est assez hétéroclite, tantôt ouvertement sacrée, lorsque l’auteur (le plus souvent anonyme) s’adresse au Christ, tantôt étonnamment profane, comme pour l’éloge du chat blanc Pangur ou l’allusion licencieuse au bel Edan qui ne dormira pas seul dans son lit la nuit prochaine. Au sein d’un ensemble qui s’étend sur une vingtaine de minutes (comme Die Einsamkeit et Under Alter’d Skies), la durée de chaque mélodie est également très variable, de 45 secondes pour la plus courte à 4 minutes pour la plus longue. Là encore, James Gilchrist sait trouver le ton juste pour ces différentes vignettes, qui nous rappellent combien Barber est supérieur à son compagnon Menotti et comme il sut creuser un sillon personnel, entre un passéisme trop facile et une modernité trop ardue.

