
"C'est parce qu'Amurat est un regard invisible que le sérail est un milieu panique"
Roland Barthes, Sur Racine((Roland Barthes, Sur Racine, Aux éditions du Seuil, 1963, p.100))
Un univers scénique inhabituel
Un spectacle de Frank Castorf, c’est d’abord un univers scénique toujours confié à la même équipe depuis 2012 (La Dame aux Camélias, Théâtre de l’Odéon, Paris), Aleksandar Denić pour le décor et Adriana Braga Peretzki pour les costumes, et Andreas Deinert pour les vidéos. Des images vidéo qui plus peut-être encore dans ce spectacle, sont déterminantes. Le spectacle devant tourner dans de nombreuses salles aux configurations différentes, Aleksandar Denić n’a pas construit son décor sur une tournette, mais un dispositif allégé composé de quatre espaces concomitants sous les yeux des spectateurs ou cachés. Le décor répond donc à des exigences techniques dues à la tournée, mais répond aussi à un discours spécifique sur l'oeuvre, mis en valeur par les éclairages particulièrement réussis de Lothar Baumgarte.
De jardin à cour, contre les murs des costumes pendus à des penderies, une tente. De l’autre côté à cour, des caisses de transport de théâtre, sans doute des malles à costumes répondant aux penderies à jardin, un chariot-cage à roulette. Au milieu, une immense reproduction d’un portrait du Sultan Bajazet 1er par Veronese (actuellement conservé à Munich). Ce portrait immense aux yeux percés de deux petites lumières qui semblent regarder en permanence ce qui se passe en scène représente, comme le néon Babylone 0–24h le laisse supposer, le sultan absent, Amurat (Mourad IV dans l’histoire) qui est le sixième personnage de l’histoire, et celui qui déclenche l’action et qu’on ne voit jamais. On joue sur le réel (Bajazet, titre de la pièce, mais le portrait est celui d’un Sultan mort en 1403, deux siècles et demi avant les faits) et non au Bajazet frère de Mourad IV qui vivait dans la première moitié du XVIIe.
Derrière une porte, une cuisine invisible au public mais visible en vidéo où se réfugient les personnages, table, fourneaux, casseroles, couteaux et tout un bric à brac entreposé, donnant à la fois sur la scène, mais laissant deviner par la vidéo deux espaces latéraux, l’un qui est un étal de légumes,
 et l’autre une pub pour le bourbon Wild Turkey ((Dinde Sauvage)) l’une des trouvailles toujours amusantes de Aleksandar Denić qui joue sur le double sens du mot Turkey en anglais, Dinde et Turquie), on apercevra aussi un frigo à Coca Cola, élément intertextuel de tous les décors de Denić.
et l’autre une pub pour le bourbon Wild Turkey ((Dinde Sauvage)) l’une des trouvailles toujours amusantes de Aleksandar Denić qui joue sur le double sens du mot Turkey en anglais, Dinde et Turquie), on apercevra aussi un frigo à Coca Cola, élément intertextuel de tous les décors de Denić.
Enfin au fond, un néon représente le célèbre symbole d’Opel, un cercle traversé par un éclair (Blitz en allemand, allusion à un des premiers produits Opel, le camion Blitz, mais qui est aussi un Z comme Zeppelin, emblème de la technologie allemande utilisé par les nazis. ((N’oublions pas que le double Blitz était le symbole SS)).
 Mais surtout, Opel fut l’une des premières firmes à faire venir des travailleurs turcs pour ses usines de Rüsselheim entre Mayence et Francfort entre 1961 et 1973, suite à l’accord signé entre Bonn et Ankara, des travailleurs qu’on appelait des « Gastarbeiter » (travailleurs invités) et par ailleurs dans les dernières années la marque Opel est l’une des mieux installées en Turquie.
Mais surtout, Opel fut l’une des premières firmes à faire venir des travailleurs turcs pour ses usines de Rüsselheim entre Mayence et Francfort entre 1961 et 1973, suite à l’accord signé entre Bonn et Ankara, des travailleurs qu’on appelait des « Gastarbeiter » (travailleurs invités) et par ailleurs dans les dernières années la marque Opel est l’une des mieux installées en Turquie.
Chez Castorf, rien n’est jamais laissé au hasard les symboles inspirés ou détournés du pouvoir, mais aussi du capitalisme/libéralisme sont toujours parlants, notamment dans une œuvre où l’enjeu de pouvoir est essentiel, où le pouvoir totalitaire, même éloigné, est pesant, et où tous les personnages, pour des raisons privées ou politiques, intriguent. Il y a un langage intertextuel qui irrigue ses mises en scène et qui est dénonciation plus ou moins ironique de notre monde complètement soumis à la publicité, aux marques et à la mode, un monde de divertissement qui oublie ce qu’il est : Osmin porte en entrant en scène un superbe costume (de la costumière-magicienne Adriana Braga-Peretzki) avec un bel imprimé de tissu Vuitton. Acomat est habillé Gucci, Roxane porte Chanel, et tous boivent du Coca. Tous les costumes ont cet aspect « paillette » un peu oriental, surchargés de décorations ou de broderies. Même lorsqu’elles ne sont pas affichées (comme le Bourbon Wild Turkey cité plus haut) les marques sont présentes (exemple, la bouteille de 50cl d’Aalborg Aquavit que s’enfilent Osmin et Acomat dans la cuisine aménagée derrière le gigantesque portrait figurant Amurat.
Castorf fait sans cesse des allers et retours entre scène représentée et acteurs en représentation, monde du spectateur et contexte du moment. Très souvent les acteurs passent de la représentation « à la vie » en interpellant leurs collègues par leur prénom réel (« Jeanne ! » par exemple) parce que si Racine est représenté, Artaud est lu dans ses aspects théoriques ou biographiques, parlant du théâtre comme objet, et l’acteur devient alors extérieur à Racine et diseur d’un texte non DE théâtre, mais SUR le théâtre, qu’ainsi on intègre ou on distancie.
On est dans la trame ou aux bords de la trame, on est dedans et dehors, on joue et l’on regarde jouer. La cuisine dissimulée derrière le portrait du Sultan est utilisée quelquefois même comme si elle était coulisse, où les personnages se reposent, entendent le texte en distanciant ou en s’amusant, comme lorsqu’Osmin et Acomat, hors scène, lisent les journaux en fumant une cigarette, un journal titrant sur Macron, le nouveau président, l’autre sur Chirac « tellement français », qu’ils triturent, l’un en brûlant les yeux du portrait macronien, rappelant ces yeux lumineux du Sultan qu’on voit sur scène, l’autre en faisant du portrait de Chirac un origami-masque, et ils en rient, comme s’ils se riaient de ces rois du pouvoir devenus subitement roitelets, et objets de dérision.

La question du pouvoir
Car la question du pouvoir est partout, à vue, écrasante comme le portrait du sultan, et dans les petits détails, comme ces journaux dont les titres évoquent les grenouillages dans la boue politique (les Balkany), comme ces poupées russes désenchâssées de la plus grosse à la minuscule, de la première de cordée à celle qui n’est rien, pour paraphraser une des idioties entendues dans une auguste bouche. Comme la demi-couronne inversée d’un Bajazet dépouillé, débarrassé de ses oripeaux de cour et à demi-nu, comme une sorte de demi-roi à la Ionesco, à la fin de l’œuvre comme si Bajazet n’était plus que corps fragile et déclassé. Comme ces costumes de Roxane, notamment en première partie (elle change sept ou huit fois de costume pendant la représentation) : elle commence en combinaison de latex, comme un objet érotique, comme une domina d’une relation SM, comme une pute de luxe et peu à peu avec un long intermède où elle est nue, elle enfile des costumes qui de plus en plus lui donnent un statut de pouvoir, jusqu’à une large robe rouge, une sorte de princesse de conte de fées à la large perruque (elle change de coiffure tout aussi souvent). Comme si le costume mimait l’ascension progressive au pouvoir en représentation. Et de fait à la fin de la première partie, Roxane est triomphante, elle va épouser Bajazet, et sans doute s’en servir aussi pour rester au pouvoir. Et les costumes d’Atalide font le parcours inverse, depuis sa première apparition en robe imposante, jusqu’à être de plus en plus déshabillée comme si elle devenait peu à peu jouet et poupée Barbie.
Être et apparence : du simple au complexe
Mais par un jeu de formes, Castorf impose au spectateur des images apparemment simples : le décor apparaît simplissime, répétons-le : un plateau nu, un portrait de sultan, une tente bleue, une cage mobile et des costumes dans des penderies de costumes à vues à jardin, et des caisses de transport de décor (ou de costumes) à cour, comme si ce théâtre était de passage. Et de fait, le spectacle est on tour, pas installé, comme ces oiseaux de passage portraitisés dans la cuisine conçue par Denić.
De plus, nous sommes chez Racine, et non chez Molière ou ailleurs : Castorf en tient compte, faisant de la scène LE lieu unique et fixe, qu’un décor sur tournette démultiplierait, allant contre la règle de la tragédie classique de l’unité de lieu. Car Castorf, au lieu de disperser cherche à concentrer, à ralentir les rythmes, à créer une atmosphère lourde et malaisée qui peut aussi déranger le spectateur voire changer des habitudes qu’on a d’un théâtre de l’excès et de l’échevelé. Racine est avant tout un auteur du malaise, et il s’agit de le transmettre sur scène.
Il s’agit aussi de mettre le spectateur en situation inconfortable, tout en respectant de longues parties du texte racinien, avec des alexandrins parfaitement dits, mais sans la musique lancinante et ennuyeuse qu’on ressent quelquefois dans la tragédie. Si Racine est l’écrivain du malaise, Bajazet est une de ses pièces les plus noires, où tous cherchent à sauver Bajazet de la mort promise par Amurat, personnage absent mais toujours présent, chacun cherche à le sauver pour de bonnes ou de mauvaises raisons, où intérêts privés et intérêts politiques se mêlent.
Simple en apparence que ce décor apparemment épuré, tel qu’il apparaît à la vue du spectateur, et des détails frappent : nous découvrons la tente (un objet cher à Castorf depuis les décors de Bert Neumann), qui n’est pas une tente, mais une tête de burqa géante, répondant à la tête géante du sultan : une burqa figurant le sérail, fermé aux yeux profanes, que nous découvrons par la vidéo, avec un moucharabieh permettant de distinguer vaguement l’intérieur et ses deux lustres visibles qui ressemblent à deux yeux, l’espace de Roxane, caché aux spectateurs comme le sérail, espace oriental avec coussins, poufs, narguilé, pipe à opium
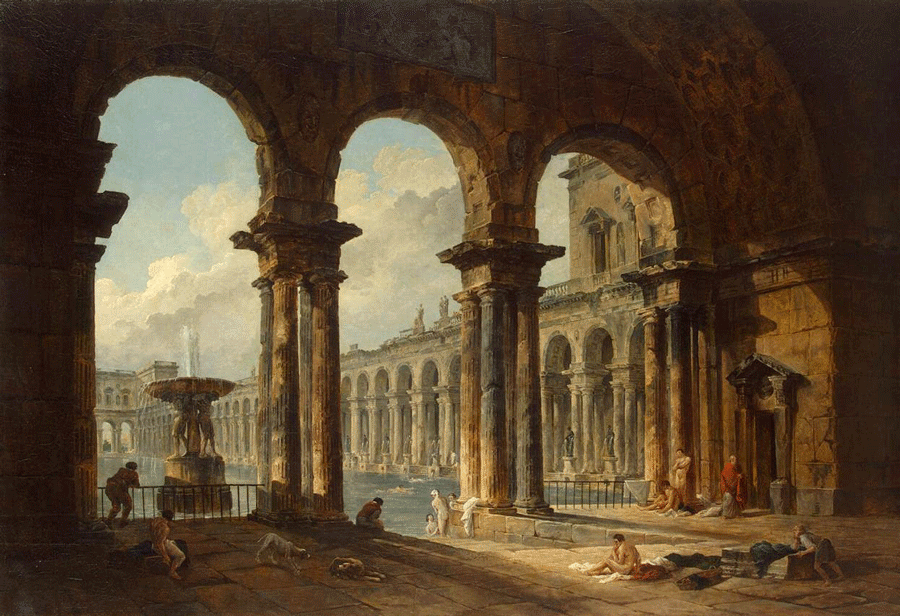
et horizon ouvert sur des arcades et une colonnade, reproduction d’un tableau de genre d’Hubert Robert, Ruines antiques utilisées comme bains (1798) ((au Musée de l’Ermitage de Saint Petersbourg)) comme si la tente se prolongeait sur l’extérieur par un bain privé, alors que les coussins internes font penser, quand Jeanne Balibar est allongée sur fond de bains d’Hubert Robert, à La Grande Odalisque d’Ingres. Espace privé luxuriant et espace public scénique austère, que pourrait illustrer le tire du fameux film de Jancso : Vices privés vertus publiques, du moins au début de la pièce, qui va peu à peu se déglinguer quand le privé envahit tout.
Et lorsque l’on regarde ce décor de face, on voit deux têtes géantes, avec deux yeux lumineux ; ceux cachés d’une Sultane mystérieuse, et un portrait géant d’un Sultan qui se retourne avec des yeux lumineux et inquisiteurs, personnage invisible et partout présent, qui détermine tous les mouvements des personnages. En deux masses gigantesques : toute la pièce est embrassée.

Une tragédie-turquerie allégorie des intrigues de la cour de France
En choisissant ce portrait, peint par Veronese, Castorf et Denić montrent en même temps une Turquie vue par la peinture occidentale, comme le Bajazet de Racine est une turquerie vue par l’occident. Et l’on sait depuis Mon nom est rouge, le roman d’Ohran Pamuk, que la question des portraits à l’occidentale fut en débat dans l’Empire ottoman, à cette période, car elle s’opposait à la tradition de la peinture ottomane, sensée représentée le monde vu par Dieu, de loin, et surtout pas individualisé.
Cette question du regard sur la Turquie se retrouve dans le jeu de mots sur Wild Turkey de la publicité du Bourbon et évidemment ne peut que nous renvoyer à la Turquie d’aujourd’hui, centre de débats très actuels que la vie politique internationale. De même le néon Babylon 0–24, (qui rappelle le « Open 24hours » du décor de Don Juan) comme l’entrée d’une boite de nuit, avec sa flèche vers la tête du Sultan, et en arrière-plan tout ce que peut évoquer Babylone, notamment à la Renaissance, Babylone ville de l’antéchrist, Babylone la Grande Prostituée (voir la très célèbre gravure de Dürer à la fin du XVe – on fait le lien avec les débuts de Roxane…). Une Babylone menaçante évidemment 24h/24.

Tout s’enchâsse donc comme ces poupées russes vues dans l’arrière cuisine : Babylone lointaine, mythique et effrayante, lieu de la perdition et de la perte, le portrait de Veronese, dans le réel celui du Sultan Bajazet 1er, qui n’est pas celui dont il est question sur le théâtre chez Racine. Ce portrait est dont allégorique, autrement dit, Amurat prend les traits d’un Bajazet qui n’est pas son frère Bajazet : jeu de piste typique d’un Castorf, mais jeu baroque aussi d’une course à l’apparence qui n’en est pas une.
Et derrière le portrait : une cuisine, avec tous les emblèmes de la cuisine, tous ses possibles. La cuisine, c’est le lieu caché de la fabrication des festins, des repas, c’est la coulisse d’un monde social en représentation, ce peut donc être le lieu des symboles : le miroir, pour être d’un côté ou de l’autre, le lieu du passage derrière le miroir, comme théâtre et coulisse, lieu du passage de tous ces oiseaux dont Denić a alimenté la décoration, ce lieu des couteaux, (de cuisine), avec lesquels on va métaphoriquement sacrifier des légumes, de la viande sanguinolente, mais aussi avec lesquels on peut aussi assassiner.
Mais aussi le lieu du repos de l’acteur, ce lieu privé où l’on devrait se cacher du public, où les acteurs peuvent être (ou jouer) eux-mêmes, ou quelquefois leurs personnages dans leur désespoir exacerbé que la fausse bienséance racinienne empêche de voir sur le théâtre. Jeux de mise en abyme. Un lieu privé-public, un lieu de folie cruelle, où les légumes sont massacrés, où Bajazet-Artaud subit un électrochoc, comme Artaud jadis, qui est aussi quelque part une gégène, mais aussi où les personnages fument à en perdre les poumons, où Roxane jetant du sel à terre cherche dans le sel son avenir ((L’alomancie, une très antique science divinatoire)), comme sa lointaine cousine Phèdre, une autre mal aimée cherchait à conjurer le sort dans les entrailles des victimes sacrificielles :
De victimes moi-même à toute heure entourée,
Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée.
Quand Racine publie Bajazet en 1672, il s’appuie sur les aventures du terrible Mourad IV (Amurat dans la pièce), conquérant de Bagdad (Babylone dans la pièce) en 1638, qui en profite pour faire tuer son frère Bajazet dans la plus pure tradition ottomane. La connaissance des intrigues du sérail de la cour ottomane fait immédiatement penser à celles de la cour de France, devenue depuis la prise de pouvoir par Louis XIV en 1661, un lieu d’intrigues où se mêlent les intrigues de cœur dont le souverain n’est pas avare et les intrigues de cour pour rechercher les grands emplois. Ainsi cette turquerie tragique est-elle déjà à sa création à lire entre les lignes à une époque où Louis XIV construit sa cour et où Racine lui-même, ambitieux, méchant (« je ne fais pas le bien que j’aime et je fais le mal que je hais » )((vers de Racine inspiré de L’Épître aux Romains, dans Plainte d’un chrétien sur les contrariétés qu’il éprouve au-dedans de lui-même, Cantiques spirituels, 1694)), va commencer une carrière « administrative » puisque deux ans après Bajazet, il deviendra Trésorier Général de France à Moulins et finira historiographe du Roi. Ainsi se croisent la tragédie des ambitions, écrite par un auteur qui lui-même est un « tueur » dirait-on aujourd’hui, et le théâtre de la cruauté…Croiser la tragédie racinienne et le théâtre de la cruauté est évidemment une idée riche de potentiel, tant le théâtre de Racine sous ses dehors faussement bienséants est un théâtre de cruauté. Il n’est que de citer le fameux sortez ! de Roxane à l’acte V qui est littéralement condamnation à mort de Bajazet, mais dont on est privé ici, le propos de Frank Castorf étant autre. Il ne s’agit pas seulement de représenter Bajazet, mais de travailler sur le potentiel du texte racinien et des voisinages, avec Artaud d’abord, avec Pascal et Dostoïevski ensuite.
Castorf ne considère jamais un texte en soi, mais par ce qu’il dit de nous, de notre société, de notre histoire et par les échos qu’il implique. La question des relations entre exigences de pouvoir et exigences privées est une des questions fortes du théâtre et de la littérature, elle est au centre de la plupart des tragédies classiques et les questions de pouvoir croisent sans cesse les questions privées, en les contredisant ou en les confirmant. Et la tragédie classique au travers de la catharsis implique fortement le public par les émotions et l’identification aristotélicienne.

Racine et Artaud : deux théâtres de la cruauté
La réflexion d’Antonin Artaud sur le théâtre de la cruauté est aussi au centre de la volonté d’implication et de participation directe du public au fait théâtral. Et la représentation ici, comme souvent chez Castorf, essaie de placer le spectateur en position inconfortable, ou en position de souffrance, soit par ce qu’il voit, soit par un rythme lancinant, par la longueur de la pièce (ici 4h est plutôt une voie moyenne, par rapport à d’autres productions), par des situations presque insupportables (comme cette simple porte de la cage qu'on jette plusieurs fois à la face d'Atalide…).
Car si le Théâtre et la peste est part du titre du spectacle, le texte même n’est pas cité : le titre était aussi le sous-titre de sa Vie de Galilée ((Berliner Ensemble, saison 2018–2019)): le théâtre servant à révéler les vérités du monde et à les renvoyer à la face du spectateur, la peste s’installant dans un corps qu’elle circonvient, comme le théâtre doit s’installer dans le corps du spectateur, et fait regarder la vie avec d’autres yeux : ce qui est peste dans le théâtre, c’est qu’il est la maladie nécessaire de l’homme. Un metteur en scène comme Castorf croit en la valeur à la fois révélatrice, provocatrice, conflictuelle du théâtre et donc à sa valeur d’agression, comme la peste, révélant nos entrailles, nos pustules, notre pus, nos souffrances, nos contradictions, notre fin.
Et le théâtre racinien est un théâtre de la déchirure, un théâtre où les valeurs s’écrasent contre les désirs et les ravages passionnels, il est théâtre de violence et de cruauté, et s’allie parfaitement aux conceptions d’Artaud : le théâtre est vérité : il suffit d’entendre Adama Diop « quand je joue, c’est là que je me sens exister »…Le jeu exacerbé convient parfaitement aux vers brûlants de Racine, et il est chez Castorf exacerbé par les gros plans, les expressions d’un visage vu en très gros plan, avec ses défauts, ses rides, dans son intimité dérangeante.
Le travail consiste donc non pas à proposer un texte double, mais un texte unique qui est tissu : où se tressent et Racine et Artaud, pour l’essentiel, c’est dire le théâtre et son commentaire, le dedans et le dehors, la vie-théâtre et le regard sur le théâtre-vie, on arrive quelquefois à peine à distinguer le passage de l’un à l’autre tant le phrasé est unifié, tant on a l’impression que les choses procèdent avec le naturel d’un fil cohérent. On entend même la voix d'Artaud au vieux poste de radio de la cuisine (création radiophonique de 1947, Pour en finir avec le jugement de Dieu).
Ce fil coud les textes en une unité profonde et sensible. Ainsi par exemple dans la deuxième partie où tout se rompt (rupture de Roxane avec le rêve d’un Bajazet aimant), intervient un montage des « Lettres de ménage » (extraits de L’ombilic des Limbes et du Pèse-nerfs) qui sont des lettres reproches et de rupture, de ces ruptures qui isolent, qui révèlent les solitudes et les désespérances
On l’a déjà dit, le théâtre de Castorf n’est pas un théâtre de la révérence et du respect de la lettre, c’est d’abord un théâtre de rigueur, mais sans aucune linéarité, un hyperthéâtre comme on dirait l’hypertexte, où ce qu’on voit réfère à plusieurs niveaux, qui va du texte dit au contexte, à l’histoire, mais aussi aux obsessions de Castorf, qui sont toujours là, volontairement parce que son travail est aussi une œuvre globale qui se construit où chaque production est une brique.
Sur Racine
Et pourtant ce Racine-là est sans doute plus linéaire que d’autres spectacles parce que le texte racinien est dit, et bien dit, pas toujours dans l’ordre, pas tout le texte, mais bien dans son essence. Il est explosé aussi, parce qu’il est dit sur scène, ou par les personnages cachés et vus en vidéo, en lui donnant quelquefois une vérité et une proximité presque surprenantes. On sait que la tragédie classique et notamment Racine ont été castrés par la scolastique, par le didascalique, par l’école (hélas), des textes brûlants, impudiques, étouffés par le commentaire à en oublier la violence première.
Le premier monologue d’Atalide la désespérée (fantastique scène devant le miroir dans la cuisine où Claire Sermonne est proprement fabuleuse) assise à la table et s’adressant à Acomat – dans la pièce, elle parle à Zaïre (acte I sc.IV), mais Castorf a supprimé les confidents Zaïre et Zatime pour concentrer sur les personnages agissant – est prodigieux de clarté, d’actualité, de présence (effet de situation ?, effet de vidéo ? effet de décor ? faisant du texte de Racine une sorte de prose cinématographique, où l’alexandrin pourtant bien présent devient puissance d’expression. Ce Racine-là, on ne l’entend pas souvent avec cette vie, cette urgence, ce feu.
Autre effet de linéarité : le mouvement de la pièce de Racine est respecté, avec l’entracte au moment où l’on annonce un messager d’Amurat (Acte III, scène VIII) envoyé par Orcan, l’âme damnée du Sultan, qui affole Roxane (« Quel malheur imprévu vient encor me confondre ?») ((Pardonnez si j'ose vous troubler.
Mais, Madame, un esclave arrive de l'armée ;
Et quoique sur la mer la porte fut fermée,
Les gardes sans tarder l'ont ouverte à genoux
Aux ordres du Sultan qui s'adressent à vous.
mais, ce qui me surprend, c'est Orcan qu'il envoie. Racine, Bajazet, III, 8 v.1096–1101))
Traditionnellement, la fin de l’acte III ménage un suspens qui est ici respecté. Sans doute ce respect des mouvements du texte de Racine surprendra-t-il ceux qui voient en Castorf un casse tout, mais Castorf est d’abord un metteur en scène rigoureux, qui sait comment doit fonctionner un texte : il avait dans son Don Juan au Residenztheater de Munich qu’on a pu voir à Montpellier l’été dernier sans doute porté le texte de Molière dans ses extrêmes (voir notre Compte rendu dans WandererSite). Ici, il laisse le texte de Racine se développer et respirer, sans doute aussi parce que le texte de Racine porte en lui les excès que des siècles de représentations bienséantes ont élimés. Mais, ce qui me surprend, c'est Orcan qu'il envoie.))

D’ailleurs, les actes IV et V ne sont pas exactement travaillés sur le même rythme et dans la même facture que ce qui précède. Il y a là une sorte de précipitation et d’affolement qui envahit la scène et qui fait que tout semble s’accélérer. C’est le moment où Atalide affolée court dehors et inscrit en peinture rouge sur un calicot la parole russe надрыв (Nadr’v) déchirement, lacération, un mot central chez Dostoïevski, une parole à laquelle elle essaie de faire adhérer des passants présents par hasard. On a déjà vu en vidéo (en direct) dès le début Atalide courir à perdre haleine à l’extérieur du théâtre, et ici la parole Dostoïevskienne devient une sorte d’emblème de cette fin où tout est perdu : la lacération, mot partagé sans doute aussi bien par Atalide que par Roxane : Atalide a mis Bajazet dans les bras de Roxane pour le sauver, et Roxane a cru – ou a voulu croire – à cet amour. La découverte d’une lettre de Bajazet où il avoue n’aimer qu’Atalide (Acte IV, sc.V)
« Ni la mort ni vous-même,
Ne me ferez jamais prononcer que je l’aime,
Puisque jamais je n’aimerai que vous… »
révèle à Roxane qu’elle n’est pas aimée, encore déchirure, encore надрыв qui nous vaut l’un des plus grands moments d’actrice de la soirée, où Jeanne Balibar, impériale prononce son monologue
« Avec quelle insolence et quelle cruauté
Ils se jouaient tous deux de ma crédulité… »
très proche du monologue désespéré de Phèdre (Acte IV, scène VI, c’est à dire à peu près au même endroit – Racine sait construire une intrigue -) « tous les jours se levaient clairs et sereins pour eux » et où elle prend sa décision « Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage » qui fait pendant à celle de Roxane :
« Va. Mais nous-même allons, précipitons nos pas.
Qu'il me voie attentive au soin de son trépas, »
Racine et Pascal
On le voit, la question de la déchirure et de la lacération (« надрыв ») est ici déterminante. C’est aussi le moment où par deux fois, la trame s’interrompt.
D’abord pour laisser dire le texte de Pascal sur Le divertissement, que Castorf avait déjà utilisé dans Don Juan.
Il prend ici plusieurs valences (toujours cet hyperthéâtre…) (Pensée 136, ed.Lafuma) : ce texte vaut pour tous les personnages : « …De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n’est pas qu’il y ait en effet du bonheur, ni qu’on s’imagine que la vraie béatitude soit d’avoir l’argent qu’on peut gagner au jeu ou dans le lièvre qu’on court, on n’en voudrait pas s’il était offert. Ce n’est pas cet usage mol et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu’on ne recherche ni les dangers de la guerre ni la peine des emplois, mais c’est le tracas qui nous détourne d’y penser et nous divertit. »
La guerre, c’est le domaine d’Amurat, parti à Babylone pour la conquérir. Il est directement visé par une autre partie du texte « Quelque condition qu’on se figure, où l’on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde. (…) S’il est sans divertissement et qu’on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu’il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent des révoltes qui peuvent arriver et enfin de la mort et des maladies, qui sont inévitables. De sorte que s’il est sans ce qu’on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et qui se divertit. »
Les grands emplois si recherchés, c’est le domaine du Vizir Acomat et son acolyte Osmin.
La recherche de la « conversation » des femmes, c’est le domaine de Bajazet, livré à deux femmes en proie à la passion.
Quant aux spectateurs, ils viennent au théâtre pour se divertir. Personne n’échappe au divertissement pascalien : écouter ce texte est évidemment noter son actualité, sa modernité dans un monde dont le divertissement est devenu principe et but. Bien entendu, Pascal a aujourd’hui à peu près disparu des classes (c’est un auteur chrétien, et donc périlleux). De l’intelligence de notre école.
Castorf est fasciné par Pascal, parce que la puissance subversive de Pascal est déterminante dans la lecture de notre monde. Et cette puissance subversive, elle est évidemment liée à Racine, qui a été élevé à Port Royal, il n’y a pas ni contradiction ni hasard à ce qu’un texte de Pascal soit lié à Racine : un immense livre « Le Dieu caché », de Lucien Goldmann en 1955 avait offert cette grille de lecture du monde du XVIIe et notamment du monde racinien et du monde pascalien ((Lucien Goldmann, Le Dieu caché, Étude sur la vision tragique dans les « Pensées » de Pascal et dans le théâtre de Racine, Gallimard, Collection TEL, première parution en 1955, parution en coll.TEL en 1976)). Voici ce qu’il dit entre autres de Bajazet (Le Dieu caché op .cit p 383–393) « Bajazet est la première pièce de l’essai de vivre et du compromis » au sens où le jeu des intérêts et des passions se croisent : Amurat n’a pas encore assis son pouvoir et va chercher la guerre pour l’asseoir (son divertissement…) et Acomat aussi bien que Roxane peuvent encore espérer l’écarter, Acomat en épousant Atalide, princesse de Sang Royal, et Roxane en épousant Bajazet, frère du Sultan et donc légitime. Quant à Osmin, il reste à l’écart, commente et regarde.
Chacun cherche à satisfaire sa passion du pouvoir ou des êtres.
Et évidemment tout s’écroule, parce qu’Atalide échoue dans toutes ses entreprises, elle est donc le maillon faible, et que Bajazet lui-même « n’agit pas conformément aux exigences de sa propre conscience. Subissant l’influence d’Atalide, il essaie de tromper Roxane et de ruser pour pouvoir vivre. Loin de refuser le monde il accepte le compromis. » (op.cit p 387).
Ce que montre Castorf, c’est d’abord que Bajazet n’est pas désirable, acceptant tous les compromis, il n’a rien d’héroïque, comme le souligne l’interprétation intense de Jean Damien Barbin parce qu’il ne sait pas choisir alors que de son côté Roxane ne trouve son compte nulle part, en perpétuel doute et en perpétuelle inquiétude. On est presque dans l’univers du drame et non de la tragédie (c’est du moins une des idées de Goldmann).
Le надрыв (Nadr’v) dostoïevskien
En brechtien, Castorf refuse le théâtre comme « divertissement », qui est l’apanage du théâtre bourgeois, – et l’appel à Pascal prend ici tout son sens – , et par Artaud, il fait du théâtre un enjeu existentiel en montrant dans cette tragédie du compromis toutes les relativités et tous les serments trahis, au nom d’un individualisme qui défend au premier chef les intérêts de l’individu, sans aucune considération pour un enjeu qui serait historique, dans une tragédie qui s’appuie pourtant sur des faits historiques réels. La question du déchirement, un mot dostoïevskien, pourrait aussi être un mot d’Artaud.
« Avoué ou non avoué, conscient ou inconscient, l’état poétique, un état transcendant de vie, est au fond ce que le public recherche à travers l’amour, le crime, les drogues, la guerre ou l’insurrection.
Le Théâtre de la Cruauté a été créé pour ramener au théâtre la notion d’une vie passionnée et convulsive : et c’est dans ce sens de rigueur violente, de condensation extrême des éléments scéniques qu’il faut entendre la cruauté sur laquelle il veut s’appuyer. » ((Artaud, le Théâtre de la cruauté, Second manifeste.))
On est bien proche de la notion de надрыв de Dostoïevski, que vient appuyer la comptine du Cancrelat, extraite des Démons qui est allégorie de la fin de Bajazet entamée par Atalide et reprise en chœur.
Il était un cancrelat
Cancrelat de souche
Dans un bol il bascula
Un bol plein de mort aux mouches
Plein de place prit le cancrelat
Et les mouches protestèrent
« Notre bol est assez plein comme ça ! »
Crièrent-elles vers Jupiter…
Mais pendant qu’elles criaient,
Nikifore arrive
Vieillard digne et sans apprêt.
La suite est simple, Nikifore jette le bol dans le bac à vaisselle plein des mouches et du cancrelat. Tous meurent, et il ne reste rien, comme dans Bajazet : Atalide se suicide, Roxane est tuée par Orcan et Bajazet est assassiné. Amurat a sa victoire (Nikifore= « porteur de victoire »).
Nous avons essayé de montrer comment la mise en scène de Frank Castorf est d’abord construction intellectuelle, à plusieurs entrées, dans un espace et avec des personnages presque enfermés dans le théâtre (seule Atalide est vue à l’extérieur, mais rejointe dans sa deuxième sortie (en deuxième partie) par les autres, comme dans un affolement général).
Dans ce jeu complexe de tissages d’intérêts, mais aussi de textes tressés entre eux, trouvant chacun sa place, y compris le texte des Démons de Dostoïevski (un texte que Castorf a mis en scène en 2000 à la Volksbühne), plein d’intrigues et de conflits, autour des idéologies ambiantes. Castorf tisse une toile faite de ses auteurs de prédilection, et montre que le texte de Racine, comme tous les grands textes, répond à chaque fois.
Acteurs et personnages
Mais comme toujours chez Castorf, la tension ambiante très lourde (c’est l’apanage du théâtre de Racine…) est tempérée par des éléments ironiques ou humoristiques portés par le texte ou les acteurs. Le texte est gauchi et détend une atmosphère alourdie quand Roxane (Jeanne Balibar, nue au milieu de la scène) allude à Mais ne t’promène donc pas toute nue de Feydeau, ou s’adresse au couple Atalide/Bajazet en allemand. Par les acteurs, et surtout par Acomat (Mounir Margoum) et Osmin (Adama Diop), sorte de couple de compères qui observent et commentent, par des mimiques ou des gestes irrésistibles (dans lesquelles Adama Diop excelle), si Acomat est intéressé personnellement à l’intrigue, solidaire de Roxane pour la conquête du pouvoir, Osmin plus extérieur et moins dangereux, apparemment peut commenter plus librement. Castorf leur fait jouer un peu le rôle de chœur, de commentateurs, dedans et dehors, dont la cuisine semble le quartier général. Ils sont tous les deux irrésistibles dans ce rôle.

La question est plus contrastée pour Bajazet.
Nous avons vu plus haut que le Bajazet de Castorf est loin du héros bon et beau (καλὸς κἀγαθός, comme disent les grecs) et que, conformément à ce qu’en dit Goldmann, Bajazet n’est pas dans le monde de l’absolu, mais dans celui du compromis au bas mot pour sauver sa peau. Jean-Damien Barbin, acteur habitué à Castorf, est ici phénoménal, en Bajazet ravagé, déchiré (c’est le надрыв permanent !), en ruine. Nous sommes à l’opposé de l’héroïsme : ce Bajazet outrageusement maquillé, aux yeux exorbités, d’un âge certain, a peu d’arguments pour « la conversation des femmes » comme dit Pascal. C’est une projection de rêves individuels, où le rêve ne correspond pas du tout à la réalité (souvenons-nous de l’investissement de Phèdre sur Hippolyte, qui n’est pas le héros dont elle rêve) : il y a dans la cristallisation de la passion – c’est bien ce que dit Castorf en proposant ce Bajazet-là- quelque chose d’une construction psychologique qui est totalement en dehors du réel, et d’autant plus en dehors que la passion est violente.
Jean-Damien Barbin, avec cette voix tonitruante, aux inflexions si variées, avec ce regard halluciné, est presque un pharmakos, (φαρμακός), une victime expiatoire des désordres du monde et des autres. Il prend aussi souvent la parole d’Artaud, dont il paraît souvent une sorte de double, psychologiquement atteint, soigné par électrochoc ou traversé par la passion des psychotropes ou des addictions diverses dont celle du tabac n’est pas la moindre. Dans le monde pestiféré à la Artaud ou à la Racine, les individus sont parcourus par leurs addictions, leurs passions, leurs désordres…encore le надрыв dostoïevskien.

Jean-Damien Barbin, apparaissant au départ en costume arabe noir, comme émergeant du désert, au visage caché comme pour se protéger. Un costume protection et presque, déguisement. D’un autre côté, Acomat apparaît au départ de la même manière en scène, couvert et protégé, mais le costume est couleur treillis, presque plus guerrier (c’est le Vizir…). Il y là aussi l’ironie de Castorf pour installer les personnages dans l’Orient fantasmé par le public. Chacun va ensuite se défaire de ses oripeaux abandonnés sur la scène pendant toute la première partie, laissant apparaître pour l’un une sorte de pyjama Gucci (Acomat), et pour l’autre (Bajazet) des costumes de dignitaire turc, mais se terminant en deuxième partie débarrassé de tout costume, en slip, le corps bariolé de rouge, une demi-couronne sur la tête comme laissant voir une sorte de personnage à la Ionesco, comme nous l’avons déjà signalé. Image de solitude, image complètement a‑érotique, un personnage perdu pour le monde et presque errant tel un Roi Lear.
Les personnages sont effectivement très fortement dessinés, dans leur hystérie, dans leurs regards divers ou ironiques, dans leur excitation et ce mouvement est aussi souligné par les changements de costumes incessants, correspondant aux états psychologiques changeants, bouleversés des personnages, dans un signe d’instabilité. Le costume est un signe soit porté par les interprètes, soit pendu aux penderies, comme en attente d’être enfilé par les acteurs selon leur humeur ou comme un paysage métaphorique de tous les possibles, au point que Roxane, au comble du désespoir, chute et entraîne sur elle une penderie et une dizaine de costumes dont elle émerge, comme image du désordre ambiant.
Au service de ce travail, il faut une troupe de comédiens rompus aux méthodes de Castorf (c’est le cas de Jeanne Balibar, Jean-Damien Barbin et Claire Sermonne, ce n’est pas le cas de Mounir Margoum et Adama Diop). Et pourtant, on note d’abord une véritable esprit de troupe, des manières communes d’aborder les textes, d’embrasser l’ironie, de gérer l’espace ; bien sûr, chacun gère son rythme, ses inflexions, ses respirations : d’ailleurs, l’un des textes, extrait du Théâtre de Séraphin, (dernière partie du théâtre et son double d’Artaud, traite des respirations) Masculin, féminin neutre « ventre d’abord, c’est par le ventre qu’il faut que le silence commence, à droite, à gauche, au point des engorgements herniaires… ». L’acteur est lui-même, mais il est aussi le rôle qu’il interprète, et c’est un essentiel va et vient, entre cérémonie du langage racinien, et familiarité – et quelquefois plus- des acteurs entre eux.
Cela aussi provoque quelques rires ou sourires : le spectateur passe de l’un à l’autre comme brinqueballé et certains ne le supportent pas – ils sortent.
Nous l’avons dit, Mounir Margoum (Acomat le Vizir) et Adama Diop forment un couple de théâtre, voulu comme tel, et lu comme tel, avec leurs œillades, leurs échanges, leur complicité en scène, puis leur détente, leur familiarité, leur respiration d’individus lorsqu’ils sont en cuisine. Ils apparaissent presque comme des acteurs de caractère. Mounir Margoum, diction impeccable, est peut-être un peu plus raide même s’il livre le texte sur le Divertissement pascalien d’une manière splendide et qu’il joue le second de Roxane avec juste ce qu’il faut de rouerie d’une manière particulièrement convaincante, il inaugure les regards dans le miroir de la cuisine, en jouant de regards croisés où c’est le reflet qui regarde la caméra, comme si on était dans une sorte de second niveau, que le personnage ne pouvait regarder directement l’objectif.
Adama Diop en Osmin avec ses mimiques, son visage incroyablement expressif et mobile, ses mains magnifiques et si longues, dessinant des volutes comme des mouvements de mime ou de danse dans l’air avec une rare élégance, est assez fascinant. Il affiche à la fois une très grande tenue et une incroyable décontraction un peu distanciée, une réserve et en même temps un œil pétillant de vivacité.
Claire Sermonne est une Atalide expressive, directe, elle a le physique du rôle, de la jeune héroïne qui tente tout, mais avec sa maladresse, ses erreurs, sa gaucherie. On l’a dit, sa scène devant le miroir de l’arrière cuisine, est absolument bouleversante avec ces traces de rouge à lèvre trainant sur la glace, avec ce visage qui se déforme au contact du miroir offrant la vision d’un double presque monstrueux. Elle dit le texte de manière impeccable parce que totalement naturelle, ne rompant pas le rythme de l’alexandrin, mais ne se laissant jamais bercer par les successions répétitives des 12 pieds. Elle réussit le tour de force de montrer une fragilité, mais de laquelle on ne se sent pas solidaire, tellement on la sent maladroite.
Nous avons déjà dit la performance de Jean-Damien Barbin, une sorte de Bajazet repoussoir, et pourtant objet d’aimantation pour les deux femmes : l’acteur qui ne pousse pas à l’identification, comme on pourrait le penser pour les grands héros raciniens. Il est un objet, indécis, excessif, un héros en décrépitude, un anti-héros – c’est déjà le fait chez Racine, mais il est par la volonté de Castorf celui en lequel on ne peut croire. Lui aussi à l’épreuve du miroir de cuisine devient repoussoir, croquant une carotte et éructant son texte devant la glace inondant le miroir de miettes de carottes. Et donc les deux femmes investissent leur passion sur un objet qui ne les mérite pas, ce qui enflamme encore plus par ricochet les phénomènes passionnels idéalisants. Il y a là une volonté sarcastique de Castorf de souligner un investissement passionnel, auquel le spectateur ne peut croire, et inutile, aboutissant sur du vide. Le contraire de l’identification, l’anti-Cid-de-Gérard-Philipe.
Et puis, il y a Jeanne Balibar, d’une beauté de feu, qui multiplie les costumes ou les personnages, jouant de sa voix comme d’un incroyable instrument, aux inflexions multiples, du cri rauque à la voix insinuante et séductrice, avec une diction et un sens de la couleur du mot, de sa musique époustouflant, et passant du somptueux racinien à l’expression de caniveau, sans transition, cassant toute magie, de même l’usage de ce corps maigre et filiforme, mis en valeur par les reprises vidéos d’Andreas Deinert, qui se tord, qu’on voit dans tous les sens et toutes les positions, un corps somptueusement habillé, tout en brillance, ou un corps nu, se lovant dans les coussins de sa tente sur fond d’Hubert Robert, image sublime, ou ce corps vulgaire offrant à voir un séant agressivement offert ; ou ce corps nu et distingué qui époustoufle par sa liberté, par son agressivité même.
C'est aussi la Balibar des grands monologues, la Roxane terrible et sultane, dont les vers sifflent, ou heurtent (avec ces nombreuses allitérations en dentales : « Tout ce que tu ne sens que pour ton Atalide » ou « ne te souvient-il plus de tout ce que je suis »), et la Roxane mal aimée, qui s’ajoute à la liste des mal aimés raciniens, où elle est littéralement bouleversante, toujours reprise en vidéo, en très gros plan, laissant voir un visage marqué, détruit et ravagé par la douleur. L'un des très grands moments est l'entendre siffler Lili Marleen, une chanson née de l'histoire d'un homme amoureux de deux femmes (Bajazet c'est deux femmes amoureuses d'un même homme), puis symbole transversal de la 2ème guerre mondiale, aussi bien du côté allemand que du côté allié, qui marque l'aspiration nostalgique à la paix, trop pacifiste pour être aimée des totalitarismes, si bien qu'elle sera plus tard interdite en RDA, et dans le bloc de l'Est. Et l'interprétation de Marlène Dietrich, allemande notoirement anti-nazie, achève de lui donner son statut. La manière dont elle siffle, dont Roxane s'empare de cet air, circulant sur la scène, est vraiment bouleversante, notamment quand on connaît sa signification. Du grand art, complètement plastique, incroyablement engagé et juste : alors que Roxane a plutôt la réputation d’être une sorte de monstre au féminin, glaciale et décidée, elle en fait une femme fragile et redoutable parce que parce que soumise à sa passion, une chatte sur un toit brûlant. Simplement époustouflant.
Sexe, mensonges et vidéos
Au terme de ce long développement deux certitudes :
- on ne peut aller voir une mise en scène de Castorf sans prendre quelques précautions, et tout d’abord lire ou relire le texte de Racine. Bajazet n’est pas l’œuvre la plus populaire, ni la plus connue. Une histoire de combines, de mensonges, d’enfer pavé de bonnes intentions dont il ne reste à la fin que l’enfer.
- le travail de Castorf est à la fois scénique et intellectuel, c’est une pensée multipolaire aux idées surgissantes, et théâtralement, avec la complicité d’Aleksandar Denić et d’Adriana Braga Peretzki, un univers à la fois rigoureux et délirant, la profondeur racinienne, mais aussi les paillettes, mais aussi tout le reste, des échos littéraires aux échos castorfiens. Denić par l’espace unique qu’il conçoit détermine un style, il y a dans ce travail une stylisation indéniable, qui ne ressemble pas à d’autres Castorf plus luxuriants, due sans doute à la présence du texte Racinien, imposant, inévitable, qui détermine un chemin.
Le spectacle est servi par une distribution exceptionnelle, qui au fur et à mesure trouve sa stabilité, sa voix, sa couleur. Déjà entre le 30 octobre et le 2 novembre quelque chose avait changé, qui semblait encore plus maîtrisé. Contrairement à ce qu’on croit, Castorf laisse grande liberté aux acteurs pour trouver leur style et leur voix à partir de ce qu’ils sont. Cela ne signifie pas loin de là que Castorf ne les dirige pas, mais il trouve les idées de mouvement ou d’intonation en les regardant faire à partir de ce qu’ils sont ; dans le scénario de ce spectacle, ils sont à la fois acteurs de Racine et acteurs d’eux-mêmes, dans un spectacle qui met l’acteur et le théâtre au centre, celui qu’on joue et celui dont on parle ; il n’y a pas dans le théâtre de Castorf un projet bouclé et balisé dès la première répétition : Castorf aime au contraire mettre l’acteur en malaise, en équilibre instable pour le faire aller jusqu’au bout de lui-même, comme il aime mettre le spectateur en malaise jusqu’au conflit : il n’aime rien tant que les huées.
Enfin, dans ce spectacle plus que d’autres, la vidéo a un rôle de moteur, sans laquelle le spectacle s’écroule : le vidéaste fidèle, Andreas Deinert, le vidéaste du Ring de Bayreuth, a dû fonctionner avec une seule caméra, créatrice d’une univers, créatrice de situations originales dignes d’un film avec des cadrages sublimes, avec des prise de vue renversantes des visages : rarement la vidéo n’a été plus justifiée, lisible, déterminante dans la progression de l’action, rarement elle n’a été plus cinématographique, et rarement elle n'a été plus théâtrale.
Enfin, fidèle au texte, l’image finale extraordinaire, en vidéo montre Acomat le Vizir parti sur un bateau. Un hors-bord de style série américaine, au fond duquel son fidèle Osmin prend le soleil, on est presque dans Miami Vice. Tous deux sourient : ils ont tiré leur épingle de ce nœud de vipères.
Il y a du soleil, on file sur l’eau, la liberté est gagnée, sur une musique joyeuse de scène finale d’ailleurs toute la musique signée du fidèle photographe de Castorf, William Minke, lancinante, obsessionnelle donne une cohérence renforcée à l’ensemble de la soirée.
Il y a du soleil, on file sur l’eau, la liberté est gagnée…et Osmin derrière Acomat qui pilote en souriant sort de sa poche intérieure un couteau… de cuisine …
À nous deux, Futur !
Noir.


Article remarquable que je partage en tous points. J'ai vu hier soir la pièce à la MC 93 de Bobigny.
Le vers racinien est revisité et brille par instants fugaces comme un diamant et ce de par l'effet de la mise en scène éblouissante de Franz Castorf et de la superbe diction des comédiens, Jeanne Balibar en premier, mais aussi les autres.
J'aurais aimé avoir un enregistrement seulement audio de ces vers pour pouvoir les réécouter dans toute leur modernité car une extraordinaire musique s'en échappe par moments qu'il faut pouvoir capter…
Je viens de voir ce spectacle à Bobigny,avec une distribution légèrement différente.Un très grand Castorf que Guy Cherki analyse très bien.A titre personnel j’aurais préféré une représentation du Bajazet de Racine intégrale,sans les ajouts des textes d’Artaud qui auraient mérité un traitement à part.Les idées de mise en scène de Castorf sont aussi variées qu’inventives.L’utilisation de la vidéo est devenue très courante mais Castorf en est le maître incontesté.Acteurs fantastiques.Un très grand spectacle.