En 1968, Ingmar Bergman tourne Vargtimmen (en français l'Heure du Loup), un inquiétant huis-clos psychologique dans lequel un peintre célèbre, Johan, vit avec sa femme Alma sur une île isolée. Prisonnier de son imagination maladive, Johan est hanté par ses œuvres, des créatures monstrueuses qui surgissent à "l'heure du loup". "À ce moment, écrit Bergman dans Lanterna Magica (1987), la nuit fait place au jour. C’est l’heure où la plupart des mourants s’éteignent, où notre sommeil est le plus profond, où nos cauchemars sont les plus riches. C’est l’heure où celui qui n’a pu s’endormir affronte sa plus violente angoisse, où les fantômes et les démons sont au plus fort de leur puissance".

La scène la plus troublante du film se déroule lors de la réception organisée par Lindhorst (Cf lien vidéo). Celui-ci demande à ce que l'on éteigne toutes les lumières et dévoile un théâtre miniature. Placé au-dessus des cintres, dans la position du marionnettiste, il observe le visage des spectateurs au moment où apparaît le personnage de Tamino affrontant l'épreuve du silence :
TAMINO
allein
O ewige Nacht ! Wann wirst du schwinden ?
Wann wird das Licht mein Auge finden ?
EINIGE STIMMEN
Bald Jüngling, oder nie ! ((TAMINO
Seul
Quand cette nuit éternelle finira-t-elle ?
Quand la lumière touchera-t-elle mes yeux ?
QUELQUES VOIX
Bientôt, jeune homme, ou jamais !))
Avec des moyens et une vision absolument iconoclastes, Romeo Castellucci choisit d'explorer dans sa Flûte enchantée, ce moment où les démons sont au plus fort de leur puissance. En sous-titrant son travail "Le chant de la mère", il donne une position centrale à la Reine de la Nuit qui exprime une bienveillance ambivalente à l'égard de sa fille Pamina qu'elle cherche à retourner contre son père Sarastro. La mise en scène de Castellucci fait allusion à ses deux célébrissimes interventions qui font entendre derrière une éblouissante pyrotechnie vocale, une inquiétante et menaçante hystérie.
La nuit, le jour
Romeo Castellucci nous parle également de ce moment où le personnage en quête d'amour atteint le cœur des ténèbres, ce point nodal où il exprime ses doutes pour la première fois, loin, très loin de cette ewige Nacht protectrice dans laquelle se réfugient Tristan et Isolde. La disparition de la lumière marque également pour Tamino le début des épreuves que les amoureux devront réussir pour pouvoir être à nouveau réunis. Si le livret de Schikaneder évoque cette séparation comme le préambule nécessaire à l'union du couple, Castellucci nous parle de la séparation de l'enfant avec la mère et des épreuves qui nous font devenir adulte.
Cette Flûte enchantée est conçue comme un spectacle total, un spectacle d'artiste. Il répond en cela à la complexité d'une œuvre à la croisée de nombreuses problématiques, parmi lesquelles un contexte historique (la Révolution vs Ancien Régime), philosophique (l'esprit des Lumières vs l'obscurantisme), politique (Pouvoir despotique vs République et démocratie). Les symboles maçonniques y abondent et rendent parfois plus inaccessibles certaines scènes – paradoxe d'autant plus vif que l'imagerie populaire a fait de cette œuvre l'archétype d'un opéra pour enfants, comme en témoigne la célèbre Flûte enchantée (1975) de Bergman, une version intégrale bien moins intéressante que la magie du court extrait de Vargtimmen. Au-delà de la candeur des princesses et des plumes de l'oiseleur, Castellucci dessine un spectacle redoutablement complexe et intelligent. Dès la scène d'introduction, il nous rappelle qu'on pénètre dans un imaginaire de créateur, un théâtre très intime fait de symboles qui sont autant de signatures visuelles qui parcourent son travail depuis plus de vingt ans. Ce spectacle pourra sembler difficile, voire ésotérique, à ceux qui n'auront pas déjà pratiqué ce que Castellucci a su créer sur les scènes de théâtre parlé.
Pour l'ouverture, pas de brigadier ni de trois coups… c'est une étrange cérémonie où un néon tremblotant descend des cintres, telle une lumière précaire qui lutte déjà contre les ténèbres et installe la symétrie qui va structurer toute la mise en scène. Là où Bergman montrait benoîtement un lever de soleil dans le parc de Drottningholm, Castellucci met en scène un personnage qui, dans un silence absolu, s'y prend à plusieurs fois pour lancer un objet métallique qui finalement brise le néon et fait jaillir le premier accord. Toute la première partie sera construite sur le principe d'une géométrie obsessionnelle, depuis l'origami géant déployé sur le sol jusqu'aux étranges sculptures algorithmiques conçues par Michael Hansmeyer (Cf. lien). Castellucci fait le pari risqué d'abandonner une scénographie linéaire qui ne serait qu'une illustration du livret. On se détache volontairement des péripéties liminaires qui sont autant d'images d'Epinal : le Serpent, l'oiseleur, la flûte etc. Les personnages sont comme aspirés et disséminés comme des éléments graphiques ou des taches de couleurs à la surface d'un tableau. Impossible de vraiment différencier visuellement qui de Papageno ou Tamino prend la parole, la ligne de chant semble indépendante de la géométrie molle et blanche qui a lieu au même moment.
La présence d'un rideau de gaze renforce cet effet de distance entre la salle et la scène – distance qui ajoute à l'effet d'un spectacle-cérémonie qui se déroulerait dans un empyrée vaporeux. C'est un monde littéralement extraterrestre qui se déploie sous nos yeux, un monde de marquises avec robe à corbeille et perruques emplumées. Comme la Flûte regorge par ailleurs d'une géométrie narrative (Jour-Nuit, Trois Dames, Trois Garçons, trois épreuves etc.), Castellucci construit un système de chorégraphies avec plateaux rotatifs et personnages doublés qui forment un vaste tableau vivant d'un blanc uniforme et immaculé. Ce macrocosme et ces jeux de miroir avec symétrie axiale fonctionne comme un art à la fois rhétorique et ésotérique, sur le modèle d'une rencontre entre la philosophie atomiste et l'esprit des Lumières versant maçonnique. L'organisation géométrique invite à penser que la société idéale provient d'un rapport équilibré entre les membres qui la composent.
Les éléments graphiques de Michael Hansmeyer évoquent tour à tour les taches d'encre de Rorschach et la symbolique du sphinx atropos. La première référence fait allusion à la série de planches présentant des taches symétriques formées de façon aléatoire en pliant en deux une feuille blanche maculée d'encre. Ces images étaient utilisées comme un test de personnalité par le psychanalyste Hermann Rorschach qui demandait à ses patients de les commenter librement. Castellucci y fait référence à la toute fin de la Tragedia Endogonidia à Avignon (P.#02 Avignon) (cf. Lien video)

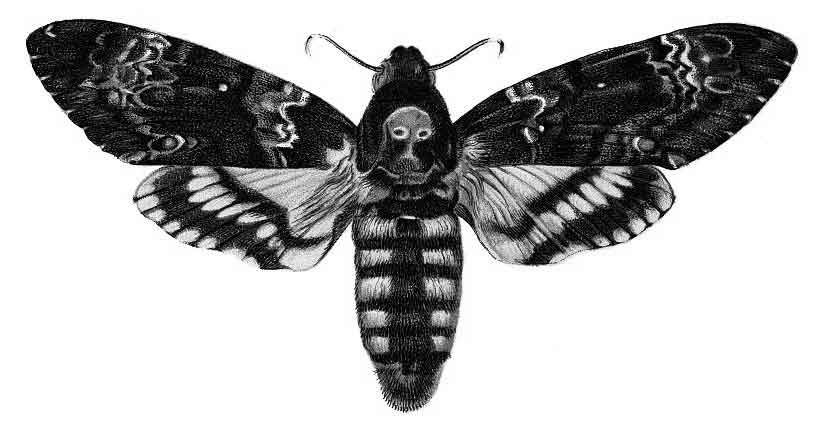
La seconde idée utilisée par Castellucci renvoie à l'acherontia atropos, espèce de papillon qui fait référence à l'Achéron, le fleuve des enfers dans la mythologie grecque. Sur l'abdomen, on peut voir un vague dessin de tête de mort qui évoque le nom d'Atropos, celle qui parmi les trois Parques, est chargée de couper le fil de la vie. Rien d'étonnant à voir au moment où apparaît la Reine de la Nuit avec son collier comme une grappe d'œufs d'insecte et deux larves humaines qui sortent de leur enveloppe pour donner sens à cette figure "maternelle", thématique centrale de ce spectacle. Ce cérémonial fait resurgir à la mémoire des scènes composées par Castellucci pour sa série des Tragedia Endogonidia (2002–2004) notamment l'épisode P.#06 Paris évoquant la Révolution française, ainsi que le Voile noir du pasteur (2011) avec ces danseuses au visage dissimulé par un voile blanc.
Le lait, le sang
Bien que diamétralement différente au premier abord, la seconde partie est construite sur ce même schéma géométrique et polysémique qui forme une sorte d'interlude parlé à l'intérieur de l'opéra. Adieu les visions paradisiaques et extatiques, nous sommes désormais dans les Trois temples de la Sagesse, de la Raison et de la Nature, où vont se dérouler les épreuves imposées par Sarastro. En écho aux Trois Dames qui ouvraient la première partie, on voit arriver successivement sur scène trois femmes ; tour à tour, elles ouvrent leur corsage et installent un dispositif relié à un tire-lait dont le bruit mécanique et lancinant plonge immédiatement une partie du public entre perplexité et effroi. Qui connaît son Castellucci appréciera la référence récurrente à la thématique de la machine et de l'humain, cet élément qui permet de transformer une fonction mécanique en une fonction dramaturgique. C'est ici la présence des Dieux dans le bras articulé d'Oreste commettant le matricide ou bien le lecteur-enregistreur qui descend des cintres dans Moses und Aron, ou bien encore le gigantesque ballet-machinerie dans le Sacre du Printemps. Le tire-lait renvoie artificiellement à la figure maternelle mais le lait qui est recueilli par la Reine de la Nuit sera répandu sur le sol – ultime image et ultime illustration d'une crise ou d'un refus de maternité. Le tube qui recueille le lait est identique au néon de la première scène ; il rappelle également le tube qui répandait sur le sol le liquide noir du péché dans Moses und Aron, ou bien le grand récipient rempli de lait dans la Tragedia endogonidia BN.#05 Bergen. Lorsque la Reine de la Nuit revient chanter Der Hölle Rache… elle asperge de lait une figurante gisant au sol, recouverte de faux sang :
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen ;
Tod und Verzweiflung flammet um mich her !
Fühlt nicht durch dich Sarastro Todesschmerzen,
So bist du meine Tochter nimmermehr ! ((Le désespoir s'agite dans mon âme.
Mort et vengeance (bis) embrasent mon cœur !
Si de ta main, Sarastro ne succombe,
Je te renie, ô ma fille, à jamais.
Je te renie et te maudis,
O ma fille, à jamais ! ))

La lumière, le feu
Dans cette seconde partie, les acteurs portent une combinaison rappelant vaguement la tenue de prisonniers dans des établissements pénitentiaires. Tous portent des perruques blondes qui ne permettent pas de les distinguer au premier abord (ce qui était déjà le cas avec les tenues de l'acte I). L'opposition entre la Nuit et le Jour se retrouve ici dans la présence de deux groupes d'acteurs ayant subi, comme Tamino et Pamina, des épreuves qui ont laissé des traces dans leur chair. Les femmes ont perdu la vue, définitivement ou en partie, tandis que les hommes ont été victimes de graves brûlures sur une partie ou la totalité de leur corps. Ces hommes et ses femmes viennent, chacun à leur tour, témoigner de leur histoire personnelle. Ils font le récit d'une expérience de vie, cette irruption dramatique de la nuit et du feu – les deux pôles d'intensité d'une lumière devenue blessure.
Claudia Castellucci (la sœur de Romeo), a écrit les dialogues de ces scènes entre performance et pur théâtre. Cette parenthèse vient s'insérer au cœur de l'opéra comme une irruption du réel dans le récit. Les acteurs ne jouent pas simplement un rôle, ils sont les personnages réels qui viennent témoigner du drame et des épreuves physiques qu'ils ont subis. On retrouve ici les principes qui ont présidé à la création par Romeo et Claudia Castellucci de la Socìetas Raffaello Sanzio, projet de théâtre radical inspiré par le concept du "théâtre de la cruauté" d'Antonin Artaud, associé à la volonté d'associer le théâtre à la dimension d'un art plastique par le biais de la performance. De nombreuses pièces ont ainsi mis en scène la question du corps comme matière sémantique et artistique – quitte à présenter sur scène des acteurs souffrant d'un handicap, pour donner un sens à l'action théâtrale. Ce sera le cas en 1995 avec l'Orestea (una commedia organica ?) où le corps tantôt difforme, tantôt amputé, exprime au plus près la brûlure du texte d'Eschyle. Deux ans plus tard, c'est par la voix déformée d'un acteur ayant subi une trachéotomie que s'exprime le personnage central du Giulio Cesare d'après William Shakespeare. Plus récemment, Castellucci crée pour Art Basel en Suisse Le Metope del Partenone, qui met en scène des scènes qui reconstituent avec force trucage et faux sang, des accidents de personne qui finissent par décéder malgré l'intervention des secours. À l'opéra, Castellucci aura recours à deux reprises à la présence du corps meurtri ; la première fois dans le fantastique Orphée et Eurydice avec cette femme atteinte du locked-in syndrome et prisonnière dans son propre corps, et la seconde avec les tétraplégiques dans l'épisode de la piscine probatoire dans Moses und Aron de Schönberg.
Les personnages de Schikaneder dialoguent ici avec des témoins d'une réalité traumatique qui fait de l'épisode des épreuves de Tamino et Pamina, un moment étrange où le réel se conjugue avec la poésie et le théâtre. Les personnages subissent des épreuves qui sont à la fois un rite d'initiation et le moment où l'on bascule dans un imaginaire peuplé de fantômes et d'images. Castellucci utilise cette errance onirique du regard qui se saisit d'un geste ou d'une posture, et fait de ce détail très simple, le point de départ vers une référence plus élaborée. Il y a une certaine naïveté et une candeur manifeste dans cette façon très lyrique qu'ont les acteurs de lever le bras pour déclamer leur texte. La diction s'accorde avec le hiératisme et la géométrie des références néoclassiques, elles-mêmes expansion naturelle des symboles maçonniques (et kabbalistiques) contenus dans le livret de la Flûte enchantée.
Un tableau ne raconte rien ; à la différence du récit, il ne se déploie pas chronologiquement mais se donne à voir dans son intégralité. Seule la circulation du regard l'anime et lui donne un sens et une existence. Le génie de Romeo Castellucci est de transformer un art du temps (la musique), en art de l'espace (la peinture). Il choisit le monologue de Sarastro dans la scène 13 pour développer cette série de tableaux muets. C'est le moment où le père s'adresse à la fille pour la rassurer et lui dire qu'il n'est pas animé par l'esprit de vengeance (on vient d'entendre juste avant la fureur de la Reine de la nuit).
In diesen heil'gen Hallen
Kennt man die Rache nicht.
Und ist ein Mensch gefallen,
Führt Liebe ihn zur Pflicht.
Dann wandelt er an Freundes Hand
Vergnügt und froh ins bess're Land.
In diesen heil'gen Mauern,
Wo Mensch den Menschen liebt,
Kann kein Verräter lauern,
Weil man dem Feind vergibt.
Wen solche Lehren nicht erfreun,
Verdient nicht ein Mensch zu sein. ((Dans ce séjour tranquille,
Rien n'agite le cœur,
Et c'est un pur asile,
De paix et de candeur.
Ici, par l'amour fraternel,
L'homme tombe expie ses torts,
Soutenu par nos bras amis,
Chez nous il achève ses jours.
Ici, pour tous les hommes,
Aimants et fraternels,
Au lieu de la rancune,
Nous voulons le pardon.
Et qui méprise notre loi
Est perdu pour l'Humanité))
On débute par le célèbre Radeau de la Méduse de Géricault, cet espoir et ce "pur asile" que les amants espèrent trouver à l'issue de leurs tourments.

 Vient ensuite la référence à la vengeance de la Reine de la nuit qui fournit à sa fille Pamina l'épée avec laquelle elle devra tuer son père (Serment des Horaces de Louis David),
Vient ensuite la référence à la vengeance de la Reine de la nuit qui fournit à sa fille Pamina l'épée avec laquelle elle devra tuer son père (Serment des Horaces de Louis David),


puis l'allusion à la trahison de Monostatos dans le Meurtre de Viriate de Jose de Madrazo). Le chef rebelle Viriate est ici assassiné par deux fêlons qui seront eux-mêmes exécutés par les romains alors même qu'ils espéraient toucher une rançon ("Roma traditoribus non premia" – Rome ne paie pas les traîtres).

 Avec El tres de Mayo de Goya, la boucle se referme sur le thème de la lutte contre l'injustice et les fausses valeurs.
Avec El tres de Mayo de Goya, la boucle se referme sur le thème de la lutte contre l'injustice et les fausses valeurs.


Il est intéressant de voir également comment Castellucci réserve un traitement particulier au personnage de Sarastro qui subit lui-même un rituel d'initiation en compagnie des grands brûlés. Sur le tablier (très maçonnique), on lit les trois lettres Aleph Vav Resh qui signifient en hébreu biblique "lumière".

Le livret parle de la victoire de la lumière sur les ténèbres mais c'est bel et bien la Reine de la nuit, et les femmes, qui remportent la victoire sur Sarastro, comme une révolte contre l'ordre patriarcal établi et un écho au tableau de Goya cité plus haut.

La vie triomphe de la mort, comme en témoigne le bel hommage à la féminité et à l'enfantement dans Four seasons restaurant, au moment où les trois enfants réussissent à éloigner Pamina de la tentation du suicide. (cf. lien vidéo)


Il reviendra donc en dernier recours au spectateur de tirer des "conclusions" de ce qu'il voit. Comme Perceval perdu dans la contemplation du Graal qui défile devant ses yeux, on doit accepter que ce spectacle sème en nous des éléments de réflexion et de fascination. Au-delà d'une efflorescence de citations et d'auto-citations qui peuvent donner le vertige, le spectacle émerveille par la façon dont Castellucci organise des références qui fonctionnaient ailleurs isolément, en un tout organique, à la fois pluriel mais en définitive extrêmement cohérent et d'une intelligence remarquable. Sans doute le plus exceptionnel travail de mise en scène d'opéra de Castellucci.
Ce compte-rendu ne pourrait pas être complet sans évoquer un plateau vocal qu'on nous pardonnera de trouver bien mince en comparaison avec le fascinant écrin de la scénographie. De l'équipe présente à Bruxelles pour la création, il ne reste que la Pamina de Ilse Eerens, voix claire et charnue dont les interventions laissent une meilleure impression que le Tamino de Tuomas Katajala. Le ténor finlandais n'a guère à offrir qu'une ligne désordonnée et excessivement vibrée tandis que Tijl Faveyts ne force pas son talent dans son double emploi de Sprecher et de Sarastro. Klemens Sander est un honnête Papageno dont la prestation éclipse par le jeu et la tenue, l'intervention éclair de Pagagena (Tatiana Probst), personnage bien peu mis en valeur par la mise en scène qui la prive d'un récitatif qui aurait pu lui permettre de d'exister au-delà du duo… Le Monostatos de Mark Omvlee n'a pas vraiment le mordant requis. Les trois Dames de Sheva Tehoval, Caroline Meng et Ambroisine Bré sont bien dépareillées et pas toujours en place… tout comme la Reine de la nuit très anguleuse et courte d'impact d'Aleksandra Olczyk. L'orchestre de l’Opéra de Lille subit une direction erratique de Eivind Gullberg Jensen, qui multiplie en ce soir de première, précipitations et rallentando, sans réussir à convaincre au-delà d'une vision brouillonne et bien déséquilibrée.
