
On a quelquefois coutume de fustiger le théâtre de répertoire. Il permet pourtant à des spectacles marquants de survivre longtemps, de permettre à des spectateurs de le voir au le revoir, et c’est un système qui garantit une éducation du public que le système de stagione ne permettra jamais. C’est ainsi que cette production de 2009/2010 a été reprise pour une série de représentations avec une nouvelle distribution dirigée cette fois par le GMD actuel, Sylvain Cambreling.
Et comme souvent, les mises en scène fortes ne vieillissent pas.
Parsifal n’est pas l’une des œuvres les plus aisées à mettre en scène, on a pu le vérifier quelques jours auparavant à Baden-Baden. Les approches vraiment convaincantes se comptent sur les doigts, dans les dernières années sans nul doute, Tcherniakov à Berlin, Castellucci à Bruxelles et Bologne, Stefan Herheim à Bayreuth, Warlikowski à Paris (qu’un imbécile a fait détruire), plus loin Götz Friedrich encore à Bayreuth.
Le choix de Calixto Bieito est de poser cette histoire hors du temps (le contraire d’un Herheim qui en faisait un concentré d’histoire de l’Allemagne) ou plutôt dans un futur d’après l’histoire, quand une catastrophe a frappé les populations et que survivent de rares communautés à la recherche d’un but. Il n’est pas le premier à envisager Parsifal comme une histoire de day after. Rolf Liebermann au début des années 80 avait dans l’unique mise en scène de sa carrière à Genève, à l’invitation d’Hugues Gall, l’un ses deux fils spirituels (l’autre étant Gérard Mortier) proposé aussi un lendemain de guerre atomique comme cadre initial.
The day after
Calixto Bieito interroge sans cesse les dérives de la civilisation, les excès du pouvoir, les faits et méfaits des religions et les violences que tout cela fait naître. Dans un monde d’après la catastrophe où les hommes errent à la recherche d’un futur, ils se constituent en groupes solidaires, ou en sectes, comme celle du Graal.
La position de Wagner elle-même ne manque pas d’ambiguïté, cherchant à la fois les racines du mystère chrétien, avec une fascination qu’il ne cachait pas pour l’orient, et recréant à usage interne les conditions d’un mythe personnel dans sa propre cathédrale le Festspielhaus de Bayreuth : peut-on croire sérieusement à cette religion-là ? Bieito part justement des dérives du religieux ou de l’usage qu’on en fait : la manipulation ne commence-t-elle pas à Wagner lui-même ?

Déjà dans le livret la communauté du Graal au lever de rideau est en déshérence, à la recherche d’une issue devant la situation d’un roi frappé parce qu’il a aimé, et qui n’en finit pas d’expier, emportant sa communauté à la ruine qu’on voit au troisième acte. Nous sommes donc déjà dans un monde frappé par une catastrophe.
Face à ce monde, le monde magique de Klingsor, avec son jardin enchanté et ses filles fleurs qui sont autant de fleurs vénéneuses attirant les chevaliers perdus (ou attirés), à l’instar des jardins enchantés des magiciennes des opéras baroques : une forme issue des épopées médiévales ou de l’Arioste et du Tasse si prisées au XVIIIe. Aucun metteur en scène à ma connaissance n’a exploité Parsifal comme une sorte de légende dorée, successeur de Roland et Ruggiero, chevalier mettant fin au royaume magique d’un Klingsor successeur d’Alcina.
Deux mondes parallèles s’affrontent dans le livret, un monde en danger (Le Graal) et un monde qui se nourrit des faiblesses de l’autre (Klingsor), mais pour Bieito, c’est le même monde qui s’entre dévore, secte contre secte, dans le même décor de désolation, une bretelle d’autoroute en ruines (décor de Susanne Gschwender), et un espace plein des restes calcinés ou abandonnés de notre propre civilisation (panneaux routiers déclassés ou réutilisés, caddy, jouets abandonnés etc…) sur lequel errent des populations en proie à la violence, au vol et au viol (de Kundry par exemple au premier acte). Un monde post-apocalyptique inspiré par le roman The Road (2006) de Cormac Mc Carthy .
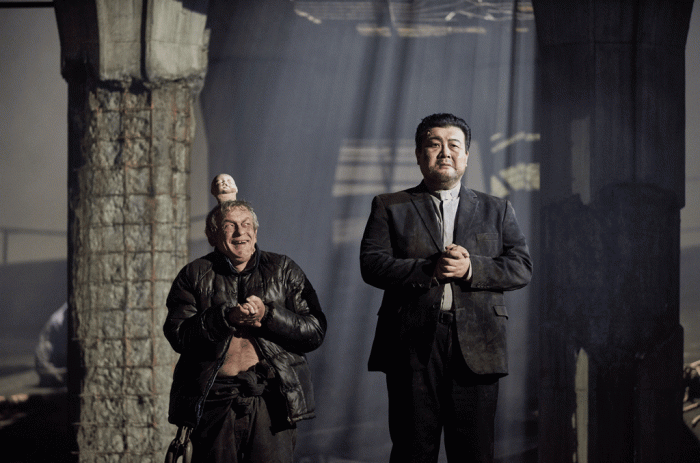
Naviguer au milieu des peurs
Ce Parsifal nous présente donc un monde uniformément noir, angoissant, sans vraie rémission. Gurnemanz par exemple n’a rien de la vision traditionnelle du compagnon d’Amfortas, figure paternelle et bienveillante. C’est un politicard. Bieito pense que c’est le personnage le plus négatif : c’est celui qui raconte, et souvent ceux qui racontent les histoires sont plus importants et laissent plus de traces que ceux qui les vivent. C’est donc celui qui arrange l’histoire pour la plier à ce qu’il veut.

Amfortas quant à lui est l’une des victimes de la situation, c’est un personnage las d’être instrumentalisé : il apparaît sur le pont, au bord du vide, au propre et au figuré. Il ne croit plus en rien, et surtout pas à un rituel creux. Le Graal n’est pas un objet, c’est un sac plein de symboles religieux qui tombe d’une grue, et qui s’ouvre dans lesquels se servent les fidèles à qui Amfortas donne en quelques sortes les grigris qu’ils attendent, à chacun son Graal à chacun son jouet. Lui reste seul en hauteur…abandonné, victime des exigences du père (un Titurel statufié, présent et monumental en scène, qui manie la populace le grand Matthias Hölle une sorte de Moloch qui exige son rite et ses victimes) et victime des manœuvres de Gurnemanz, mais surtout convaincu depuis qu’il a fait l’expérience de l’amour de ne plus reconnaître la valeur du rituel. Selon Bieito, le rituel est vide parce qu’il n’est que rituel, et qu’il n’est plus alimenté par l’amour et le respect humain, dans un monde sans amour ni respect pour l’autre.

Autre instrument aux mains de Gurnemanz, Parsifal une sorte de soldat perdu qui surgit comme le trouble-fête qui tue le cygne, ici figuré par un enfant victime sacrificielle, offrande, dans une scène terrible qui rajoute encore à la violence ambiante, toujours à fleur de peau, toujours prête à exploser. Nous sommes dans un monde où sans doute se déroulent des sacrifices humains (chez Cormac Mc Carthy, le cannibalisme a ressurgi). C’est Gurnemanz qui pense que peut-être est-ce là le « sauveur » dont on a besoin pour remplacer Amfortas défaillant ; vu ainsi, on est proche de la manipulation des anabaptistes dans Le Prophète de Meyerbeer. Gurnemanz est celui qui fait mouvoir les fils des marionnettes. Et Parsifal est la prochaine sur la liste.

Klingsor : un Mephisto sans Veau d'Or
Klingsor est l’autre, qui instrumentalise Kundry comme d’une certaine manière Gurnemanz l’a instrumentalisée, il utilise la femme (les filles fleurs, martyrisées) comme exclusif objet de convoitise pour l’homme qui passe, un peu ce que Wotan veut faire de Brünnhilde, et dans cette mise en scène, le magicien a perdu sa magie pour revêtir une humanité aussi misérable que celle des autres : même si Kundry lui appartient, elle va offrir à Parsifal un discours autre, plus libre, d’une certaine manière plus humain. Bieito croit en Kundry.

Parsifal va traverser la moitié de l’œuvre étranger à ce qui se passe, une sorte de Kaspar Hauser, dit Bieito, et c’est là le livret de Wagner, y compris les filles fleurs qu’il regarde avec désir et amusement, elles qui sont abîmées par la violence humaine, sorte de viande offerte par Klingsor au désir masculin.

La rencontre avec Kundry, le personnage selon Bieito le plus passionnant et le plus positif de l’œuvre et le baiser d’amour de mère et de femme (l’évocation de la mère est le seul moment au premier acte où Parsifal réagit) qui va faire naître en lui la douleur : l’amour qui provoque la douleur et qui fait la partager (Mit-Leid). En même temps s’installe entre Kundry et Parsifal une sorte de complicité dans une lecture du monde commune. Kundry est ici une figure à la fois maternelle et amicale, plus qu’une figure maléfique, c’est celle qui connaît le passé de Parsifal, qui sait en même temps confusément que la seule relation féminine qu’il ait connue est celle de sa mère, et que cette relation à la mère est presque fondatrice (les mères chez Wagner…). Ce que comprend Parsifal c’est autant la blessure d’Amfortas que l’espoir mis en lui par Gurnemanz. A la fin de l’acte II, il va partir alléger la douleur d’Amfortas ET sauver le monde.

Le monde ne sera pas sauvé
Quand il arrive, au troisième acte, Gurnemanz en fait un héros, il revient d'ailleurs en icône angélique résolutive, vêtue d’une manière outrageusement caricaturale (costumes de Mercè Paloma) chevalier un peu fagoté des opéras baroques évoqués plus haut, figure iconique telle qu’on en voit transformées en statues de bois ou de porcelaine dans les processions du sud de l’Europe, ou même à la manière d’une marionnette sicilienne…(on sait que Wagner séjourna à Palerme en composant Parsifal).
Bieito habille son Parsifal d’une manière si caricaturale qu’on voit immédiatement une sorte de nouvelle supercherie donnée en pâture. D’ailleurs, Parsifal lui-même croit-il en cet Enchantement du vendredi Saint chanté par Gurnemanz : il regarde Kundry et tous deux rient, comme s’ils partageaient quelque chose à deux dans une vraie complicité, et comme s’ils ne croyaient surtout pas dans le rite accompli ou à accomplir. La question du Vendredi Saint, du baptême leur est au fond indifférente : l’essentiel est ailleurs. Comme le dit Bieito dans le programme de salle, « on trouve le Graal en soi-même », pas de rituel, pas de religion qui apporte des catastrophes, seul l’amour vaut pour toutes les religions, et donc tout habillage, tout rite ne peut qu’être vide et creux. Le travail de Bieito, complexe, fascinant par les chemins qu’il ouvre, est plein de doutes sur la valeur humaniste des religions, plutôt pessimiste mais en même temps profondément humain.
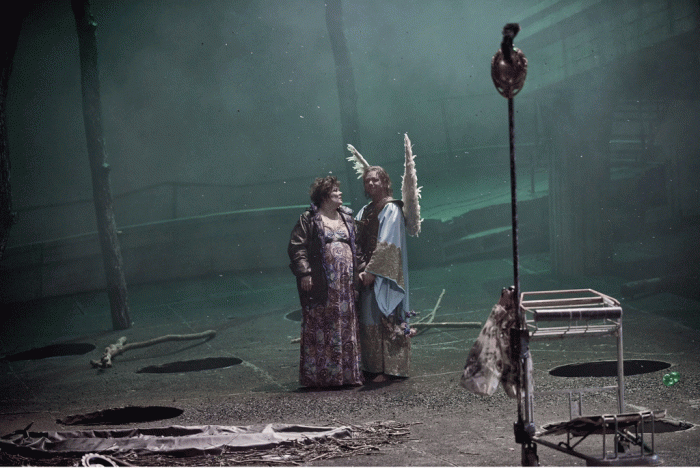
Ce travail d’une très grande profondeur, qui puise ses sources à la fois dans le livret, analysé avec une méticuleuse précision, dans les textes wagnériens, lus avec attention, et dans des sources à la fois habituelles (Schopenhauer) et très contemporaines (Mc Carthy), vaut à lui seul le voyage et mérite la curiosité de tout spectateur wagnérien. Et comme souvent les grandes mises en scènes, celui-ci n’a pas pris une ride.
Très bon orchestre et magnifique choeur
Et la vraie dignité musicale de l’ensemble contribue à faire de la soirée un authentique moment a, avec un chœur exceptionnel, un orchestre qui fait honneur à l’œuvre et qui soutient valeureusement une distribution homogène.
On sait que le chœur de Stuttgart est l’un des grands chœurs d’opéra d’Allemagne, il le démontre encore ce soir par une performance puissante, évidemment renforcée par le volume d’une salle à la capacité moyenne qui lui donne une forte présence. Articulation, diction, modulations, contrastes, et moments impressionnants (troisième acte) ont renforcé l’intensité de la soirée (chef de chœur Christoph Heil).
Sylvain Cambreling inexplicablement fait partie de ces chefs français qui en France sont laissés de côté pour ne pas dire méprisés par une certaine partie du public. Comme on se souvient qu’il en était de même pour Georges Prêtre systématiquement hué lors de ses apparitions à l’opéra dans les années 70, souhaitons que les choses évoluent. Il est le GMD de Stuttgart pour quelques mois encore (En septembre prochain, à l’arrivée de Christoph Schoner, c’est Cornelius Meister qui lui succèdera), et conduit l’orchestre avec une vigueur, une énergie, un sens dramatique soucieux de ce qui se passe sur le plateau. Il n’y a là aucune recherche du beau son pour le beau son, aucune complaisance ; Il travaille en authentique chef de théâtre, avec un souci de cohérence avec une mise en scène tendue d’un bout à l’autre. L’orchestre, lui aussi de bon niveau, le suit sans scories, sans décalages avec le plateau. Il en résulte une vraie cohérence musicale qu’il faut saluer.
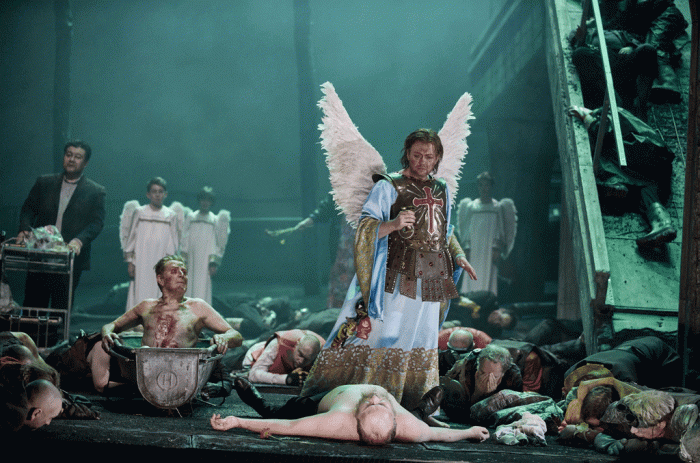
Distribution équilibrée
La distribution faite d’invités et de membres de la troupe est homogène au sens où aucun élément ne se détache vraiment, mais aucun ne dépareille l’ensemble non plus, de sorte que l’on sort globalement satisfait.
Matthias Hölle est Titurel, avec son autorité naturelle et sa stature « historique » : il écuma pendant plus de deux décennies les distributions de Bayreuth dans les grands rôles de basse, on l’a entendu dans Titurel à Berlin dans la mise en scène de Tcherniakov, il est ici avec une voix encore imposante, un personnage voisin (mêmes lunettes noires), exigeant, autoritaire dont on sent la prise sur son fils et sur le reste du groupe, au point qu’au sommet de la désespérance, au troisième acte, il est assassiné.
Intéressant le Klingsor particulièrement présent scéniquement de Tobias Schnabel, un Klingsor pas vraiment magicien, une sorte de Mephisto sans Veau d’Or, il occupe l’espace d’une manière peu commune. Si la voix est moins spectaculaire, car elle pourrait être mieux projetée, la diction et l’expression sont remarquables.
Amfortas est Markus Marquardt, voix puissante et expressive, théâtralement présente, mais avec un jeu un peu superficiel. Le texte n’est pas dit avec la force poétique que d’autres Amfortas possèdent, on est ici au théâtre expressionniste, non aux frontières du monde du Lied.
Gurnemanz, engoncé dans son costume anthracite de clergyman est plus inquiétant, c’est lui qui manœuvre l’ensemble et son personnage est sombre : Attila Jun a cet aspect inquiétant, mais la voix puissante n’est en revanche pas très passionnante : il manque l’expression, il manque les accents, il manque une profondeur. Le texte est dit, mais sans véritable engagement interprétatif. Même si le succès du public est au rendez-vous, la prestation reste indifférente.
Le Parsifal de Daniel Kirch est vocalement correct, plus héroïque que poétique, sans vrai lyrisme. Il y a là aussi un problème de regard sur le texte. Kirch qui est loin d’être un mauvais chanteur reste assez extérieur à ce qui se passe en scène qu’il semble traverser sans prendre sa part, il chante un Parsifal parmi d’autres mais pas ce Parsifal-là, c’est un peu dommage, même si dans l’ensemble il ne démérite pas..
Reste la Kundry de Christiane Libor. Une Kundry attifée, un peu perdue dans un monde d’hommes violents, volontairement loin de séduire, un personnage étrange, sombre, peu attirant, et pourtant particulièrement présente scéniquement. Vocalement, la voix est puissante, mais n’a pas forcément les inflexions voulues au deuxième acte, même si la prestation d’ensemble est honorable. Pour cette mise en scène-là, autant elle est particulièrement présente et juste scéniquement aux premiers et troisièmes actes, autant son deuxième acte ne convainc pas et c’est paradoxal parce que c’est justement au deuxième acte qu’elle chante. L’expression n’a pas l’urgence voulue, et son chant peu coloré. Déception.
Malgré des réserves, l’ensemble reste vraiment d’une grande dignité et on ne laisse aucun regret : une fois de plus, Parsifal a semé ses questions et le spectateur repart à la fois satisfait et méditatif alimentant une réflexion que cette œuvre sans cesse revisitée n’est pas encore prête de clore.

