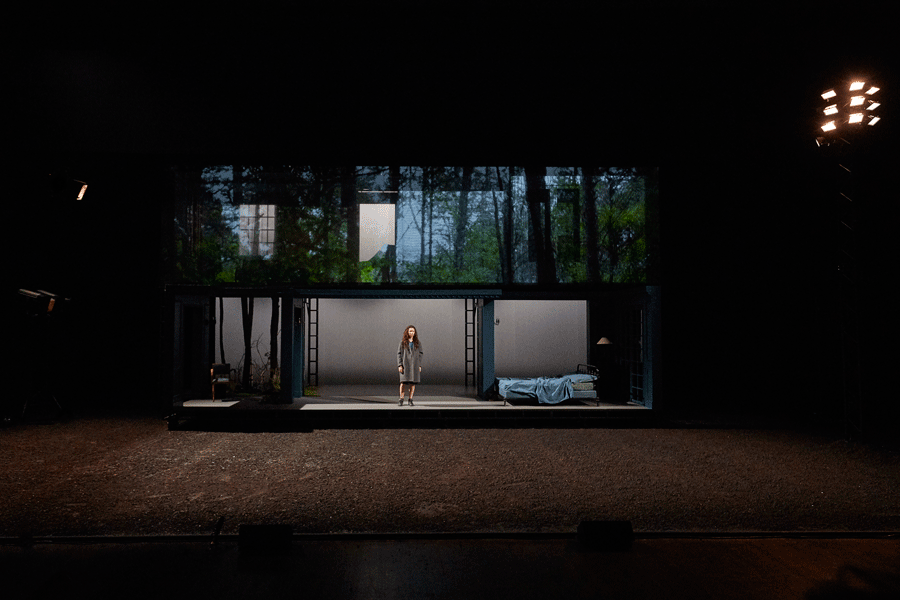
La salle est comble en ce samedi soir et le public de festivaliers paraît assez concentré, rafraîchi par la douce climatisation, pressentant aussi la nécessité de son attention autant en raison de la pièce relevant d’un théâtre symboliste jugé complexe, que pour le travail de la jeune metteure en scène et de ses équipes. « Ouvrez la porte ! » entend-on en off alors que l’obscurité se fait et qu’on découvre un écran massif obstruant le cadre de scène. Un montage en noir et blanc défile alors. Des images fugaces. Comme un flot incontrôlable. Puis, c’est le cut. Et apparaît une forêt. Les arbres se balancent doucement sous la brise tandis que monte le son net du flux de la mer, eau qui vient lécher le rivage et se retire instantanément. Comme pour échapper à toute prise. Le symbole discret d’une puissance élémentaire sans visage. Un mouvement contre lequel il est vain de lutter pour le saisir. Comme une annonce de ce qui va advenir peut-être. « Versez l’eau, versez toute l’eau du déluge ; vous n’en viendrez jamais à bout », dit la voix off.
C’est alors qu’apparaît un homme, un chasseur – il porte un fusil. Golaud – Vincent Dissez d’une élégance sombre – avance dans un bosquet. C’est aujourd’hui et il y a longtemps. Dans un instant hors du temps. Lorsqu’il rencontre la jeune Mélisande jouée par la troublante Alix Riemer, près d’une fontaine. Elle pleure, révèle qu’elle s’est enfuie, qu’elle a perdu la couronne qu’il lui a donnée, tombée au fond de l’eau. Elle se tend, ne veut pas qu’il la touche puis cède peu à peu. Elle le suit et le questionne sur sa destination. « Je ne sais pas… Je suis perdu aussi. » lâche-t-il dans un souffle.
Ainsi s’ouvre la pièce au moment le décor apparaît. Derrière une allée de terre qui la contourne, une maison ouverte, avec un étage. Des arbres nus de leurs feuilles sur le pâle lointain. Un lit double en bas. Un salon à l’étage, gris, feutré, éclairé par la lumière d’un jour artificiel, brouillant tout repère temporel. Le lieu semble abandonné, empreint d’une grande étrangeté. « Un espace à la fois concret et métaphorique » selon le souhait de Julie Duclos qui voulait traduire par ses choix scénographiques « un mystère permanent », mystère dont elle reconnaît que la vidéo par exemple, contribue à l’installer et à chercher par-delà le domaine de ce qui est visible. Ainsi, elle incite le spectateur à se « faire voyant ».

La fable reste assez convenue pourtant et reprend le topos des amants maudits. Mélisande n’est pas heureuse auprès de Golaud qu’elle a épousé au cours d’une période elliptique difficilement mesurable. Elle n’est pas heureuse comme elle le répète. Golaud a un frère plus jeune : Pelléas. Les deux frères s’opposent. L’un chasse, l’autre pas. L’un est déjà père, l’autre pas. L’un est plus âgé que Mélisande, l’autre semble appartenir à sa génération. L’un est insouciant, entouré des siens ; l’autre est ombrageux, soumis aux tourments d’une lourde solitude. Et c’est pourquoi Pelléas et Mélisande se retrouvent, presque implicitement unis dans cette forme d’absence qui les habite tous les deux, au fil de ce temps inconnu qui passe dans la demeure du roi Arkël. Julie Duclos suppose qu’ils sont « reliés par la mort qui plane au-dessus d’eux ». Sans doute, une force cachée les relie-t-elle en effet, les conduit-elle ensemble vers un destin funeste. La pièce recèle en effet une intensité tragique indiscutable. Pour autant, pas de passion dévorante et dévastatrice ni de surplomb olympien qui impose sa volonté aux hommes. Le texte que la jeune metteure en scène a pris soin de faire rendre avec finesse par tous ses comédiens révèle un « tragique quotidien » selon les mots de l’auteur lui-même, autrement dit une forme de discours singulier où le poétique effleure en permanence l’ordinaire de l’existence. Où l’inquiétant invisible est continuellement souligné en creux.
Le décor de la maison, ses parois modulables à l’étage, ses vides, ses ouvertures, tout suggère qu’il faut aller plus loin encore, dépasser le cadre de la structure spatiale. Déambuler au lointain vers l’obscurité des coulisses où se cachent des choses. Comme Pelléas et Mélisande qui se rejoignent sous le chêne à la nuit tombée.

Comme Golaud au cœur des ténèbres qui les observe alors qu’ils s’embrassent. Comme Yniold qui espionne les deux amants et tente de révéler avec ses mots à son père ce qu’il voit. Et c’est bien de cela qu’il s’agit. C’est qu’il faudrait voir à travers le voile de l’écran. Voir à travers le brouillard, jaillissant de sous la maison. Voir à travers le noir du gouffre alors que Pelléas « étouffe » dans la minéralité de la grotte où il se trouve avec Golaud – très beau moment de clair-obscur entre les deux comédiens Vincent Dissez et Mathieu Sampeur.
À ce propos, on retiendra le formidable travail sur l’utilisation de la vidéo qui, au-delà du raffinement esthétique, éclaire le propos de la metteure en scène. Les scènes filmées – celle au bord de l’océan – ont une fonction diégétique nette : elles comblent l’ellipse au plateau, permettent de « voir » les changements de lieux dans la fable. Cependant, celles qui sont filmées en direct participent de cette réflexion sur les variations du regard. Elles nous suggèrent in fine qu’on peut voir au-delà des obstacles physiques pour l’œil. Et invitent de même à ne pas perdre de vue que la frontière entre fiction et réalité reste effective bien que poreuse. « Tout est faux » affirme Julie Duclos insistant sur le fait que la technique, de même que les changements à vue – il y en a dans sa mise en scène – rappellent que « nous sommes au théâtre », ce qui est peut-être le meilleur moyen de « croire à nouveau à la fiction ».
Même si leur fin est funeste, les deux jeunes amants vivent leur amour, brièvement mais intensément. Et Pelléas – Matthieu Sampeur d’une grande justesse – de dire que « tout est perdu, tout est sauvé ! tout est sauvé ce soir (…) Ah ! qu’il fait beau dans les ténèbres !… »
Ainsi, plus qu’un simple hommage au mythe de Tristan et Iseult, Pelléas et Mélisande propose une méditation sur l’existence. Et ici cette méditation se colore d’inquiétude en permanence. Les bruits sourds retentissant au fil de la pièce indiquent la menace. Au loin pour l’instant. Mais bien là, quelque part. De notre côté peut-être, dans un monde actuel en danger imminent. Golaud, dans une mise en garde à valeur métaphorique, n’avertit-il pas que « tout le château s’engloutira une de ces nuits, si l’on n’y prend pas garde. » Sombre présage qui se réalise d’abord avec la mort des deux amants puis à travers le sens ambigu de la toute dernière phrase du texte au sujet de la petite fille mise au monde par Mélisande, avant qu’elle ne rende l’âme : « C’est au tour de la pauvre petite… »
Julie Duclos relève donc brillamment le défi qu’elle s’est lancé et propose une mise en scène à l’atmosphère subtilement froide, laissant percevoir une violence sourde, proche et menaçante sans la montrer. Certes, le théâtre est l’art de la représentation. Pourtant quand il se fait art de la suggestion, il ne perd pas en justesse. Bien au contraire. On peut le constater à la FabricA en ce moment.

