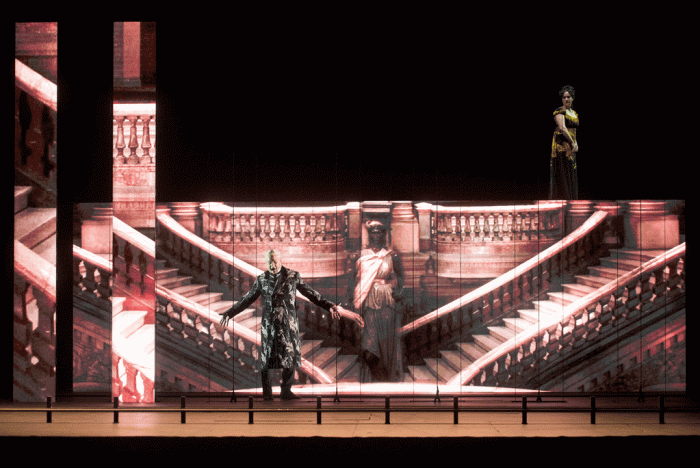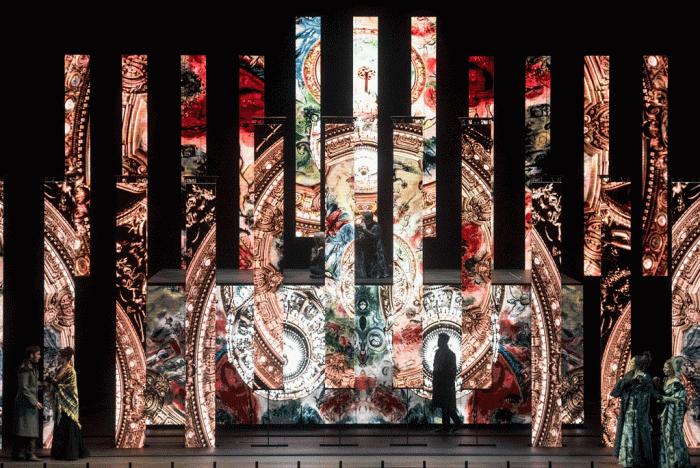
Si, dans la Comédie humaine, les allusions à la musique ne sont pas rares, l’œuvre de Balzac n’a guère tenté les compositeurs d’opéra ; Oberst Chabert (Le Colonel Chabert) de l’Allemand Hermann Wolfgang von Walterhausen, demeure une exception. Ou plutôt demeurait, car il faudra désormais compter avec Trompe-la-Mort, première création mondiale voulue par Stéphane Lissner. L’actuel directeur l’Opéra national de Paris a souhaité que les ouvrages qu’il commande soient tous inspirés par la littérature française. Faire appel à Luca Francesconi allait de soi : les deux hommes se sont connus à La Scala de Milan, où, pendant le mandat de Lissner, Francesconi avait présenté sa vision lyrique de Quartett, de Heiner Müller, d’après Les Liaisons dangereuses de Choderclos de Laclos. Et Francesconi est un admirateur inconditionnel de Balzac, et du personnage de Vautrin, figure essentielle qui apparaît dans Le Père Goriot et pèse de toute sa noirceur sur Les Illusions perdues, Splendeur et misère des courtisanes, et même sur l’inachevé Député d’Arcis, ainsi que sur une pièce de théâtre de 1840, interdite après une seule représentation. De là un projet qui pouvait paraître démesuré, mais qui s’avère une réussite prouvant que non seulement le genre lyrique n’est pas mort mais qu’il est bien un art complet, unissant musique, chant, théâtre et arts plastiques – à cela on ajoute aujourd’hui la vidéo.
Auteur du livret de ces deux actes, Francesconi a d’abord pour intention de raconter une histoire – tant mieux, car on est fatigué à juste titre des élucubrations pseudo-philosophiques qui font des ravages dans l’art lyrique contemporain. Vautrin, autrement dit Jacques Collin, autrement dit Trompe-la-mort, forçat évadé qui usurpe l’identité du prêtre Carlos Herrera et finit, grâce à un chantage, par devenir chef de la police, est l’une des plus fortes créations balzaciennes. De celui dont l’écrivain affirme que « sa figure, par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes », on suit une partie de l’itinéraire, depuis sa rencontre avec Lucien de Rubempré jusqu’à son accession à des fonctions officielles. On suit aussi l’ascension et la chute de Lucien, auquel Vautrin, qui éprouve pour lui une violente attirance, a promis gloire et fortune en échange d’une obéissance absolue. Autour d’eux, Paris, qui, sous le brillant des apparences, cache compromissions et corruption.
Ce que Francesconi traduit par quatre niveaux, bien précisés dans son livret. Le premier, celui du jeu social et des mondanités vaines. Le second, celui « des rapports intimes et des machinations inavouables. Il est la vie de la coulisse ». Le troisième, celui du voyage en calèche de Lucien et Vautrin après leur rencontre, flash-back récurrent et fil rouge de l’intrigue. Le quatrième, le plus troublant, celui des forces obscures de la vie, et des sous-sols du théâtre. Une conception que les décors de Guy Cassiers et Tim Van Steenbergen concrétisent en un formidable jeu de métaphores qui s’appuient sur le Palais Garnier et son architecture, des profondeurs au plafond de Chagall, y compris une vue aérienne du bâtiment, tandis que des panneaux mobiles verticaux en reprennent des éléments. Une scénographie qui fait corps avec la mise en scène de Guy Cassiers, débordante d’intelligence et en même temps parfaitement accessible. Impitoyable gravure à l’eau forte d’une société dont certains membres ne sont guère plus que des marionnettes (quelques-uns sont placés sur un tapis roulant, signe qu’ils n’agissent pas mais subissent), vision politique, aussi, qui renvoie sans équivoque au monde contemporain.
La musique épouse ces mêmes niveaux, confiée à un orchestre très fourni, au point que les percussions sont placées dans les loges d’avant-scène. Souvent sombre et tendue, elle sait aussi s’apaiser, comme dans le voyage d’Herrera et de Lucien, où les cordes sont plus présentes, et ne dédaigne pas de laisser la place à de grands airs, celui d’Esther, d’une écriture fluide et très mélodique, celui de Vautrin dans la dernière scène, magistral, baigné de haine et de violence. Sans doute est-il présomptueux de donner un avis définitif après une seule audition d’un ouvrage si complexe. Mais la direction de Susanna Mälkki, aussi précise que lyrique, aide considérablement l’auditeur à entrer dans le monde de Francesconi.
La distribution, en majeure partie française, est à la hauteur de la tâche. Laurent Naouri a fait siens Golaud de Pelléas et Mélisande et Iago d’Otello, deux forts caractères aussi exigeants musicalement que vocalement et théâtralement. Il peut y ajouter Trompe-la-Mort, auquel il apporte sa véhémence verbale, et les couleurs d’un métal au tranchant bien affûté ; passant aisément du parlé au chanté, du prêtre à l’accent espagnol au manipulateur qui découpe les mots au scalpel, il livre une composition saisissante et ces dès son apparition muette sur un écran, dans les premières minutes du spectacle, alors qu’il modifie ses traits en versant de l’acide sur son visage.
Cyrille Dubois a tout pour incarner Lucien de Rubempré : la sveltesse, l’ardeur juvénile, un timbre de ténor lumineux et suave, une musicalité parfaite et une présence scénique touchante, dans un emploi qui le mène jusqu’à ses limites vocales sans qu’il en souffre. Le rôle du Baron de Nucingen, amateur de jeunesse au point d’acheter Esther, est ingrat – on ne sait s’il inspire du dégoût ou de la pitié ; Marc Labonnette en trace un portrait n’évite pas la charge mais qui emporte l’adhésion. Philippe Talbot pourrait être, physiquement, un Rastignac séduisant ; vocalement, hélas, il passe difficilement la barrière de l’orchestre. Ce dont ne souffre pas Christian Helmer, Marquis de Granville autoritaire, au chant plein de morgue, mais sa caractérisation du personnage demeure bien monolithique. Le trio Contenson (Laurent Alvaro), Peyrade (François Piolino), Corentin (Rodolphe Briand) permet à trois interprètes épatants de créer des compositions savoureuses, ce qui n’est pas à la portée du premier venu.
Leurs partenaires féminines ne déméritent pas, même si Ildiko Komlosi ne fait pas d’Asie, la complice de Vautrin, le « monstre » décrit pas le romancier mais plutôt une mère maquerelle bien en chair et joviale, dont le sourire ne suffit pas à faire oublier son français déplorable et une voix qui n’est plus qu’un souvenir. Toujours aussi attachante, Julie Fuchs prête à Esther sa sincérité, sa finesse d’excellente musicienne, le cristal de son timbre ; sans doute lui manque-t-il encore la fragilité qui conduit la jeune courtisane au désespoir. Chara Skerath tire ce quelle peut de Clotilde de Grandlieu, silhouette très anecdotique. Tendue, et sollicitant souvent l’aigu, la tessiture de la Comtesse de Sérisy n’est pas flatteuse, mais Béatrice Uria-Monzon en surmonte vaillamment les aspérités, au prix d’une élocution parfois peu compréhensible.
Une création qu’on aimerait revoir, digne du génie littéraire qui l’a inspirée, et d’un compositeur qui, sans se soucier des modes, suit courageusement son chemin.