
Rien de révolutionnaire dans la nouvelle production de La Traviata que Paco Azorin vient de présenter à Peralada : rien de raté, à l'exception des chorégraphies pseudo subversives de Carlos Martos, mais rien de vraiment réussi non plus. Pour le metteur en scène espagnol le jeu et avec lui le luxe, donc la luxure et la perdition, est ce qui permet à Violetta de s'élever dans la société, mais ce qui la mènera également à sa perte. C'est dans une salle de jeux qu'elle a sans doute été remarquée et qu'elle est devenue l'une des « courtisanes » les plus en vue, c'est là qu'au milieu d'une foule interlope elle oublie, tout dans une vie de débauche et là qu'elle mourra, précisément sur une table de billard où les jeux semblent avoir été faits dès le départ… Si l'idée n'est pas mauvaise en soi, la réalisation pêche par un excès d'images psychédéliques surchargées de couleurs (projections vidéo zébrées de rouge), de scènes orgiaques d'un goût douteux et risible (chœur et figurants qui simulent d'improbables coïts) et d'escalades inutiles (les tables de billard redressées à l'oblique en fond de scène, devenant au second acte un espace pour acrobates chevronnés…).
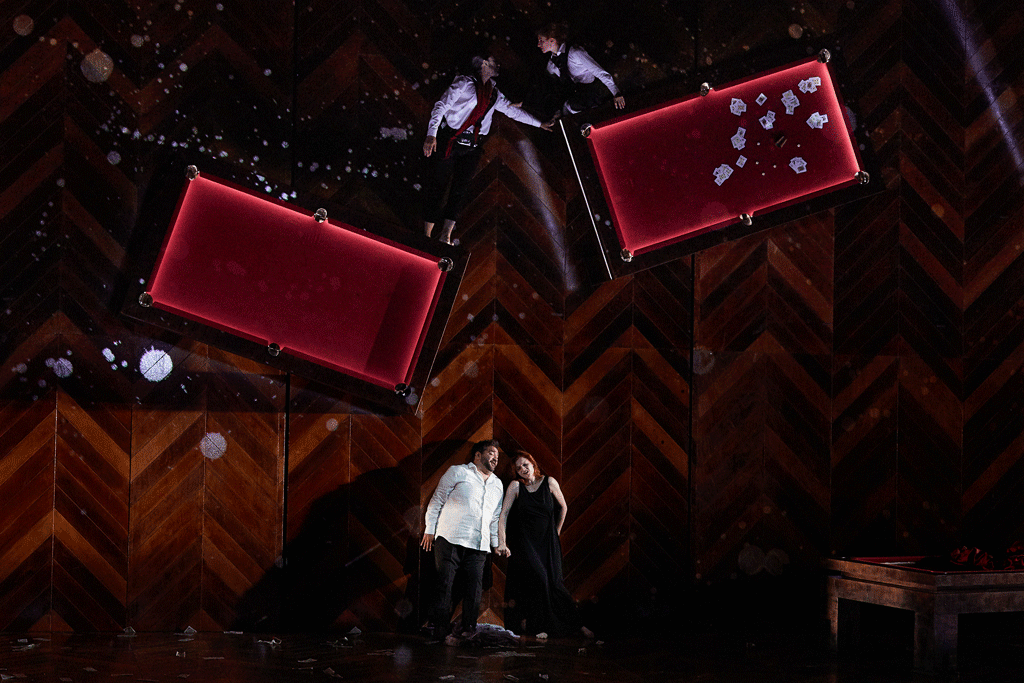
La saison prochaine Paco Azorin s’attaquera à une nouvelle partition de Verdi avec une Aida annoncée à grand renfort, qui réunira Sondra Radvanovsky, Piotr Beczala (qui débutera dans le rôle de Radamès), Anita Rachvelishvilli et Carlos Alvarez placée sous la direction de Dan Ettinger.
Au plateau la célèbre dévoyée réalise en toute impunité une fuite en avant, consciente des risques qu'elle prend et du prix à payer pour oser défier ainsi sa condition de fille du peuple, la société toujours corsetée et moralisatrice et croire que l'on peut s'opposer aux hommes et un en particulier, le père de celui auprès de qui elle aimerait tant vivre. Comme un leitmotiv Violetta se rêve enceinte (dès le prélude), puis mère d'une enfant qui réapparait à plusieurs moments-clé du drame, comme pour mieux affirmer son aspiration à une vie rangée, bourgeoise, qui lui permettrait d'entrer dans le rang. Rien de tout cela n'arrivera et malgré ses velléités de rébellion, cette Traviata mourra comme les autres, misérable et pitoyable, victime expiatoire et sacrificielle, offrant à Alfredo et à son père, son incurable maladie et sa mort pour preuve de sa bonté d'âme et de sa bonne foi.

La russe Ekaterina Bakanova, longiligne rousse flamboyante, adhère sans réserve à cette proposition ; comédienne particulièrement investie, autant physiquement qu'intellectuellement, la soprano se dépense sans compter, même si la voix ne suit que par intermittence cette implication, surtout au premier acte où les exigences musicales dépassent largement ses moyens. Les actes suivants, plus dramatiques conviennent davantage à sa vocalité et offrent à cette artiste un vaste espace pour laisser libre-court à son expressivité et à ce timbre attachant qu'elle déploie jusqu'au final assez émouvant. Face à un tempérament de cette trempe, René Barbera dessine un frêle Alfredo, plutôt gauche en scène, attitude heureusement corrigée par une exécution musicale de qualité. Plus légère que bon nombre de ses confrères, sa texture vocale et sa fréquentation du répertoire belcantiste assurent à son statut de ténor un charme réel. Dommage que pour des raisons scéniques il doive se retrouver fréquemment à terre, jeté comme un vulgaire ballot par son père, montré comme un être violent et profondément cynique. Forcé d'obéir à son metteur en scène, Quinn Kelsey semble aller contre sa nature et compose un Germont brutal et antipathique. Son instrument habituellement plus doux surprend ici par les aspects cassants auxquels il doit recourir et qui ne sont pas sans conséquence sur notre écoute. D'honnêtes comprimari et d'excellents choristes préparés avec soin par José Luis Basso viennent compléter cette distribution dirigée pour une fois plutôt correctement par Riccardo Frizza, moins fâché avec les tempi, qu'il prend la peine de respecter et plus attentif à mener à terme la subtile narration verdienne.

