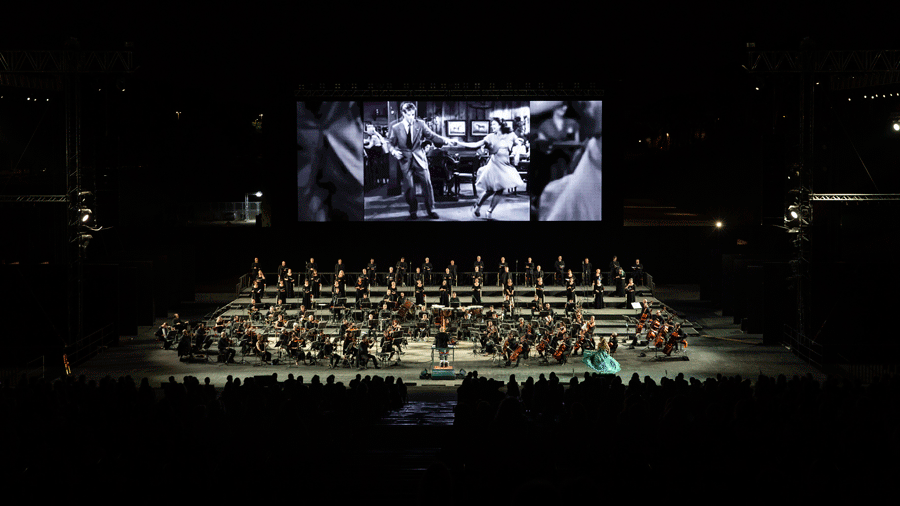
Il faut partir du principe que les mélomanes et les puristes du lyrique ne devraient pas fréquenter les espaces en plein air en été. Quelle que soit leur adéquation ou leur adaptation, l'acoustique n'est jamais satisfaisante (sauf peut-être au Sferisterio di Macerata). Aller à l'opéra au Circo Massimo signifie, et vous le savez déjà avant votre arrivée, que la suggestion environnementale doit prévaloir sur la perfection du son et que les voix et les instruments seront nécessairement amplifiés afin d'arriver bien amalgamés et équilibrés au public des gradins et de ne pas être trop perturbés par les bruits de la ville. Mais l'impact émotionnel est fort : assis sur les gradins, les spectateurs ont à gauche les ruines du Palatin illuminées, en arrière-plan l'étendue du Circo Massimo, la lune se lève derrière la scène … et, revenant vers le centre-ville après le spectacle, la promenade vers le Colisée et sous l'arche de Constantin procure une émotion indicible que seule Rome peut offrir.
Peut-être la forme concertante et la langue originale ont-elles semé le doute sans le public potentiel. Deux faux problèmes.
Le premier : l'orchestre et le chœur sont de haut niveau et bien préparés et dirigés, de sorte que le concert met même en valeur la partition musicale et focalise l'attention du public, qui n'est pas distrait par la mise en scène ; de plus, les protagonistes sont si bons qu’ils créent une relation communicative entre eux, même sans mise en scène ni décors mais en utilisant des mouvements et des gestes sans jamais se rapprocher les uns des autres, comme le prévoit le protocole sanitaire.
Le second : La veuve joyeuse a été composée par Lehàr en allemand et c’est dans la langue originale qu’elle donne le meilleur d'elle-même dans l’adéquation des mots et de la musique ; la traduction italienne, en fait, à laquelle nous avons toujours été habitués, a été faite sur la partition déjà composée et souffre donc de forçages et d'extrêmes : depuis des années maintenant toutes les œuvres sont proposées en langue originale, quelle qu’elle soit …
J'ajouterai un troisième faux problème, lié à la structure de l'opérette qui prévoit beaucoup de dialogues. Ici, les dialogues ont été fortement réduits, ne laissant que l'essentiel (le rôle de Njegus a même été éliminé), et les vidéos (un projet de Giulia Randazzo et Giulia Bellè), notamment des images de films en noir et blanc des années 30 et diverses légendes, aident beaucoup à la compréhension de l'intrigue.

Du point de vue de la distribution, qui est tout ici, bien sûr, il s'agit d'une production de très haut niveau. À commencer par Nadja Mchantaf ((NdT : en troupe à la Komische Oper de Berlin, que nous connaissons bien à Wanderer, et que nous apprécions)) dans le rôle-titre, une Hanna Glawari au grand charme et à la voix parfaite pour le rôle, surtout dans les duos intenses et particulièrement soignés avec Danilo ; le soprano révèle des talents remarquables de danseuse et sa Veuve est jeune et gaie mais pas joyeuse, passionnée et capricieuse mais toujours élégante et mesurée, dotée de charme et de volonté de vivre mais pas effrontée ; consciente de son enfance difficile, Hanna veut profiter de la vie non pas dans un sens superficiel, vivre le moment et c’est tout, mais avec un véritable projet de vie à long terme.

A ses côtés, avec un charme égal et une même qualité de chant, Markus Werba a une voix douce et ductile, capable de trouver les justes nuances dans le rendu non seulement de L'évolution du comte Danilo mais aussi de ses bouleversements et de la profondeur de l'amour qu'il ressent pour Hanna.

Juan Francisco Gatell est un petit rôle de luxe : son Camille de Rossillon a une voix étendue et un chant ciselé. La Valencienne d'Hasmik Torosyan est aussi bonne vocalement, très à l’aise mais gênée par la partition qu’elle tient sans cesse dans sa main. Andrea Concetti met sa grande expérience au service du Baron Zeta, dessinant un homme relativement âgé, qui a bien compris les mécanismes de la vie et qui gère avec une grande diplomatie les relations sociales dans son milieu, une sorte de Don Alfonso de Mozart en somme. À leurs côtés, très bien distribués et très justes, Marcello Nardis (Raoul de St Brioche), Simon Schnorr (Cascada), Roberto Accurso (Bogdanowitsch), Marianna Mappa (Sylviane), Roberto Maietta (Kromow), Angela Schisano (Olga), Sara Rocchi (Praskowia), Alessio Verna (Pritschitsch) et les six Grisettes du Chœur : Michela Nardella, Emanuela Luchetti, Claudia Farneti, Stefania Rosai, Silvia Pasini, Marzia Zanonzini. Le chœur a été bien préparé par Roberto Gabbiani.

Stefano Montanari dirige avec juste vigueur l'Orchestra del Teatro dell’Opera : le chef d'orchestre a de l'expérience et sait que dans la forme concertante l'intérêt du public doit toujours être constant et élevé et chaque section des pupitres est ponctuellement suivie et fusionnée avec les autres. Le son est riche, résultat de composantes harmoniques séduisantes et veloutées : l'écoute rappelle immédiatement la grandeur de la Belle Epoque et la séduction que le royaume féerique de Pontevedro exerce dans l'imaginaire collectif.
Des applaudissements convaincus et spontanés tant à scène ouverte que lors des saluts.

