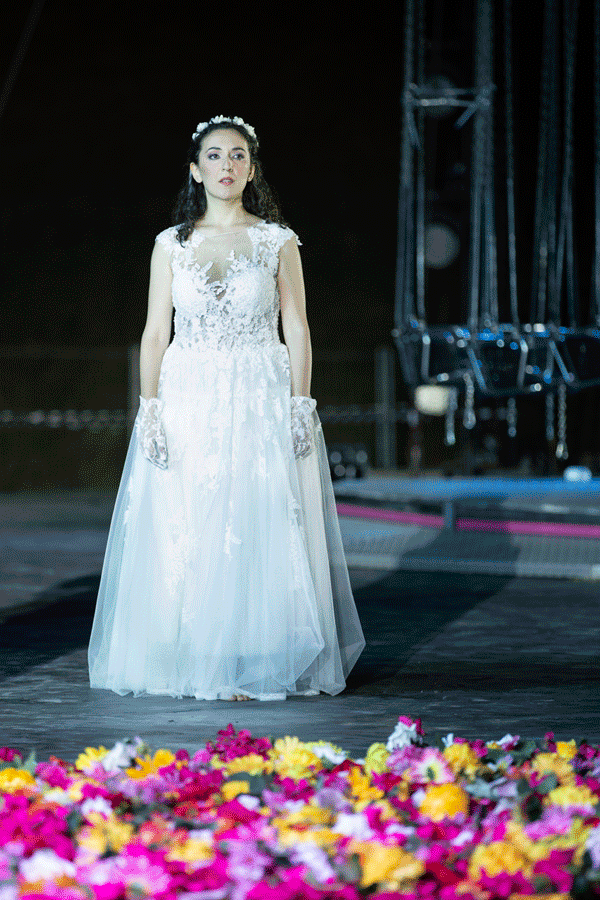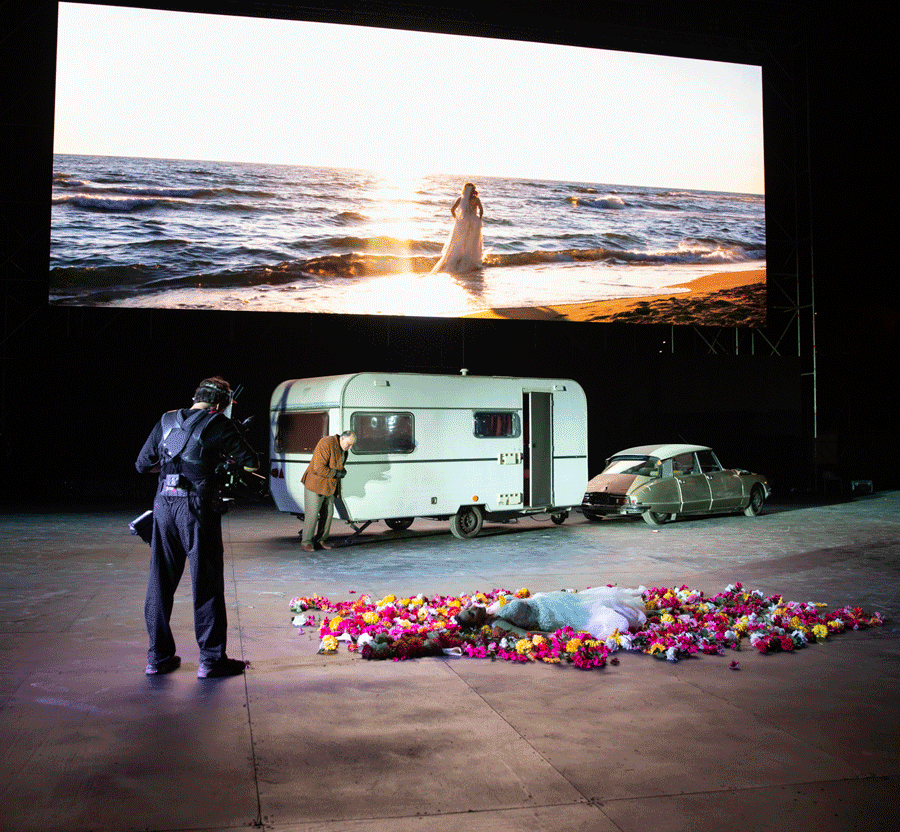
Le choix de Rigoletto peut aisément s’expliquer. D’une part c’est un des titres de la trilogie populaire de Verdi qui peut parfaitement convenir à une saison d’été, d’autre part, l’œuvre répond aux exigences des protocoles sanitaires en vigueur, n’ayant pas un chœur énorme (un seul chœur d‘hommes), enfin outre que tout orchestre d’opéra en Italie connaît cette œuvre de base du répertoire, l’Opéra de Rome l’a produite en 2018 (mise en scène Daniele Abbado), déjà dirigée par Daniele Gatti, et l’orchestre est donc déjà préparé à son approche.
Il était impossible de reprendre cette dernière production et l’Opéra de Rome a demandé à Damiano Michieletto une production ad hoc, adaptée à l’énormité du lieu, aux exigences sanitaires de distanciation (y compris sur scène).
Voilà donc une autre réponse, après celle de La Fenice dont nous avons rendu compte et qui restait dans l’espace clos du théâtre.
Plusieurs solutions ont été envisagées en alternative aux Thermes de Caracalla dont la fosse était trop petite pour permettre le déploiement de l’orchestre dans les conditions voulues. Le choix s’est porté sur le Circo Massimo, espace large, bien délimité, et situé dans une zone à la fois touristique et aisément accessible.
Du côté des spectateurs, les gradins déployés accueillent un peu moins de 1500 spectateurs sur des sièges séparés par 1m au moins, (soit de deux en deux, soit isolés) sur une trentaine de rangs. Évidemment, la question de l’éloignement de la scène se pose, et on y répond à la fois par une inévitable sonorisation et par la présence d’un écran gigantesque, qui participe de la mise en scène, et qui permet en outre de voir de plus près les artistes.
Damiano Michieletto transpose la trame (comme à son habitude), cette fois dans l’ambiance de la malavita ((La pègre))des années 80, où Rigoletto est comme l’âme damnée et le rabatteur du caïd du lieu (le duc), tout en étant propriétaire d’un manège de foire, le décor est essentiellement constitué de voitures de l’époque (ainsi qu’une camionnette et une caravane) et un manège de foire.

C’est un décor (du complice habituel de Michieletto, Paolo Fantin) efficace, mobile, et l’utilisation des voitures permet de respecter les distances physiques sans en avoir l’air, on se cache derrière, on monte dedans, et ainsi d’un véhicule à l’autre les personnages (jolis costumes de l’autre complice Carla Teti) , tous munis de gants, se dispersent naturellement et l’abondance de brume permet de masquer les personnages (dans une Mantoue fantasmée, dont la brume, on le sait fait partie de l’ADN).L’espace et la précision des mouvements demandait un travail chorégraphique important et habile (Chiara Vecchi) et une gestion vidéo au plus près (Filippo Rossi)
La largeur de la scène (1500 m²) permet aussi de distribuer tous les figurants (la cour, ou plutôt la bande), tandis que le chœur chante le long de l’orchestre en respectant le protocole sanitaire, tout autant que l’orchestre de scène, dissimulé à jardin.
L’écran, nous l’avons dit, permet à la fois de voir l’action au plus près (la scène est immense, le public est plutôt éloigné), mais aussi permet de lire dans l’âme des personnages principaux : souvenirs des temps heureux où Rigoletto emmenait sa petite famille à la plage, avec Gilda petite fille, et où l’épouse décédée est une réplique de Gilda, manière de montrer que l’amour que Rigoletto a pour Gilda est une sorte de report de son amour pour sa mère, ou « suicide » final de Gilda s’enfonçant dans l’eau. Autre idée, les fleurs qui sont autant de fleurs funèbres, comme des couronnes de funérailles, qui sont le lieu de la mort et de la malédiction, lit de fleurs sur lequel reposera à la fin le cadavre de Gilda comme transfigurée. Mais l’utilisation de la vidéo, avec camera au plus près des visages qui rappelle évidemment ce que fait Frank Castorf depuis des années, était loin d’avoir le rôle dramaturgique déterminant que le dialogue scène écran peut avoir chez le metteur en scène allemand, on restait essentiellement dans l’illustratif.
Rigoletto dans la pègre, l’idée a déjà été exploitée (brillamment) par Jonathan Miller à l’ENO il y a deux ou trois décennies, une des productions phares de cette œuvre et donc Michieletto n’invente rien, il aménage l’idée aux conditions du moment et cela réussit bien : vu le dispositif, vu les exigences sanitaires. On ne demande pas plus et il est difficile de donner dans la subtilité qu’on aurait pu développer dans un théâtre fermé. C’est du travail de très grand professionnel, plus subtil qu’il n’y paraît à première vue, notamment dans la peinture des personnages et on le verra, de Gilda en particulier.

Bien sûr, on pourrait reprocher la trop grande ouverture qui ne filtre aucun des bruits de la rue, klaxons, automobiles, mais aussi convives des bars voisins plutôt bruyants, mais c’est aussi la douce nuit romaine et ma foi, dans le bonheur d’être là, il y avait aussi cette dolce vita estivale : on ne pouvait guère demander le silence religieux du théâtre clos, cela fait partie du jeu ou du deal…
La question musicale est donc un peu plus délicate, le dispositif construit ad hoc n’a rien qui puisse aider le son à se diffuser un tant soit peu naturellement, et donc, dans ce théâtre à ciel ouvert, sans mur ni coque acoustique, tout est forcément sonorisé. Au départ, cela perturbe un peu, mais la diffusion sonore a aussi été étudiée pour ne pas être invasive, pour apparaître presque naturelle, avec la distance voulue, et assez claire. Pour les voix, cela convient globalement, parce qu’elles n’apparaissent pas « gonflées » ou « aidées », pour l’orchestre, c’est évidemment un peu plus difficile, mais là aussi le travail de la mise en son ne trahit rien des intentions du chef, mais permet au contraire de saisir au mieux ce qu’il a voulu faire.
Dans le contexte, le spectateur, trop heureux d’entendre de l’opéra en direct (et du Verdi qui plus est), trop heureux d’être au cœur de la douce nuit romaine, et trop heureux de retrouver quelque chose de l’ambiance d’un spectacle (malgré masques, distanciation, prise de température et pas d’entracte long, mais deux brèves pauses entre les actes), fait contre mauvaise fortune bon cœur : répétons-le, il fallait oser ce geste et il faut saluer l’entreprise orchestrée par le sovrintendente Carlo Fuortes, qui, soutenu par la Ville de Rome, a pu réussir à proposer un été festival, ce qui au départ était loin d’être sûr.
Le cast réuni, sans être exceptionnel, est suffisamment solide pour émouvoir et faire participer le spectateur au mélodrame verdien. On y compte quand même quelques-unes des voix les plus importantes du chant italien, et de vraies promesses.
Les rôles de complément ont été tous tenus honorablement et surtout, grâce à la précision du travail de Michieletto, tous étaient profilés et méritent d’être tous cités depuis Gabriele Sagona (Monterone), Irida Dragoti (Giovanna), Alessio Verna (Marullo) e Pietro Picone (Borsa) jusqu’à la comtesse Ceprano (Angela Nicoli ) et au page (Marika Spadafino).
La Maddalena très aguichante de Martina Belli et le Sparafucile puissant de Riccardo Zanellato ne manquaient pas de présence, le duo si important Sparafucile/Rigoletto (une des clefs de compréhension de l’œuvre) a fonctionné notamment grâce au jeu de Zanellato, très contrôlé et très contenu par la mise en scène.
Le duc était Iván Ayón Rivas, le jeune ténor péruvien qui déjà était le duc (cast B) de la production de 2018 à Rome. Le personnage et le look très typé de jeune malfrat arrogant ont fonctionné dans le contexte voulu par la mise en scène, et le jeune ténor, au timbre chaleureux, à la voix bien contrôlée et à la technique sûre s’en est sorti avec tous les honneurs, jamais histrionique, jamais caricatural, il a vraiment beaucoup travaillé le rôle selon les demandes de Daniele Gatti.

Rosa Feola était Gilda, nouvelle venue dans le travail avec Gatti puisqu’en 2018, Gilda était Lisette Oropesa (prise à Madrid pour Traviata en cette période). La Oropesa avait sans doute une présence vocale plus affirmée et mature, mais Rosa Feola avait la voix et le look voulus par la mise en scène : Gilda est une adolescente qui découvre et la puissance de son corps et l’amour, elle n’est pas dans cette mise en en scène l’oie blanche victime du vilain duc ou de ses compagnons. Dès sa première apparition, on la voit revenir en jeune fille sortie de discothèque avec une robe bien moulante, et se dévêtir bien vite pour endosser jean et pull casual quand le père rentre chez lui. Pas folle la guêpe… Et pas si naïve. La Gilda de Michieletto est une jeune en proie à la naissance du désir, heureuse de plaire et qui croit découvrir l’amour… Ainsi Rosa Feola est-elle le mélange de naïveté et de duplicité qu’elle exprime bien dans un chant sûr, lumineux, avec une vraie présence en scène, elle non plus (Gatti oblige) à mille lieues de l’exposition histrionique de la voix, mais au contraire psychologiquement plus engagée (dans le Caro nome notamment) et têtue dans ses volontés (scènes finales, d’une rare justesse psychologique).
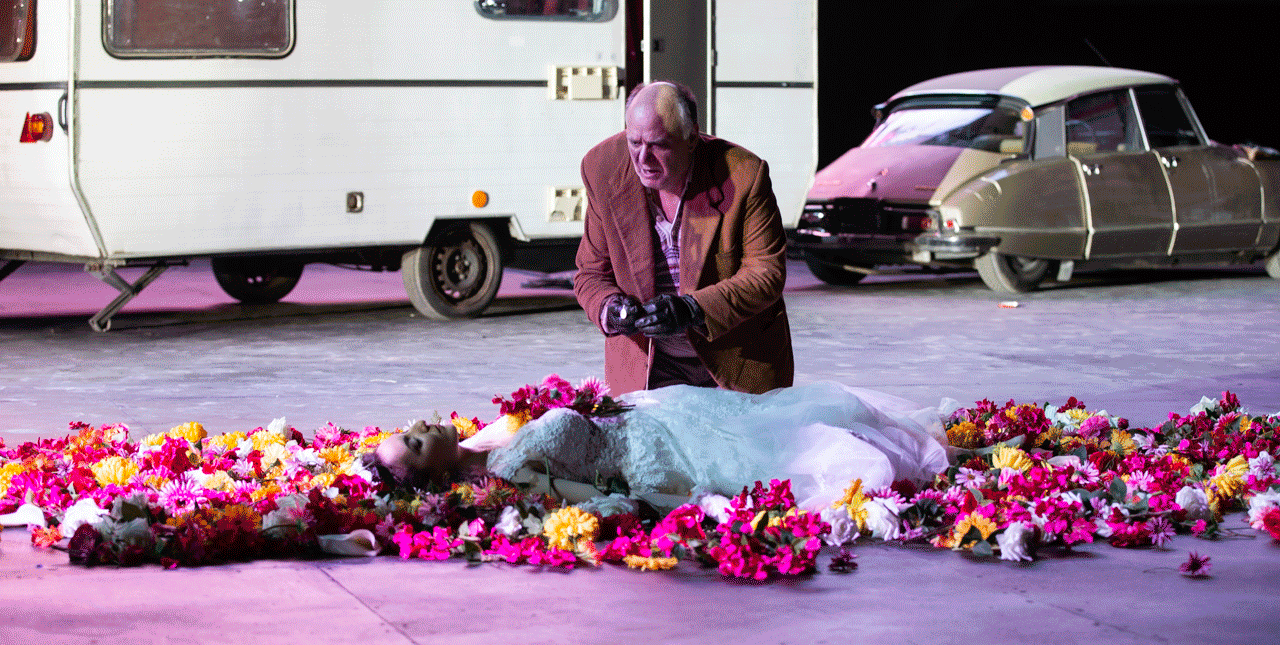
Enfin Roberto Frontali devient aujourd’hui le Rigoletto de référence : on est loin des caricatures, du bouffon et d’interprétations encroûtées par la tradition. Il y a dans son approche une profondeur psychologique, une sensibilité qui transforment complètement le personnage. C’est un regard neuf qui est donné, non le père abusif aveuglé par l’amour de sa fille – élément certes important- mais celui qui, aux prises avec un monde de brutes géré par le mal au quotidien, est contraint d’entrer dans le jeu du meurtre, c’est la question de la malédiction (La maledizione était le premier titre envisagé par Verdi) qui contraint à son corps défendant d’épouser le mal et conduit à l’assassinat. Nous sommes à l’opposé de l’expressionnisme. C’est un Rigoletto subtil, ravagé de l’intérieur, au chant rempli d’inflexions et à l’étonnante variété de couleurs, un chant presque « impressionniste » (entendu comme l’opposé de l’expressionnisme) qui en fait aujourd’hui le Rigoletto inévitable de tout grand théâtre (à condition qu’il soit dirigé…). Grandissime interprétation.
Mais la clef de voûte de l’ensemble, c’est Daniele Gatti dont la direction stupéfie par l’audace, et ce malgré les conditions sonores dont nous avons fait état plus haut. Le discours sur un Verdi débarrassé des incrustations de la tradition est loin d’être neuf, on en a parlé avec Claudio Abbado, et aussi avec Riccardo Muti, au seuil des années 1980. On se souvient des polémiques que Muti avait déchainées en supprimant l’aigu de « Di quella Pira » dans son Trovatore florentin au point que la question des aigus à supprimer devenait le signe d’une relecture : on ne fait pas les aigus non écrits.
Daniele Gatti va au-delà. Il nous a accordé une interview que nous publierons sous peu dans laquelle il entre dans le détail de ses options, mais d’emblée, sa direction épouse un dessein psychologique que Gatti lit dans la partition même de Verdi, où certaines notations semblent avoir été négligées par la tradition interprétative, qui souvent est conduite depuis la naissance de l’opéra par les chanteurs, désireux de briller ou de se montrer à leur avantage, d’où des prises de liberté singulières qui finissent par s’installer.
Gatti note en Rigoletto une rupture par rapport aux opéras de Verdi plus ou moins contemporains, une musique moins exubérante, plus sombre (utilisation de la contrebasse et du violoncelle solo), à la recherche de nouvelles couleurs en lien avec le développement dramaturgique. Alors les rythmes changent. « Questa o quella » l’air initial du Duc, est abordé à un tempo plus retenu plus courtisan, sans vulgarité parce que Verdi écrit sur la partition élégant. Le tempo suit les didascalies verdiennes. Le Caro nome est le chant d’une jeune fille qui découvre l’amour, elle ne peut chanter cet air de manière brillante, mais au contraire éthérée, émerveillée…Toute la lecture de Gatti vise à montrer que Verdi a collé de manière miraculeuse aux éléments psychologiques du drame.
Ainsi cette direction est pleine de couleurs nouvelles, avec une lecture presque intimiste d’une clarté étonnante : déjà il y a deux ans on avait pu apprécier la profondeur de cette lecture, mais il semble que Gatti soit allé encore plus loin, trouvant en Rigoletto l’autre chef d’œuvre absolu de Verdi, aux côtés de Falstaff. C’est pourquoi on peut regretter que les conditions acoustiques ne soient pas idéales pour en mieux apprécier les contours.
Cette production très spéciale de Rigoletto, réalisée dans des conditions si particulières rend justice à la partition de Verdi. Habituellement, les saisons estivales ne sont pas les moments les plus adaptés à des relectures raffinées, c’est ici le contraire. La lecture musicale est révélatrice d’une écriture, de trouvailles, de rythmes nouveaux et aussi d’une peinture nouvelle du personnage, grâce à la prestation exceptionnelle de Roberto Frontali, qui a trouvé là son grand rôle.