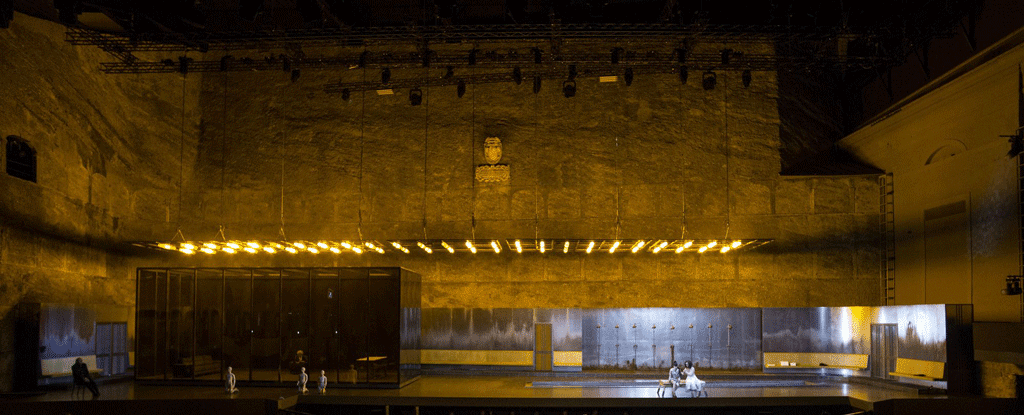
Elektra, d’abord un texte
Pour celui qui écrit, Elektra est une œuvre sacrale, une de ces œuvres fétiches qui marquent une vie, parce que la première Elektra fut d’une certaine manière définitive : 1974 puis 1975, Paris, Nilsson, Rysanek, Ludwig (puis Varnay l’année suivante), et Karl Böhm. Il est très difficile, encore aujourd’hui, d’effacer ce souvenir qui reste la référence absolue. Quarante-cinq ans après, cette Elektra-là n’est pas encore détrônée. Aucune production depuis n’a pu égaler l’émotion inaugurale.
Et pourtant, en 2020 à Salzbourg et pour des raisons très variées, quelque chose s’est passé qui rappelait la stupéfaction de l’époque, au détour d’une phrase, au détour d’une attitude, au détour d’une note, quelque chose s’est passé.
En 1975, la question de la mise en scène se posait avec beaucoup moins d’acuité et la vieille production d’August Everding pas si mal faite, revue il y a quelques années à Hambourg, ne brillait pas par son originalité, bien plutôt par sa durée de vie (presque cinquante ans), et son côté passable laissait les voix et l’orchestre envahir notre espace mental et émotionnel.
Il est difficile aujourd’hui de ne pas considérer la question de la mise en scène, devenue l’un des protagonistes obligés à l’opéra et la conquête notoire de ces quarante-cinq dernières années. On n’imagine pas une production, notamment d’Elektra, sans une grande mise en scène. La dernière qu’on porta aux nues est celle de Patrice Chéreau, parce que ce fut là son dernier travail, son chant du cygne emblématique d’une carrière qui fit entrer à l’opéra une certaine manière de faire du théâtre.
Krzysztof Warlikowski avait une quinzaine d’années au moment où le Ring de Chéreau fut la bombe que l’on sait qui ouvrit les vannes de l’ère dite – à mauvais escient- des metteurs en scène, un Ring merveilleusement dirigé, mais qui ne put bénéficier d’une génération de chanteurs – avec quelques exceptions notables – du niveau de celle d’aujourd’hui pour Wagner et Strauss.
Warlikowski a cette chance d’avoir des chanteurs exceptionnels, qui plus est très engagés au niveau théâtral, ce qui pour Elektra est indispensable. Il ne faut jamais oublier que si Elektra est un opéra, appuyé sur la tragédie grecque et le mythe des Atrides, son livret est aussi une œuvre théâtrale en soi.
A l'instar du texte d’Oscar Wilde pour Salomé qui est d’abord une pièce de théâtre, certains livrets d’Hofmannsthal ont été indifféremment proposés au théâtre et à l’opéra, c’est notamment le cas pour sa tragédie Elektra antérieure de 6 ans à la création de l’opéra, et pour Der Rosenkavalier. C’est un texte qui tient aussi sans la musique. D’où l’importance d’avoir sous la main des chanteurs-acteurs, conscients de ce qu’ils chantent et de ce qu’ils portent.
Strauss comme beaucoup de compositeurs rêvait de retrouver le sens de la tragédie grecque, une utopie aux origines même du genre opéra. Ajoutons enfin que les mythes grecs et la tragédie grecque revinrent dans le théâtre de la première moitié du XXe siècle jusqu’à la deuxième guerre mondiale, il suffit de penser en France à Anouilh, Giraudoux, Cocteau et Sartre, qui tous ont puisé dans les grands mythes grecs pour les réadapter à la lecture de leur monde.
Warlikowski est rompu à cette culture, c’est un romaniste, c’est aussi un spécialiste de théâtre grec avant d’être un praticien du théâtre : il a cette formation théorique-là. Par ailleurs, il vient d’un pays qui a donné au monde du théâtre deux de ses plus grands noms, Tadeusz Kantor et Jerzy Grotowski. La contribution de la Pologne au théâtre contemporain est évidemment déterminante sinon fondatrice. Et dans ce parcours, la première tragédie grecque qu’il met en scène est comme par hasard l’Electre de Sophocle en 1997.

Le discours inaugural de Clytemnestre : un chant parlé
Dans la tragédie, la parole est performative, c’est elle qui fait avancer l’action et elle est donc centrale. Il est déterminant d’avoir des chanteurs qu’on entend parler. Il n’y a point de hasard : c’est par une parole originelle que cette production d’Elektra s’ouvre, celle de Clytemnestre – des trois femmes le rôle le plus court mais le plus fort peut-être, et presque le plus parlé. Le monologue de Clytemnestre face à Elektra, pivot de l’œuvre est d’abord à dire avant d’être à chanter : les grandes Clytemnestre, que ce soit Regina Resnik, Astrid Varnay, ou Waltraud Meier, sont d’abord des diseuses, et c’est par le sens des mots et la couleur qu’elles dessinent le personnage. On peut chanter Clytemnestre sans la voix. Rolf Liebermann n’avait-il pas rêvé de confier le rôle à Maria Callas, autre diseuse, autre génie conscient de l’importance du texte ?
En faisant dire à Clytemnestre avant toute note de musique la justification du meurtre d’Agamemnon par le sacrifice d’Iphigénie, il fait de Clytemnestre celle qui motive le drame et donc la femme à abattre, mais aussi une victime avant d’être la criminelle et surtout une mère. Elle est la mère privée de son enfant. Une enfant qu’on voit sur l’écran, dans l’espace familial clos où trône Agamemnon sur le fauteuil central. En étant mère, Clytemnestre reconquiert une humanité qu’on lui dénie quelquefois, surtout dans Elektra et ce avant même que ne surgisse la musique.
Les personnages sont en place, Agamemnon, dont le cadavre ne quitte pas la scène, puisqu’Elektra ne cesse de l’évoquer, Clytemnestre qui selon Eschyle, l’a elle-même tué (et non Egisthe), et l’absente, Iphigénie, que Warlikowski montre (rappelons qu’il a aussi mis en scène à Paris Iphigénie en Tauride) pour souligner évidemment les chaînes de causalité qui aboutissent au drame.
Il faut toujours dans la tragédie avoir conscience du passé (et pas seulement dans la tragédie d’ailleurs…) parce que le moment tragique au théâtre est toujours le dernier jour, celui où tout va éclater, le jour de la résolution des nœuds du passé. La crise tragique est toujours une crise finale, le dernier jour des condamnés que sont les héros tragiques. Œdipe-Roi en est l’emblème, j’emploie l’exemple à dessein dans le cas d’un Warlikowski qui sur cette même scène, a mis en scène Die Bassariden de Henze, dernier jour du condamné Œdipe en 2018.
Cette parole initiale de Clytemnestre, vêtue de noir, derrière un micro, comme une performeuse scénique (on pense…à Edith Piaf, une autre maîtresse du verbe), personnage déjà frappé par le destin mais qui refuse d’être « la méchante », a quelque chose de prophétique (au sens étymologique qui DIT à l’ avance), et l’extraordinaire manière de porter le texte par Katja Ariane Baumgartner montre que l’art du chanteur est d’abord un art du dire, conforme en cela aux origines de l’opéra ‑déjà chez Monteverdi‑, où le texte a la prééminence sur la musique (Wagner s’en souviendra, bien évidemment et tous ceux qui le suivront, à commencer par Debussy).
Avant d’être confrontation vocale et musicale, c’est de texte qu’il s’agit.
Dans ce monologue venu de l’Agamemnon d’Eschyle, Clytemnestre raconte le meurtre d’Agamemnon, le revendique, en distille les détails, mais de l’autre côté Elektra écoute, réagit, comme si elle rêvait ce monologue pour justifier sa haine, sa situation, son auto-exclusion, pour tout dire sa névrose. Le monologue de Clytemnestre n’est pas en-direct c’est un produit de l’âme d’Elektra qui se l’écoute et se le ressasse, c’est d’ailleurs, comme dans les rêves un condensé, le concentré d’un dialogue de Clytemnestre et du chœur à la fin de Agamemnon d’Eschyle, comme si Elektra composait ce concentré en fonction de son ressentiment et de sa vengeance, comme si elle se repaissait des paroles de sa mère décrivant le sang d’Agamemnon comme les gouttes de rosée d’une renaissance et qu’elle en refusait l’humanité. Et la dernière question que Clytemnestre se pose qu’adviendra-t-il de moi ? trouve sa réponse dans la tragédie qui va se dérouler, la musique peut devenir alors enchaînement.
Après ce monologue d’une force inouïe, la musique éclate donc.
Mais elle n’éclate plus du néant, du silence, comme de coutume, elle éclate en renforcement du texte, en redondance dirait-on presque. Et du même coup, elle perd son effet de surprise, déplacé ailleurs. Effectivement, un des caractères de cette production, c’est que l’orchestre, malgré sa force, son volume, sa profusion, accompagne le texte et jusqu’au bout, ce sera le texte le fil-profil du spectacle.

L’espace de la tragédie
L’espace tragique est à la fois multiple et unique. On a comme pour la Salomé de Castellucci, fermé les arcades du manège des rochers et placé dès l’entrée en salle une lumière forte, jaune, qui implique scène et salle dans la boite tragique d’où l’on ne peut s’échapper. Ce qui m’a impressionné en entrant dans cette salle pourtant vaste, c’est déjà l’impression de clôture, d’étouffement, l’impression de ne pas échapper au piège (ajoutons que les masques obligatoires dans le public renforcent cette impression première), l’impression que nous sommes tous concernés par ce qui va se passer.
Sur la scène immense, l’esthétique bien reconnaissable de la scénographe Małgorzata Szczęśniak avec son univers froid, métallique, humide aussi, un univers de malaise, avec des notations qui sont pour moi référentielles et qui vont orienter ma réflexion, voire ma rêverie.
À jardin, une cage métallique, noire, telle une sorte de Kaaba (c’est la référence qui m’est venue, comme un lieu mystérieux et fermé, caché au monde, et pourtant sorte de Saint des Saints qu’on contourne et vers lequel les personnages se tournent) qui ne sera que l’espace muet des pantomimes familiales cachées, le lieu clos des haines et des crimes, un lieu presque hitchcockien étouffant, pétri des souvenirs du passé, rempli d'ombres, de personnages muets très Warlikowskiens, un espace de fantômes et un monde duquel Elektra s’est exclue et dont Chrysothemis est la passeuse, espace meublé d’un canapé et d’un fauteuil ainsi que d’une table-autel-catafalque : une salle d’attente (j'emploie ce terme à dessein, par référence à un spectacle de Krisztian Lupa) pour tragédie en cours, pour funérailles éternelles.
Tout autour un espace étrange et apparemment inattendu, un long banc qui court toute la scène en sa largeur, sur lequel des serviettes sont pliées (on pense au Parsifal de Laufenberg à Bayreuth), interrompu par une série de douches, et au milieu, à cour, un bassin allongé, rempli d’eau, comme la piscine probatique où l’on est guéri par le Seigneur, ou un bain lustral nécessaire à la purification des péchés, puisque l’eau d’après Tertullien efface les souillures. Le bain purificateur était bien connu des crétois et les palais minoens-sanctuaires étaient remplis de bains lustraux. Il s’agit donc d’un rituel religieux, qu’on doit mettre en lien avec le « cube familial noir ». Pour pénétrer dans ce monde des Atrides, mieux vaut se purifier auparavant.
Mais il n’y a jamais de hasard au théâtre où tout est signe.
Pindare et les tragiques disent qu’Agamemnon a été tué dans son bain par Clytemnestre. Cette piscine bain de purification et d’oubli est aussi lieu du crime, lieu originel d’où part le désir de vengeance d’Elektra, – et d'ailleurs le fantôme d'Agamemnon y pénètre, et c’est aussi la piscine où Oreste en entrant trempe ses pieds, c’est le lieu autour duquel les servantes s’affairent, comme pour chercher encore et toujours à effacer les traces du crime.
Et du même coup bien des gestes prennent sens : cette jeune femme qu’une servante (au sens sacré, qui sert le culte) aide ou force à se purifier sous la douche, sans doute pour un futur sacrifice, c’est l’expiation (mais douches et sacrifice renvoient aussi à d'autres effroyables souvenirs) et ces enfants innocents qui se baignent, comme pour neutraliser le souvenir criminel, c’est l’oubli, aussi pour rappeler l’innocence sacrifiée d’Iphigénie. Enfin ces enfants-mannequins, qu’on déplace autour des lieux ou autour de Clytemnestre pour marquer l’idée d’une famille fossilisée, ses trois enfants perdus, les fantômes d’une enfance innocente aujourd’hui dévastée, dont Chrysothemis, Elektra, Oreste, sont les restes lacérés.
Il y a dans ce décor toutes les strates de la tragédie, où les lieux parlent sans cesse de passé. Lieu de mémoire et lieu de la purification et du nettoyage, l’espace où évolue Elektra n’est pas l’extérieur des murs, il est espace d’Agamemnon, espace du crime, de son souvenir, de son expiation éternelle, mais aussi lieu dont on cherche à effacer la valence, d’où les enfants qui s’y baignent, innocemment – au sens propre, « sans savoir », mais où les douches aussi gardent des traces de rouille qui ressemblent bien à des traces de sang séché. Tout est signe, et tout peut être interprétable dans un sens propre ou figuré. N’est-ce pas Clytemnestre qui évoque le sang d’Agamemnon en le comparant à des gouttes de rosée ? Au palais d’Agamemnon, l’eau et le sang se confondent : se purifier dans l’eau lustrale c’est plonger dans le bain rempli du sang d’Agamemnon.
Mais en ce lever de rideau bien d‘autres choses affleurent, comme une évidence qu’on n’avait pas remarquée avec cette acuité jusqu’alors. J’ai souligné l’impression que la clôture ne se limitait pas à cette boite noire éclairée de rouge ou de pourpre, couleur de pouvoir, mais à tout l’espace scène-salle. Ce qui saisit au départ dès la première scène, c’est que ce monde clos est un monde de femmes, on a même l’espace d’un instant l’image d’un harem sans maître : il faut attendre le dernier tiers de l’œuvre pour qu’apparaissent des hommes. Harem renvoie à l’idée d’un monde clos, monde des complots, des secrets, des rapports à la fois violents et feutrés, un monde de femmes en attente du retour hypothétique d’un maître légitime, d’où les fleurs apportées par les servantes au retour d’Oreste, nouveau maître l’espace d’un instant, mais qui n’est qu’un oiseau de passage.

Elektra ou l'impossible action
Dans ce monde, Elektra n’est plus tant la souillon qui gît en remâchant sa haine aux pieds de la porte des Lionnes, elle porte (costumes très efficaces de Małgorzata Szczęśniak) une petite robe à grosses fleurs sur les volants, presque une robe de « petite jeune fille », un petit boléro et un sac en bandoulière, ce qui convient bien au format d’Ausrine Stundyté, qui n’a physiquement rien des Elektra habituelles de nos scènes d’opéra. Elle est une Elektra « soignée », qui ne respire ni l’abandon, ni la souillure, ni l’exclusion. Il y a chez Stundyté, sculptée par Warlikowski un petit quelque chose de l’Antigone d’Anouilh « c'est la petite (…) qui est assise là-bas, et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense ». Mais au contraire d’Antigone qui passe à l’acte, elle tourne en rond entre ses quatre murs en ruminant ses projets et ses rêves de vengeance tout en restant incapable de passer à l’acte : c’est une attitude adolescente, presque enfantine. Ce côté buté, enfantin mais impuissant, c’est une nouvelle Elektra qui est ici proposée, une Elektra sans envies, sans désir de futur, confinée entre des douches suspectes et un bassin, le lieu de l’obsession névrotique et sur/sous une sorte de banc sous lequel elle se réfugie au comble de la désespérance car ce banc, ce pourrait bien être la tombe d’Agamemnon. L’univers d’Elektra est bouché, obstrué par l’obsession d’Agamemnon, dont tous les murs respirent la présence (et d’ailleurs Warlikowski le donne à voir sur scène), comme si elle était certes un personnage de tragédie, mais pas un personnage tragique.
On ne le répètera jamais assez « Le héros tragique dispute à une fatalité virtuellement écrasante un destin qui n’appartient qu’à lui ». En ce sens l’archétype en est Œdipe. Cette Electre, dans l’Elektra de Hofmannsthal, sa tragédie inspirée de Sophocle (et mise en scène à la création en 1903 par Max Reinhardt, le troisième fondateur du Festival de Salzbourg, il n’y pas de hasard) ne fait que parler, sans jamais agir, car elle attend l’hypothétique retour d’Oreste pour le faire agir. Elle maudit sa sœur Chrysothemis et cette malédiction est une parole vide, puisque Chrysothemis (qui lui répond par un regard un peu incrédule) est celle qui survit, qui dit non, qui s’oppose, même si Elektra la pousse à agir (Du ! / denn du bist stark ! Toi / parce que tu es forte) Et l’Elektra de Warlikowski est cette jeune fille ravagée par la psyché qui vit dans un monde intérieur qu’elle est incapable de concrétiser. Elle est une sorte d’exilée de l’intérieur. Dans cette mise en scène, elle n’est pas l’exclue mais celle qui s’est exclue du cercle familial : elle s’est exclue du « cube » qu’on voit sur scène, sorte de nid/nœud de vipères, mais elle reste part de ce monde, puisque dans ce monde des Atrides, la prostration hitchcockienne de l’intérieur et le lieu du meurtre avec ses douches et sa piscine (et ses fantômes) sont totalement interdépendants. D’où l’extrême violence de la rencontre avec Clytemnestre, d’où aussi l’extrême tension de la relation à Chrysothemis. Chrysothemis est la passeuse, celle qui va de l’intérieur à l’extérieur, le seul lien d’Elektra avec la famille, un personnage transactionnel en quelque sorte et assez autonome. Mais dans ce travail, Elektra n’est pas le personnage central dont on l’a l’habitude, elle est presque marginalisée par les trois autres (Clytemnestre, Chrysothémis… et Oreste), dans un jeu halluciné, certes (Stundyté est une grande personnalité scénique), mais pas si différent de nos habitudes. Ce sont les autres personnages qui sont vus de manière plus neuve.

Clytemnestre entre déesse monstrueuse et faible femme
En sortant de sa clôture et en allant vers Elektra, Clytemnestre montre aussi sa faiblesse et sa dépendance, elle montre une humanité qu’on avait perçue dans son monologue initial et elle cherche aussi à rompre sa malédiction interne. Elle continue à ne pas se remettre du meurtre d’Agamemnon, à chercher à expier, à se justifier pour pouvoir vivre et éviter la vengeance. L’héroïne tragique qui ouvre le spectacle est en noir, la femme angoissée qui vient voir Elektra est en rouge, rouge sang, rouge passion. Et d’une certaine manière, en choisissant Egisthe, un médiocre, elle a choisi la solitude. Elle essaie aussi d’expier au quotidien, un quotidien gâché par le sacrifice d’Iphigénie dont elle ne se remet pas, dont elle n’a pas fait le deuil dirait-on aujourd’hui, mais le meurtre d’Agamemnon est une vengeance humaine qui n'a rien résolu, puisqu’elle continue à être inquiète, notamment du retour d’Oreste dont un oracle lui a prédit le retour meurtrier. Comme toujours lorsqu’un oracle est menaçant, on cherche à s’y soustraire et elle éloigne Oreste enfant en le donnant à tuer. Sous le regard des Dieux et sous le regard d’Elektra qui est un reproche vivant, elle ne peut échapper au destin. D’où cette confrontation ultime avec Elektra, qu’elle va essayer d’amadouer, une confrontation qui souligne aussi leur lien : les cheveux de Clytemnestre, ordonnées mais épais, ressemblent à ceux d’Elektra, tout aussi épais (ceux de Chrysothemis sont lisses ou lissés), les liens du sang ne peuvent tromper, combat de monstres… Et au rouge du vêtement de Clytemnestre répond le boléro rouge d’Elektra, – rouge à demi, dirait-on et le rouge des fleurs, comme des fleurs teintées de la rosée du sang d’Agamnemnon. Clytemnestre va loin dans une sorte d’impudeur qui est aussi intimité devant sa fille : elle se défait de ses chaussures, de tous ses bijoux protecteurs, et d’une certaine manière elle se met à nu. Elle a renvoyé ses servantes plus ou moins espionnes d’Egisthe, qui la poussent à expier ses rêves et malaises par des sacrifices. Elle va essayer de séduire, d’argumenter, de quémander en position d’infériorité (extraordinaire performance d’actrice de Tanja Ariane Baumgartner, véritable hommage à l’esthétique expressionniste), mais que vaut un argument face à un bloc fermé comme Elektra. Alors au contraire de Chéreau qui cherchait à montrer entre elles une tendresse manquée, une mère perdue face à une fille perdue et éperdue, Warlikowski fait de cette rencontre un choc mur à mur, d’une violence d’abord rentrée et puis terriblement exprimée dans son effrayante clairvoyance : Clytemnestre est venue chercher un moyen d’échapper à ses cauchemars , et la (clair)voyante Elektra lui renvoie la vérité, la crainte du retour d’Oreste et la crainte d’une mort dont le récit fait étrangement écho à son propre récit initial de la mort d’Agamemnon, jusqu’à l’évocation de filets de sang quand Clytemnestre parlait du filet qui emprisonnait le roi pour l’empêcher de s’échapper, jusqu’à la bloquer contre les douches où l’on voyait plus tôt une fille à sacrifier. Image saisissante de la fille et de la mère, accolées chacune à une paroi du « cube clos » que j’ai appelé plus haut Kaaba, de cet espace familial qu’Elektra abhorre et dont elle s’est exclue, avec une Clytemnestre qui avait nerveusement repris ses bijoux protecteurs (qui n’ont plus d’ailleurs aucun effet) écroulée et vaincue face à une Elektra en proie à la folie évocatoire. Et c’est Chrysothemis qui vient chercher sa mère (dans beaucoup de mises en scène, ce sont ses servantes ou ses confidentes) directement et l’entraîne à l’intérieur.
Chrysothemis, ou la surprise de cette mise en scène.
Chrysothemis semble être la troisième et la moins importante des trois femmes qui dominent l’œuvre. D’abord, elle s’affiche comme celle qui veut vivre, qui veut s’échapper de l’étouffoir, de l’assommoir que constitue le palais et ses fantômes, ensuite, c’est celle qui par rapport à Elektra, est élégante, conforme, et qui dans la tragédie finit la seule sur scène, vivante, ce qui dans une tragédie est souvent un défaut. Le personnage qui reste vivant n’a pas droit à la grandeur. D’ailleurs, si le nom d’Electre est sur les lèvres, celui de Chrysothemis a disparu des mémoires.
Dans la tragédie grecque, Chrysothemis, un peu comme Ismène par rapport à Antigone, est celle qui essaie de limiter les dégâts, une représentante du monde relatif, une sorte d’intermédiaire entre Electre et le palais qui veut éviter l’irréparable pour préserver également son choix de vie.
Cet aspect est souligné chez Hofmannsthal où elle évoque aussi le choix du désir, du mariage, un choix de normalité qui va à rebours du rêve d’Elektra.
Nous aborderons plus avant l’incarnation, il n’y a pas d’autres mot, d’Asmik Grigorian dans ce rôle dont elle s’empare, et qu’elle impose immédiatement. Warlikowski et Szczęśniak la coiffent déjà différemment, si Elektra et Clytemnestre ont des coiffures assez voisines par le volume, Chrysothemis se différencie par des cheveux longs et lisses et dans la représentation vue le 24 août, un petit chignon dominant les cheveux longs. Elle s’affiche donc différente, par nature et aussi par choix du vêtement, un petit tailleur très ajusté aux reflets argent et des hauts talons, on découvrira plus tard un soutien-gorge rouge, érotiquement marqué, qui montre le désir installé dans ce corps. Là où Elektra est vêtue en jeune fille, sorte de post-adolescente, Chrysothemis est déjà femme.
Chrysothemis fait l’aller-retour entre deux étouffoirs, celui du palais, clos et renfermé sur le souvenir obsédant du meurtre, et celui d’Elektra, univers froid et aquatique, tombe d’Agamemnon et mémorial du meurtre. Elle en est l’élément-lien, c’est pourquoi elle vient chercher sa mère assommée par les paroles vipérines d’Elektra à la fin de leur scène. Cette Chrysothemis n’est ni victime ni un être faible : d’ailleurs Elektra le lui rappelle (voir plus haut : Du ! / denn du bist stark !)((Toi ! / Parce que tu es forte)), elle poursuit elle-aussi son chemin, d’où la confrontation d’une grande violence des deux sœurs quand on apprend la mort d’Oreste.
Chez Warlikowski, Chrysothemis n’est ni une suiveuse ni un faire-valoir, c’est une protagoniste qui existe et qui résiste, et qui finit par « prendre le pouvoir ». C’est elle qui achève Egisthe, parachevant le crime fondateur qui venge le meurtre d’Agamemnon.
On se souvient que chez Chéreau, Oreste laissait ce soin à son serviteur (le mythique Franz Mazura, récemment disparu) comme pour dire, « je ne me salis pas du sang des seconds couteaux », Warlikowski qui s’en souvient peut-être montre Chrysothemis l’espace d’un instant achevant Egisthe, comme au contraire une manière pour elle de reprendre la main et d’acquérir une sorte de légitimité (on connaît dans les mythologies de l’antiquité gréco-romaine la valence des crimes fondateurs – Romulus et Remus par exemple). Et dans la dernière scène de l’opéra, elle a les mains et le visage tachés de sang, la voilà à son tour éclaboussée par ce sang fondateur, cette rosée (pour reprendre l’expression initiale de Clytemnestre) qui est renaissance, la voilà partie prenante, quand Oreste fuit et qu’Elektra (chez Warlikowski) se suicide parce que tous deux sont exclusivement mobilisés par le crime à accomplir et qu’ils n’ont jamais pu envisager le monde d’après. La voilà correspondant étrangement aux mots d’Oreste dans son monologue final dans Les Mouches de Sartre (A présent, je suis des vôtres, ô mes sujets, nous sommes liés par le sang, et je mérite d'être votre roi.). La voilà qui se substitue à Oreste.
La prise de pouvoir par Chrysothemis… Mycènes attendait un maître… C’est un peu un coup de théâtre final. On a l’habitude d’entendre Chrysothemis perdue, seule vivante au milieu des cadavres, appeler Oreste au secours. Elle reste seule, mais elle rappelle Oreste comme pour le sauver, pour qu’il échappe aux mouches…Sur elle se résout le drame.
Cette Chrysothemis qui est vie prend le pouvoir et très perceptiblement Warlikowski la montre résolutrice. L’immense flaque de sang envahie de mouches qui avait explosé au moment du meurtre de Clytemnestre (merci encore Jean-Paul Sartre !) est dévorée et finit par disparaître ainsi que les mouches sur Mycènes.
Quelque chose de nouveau peut naître.

Oreste, l’oiseau de passage
Quatrième personnage du drame, le seul homme parmi les protagonistes, Oreste, qu’on croyait mort, et qui vient pour accomplir la vengeance. Il faut là aussi souligner la performance de Derek Welton, qui est une voix, riche, profonde, mais qui n’est en quelque sorte que voix. Une voix peu expressive, presque mécanique, d’un personnage qui entre en scène comme mû par une force supérieure (le destin ?), un personnage comme manœuvré, sans personnalité, un ado retardé (il est bien le frère d’Elektra), avec son pull Jacquard d’ado retardé, avec son pas presque robotisé, avec des gestes comme commandés d’ailleurs, comme cette manière qu’il a de se purifier les pieds dans le bain « lustral » souvenir du meurtre d’Agamemnon, manière aussi de se lier physiquement à ce passé. Cette mécanique est venue pour tuer, et l’entrevue avec Elektra est presque un malentendu : magnifique Ausrine Stundyté qui croit le pousser à tuer, alors qu’il n’est que machine à tuer. L’épisode de la hache prend d’ailleurs tout son sens. Elektra cherche nerveusement la hache et pour ce faire prend prosaïquement dans son sac à main un outil (une lime ?) pour gratter, manière discrètement ironique pour Warlikowski d’indiquer la vanité du geste, et elle récupère la hache sous le banc-tombe. Pour Elektra, la hache, comme le labrus, la double-hache symbole religieux crétois, est l’objet avec lequel le rituel du meurtre devrait être réalisé. Oreste arrive sans cette idée de rituel, ruminée par Elektra des années durant, incapable de le réaliser elle-même et qui attend Oreste pour le faire. Oreste arrive comme une mécanique, chargé de tuer, dressé pour, il va tuer avec le moyen du bord, un couteau, presque sans investissement sacral, comme un simple assassin. Il y a là comme deux destins parallèles l’une est pensée, psychè, rumination, l’autre est machine, et comme des parallèles, ils se rejoignent à l’infini. Le plan d’Elektra se réalise sans elle et sans la mise en scène dont elle avait rêvé. Cet Oreste inexpressif, qui est dressé pour le meurtre, après le meurtre se réveille et va être pris par le remords et les Érinyes : il va commencer alors sa vie d’errance qui est sa vraie vie…
Ainsi donc Elektra dont le seul but était le meurtre de sa mère et d’Egisthe, est au bout de son rêve, qui n’a même pas été réalisé dans la forme qu’elle rêvait, tandis qu’Oreste commence sa vie de remords. La seule qui volontairement prend part à un meurtre qu’elle n’avait ni voulu, ni prémédité, qui prend une décision qui la mène au-delà, qui domine son destin et en décide, c’est Chrysothémis, vivante, et – on le suppose, sans regrets.
Tels sont les personnages reprofilés par Warlikowski, toujours soucieux de souligner un contexte, des motivations, et des psychologies. Clytemnestre craignant qu’Oreste ne vive, mais victime de l’ironie tragique de l’annonce de sa mort, Elektra ne vivant que pour qu’Oreste revienne accomplir le meurtre, incapable de faire sans Oreste et qu’Oreste accomplit sans elle. Tout cela a quelque chose non de tragique, mais de pathétique, d’humain, trop humain. Elektra fait tuer et se suicide, Oreste arrive, tue, passe et part, et Chrysothemis s’empare du sens de l’histoire et de l’après : tout cela est une saisissante ligne dramaturgique.
Autour des personnages reprofilés, une dramaturgie
Il reste à contextualiser cette ligne, et la mise en scène abonde de signes et de détails dont nous avons évoqué certains. D’abord cette impression initiale de monde de femmes clos, voire de harem sans maître que nous avons évoqué, et que l’arrivée d’Oreste (les servantes lui apportent des fleurs en signe de bienvenue) semble résoudre. Cela signifie aussi d’une part que c’est le chef légitime qui revient et donc que le pouvoir Clytemnestre/Egisthe est pour le petit monde du palais illégitime. Mais Oreste n’est pas un futur roi, puisque le meurtre est fondateur pour lui d’une vie de remords et d’errance.
Chrysothemis va acquérir par le sang une légitimité inattendue, seule survivante d’un massacre (Warlikowski laisse entendre que le meurtre du couple est en fait un massacre qui touche aussi l’entourage), ce que j’ai appelé Kaaba, ce cube noir éclairé de l’intérieur de rouge et de pourpre devient un immense tombeau.
Un monde qui attend
L’intérieur du cube avait quelque chose d’un monde étouffant en attente, souvenir du sacrifice d’Iphigénie (en vidéo) où l’on voyait Agamemnon sur le fauteuil qui a la fin est occupé par le cadavre de Clytemnestre, selon le vieux principe de permanence des lieux sacrés, et cet espace intérieur est une salle d’attente traversée de ses fantômes, de ses cadavres et de ses sacrifices : on attend la crise finale.
Un monde en attente est un monde qui n’avance pas. L’autre côté avec la piscine, les douches, ce que j’ai appelé l’espace d’Elektra n’avançait pas plus. Il faut attendre le meurtre de Clytemnestre pour que les deux fusionnent, pour que tout bouge puisque l’espace intérieur vient recouvrir la piscine, comme pour l’effacer : le meurtre de Clytemnestre et Egisthe résout l’espace et le transforme, il unifie physiquement ce monde que Warlikowski nous montrait étouffer partout, mais divisé en deux. Cela confirme d’ailleurs que la piscine en question était bien le lieu du bain fatal d’Agamemnon, avec ses traces, ses rites et ses angoisses. Le cube devient alors presque « monument » à Agamemnon.
La médiocrité du petit monde
Les servantes (au sens religieux ?) semblent ne pas être atteintes par la sacralisation du lieu, elles goûtent l’eau de la piscine, y trempent leurs pieds, bavardent, tandis qu’au fond une jeune femme est lavée avec soin sous la douche (purifiée ?) sans doute l’un des sacrifices que Clytemnestre accomplit au quotidien pour effacer ses rêves. Un monde de bavardage et d’ennui (ce qui m’a renvoyé à la représentation d’un harem) et donc de méchanceté et de cruauté, un monde régi et organisé aussi par Egisthe (référence à ce que dit Clytemnestre de ses servantes qui l’observent au plus près et la conseillent) et à dire un monde petit. Une excroissance du monde interne qu’Elektra s’interdit de pénétrer. Et parmi elles, des servantes chargées de déplacer les trois mannequins enfantins distribués sur la scène et qu’on va placer autour de Clytemnestre, la mère coupable, et en même temps trace permanente de l’idée de famille (les Atrides) qui pèse littéralement sur le lieu, trace presque momifiée par ces mannequins.

L’écran
Enfin il y a l’écran. Comme souvent, Warlikowski montre l’évocatoire à l’écran, ici deux visions puissantes :
- d’une part, celle de la petite Iphigénie qui joue devant son père et qui tient la hache qui va la tuer, vision médiatisée par Clytemnestre décrivant le meurtre de sa fille, et surtout l’accueil d’Agamemnon par Iphigénie aux Enfers : ces images sont donc doublement évocatoires.
- et d’autre part dès que le meurtre « réparateur » est accompli, une immense flaque de sang recouvre les murs immenses de la Felsenreitschule et couvre pratiquement la scène. Et immédiatement autour du sang viennent les mouches, ce marqueur du remords qui toujours plus nombreuses envahissent la tache de sang et la réduisent.
Un Warlikowski sartrien ?
La pièce de Jean Paul Sartre (bien passée de mode) – Les Mouches (sa première pièce en 1943)- traite de la vengeance d’Oreste, et de l’impossibilité pour lui d’effacer le remords – La vision d’un Oreste venu pour libérer les autres de la malédiction née du crime de Clytemnestre, mais qui s’en va entraînant avec lui les mouches disparues de la ville qui vont désormais le poursuivre. Écoutons le monologue final d’Oreste déjà cité plus haut : « Vos fautes et vos remords, vos angoisses nocturnes, le crime d'Égisthe, tout est à moi, je prends tout sur moi. Ne craignez plus vos morts, ce sont mes morts. Et voyez : vos mouches fidèles vous ont quittés pour moi. Mais n'ayez crainte, gens d'Argos : je ne m'assiérai pas, tout sanglant, sur le trône de ma victime : un Dieu me l'a offert et j 'ai dit non. Je veux être un roi sans terre et sans sujets . Adieu, mes hommes, tentez de vivre : tout est neuf ici, tout est à commencer. »
Warlikowski serait-il sartrien ?
Un choix de distribution imposé par le projet dramaturgique
Dans un tel travail de mise en scène où Warlikowski respecte le déroulement de la tragédie, mais en transforme la vision générale à partir du travail sur les personnages et le sens de leur action, où le texte proféré – et donc le théâtre – a une telle importance, il est impossible de juger des voix et de la musique indépendamment du projet théâtral. Une fois de plus, la dramaturgie détermine le sens de la musique, et surtout du choix des voix. Une fois de plus et une fois encore n’en déplaise à ceux qui lisent l’opéra à l’aune des voix, les choix vocaux sont déterminés par les choix dramaturgiques : cette Elektra aurait été impossible avec une Nilsson, ou plus près de nous, une Theorin ou une Herlitzius.
Tout aussi impossible dans ce travail sur les personnages une Clytemnestre aussi intérieure que celle de Waltraud Meier. Il fallait aussi un Oreste jeune, à la voix puissante et un peu mécanique, volontairement légèrement métallique. Et il fallait une Chrysothemis qui soit d’abord une bête de scène, et surtout qui ne puisse apparaître « dominée » comme l’était par exemple la Pieczonka chez Chéreau. On a souvent d’ailleurs ces dernières années un peu effacé Chrysothemis des autres protagonistes, au profit d’un rôle de faire valoir parce que l’attention de la plupart des distributions se concentrait autour du couple Clytemnestre-Elektra. Dans mon souvenir référence de 1974–75, Nilsson et Rysanek au sommet de leur gloire, étaient à peu près égales en puissance, en volume, en présence, même si leur voix avaient des couleurs très différentes, comme entre une Sieglinde et une Brünnhilde et Clytemnestre était portée par deux des voix les plus légendaires, déjà à l’époque, Christa Ludwig (1974) et Astrid Varnay (1975). Dans bien des productions récentes, il y a des Chrysothemis un peu passe-partout, comme si tout devait se concentrer autour des deux autres.
Les personnages de complément
Il y a donc autour des quatre protagonistes de nombreux personnages annexes, serviteurs, servantes, qui passent et qui ont une ou deux répliques : tous sont à leur place. Dans un festival comme Salzbourg pas de droit à l’erreur dans aucun choix de rôle. Les servantes de la première scène sont vraiment excellentes, et on signalera la troisième servante de Deniz Uzun, avec une belle projection, une voix large, charnue, qu’on avait déjà remarquée à Zurich où elle chantait Krista dans L’affaire Makropoulos l’automne 2019. Nous avions écrit d’elle : « (elle) montre une fraicheur, une présence vocale et scénique, une énergie et une intensité toute particulières. À suivre. ».
Et puis il y a Egisthe, traité complètement différemment de l’habitude, interprété par l’excellent Michael Laurenz, jetant au passage un regard lubrique sur Chrysothemis qui n’hésite pas à le provoquer de manière caricaturale…
Cet Egisthe a le profil de la banalité, chemise, costume cravate, il n’a pas le profil de l’ivrogne, et Laurenz n’a pas la voix du ténor de caractère qui habituellement l’incarne. Il est médiocrement normal. La banalité du mal, chère à Hannah Arendt.
Et d’ailleurs, Clytemnestre le laisse entendre, n’a‑t‑il pas fait des servantes qui assistent au plus près Clytemnestre des sortes d’espionnes qu’il a dressées (et avec qui il a peut-être aussi couché, vu le regard dont il gratifie Chrysothemis). Cet Egisthe, c’est la clef de voûte de ce système illégitime, vaguement fasciste, propre sur soi et pourri de l’intérieur. Face à Clytemnestre qui débat avec les dieux, Egisthe est le politique, dans l’acception la plus médiocre. L’assassinat de Clytemnestre est un devoir rituel, celui d’Egisthe un assassinat politique achevé par une Chrysothémis qui choisit le siècle, le temporel et pas le spirituel.
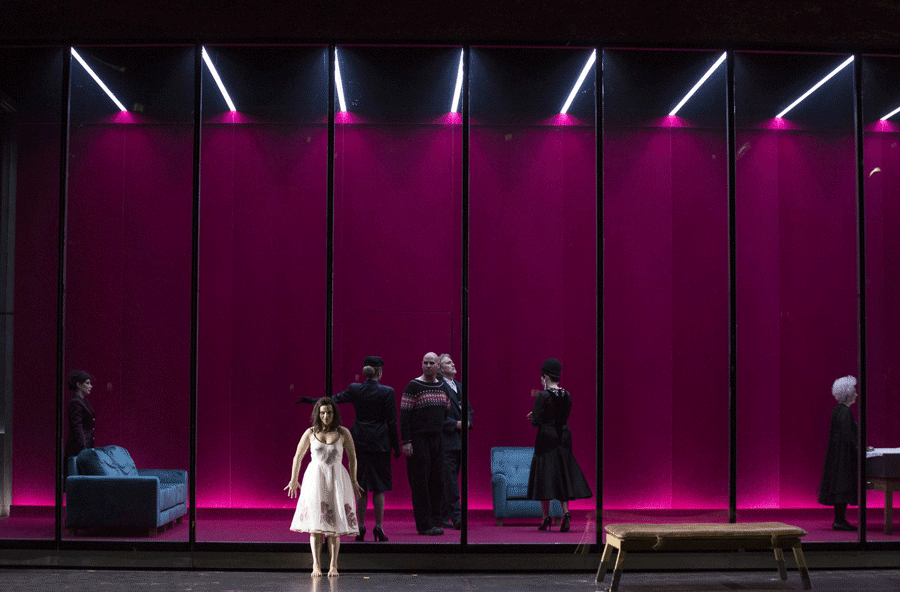
Derek Welton, étranger dans la ville, voyageur sans bagage
Le choix scénique de Warlikowski impose de revenir à une égalité au sommet entre les trois femmes en y ajoutant Oreste, dont le profilage est inhabituel : pour moi on revient à la vérité première de cette œuvre, qu’il est impossible de ne pas distribuer à des phares de l’interprétation, mais Warlikowski fait d’Oreste un personnage, étrange, presque camusien, un étranger. Derek Welton, que nous connaissons bien (il est le Klingsor de la production actuelle de Parsifal à Bayreuth et l’un des piliers de la Deutsche Oper de Berlin) s’impose ici par une composition réussie dans la voix comme dans le jeu. Il a une voix glaciale et inexpressive, et son entrée est soulignée par un éclairage bleu nuit aux reflets métalliques qui laisse entrer un mystère pesant sur scène. Jusque-là, les éclairages de Felice Ross étaient plutôt vifs et clairs (des rouges, des pourpres, des ors), ici ce sont les reflets métalliques des douches, la nuit, comme dans un film noir. L’entrée furtive d’un Oreste qui ressemble à celle d’un Jack l’éventreur dans Lulu. Il a toute l’allure d’un ordinaire, complètement anonyme, et le regard un peu perdu de celui qui est conduit par une force mystérieuse, le destin.
Oreste n’est pas un rôle facile parce qu’il est épisodique et aussi parce que musicalement, le grand monologue de la reconnaissance d’Elektra, l’un des moments les plus lyriques de la partition, occupe l’essentiel de la scène. Le personnage ne peut être que vécu comme secondaire. Derek Welton réussit à faire exister le rôle dans son inexistence – on peut oser ce paradoxe. Il réussit à personnifier l’impersonnel et le machinal, à personnifier un peu le killer psychopathe et la voix, puissante, sonore, mais peu expressive n’en est que plus saisissante. La rencontre devient rencontre de deux âmes perdues et Welton ensuite ne sera qu’un héros de pantomime, avec son pas hésitant et mécanique (sa sortie de scène) et sa descente finale dans la salle, devenue symbole d’extérieur et de fuite quand habituellement il disparaît de la scène quelquefois même à l’insu de tous, sans être vu : il y a ici un départ « théâtral » qui n’a rien du hasard. Il faut qu’il soit vu…catharsis, quand tu nous tiens. Et Welton en fait une véritable incarnation.
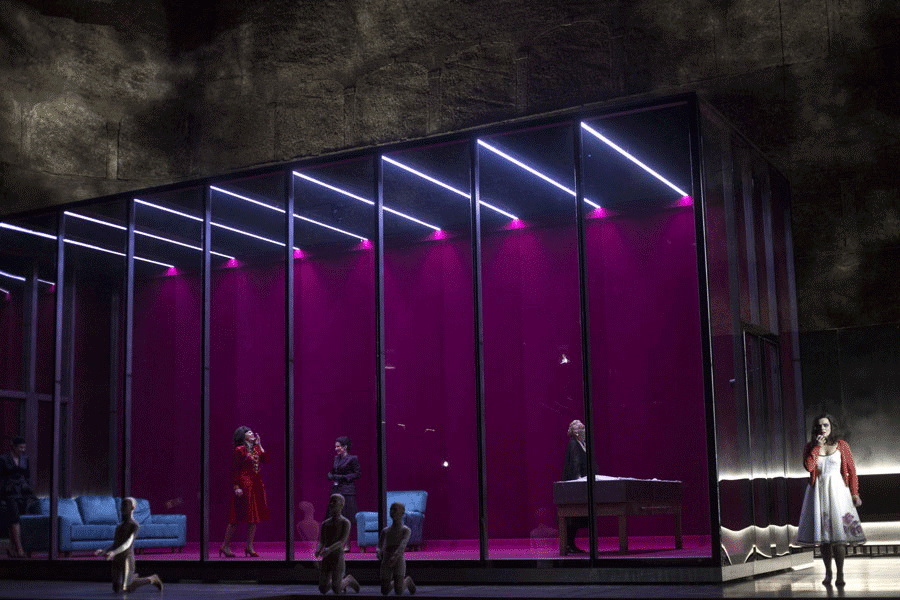
Ausrine Stundyté ou l’Elektra format jeune fille
Les discussions autour de la nature des voix n’ont d’intérêt que si elles apportent quelque chose au drame, littéralement « à ce qui se passe ». Évidemment Ausrine Stundyté n’a pas le format vocal d’une Elektra ordinaire, mais dans cette dramaturgie, elle n’a pas non plus le format scénique d’une dominante. Elle est l’un des quatre personnages et pas forcément le plus important, ou celui qui va nous frapper le plus. Stundyté réussit néanmoins à imposer ce personnage qui est proie de son illusion d’action sans jamais arriver à agir et qui ne cesse de tourner à vide. Et la voix suit ce chemin, une voix expressive, hallucinée, mais pas si imposante, une voix qui débat, qui est dans l’arène, toujours présente, mais qui ne s’impose pas. Sans cesse Welser-Möst allège, atténue, pour qu’elle soit entendue, pour que le texte soit clair : on n’est pas devant l’ouragan qui bouscule tout, il fallait une voix qui ne bousculât pas pour appuyer la conception dramaturgique partagée. Et ce n’est pas trahir l’œuvre, parce qu’il n’y a là rien qui ne soit justifiable. Elektra a la voix de son joli costume de jeune fille, une voix puissante et forte, mais égale aux autres parce que le personnage qu’elle incarne n’arrive pas à dominer, et il n’écrase donc pas de son volume le plateau. C’est peut-être un profil neuf pour Elektra, assez cohérent avec Hofmannsthal, et qui peut-être aurait ravi les deux créateurs. Il reste que la performance vocale, avec ses moyens, et la performance scénique sont impressionnantes : ce visage juvénile un peu mutin et cette voix quelquefois séductrice, d’autres fois désespérée, ailleurs insinuante et perverse, aux couleurs variées, guidée par une intelligence interprétative de tous les instants auront marqué la soirée.
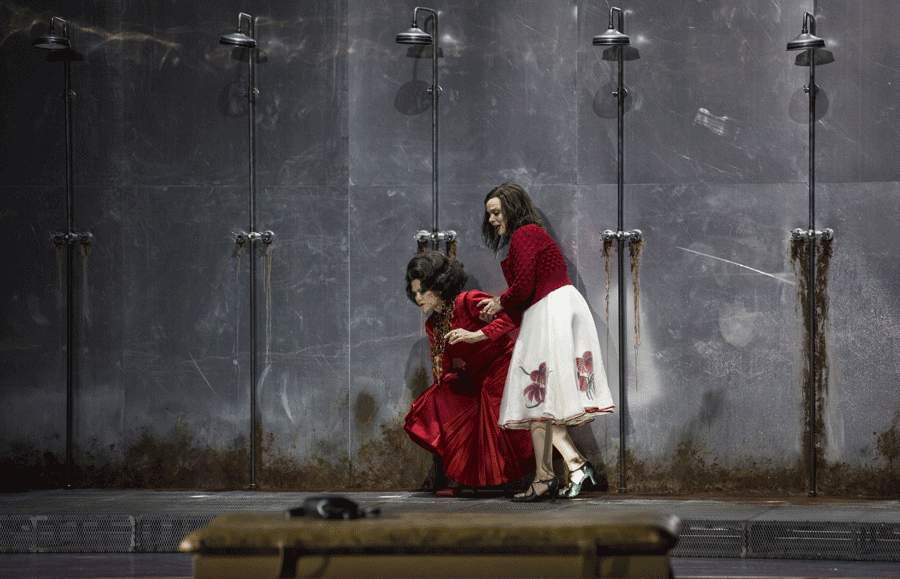
Habemus Clytaemnestram
Tanja Ariane Baumgartner est une immense tragédienne. Quand elle parle, elle en a la voix rauque et acide, et son chant a une puissance et une expressivité tout à fait exceptionnelles pour un rôle qui s’est décliné sur des modes très divers, de la vieille folle couverte de grigris (Varnay), du monstre à la fois effrayant et pris de terreur (Resnik), à la reine qui est aussi mère et femme (Meier). Et chaque vision peut trouver dans le texte sa justification.
Nous avons ici une autre Clytemnestre, mûre mais pas vieille, une femme, affirmée, angoissée, mais aussi un spécimen de divinité (sa fille lui dit d’ailleurs, « Die Götter ! bist doch selber eine Göttin ! » ((Les dieuxi Tu es toi-même une déesse)). Elle vient chercher une familiarité chez Elektra qu’elle ressent peut-être comme proche d’elle ou dont elle a une sorte de nostalgie. Elle se met à nu, se couche sur ce banc-tombe, comme le fera plus tard Elektra elle-même, elle est de plain-pied avec sa fille à qui elle veut parler. La performance vocale est impressionnante parce que son chant découle de ses paroles, d’une grande clarté, expressives, variées, avec une impressionnante palette de couleurs, mais aussi de volume, du cri au murmure. C’est une Clytemnestre qu’on n’a peut-être pas envie de connaître mais qui a une vie intérieure intense et le fait ressentir sur la peau du spectateur. Dans son duel avec Elektra survit la femme que nous avons découverte au prologue parlé et si elle perd formellement la partie, écroulée et défaite, elle la gagne auprès du spectateur, elle réussit à rendre ce personnage touchant, lui aussi perdu, et terriblement seul ; c’est Elektra qui apparaît presque comme le monstre, d’autant plus monstrueux qu’il revêt les habits d’une petite jeune fille. À travers cette femme défaite qu’on va ramasser, Tanja Ariane Baumgartner réussit à faire ressentir ce nœud de contradictions, de douleurs, de peurs, qui est aussi quête, d’un regard, d’un échange, d’une esquisse de complicité d’un dialogue qu’elle n’a pas ou plus à l’intérieur de son palais tombeau.
Elle est reine-déesse dans la première partie, assise comme sur un trône face à ses servantes espionnes, elle leur parle et parle à Elektra en même temps en gardant une distance y compris un peu sentencieuse « Was die Wahrheit ist, das bringt kein Mensch heraus » ((ce qu’est la vérité, aucun homme ne le sait)), elle évoque les sacrifices incessants, ce contact presque atavique avec le sang (d’où cette robe) avec des expressions glaçantes, et puis seule à seule avec sa fille, elle change d’attitude, elle « s’humanise », elle s’humilie même.
Dans sa robe rouge sang, débarrassée de ses atours et pieds nus, elle gagne quelque chose d’une humanité – cette normalité qu’elle n’a pas toujours dans d’autres productions. Nous nous trouvons devant une interprétation supérieure, parce qu’elle réussit à être à la fois intérieure et expressionniste, écrasante et écrasée, déesse, reine et femme, monstrueuse et pitoyable. Tanja Ariane Baumgartner est magistrale et s’installe pour longtemps au sommet des Clytemnestre de référence.

Asmik Grigorian, Chrysothemis de légende
Et puis il y a Chrysothemis vue la plupart du temps comme un personnage pâle et sans colonne vertébrale, ce qui semble difficile à admettre quand on entend la voix que Strauss lui donne, aussi énorme que celle d’Elektra ou presque.
Warlikowski part de l’opposition des caractères. L’un compose avec le monde familial, le et l’autre pas. Chrysothemis est des trois femmes peut-être la plus vivante et la plus vibrante, c’est du moins ce que l’interprétation éblouissante d’Asmik Grigorian nous fait entendre. Depuis longtemps je n’avais entendu une Chrysothemis aussi intense, une voix aussi expressive, un texte aussi merveilleusement distillé, un personnage aussi incarné, une personnalité pareille. Cette Chrysothemis bouscule, parce qu’au-delà de son petit tailleur argent qui nous la ferait passer pour une futile, elle prend sans cesse un poids déterminant sur scène, elle est pure incarnation de cette femme qui joue les médiatrices entre la famille et l’exclue, et qui n’aspire qu’à sortir de ce tunnel. La voix est claire, lumineuse, les aigus incroyables de tenue et d’homogénéité, on entend derrière déjà une future héroïne wagnérienne, une Senta, sinon une Sieglinde. En Salomé, en Marie, en Marietta Asmik Grigorian a déjà depuis longtemps convaincu. En Chrysothemis, elle emporte, elle nous enlève par son intensité, par l’émotion qu’elle distille, par la justesse du jeu, par la présence inouïe en scène. L’opposition de timbres face à Stundyté correspond à l’opposition des deux personnages, qui savent chacune défendre un territoire différent : Stundyté est ailleurs et chante ailleurs, comme emportée par son obsession, Grigorian est dedans, dans le drame dont elle se dépatouille, elle nous émeut aussi parce que Warlikowski nous la rend proche, terrestre. D’où ce coup de théâtre et coup d’éclat quand nous la voyons elle aussi qui était toute élégante et proprette, plonger les mains dans le sang pour saisir son destin : dans la scène finale elle s’occupe d’abord d’Oreste qu’elle assoit et réconforte après le crime et puis d’Elektra, et c’est sa voix qui domine, qui appelle, qui sollicite, c’est aussi sur ses cris que l’opéra se clôt. La voix est d’une stupéfiante stabilité sur tout le registre, mais avec une maîtrise technique et un sens de la variation des couleurs, du volume, du timbre même, lumineux, sachant à chaque fois provoquer l’émotion et faire ressentir les intentions. Là aussi l’interprétation est magistrale.
Un orchestre superlatif
Et tout est porté par un orchestre dirigé par un Franz Welser-Möst jamais entendu aussi convaincant, engagé, et surtout soucieux des voix, du plateau et de ce qui s‘y passe. Welser-Möst réussit à moduler sans cesse l’orchestre, pour accompagner les voix (c’est très clair avec Stundyté) et faire que tout le texte soit clairement perceptible. On lui reproche souvent de jouer fort, ici, il joue juste, suivi par un Philharmonique de Vienne stupéfiant, kaléidoscope de couleurs, de nuances, de clarté qui n’est pas sans rappeler ce qu’il faisait jadis avec Böhm. Dans cette lecture, du chef comme de l’orchestre, c’est la référence qui vient immédiatement à l’esprit, comme un héritage encore proche et encore ressenti, presque fondateur. Il y a dans l’orchestre à la fois la violence, la tendresse, le mystère, tout s’enchaine avec le souci d'une dramaturgie, y compris en fosse, tout à fait stupéfiant : on a là sans contexte une des interprétations récentes d’Elektra les plus impressionnantes qu’il ait été donné d’entendre, parce qu’il y a totale cohérence, totale osmose entre plateau et fosse, et aussi joie de jouer de manière engagée, mais aussi qu'on est proche d'une vérité musicale de cet opéra, d'un Ur-Strauss qu'on ressent par l'alliance de ce qu'on voit et qu'on entend. C’est bien une fois de plus l’idée pourtant banale qui s’impose : il n’y a pas de grand spectacle sans entente entre fosse et plateau, entre chef et metteur en scène. On ne peut aujourd’hui, au XXIe siècle, monter un projet aussi important sans le construire ensemble, on ne peut concevoir un spectacle où le projet musical serait indépendant du projet scénique. Ce qui fonctionne ici, c’est la cohérence d’ensemble où à chaque inflexion du texte correspond une nuance, une couleur de l’orchestre ou d’un instrument singulier. Pas de dentelle dramaturgique sans dentelle musicale.
Le Philharmonique de Vienne déchaîné et maîtrisé à la fois, qui retrouve là son répertoire atavique nous laisse rêveur avec un chef vraiment prodigieux et une mise en scène qui relit le mythe et replace la tragédie grecque dans son rôle de guide de nos mythologies contemporaines, voilà qui achève de consacrer une production qui sans nul doute restera dans les annales du Festival et de l’interprétation straussienne, un merveilleux cadeau pour le centenaire de Salzbourg, une merveilleuse renaissance.
Vidéo disponible sur ArteConcert jusqu'au 31 /10/2020
https://www.arte.tv/fr/videos/098928–000‑A/elektra-de-richard-strauss/

