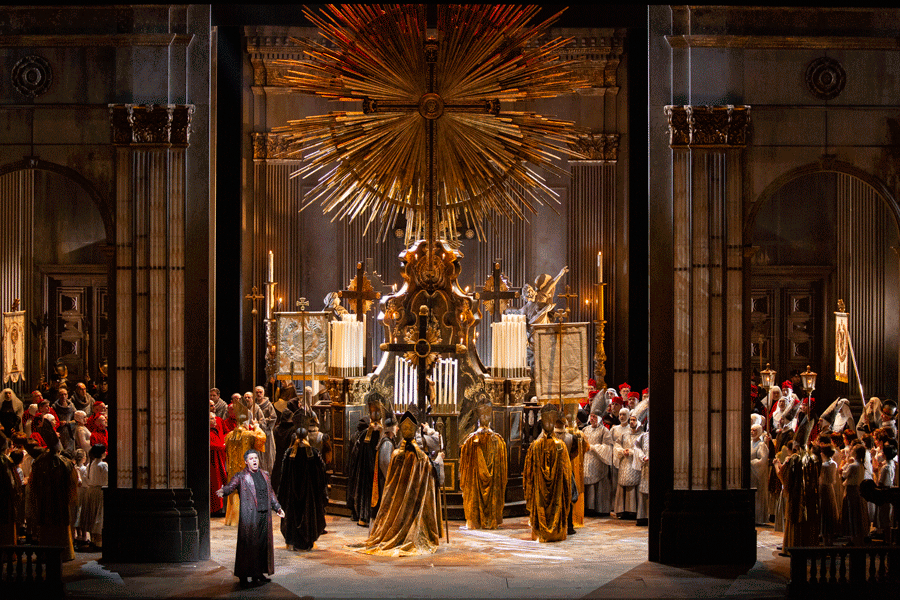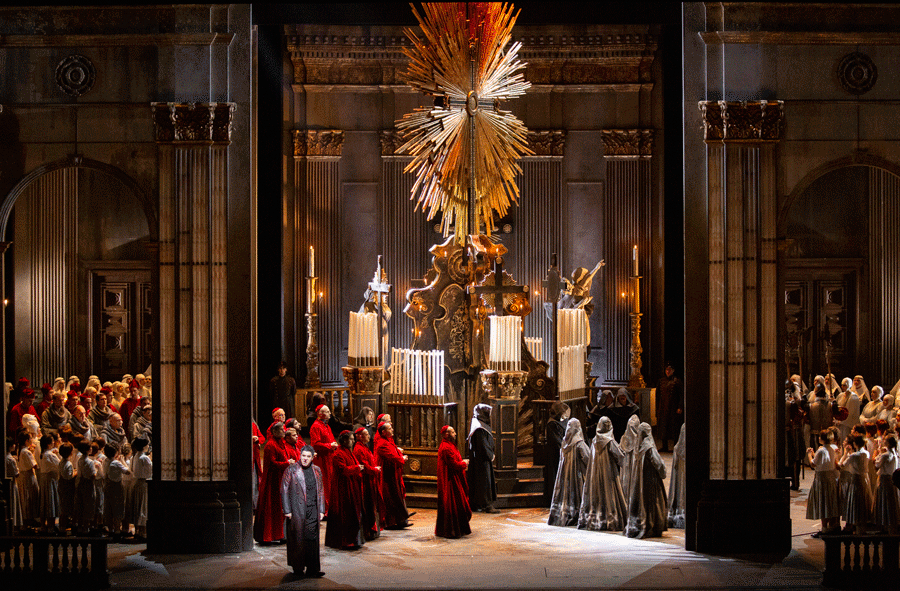
La fonction de la « Prima » à la Scala est multiple, d’une part faire rentrer un peu d’argent dans les caisses (à 2400 Euros la place d’orchestre, même si la platea est remplie d’invités, ça aide), d’autre part, faire croire que la Scala est encore le-plus-grand-théâtre-lyrique-du-monde (sic), et enfin, continuer à affirmer que la Scala est le théâtre de l’identité italienne, où se retrouvent le 7 décembre le ban et l’arrière ban de la société politique et économique de la Péninsule.
Il y a belle lurette que la Scala n'est plus la référence du genre opéra, même pas italien, et chaque première annoncée comme le miracle des miracles, la merveille des merveilles, est oubliée bien vite après la fête. Pour celui qui écrit, qui adore ce théâtre, ce constat est douloureux mais doit être fait.
Néanmoins, la Prima a une fonction essentielle pour le théâtre : elle vérifie l’état des forces, techniques et artistiques et leur qualité intrinsèque. Et de ce point de vue, cette Tosca a démontré une fois de plus que chœur, orchestre, techniciens font partie des forces professionnelles les plus accomplies au monde. Quand on a à disposition de telles forces de travail, on devrait être encore plus enclin à produire des joyaux…ce n’est malheureusement pas le cas.
La Scala s’est longtemps distinguée aussi par son public, l’un des plus compétents du monde, notamment pour le répertoire italien, un public à qui « on ne la faisait pas », qui pouvait accueillir avec curiosité et intérêt de nouveaux chanteurs, ou rejeter des stars : on ne compte pas les stars légendaires qui ont été jetées par la salle, Pavarotti, Caballé, Fleming, Ricciarelli pour ne citer que les plus connues. Je me souviens de la Prima du Don Carlo de Muti en 1992 où Dessi et Pavarotti ont été copieusement hués dans une soirée qui fut un naufrage.
Aujourd’hui, ce public-là ne trouve plus dans la programmation de quoi s’intéresser et a déserté, soit il a vieilli, soit il va ailleurs : on voit beaucoup de milanais à Turin, Venise, ou Rome, à Rome justement où vient de briller un milanais d’exception, Daniele Gatti dans les Vêpres siciliennes. Et les politiques successives des dernières années ont pensé qu’il fallait pour remplir la salle, jouer le tourisme, les packages, la foire de Milan, et attirer un public occasionnel avide de selfies plus que d’opéra qui tapote sur son smartphone pendant la représentation (quand on est en galerie et qu’on regarde la Platea, on a l’impression de centaines de lucioles, c’en serait comique si ce n’était tragique). La conséquence : le nombre de spectateurs qui partent à l’entracte est notable puisque les selfies sont faits.
Alors cette Prima de Tosca est conforme : elle brille pour satisfaire le public occasionnel, content d’être à la Scala, à qui l’on offre un produit tape à l’œil, vide, creux, sur lequel il n’y surtout pas matière à penser, un spectacle pour la TV, pour la vidéo (c’est le metteur en scène lui-même qui le dit) un spectacle superficiel à la limite du supportable.
Davide Livermore a déjà signé l’Attila d’ouverture de la saison dernière, et auparavant un Don Pasquale, toujours avec Riccardo Chailly. Les mises en scènes citées sans être des pierres de touche, n’étaient pas si mauvaises, et bien faites. Celle-ci est plus problématique.
Avec cette Tosca en effet, on est en droit de se demander quelle mouche a piqué Livermore et le collectif Giò Forma qui signe le décor. Sans doute ont-ils voulu démontrer que les dispositifs techniques de la Scala fonctionnaient à merveille, car ça monte, ça descend, ça tourne, ça bouge de tous côtés au point de gêner l’écoute tant l’attention est distraite par cette agitation permanente où les cierges ne cessent de se balader, poussés par une myriade de religieuses. On dit souvent la même chose des mises en scène échevelées de Frank Castorf, qui empêcheraient de se concentrer sur la musique mais au moins, l’œil y est distrait par des signes qui font sens. Mais pas ici : ici, ça bouge pour bouger. Sant’Andrea della Valle devient un manège étourdissant pas enchanté du tout.

Ce premier acte est littéralement insupportable et finit par un spectaculaire Te Deum scandé au final par une explosion de feu qui allume toutes les chandelles, comme allumées par un diable nommé Scarpia, qui semble diriger la scène comme un metteur en scène luciférien. On n’y croit pas mais ça fait de l’effet et la salle croule sous les bravos.
D’autres effets comme le portrait (en vidéo) de la Maddalena en noir et blanc qui se colore au moment où Mario entonne « Recondita armonia » ou comme le chœur énorme qui accompagne le « baccano » des enfants de chœur virevoltant autour du sacristain s’ajoutent à l’ensemble. Pas d’autres idées de mise en scène parce que la conduite d’acteurs est aussi fruste que dans la pire des Tosca traditionnelles, les chanteurs sont plus ou moins laissés à leurs habitudes : sensualité de Tosca, persuasion vipérine de Scarpia disparaissent au profit d’une platitude bien-pensante sur une scène parcourue de religieuses qui vont et viennent, comme le décor : il faut montrer que dans cette Rome pontificale du début du XIXe, la religion est partout, quelle trouvaille !
Impressionner, montrer de manière concomitante plusieurs angles, comme une sorte de kaléidoscope, multiplier l’espace pour en suggérer la monumentalité, étourdir, voilà qui semble gouverner ce premier acte tape à l’œil et superficiel.

Le deuxième acte se déroule au Palais Farnese, dans le bureau de Scarpia, qu’on devine être le bureau central du Palais (celui de l’ambassadeur de France aujourd’hui) décoré des fresques de Salviati, remplacées par des vidéos (signées D‑Wok), scènes religieuses vivantes et inutiles dont on continue à se demander pourquoi elles agrémentent et colorent la scène, détournant là encore l’attention de la trame et du drame. Le bureau de Scarpia est parcouru lui-aussi de religieuses affairées, un motif insistant sans doute signe de l’alliance du sabre et du goupillon. Moins de mouvement dans cet acte sinon des mouvements de rideau annonçant les drames, et la montée du décor pour faire apparaître sous le plancher la salle de torture où Cavaradossi est mis à la question, alors que l’effet dramaturgique des cris d’un Mario invisible est bien plus fort : montrer c’est ici aplatir, c’est aussi essayer de faire pleurer Margot, dans une version résolument télévisuelle de l’opéra
Ce second acte se déroule conformément à l’habitude, sauf qu’au lieu d’un Scarpia-serpent, on a un Scarpia-bête-sauvage qui cherche à violer Tosca : où est l’élégance glaciale et effrayante du personnage ? Du coup, le vissi d’arte semble tomber à plat (Tosca est allongée à terre, et se lève progressivement) alors que Puccini a ménagé les effets que la mise en scène ne semble pas écouter. La musique amène au Vissi d’arte, chez Livermore, il arrive presque comme un cheveu sur la soupe.

Livermore s’en donne à cœur joie pour le meurtre de Scarpia encouragé par les quelques mesures supplémentaires de cette édition qui d’ailleurs ne sont pas malvenues : tuer un homme ce n’est pas si facile, notamment pour une faible femme. Elle donne bien quelques coups de couteau mais la bête râle encore, il faut donc aussi l’étrangler, et Tosca allongée sur Scarpia finit ainsi le travail. On a compris que le viol initié par Scarpia trouve ici dans une position inversée sa conclusion : eros/thanatos, la victime se venge. Tout est bien qui finit bien.

Le troisième acte impose un nouveau décor monumental (cette mise en scène se définit par le décor, comme pour donner à voir, sans donner ni à penser, ni à sentir), une masse centrale informe qu’on découvre par un jeu de projections être l’aile de l’Ange du Château Saint Ange, une aile plus inquiétante que protectrice sur fond de ciel orageux (c'est bien le moins).

Qui tourne sur elle-même (il faut bien bouger) mais qui ne sert strictement à rien pendant Ê lucevan le stelle et pendantle duo de Tosca et Mario, , les deux moments exécutés au premier plan. Seule la fin est originale (enfin, inhabituelle) : au lieu de tomber dans le vide, Tosca saute directement au ciel, transfigurée et au centre de rais de lumière, comme la vierge de l’Assomption… On aime bien le personnage de Tosca, mais elle vient d’assassiner sauvagement un homme, Dieu est bien bon de l’admettre aux cieux sans autre forme de procès, sans même quelques heures de purgatoire.
Autres signes scéniques, les costumes de Gianluca Falaschi dans l’ensemble plutôt réussis, si l’on excepte ceux de Tosca, plutôt curieux.

Au premier acte une sorte de costume de gouvernante anglaise, corsage blanc et jupe longue noire qui peut rappeler les origines populaires de Tosca, ou sa simplicité, mais qui est moyennement seyant et surprenant pour la "celebre cantante" : une Tosca mal fagotée au premier acte, c’est plutôt rare.
Au deuxième et troisième acte, elle porte une robe de couleur bleu vif et rouge (voir ci-dessus), qui tranche avec l’ambiance nocturne et mordorée, et l’isole, presque des couleurs de Madone un peu vulgaire, avec ce rouge sang qui rappelle celui du costume de Scarpia et de ses sbires. Mais les gants blancs lui donnent aussi un petit air de drapeau français tricolore (allusion à la victoire de Marengo…?) en tous cas aussi peu seyant pour la Netrebko que pour la Hernández : c'est un choix étonnant, qui singularise le personnage, au milieu d’autres costumes moins singuliers mais globalement plus réussis, ceux de Scarpia et ses sbires, vêtus de cuir noir aux taches rouges illustrant parfaitement Le Rouge et le Noir stendhalien et cohérents avec l’ambiance et les éclairages, plus ou moins inspirés de ceux de l’époque du drame.
Au total, ce travail techniquement très au point reste superficiel, fait pour un public télévisuel, ce qui rend presque les représentations en salle un simple support de retransmission, c’est à dire la négation même d’un spectacle théâtral, surtout à la Scala. C’est peut-être en rapport au changement de public que nous signalions plus haut, mais un théâtre de la réputation de la Scala se doit d’amener le public à s’éduquer, se confronter à une réflexion, une émotion, un récit, une histoire. Non lui servir la soupe.
Attila (la saison dernière) était un titre d’une autre époque, avec des personnages psychologiquement dessinés de manière différente, Tosca est une autre affaire, bien plus complexe, qui pose la question des états totalitaires et policiers, de la religion et de son usage temporel, mais aussi de l’influence des idées des lumières et de la révolution française sur les états d’ancien régime, et notamment les états du pape, d’où sa facilité d’adaptation à des situations historiques totalitaires (d’où la fortune des mises en scène impliquant le fascisme).
Tosca pose aussi d’autres questions plus liées aux individus, notamment celle du désir. La relation Mario/Tosca est une relation qu’on sent physiquement forte, la jalousie de Tosca est celle d’une maîtresse qui n’a pas tout à fait confiance en un Mario sensible à la beauté féminine, sans doute tenté plus qu’il ne le dit par l’Attavanti.

Le duo du dernier acte (dolci mani, languide carezze) est une évocation des moments tendres et de l’amour physique, non d’un amour éthéré et romantique. Si l’on n’a pas en tête cet aspect de Floria Tosca, on ne peut comprendre sa jalousie du premier acte ni l’urgence du deuxième acte ainsi que l’ardeur du personnage à tuer Scarpia. Tosca est un personnage de l’extrême, plus que Mario sans doute. Ces aspects ont sans doute justifié le choix significatif d’Anna Magnani pour interpréter E avanti a lui tremava tutta Roma, le film de Carmine Gallone (1946) où elle incarne une cantatrice qui vit la même aventure que Tosca mais au temps du fascisme aux côtés de Gino Sinimberghi et Tito Gobbi. Il y a chez la Magnani (comme chez Tosca) le sens du tragique, la sensibilité, l’intelligence, et surtout la « romanité » entendue comme profonde appartenance à Rome, même si la pièce est de Sardou. Puccini a compris derrière Tosca à la fois la passion de l’opéra (c’est une cantatrice qui porte en elle les excès et les délices du genre lyrique) mais aussi la présence lourde et symbolique de la ville de Rome avec ses trois lieux emblématiques que sont Sant’Andrea della Valle, le tout voisin Palazzo Farnese et le Château Saint Ange. Cette inscription dans les lieux est tout aussi déterminante (et Andrea Andermann l’avait bien compris dans sa fameuse Tosca télévisée avec Malfitano et Domingo). Il y a tout cela derrière Tosca, toute cette complexité, toute cette précision qui exige d’ailleurs de la part des interprètes une profondeur toute particulière, mais Livermore en revanche n’en tire pas grand-chose.

Musicalement, les choses sont plus contrastées, et marquent la difficulté à monter une Tosca qui soit indiscutable. Certes, ne nous voilons pas la face, il s’agissait pour Alexander Pereira d’offrir à Anna Netrebko l’occasion de sa première Tosca, et le peu de goût de la cantatrice pour les mises en scènes dramaturgiquement plus profondes, et de type problématique (on se souvient qu’elle annula ses Manon Lescaut munichoises à cause de Hans Neuenfels), peu de goût partagé par Riccardo Chailly, ont sans doute abouti à ce choix scénique de paillettes insipides. Mais c’est de Tosca qu’il s’agit, un titre où le seul chant n’est pas suffisant, fût-il celui de la plus belle voix du monde, il faut bien autre chose et c’est tout l’enjeu de cette musique.
Riccardo Chailly comme souvent a voulu montrer les éléments qui ont conduit à la Tosca actuelle : son projet Puccini consiste à révéler des éléments jamais proposés, ou les premières versions des opéras les plus connus, comme il le fit pour Butterfly. Pour Tosca, en s’appuyant sur l’édition de Roger Parker pour Ricordi, il s’agit de faire entendre quelques mesures supplémentaires par ci par là, au milieu du premier acte durant le duo Mario/Tosca, un peu inutiles et redondantes, durant le Te Deum (ici plutôt réussies), au moment du meurtre de Scarpia, ou surtout au moment du final, qui conduisent presque toutes à la même conclusion : Puccini a bien fait de corriger, et de couper, tant ces mesures (notamment au final) n’ajoutent rien sinon du temps inutile, et rallongent et étirent en l’espèce un final éminemment dramatique. Coquetterie que de présenter ces versions désormais abandonnées ? Je ne crois pas. Même si ce sont des musiques inutiles, il est intéressant de les avoir entendues une fois et c’est dans la mission de la Scala, théâtre de référence en la matière, de les proposer.
Le direction de Riccardo Chailly est certainement ce qui frappe : même si certains lui ont reproché un tempo trop retenu, la précision, la clarté du rendu et la limpidité de la lecture, font entendre toute la profondeur de la partition puccinienne, en en révélant les différents niveaux. Il affiche aussi la volonté claire d’accompagner les chanteurs en retenant le volume, ce qui n’est pas toujours le cas dans ses interprétations de Puccini, et donne à ce travail une couleur convaincante, avec un véritable travail sur le son, sur le velouté de certains moments, mettant en relief aussi certains passages particulièrement dramatiques. Tout cela concourt à faire de cette lecture douée d’une grande respiration sans doute l’élément essentiel à retenir de la soirée. Cette Tosca est décidément passionnante, parce qu’elle possède la théâtralité voulue, avec un travail précis sur l’art de la conversation en musique, alternant moment de discours et moments dramatiques, particulièrement dans le deuxième acte. Chailly réussit à révéler le modernisme de la composition puccinienne et la dramaturgie musicale, sans jamais négliger une ligne générale cohérente, avec un travail d’une rigueur rare, où il manque peut-être de l’élan ou de l’émotion, cette pointe de laisser aller passionnel que Karajan savait si bien donner et doser mais c’est tellement maîtrisé qu’on reste admiratif.
Il est suivi par un orchestre impeccable, expressif, coloré, qui montre que l’Orchestre de la Scala sait être une phalange exceptionnelle, voire irremplaçable. Il en va de même pour le chœur préparé par Bruno Casoni, fabuleux dans le final du premier acte.
Musicalement, on est donc plutôt gâté, on retrouve la Scala des grands soirs.
Plus discutable est la distribution, globalement de qualité, qui ne reflète pas tout à fait ce qu’est la distribution d’une grande Tosca incontestable. C’est une distribution qui pose moins la question des exigences vocales que des exigences interprétatives de cette œuvre.
Rien à redire du côté des comprimari et rôles secondaires, comme toujours tenus come si deve, aussi bien le sagrestano d’Alfonso Antoniozzi, moins caricatural que d’habitude et de très bonne tenue, que le Spoletta efficace et mordant de Carlo Bosi, toujours excellent. Un peu rude l’Angelotti de Carlo Cigni, et bien en place autant Ernesto Panariello (carceriere) que le Sciarrone de Giulio Mastrototaro sans oublier le pâtre de Gianluigi Sartori, jeune membre du chœur d’enfants de la Scala, particulièrement doué.

Du côté des protagonistes, le Scarpia de Luca Salsi a les notes, a la puissance, a le mordant, mais il lui manque ce qui fait les grands Scarpia, la subtilité, le contrôle, l’élégance. Sans nul doute la mise en scène en fait une sorte de grosse brute assoiffée de désir bestial : mais est-ce le caractère de Salsi qui pousse le metteur en scène à en faire ce Scarpia-là ou est-ce un choix délibéré indépendant de l'interprète. Qui de l’œuf, qui de la poule ? On peut se rappeler dans le passé le Scarpia vénéneux et d’une rare élégance de Gabriel Bacquier, une référence, ou même du glacial Sherill Milnes dans les temps déjà anciens. Il y a chez Scarpia – et c’est effrayant – une politesse extérieure d’une insistance mordante qui couvre l’horreur du personnage. Chez Salsi, tout est direct, c’est du « tout tout de suite » dans un comportement bestial. Si la voix peut convaincre par son volume et son engagement, (et le public lui fait fête) le personnage est discutable, et au total manque d’intérêt. J’ai souvenir de Thomas Hampson à Munich face à Harteros qui avec une voix bien moins volumineuse, qui était un vrai poignard effilé et subtil. Et dans le genre brute, Bryn Terfel avec Petrenko était époustouflant, et il y avait chez lui un art du dire à la fois brutal et aiguisé qu’on ne trouve pas chez Salsi.

Francesco Meli est Mario. Celui qui fut le grand belcantiste de sa génération, subtil, contrôlé, maîtrisant un style éminemment difficile, dans un répertoire rare, se donne désormais au répertoire post romantique. Et si le timbre reste lumineux – un timbre d’exception- il chante Mario plus qu’il ne le vit. Malgré toutes ses qualités de phrasé, de diction, de clarté, malgré sa capacité aux mezzevoci, ce chant manque de couleur, reste quelquefois un peu monocorde. Les qualités formidables de ce chanteur se banalisent ici, et si la voix est toujours fascinante, il lui reste un peu de mal à émettre les aigus d’une ligne sûre. Mais au-delà des menues questions techniques, c’est la question de l’interprétation – le metteur en scène ou le chef ne semblent pas s’être trop préoccupés du plateau, sans doute trop préoccupés de leur travail de mise en scène ou de concertation, et c’est dommage : ce Mario-là mérite d’être approfondi encore, c’est tellement clair dans E lucevan le stelle magnifiquement chanté mais qui ne dégage rien ou peu. Cela manque d’épaisseur théâtrale, parce que le chant reste un peu extérieur, malgré toutes les éminentes qualités et malgré la grâce d’un Mario à la couleur typiquement italienne.
Saioa Hernández était la doublure d’Anna Netrebko et la Scala lui avait donné les trois représentations de janvier. Le forfait de la diva lui a donné deux représentations supplémentaires, elle aura donc au total assuré cinq représentations, autant que la diva.
Elle a affronté la partie avec cran et une voix puissante et juste. On n’a pas de souci pour la voix de la Hernández qu’on a entendue l’an dernier triomphante dans Odabella et encore plus dans Abigaille cet automne à Parme, Tosca est évidemment dans ses cordes (vocales). Mais Tosca n’est pas Abigaille : c’est une autre question qui se pose. Tosca est un rôle complexe, qui exige un vrai travail sur la couleur pour donner une image juste du personnage aux facettes multiples tour à tour coquette, séductrice, amoureuse, jalouse, tragique. Et c’est peut-être là où la Hernández manque encore d’un peu de maturité pour dessiner le personnage dans tous ses replis comme il se doit. Comme chez Meli, c’est très bien chanté (même si quelques aigus sont quelquefois un peu courts mais c’est un détail) c’est puissant, c’est juste, mais cela manque de caractère. Cela reste un travail très attentif, contrôlé, mais au total un peu extérieur, plus chanté que ressenti, d’où il ne sort aucune émotion (c’est patent dans le Vissi d’arte et dans le duo du dernier acte), aucune urgence, peu de vibration et bien peu de couleurs. Et c’est dommage. Prenons rendez-vous un peu plus tard dans cette carrière, et sans doute les choses auront-elles évolué. En tous cas, elle est ici à sa place et ne fait pas regretter Netrebko.
On peut le constater, voilà une issue contrastée à une représentation qui reste d’un niveau plus satisfaisant musicalement que scéniquement. La mise en scène en Italie privilégie souvent le spectaculaire, les images, l’esthétique plus que la dramaturgie – sans doute une survivance de l’opéra comme divertissement de cour. Certains comme Strehler ou Ronconi hier ou Castellucci aujourd’hui réussissent à allier l’ensemble, mais Davide Livermore ici a plutôt fabriqué un produit qu’un spectacle, presque un produit de com dans le sens le plus consumériste qui soit. C’était peut-être ce qui lui était demandé, mais c’est vraiment dommage.