Sans doute peu de lecteurs connaissent-ils Cesare Lievi, un des très grands espoirs de la mise en scène de théâtre et d’opéra à la fin des années 1980. Son histoire mérite d’être rappelée.
Cesare Lievi et son frère Daniele ont créé au début des années 1980 un petit théâtre le « Teatro dell’Acqua » sans grands moyens situé à Gargnano del Garda. Peu de moyens mais des idées qui fusaient et qui portèrent les regards de nombreux théâtres, notamment allemands sur les deux frères, indissolublement liés et passionnés de culture allemande. Notamment un spectacle en miniature qui fut un des coups de génie de la décennie, le Barbablù de Georg Trakl (repris plus tard dans les combles du Burgtheater de Vienne). On leur doit de nombreux spectacles de théâtre, notamment à Heidelberg ( Le nouveau locataire de Ionesco par exemple), et bientôt à l’opéra (une très belle Clemenza di Tito à Francfort).
Ce qui faisait l’originalité de leurs spectacles, c’était le lien très étroit des scénographies de Daniele Lievi aux idées de mise en scène et aux textes choisis par Cesare (il faut y ajouter les éclairages fabuleux de Gigi Saccomandi). Mais la mort prématurée de Daniele Lievi peu avant 1990 interrompit cette série de spectacles fascinants qui aurait sans doute conduit la paire à devenir des figures référentielles de la scène européenne. Cesare a continué à produire des spectacles, on lui doit notamment le Parsifal inaugural de la saison de la Scala le 7 décembre 1991, sous la direction de Riccardo Muti, et entre autres cette Cenerentola créée à Zurich en 1994 avec l’alors toute jeune Cecilia Bartoli, reprise au MET en 1996 Mais sans doute la perte du frère a t‑elle été un coup si dur que Cesare n’a plus produit par la suite avec l’ardeur qui avait marqué les premières années. Cesare Lievi enseigne la mise en scène à l’université de Milan et est aussi l’auteur de nombreuses traductions de grands textes de théâtre allemands. C’est l’un des hommes de théâtre les plus intéressants des trente dernières années.
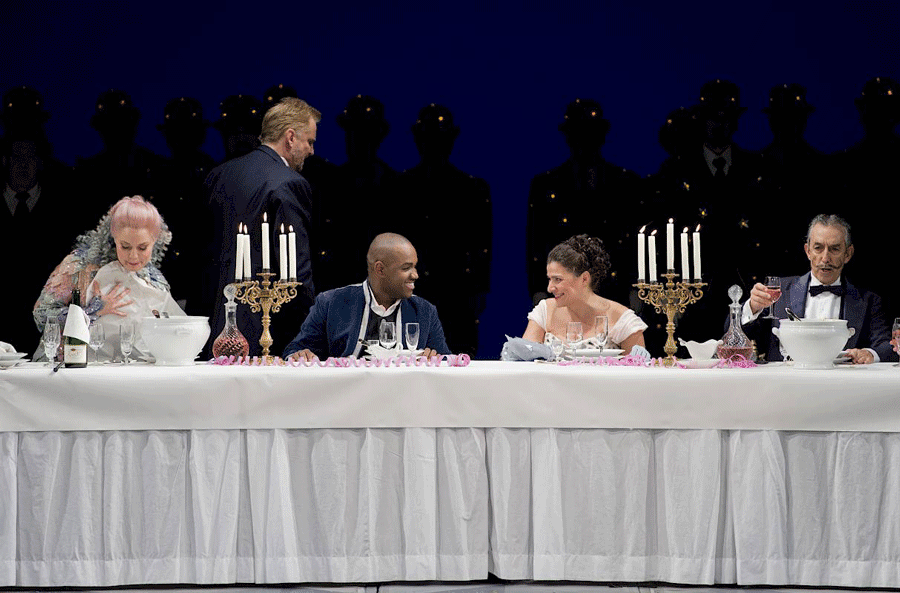
C’est donc avec une particulière émotion que j’ai vu cette Cenerentola, où l’on reconnaît la « touche » esthétique Lievi avec cet univers à la Magritte, ce réalisme poétique qui n’a rien perdu de son charme ni de son effet sur le public, même après 26 ans. Et cette émotion est d’autant plus vibrante que Cecilia Bartoli, désormais la star immense que l’on sait continue de la porter, avec la même fraicheur et la même jeunesse, mais donnant au personnage une plus grande profondeur peut-être et une maturité qui confère à son Angelina un poids singulier.
Elle sont rares les mises en scène qui tiennent la scène aussi longtemps, et notamment Cenerentola, où seule celle de Ponnelle de 1973 (autre coup de génie) – la production mère en quelque sorte – lui dispute la longévité. D’autres productions plus récentes (celle de Michieletto par exemple à Salzbourg) sans être médiocres sont « occasionnelles », correspondent à un regard particulier, plus lié à l’actualité, d’autres sont médiocres et à faire tomber dans les oubliettes de l’histoire (Guillaume Gallienne à Paris). Celles de Lievi et Ponnelle ont un caractère « intemporel », qui ne vieillit pas et qui rend justice à la profondeur de l’œuvre.
C’est clair chez Lievi, qui tient compte de la diversité d’un opéra où le côté bouffe le dispute au cynisme et à la cruauté. Il fait d’Angelina un personnage qui n’est soumis que de façade, mais qui n’en pense pas moins, et qui sait aussi manœuvrer. Et la présence de Bartoli facilite évidemment cette vision, car Bartoli n’est jamais tout d’une pièce et donne toujours un poids tout particulier à ses interprétations. Plus conformes sont les autres personnages, et notamment les deux vilaines sœurs et le père indigne, sans être d’ailleurs dans cette production des caricatures, mais des participants volontaires d’un jeu de dupes, d'où tout sentiment est absent : les sœurs obéissent à leur ambition, le père les met en avant pour grappiller l’argent qui lui permettra de se refaire une santé. Ce ne sont que jeux d’intérêts, où l’apparence domine.
La seule à ne rien avoir à perdre est Angelina, ignorée de sa famille, qui au fond ne représente qu’elle-même, vu que Don Magnifico la renie (il va jusqu'à la faire passer pour morte) et ne veut en entendre parler. Conformes aussi le Prince, Dandini, et dans une moindre mesure Alidoro : c’est la personnalité de l’héroïne qui fait tourner la machine.
Le livret de Jacopo Ferretti déplace et transforme Perrault, en remplaçant la fée par Alidoro (Ailes d’or), une sorte d’ange gardien, d’abord du prince dont il est le précepteur, puis de Cenerentola qu’il protège et transforme (et Luigi Perego auteur des costumes lui donne un costume blanc et des ailes d’or ), en transformant l’histoire de la pantoufle de vair (ou de verre selon les traditions) en bracelet, sans donner un poids dramaturgique déterminant à l’histoire de l’essayage de la pantoufle : au fond, la messe est très vite dite . Ce qui intéresse, au-delà du conte, c’est la réaction des sœurs et du père, sur laquelle est concentrée toute la fin : ils ont du mal à avaler la pilule et celle très subtile d'Angelina, elle pardonne en donnant une leçon, comme ces souverains illuministes chers à Mozart. La clémence est aussi une arme politique.

L'autre caractère de cette production, qui au demeurant n’est pas avare de sourires, ni d’effets (l'apparition de l'âne volant en fond, lors de l'air de Don Magnifico – mi sognai…un bellissimo somaro‑, la tempête oùle parapluie de Magnifico s’enflamme, sauvé par une Cenerentola qui malgré tout, aime son père…), c’est son dispositif apparemment léger. Lievi a toujours aimé les dispositifs où les cloisons glissent, où l’œil n’est pas distrait par un décor trop chargé ni trop abondant : ici c’est comme souvent chez Lievi une boite, comme une boite à malice, ouverte sur un ciel à la Magritte (qui est aussi lieu du rêve et de la magie marqués ici par des changements d'éclairages.
Malgré tout (est-ce voulu ?) deux interruptions longues marquent le passage de la maison au palais au premier acte et du palais à la maison au second, ce qui nuit à la fluidité du déroulé, mais qui marque dramaturgiquement deux ambiances. Le côté essentiel du décor ne semble pas justifier une aussi longue attente, et c’est sans doute une manière du montrer le changement de lieu et de dramaturgie. Quant au repas (avec les spaghetti) final de l’acte I, il est une allusion à peine voilée à Ponnelle, par le repas-même (Lievi y ajoute un jeu sur la place du Prince, puisque Ramiro encore majordome prend la place de Dandini, d’où une sorte de jeu de chaises musicales, où chacun essaie d’occuper une place à table). Quant aux spaghettis, il est difficile de n’y pas voir une allusion à L’Italienne à Alger du même Ponnelle.
Enfin la pièce montée finale dont trois parts sont coupées pour le père et les deux vilaines sœurs, qu’Angelina elle-même leur sert (leur servir le gâteau devient signe de pardon et non signe d’esclavage). Leur donner leur « part du gâteau » est aussi les associer au triomphe, c’est à dire en faire eux aussi des bénéficiaires, tout en leur donnant une leçon assumée de morale, de comportement et d’humanité. L’ordre règne au pays d’une Cendrillon pas si victime ou naïve.

Comme on l’a souligné, voilà une production qui repose historiquement sur Cecilia Bartoli, qui continue d’incarner Angelina-Cenerentola, après 26 ans, avec le même succès, liée à une production qu’elle a créée. Il y a chez Bartoli dans ce rôle comme une « flaque d’éternité » selon la belle expression de Jacques Rivière. En ce sens elle est comparable à Freni dans Mimi, qui ultra sexagénaire, continuait de chanter le rôle apparaissant toujours aussi fraiche et jeune et qui a continué de porter Mimi dans la mise en scène de Zeffirelli qu’elle créa, tout comme une éternelle Bartoli dans celle de Lievi.
Sans continuer de jouer aux comparaisons, il y a dans la Cenerentola de Bartoli des éléments permanents, la jeunesse, la fraicheur, mais aussi désormais la tenue et la maturité (cette Angelina n’est pas une oie, ni une ingénue) il y a aussi la maîtrise technique où s’inventent des variations ou des cadences nouvelles , mais encore cette profondeur dont il était question plus haut, où Bartoli passe de manière étourdissante de la joie à la mélancolie, de la gravité à la rouerie : il y a chez elle une plasticité du jeu et du visage, un sens de l’à‑propos et une variété des expressions qui restent confondants. Il y a surtout une intelligence du jeu scénique et vocal qui confine au feu d’artifice, tant la voix est expressive, tant les modulations en sont contrôlées, tant aussi le texte est clair et la diction parfaite dans une salle qui est comme faite pour sa voix.
L’équilibre scène-salle à Zurich est étonnant parce que cette salle aux dimensions très moyennes permet aussi bien Mozart et Rossini que Wagner et Zimmermann. Ainsi donc La Cenerentola est-elle chez elle dans une salle qui a la dimension de la plupart des théâtres du XIXe, plus comparable à l’Opéra-Comique de Paris qu’au MET ou même à Garnier. On aime Zurich pour cette plasticité, et pour un sens de l’intimité telle qu’on se sent toujours très proche et de l’orchestre et des chanteurs.
Et on se trouve ici au seuil de l’idéal : Cecilia Bartoli, à laquelle les imbéciles reprochent une « petite voix » ((Après tout, la Berganza au temps de sa splendeur n’avait pas une si grande voix et personne ne lui en fit le reproche : la Berganza, comme la Bartoli, savait chanter, phraser et surtout penser)), sait parfaitement gérer les choses et adapter son organe aux espaces : à Zurich, la salle lui permet quasiment de tout faire. Son non più mesta est un feu d’artifice d’une incroyable aisance, rien n’est perdu de sa légendaire facilité dans les agilités, avec un jeu incroyable sur tout le spectre, du grave à l’aigu, et une inventivité rare dans les cadences, jouant sur l’ironie, sur les doubles sens, sur la couleur. Quelle artiste !
.
Face à elle Javier Camarena compose un Ramiro exceptionnel. Le personnage est moins riche que Cenerentola dans ce jeu très marivaudien où l’amoureux se déguise pour voir la vérité des êtres, mais Camarena transfigure le personnage en lui enlevant ce qu’il peut avoir de mièvre. Camarena est un ténor à la voix claire, à la diction impeccable et au phrasé modèle, avec une rare homogénéité sur l’ensemble du spectre, jamais maniéré, toujours direct et puissant.
Il sait aussi à la fois oser les feux d’artifices qui mettent la salle à genoux (notamment dans son air du second acte Noi voleremo, – Domanderemo, (…)) où les aigus stratosphériques stupéfient, tout en montrant des moments lyriques d’une rare délicatesse (notamment au premier acte Quell'accento, quel sembiante
È una cosa sovrumana.
où Camarena répond exactement à la didascalie si claire et si précise : da sé, astratto… C’est une prestation en tous points exceptionnelle où les deux voix se fondent et s’allient parfaitement parce qu’elles s’écoutent l’une l’autre en une respiration et une fusion communes.
Le troisième larron, c’est Alessandro Corbelli. Le baryton italien compte parmi les chanteurs rossiniens les plus accomplis : la voix n’a jamais été très puissante mais Corbelli est l’un des chanteurs au style le plus sûr, avec une élégance dans le phrasé, une clarté dans la diction et dans l’expression d’une qualité très rare. L'an dernier à Lucerne il était Dandini, un Dandini inhabituellement mur, presqu'un double du Magnifico de Carlos Chausson.
C’est un chanteur qui maîtrise totalement ce qui manque à bien d’autres de ses collègues : le texte et le style. Ce n’est pas un Magnifico spectaculaire comme jadis Paolo Montarsolo, mais il campe de manière impeccable le personnage dans sa veulerie. Il n’exagère rien, n’est jamais ridicule, sans jamais attirer la sympathie, comme pourrait le faire un Don Magnifico bouffe.
Il est ce que le livret dit : lâche, méchant et sans attrait. C’est pourquoi il est parfaitement dans la ligne de la mise en scène, bien que ce soit une première fois pour lui à Zurich car la plupart des reprises y ont été assurées par Carlos Chausson, lui aussi un très grand Magnifico. Alessandro Corbelli avec ses moyens actuels compose parfaitement le personnage.

Dandini est Oliver Widmer : il compose le personnage, avec sa légère vulgarité et sa voix très bien projetée, sonore, présente. Il a ce côté un peu « exagéré » qui convient à Dandini. Il articule parfaitement le texte, il n’est pas dépourvu d’élégance, mais il lui manque peut-être un peu le délié du phrasé rossinien, car il n’a pas toujours la fluidité voulue. Cependant il remplit la scène de sa forte présence et avec un jeu très maîtrisé (lui aussi connaît bien la mise en scène pour l’avoir pratiquée depuis les origines).
Alidoro est la jeune basse russe Stanislav Vorobyov, en troupe à Zurich après en avoir été membre du studio : il remporte un succès personnel mérité tant il se sort bien de son air La del ciel nell’arcano profondo, écrit par Rossini deux ans après la création où l’air d’Alidoro, Vasto teatro è il mondo, bien plus facile avait été écrit par Luca Agolini, en charge des récitatifs. De ce long air, Vorobyov se sort avec beaucoup de présence vocale, une belle puissance, du style : un nom à suivre car on n’entend pas toujours des Alidoro (un rôle difficile) de cette trempe.
Enfin les deux sœurs aux costumes soignés et un peu ridicules, avec une pointe d’extravagance mais sans exagération (notamment celui de Clorinda, en sirène…et celui de Tisbe, sorte de Papagena pompeuse), l’une, Liliana Nikiteanu a chanté Tisbe dès 1994 et elle reste un des piliers de la troupe de l’Opernhaus Zurich et l’autre Martina Danková(Clorinda), fut elle aussi un membre de la troupe pendant de nombreuses années : elles maîtrisent les deux personnages, connaissent parfaitement la mise en scène et composent une paire exemplaire et engagée à souhait au niveau scénique.
Mais la nouveauté de cette reprise, c’est d’avoir confié la direction musicale à Gianluca Capuano, le chef désormais fidèlement attaché aux apparitions scéniques de Cecilia Bartoli, un chef qui vient du baroque et qui dirige la formation baroque de la Philharmonia Zürich, l’Orchestra La Scintilla, qui sera aussi en fosse pour l’Iphigénie en Tauride de février.
La tradition orchestrale liée aux œuvres de Rossini a été fortement marquée par les éditions nouvelles des opéras dues à la Fondation Rossini, et l’édition de La Cenerentola signée Alberto Zedda remonte au début des années 70. C’est cette édition qui a été popularisée par Claudio Abbado.
Claudio Abbado a profondément changé le regard musical sur le Rossini souriant, à partir du Barbiere di Siviglia, déjà en 1968 à Salzbourg, puis à la Scala. Il a poursuivi avec La Cenerentola, puis l’Italiana in Algeri et Il Viaggio a Reims. Depuis, il y a eu de vrais chefs pour Rossini (Chailly, qui enregistra avec Bartoli une Cenerentola qui fit date) mais aussi Daniele Gatti, qui dirige moins Rossini aujourd’hui, mais qui l’a souvent dirigé jusqu’au début des années 2000 (souvenons-nous d’une mémorable Donna del Lago à Pesaro), ou Riccardo Muti qui cependant s’est intéressé au Rossini plus tardif. Mais la référence en matière de Rossini souriant reste Claudio Abbado, irremplacé, parce qu’irremplaçable.
Il fallait donc chercher un autre chemin, et la situation de Rossini, dernier auteur d’opere serie au sens du XVIII° et premier compositeur de Grand-Opéra au sens du XIX°, est à la charnière de deux périodes. Ainsi a‑t‑on commencé à s’intéresser à une « relecture » baroque des opéras de Rossini, en les interprétant avec des orchestres rompus à ce répertoire. Cecilia Bartoli à Salzbourg avait invité Jean-Christophe Spinosi et son Ensemble Matheuz pour La Cenerentola mise en scène par Damiano Michieletto. Mais Spinosi a peu d’affinité avec ce répertoire et son approche est très loin d’avoir convaincu. Elle a aussi appelé Diego Fasolis, autre baroqueux, avec les Musiciens du Prince à Versailles en 2017, et Gianluca Capuano a repris le flambeau pour une série de Cenerentola, toujours avec les Musiciens du Prince, à Lucerne et ailleurs (voir notre article). Depuis, Capuano et Bartoli travaillent ensemble.
C’est donc une direction repensée du grand répertoire à l’éclairage de l’approche baroque et du son des instruments anciens que Bartoli désormais a imposé, un travail qui je crois, va se prolonger sur le répertoire belcantiste, à commencer par le Don Pasquale salzbourgeois à Pentecôte 2020.
En effet, il y a sur le répertoire rossinien comme sur le Bel Canto (et peut-être encore plus sur le Bel Canto) un effet d’encroûtage, de fossilisation, d’enkystement qui fait que des traditions s’installent, un mode opératoire un peu plan-plan se diffuse dans tous les théâtres parce que les opéras souriants ou bouffes de Rossini font partie du grand répertoire que tout théâtre, de St Petersbourg à Buenos-Aires, se doit d’avoir dans ses réserves.
Un des mérites de Cecilia Bartoli qui ne cesse de fouiller notamment le répertoire XVIII° en exhumant çà et là des airs pour sa voix de mezzo-coloratura, est de soutenir ce mouvement de ravalement, en prêtant sa voix et son nom pour relancer l’intérêt.
Ainsi, la direction musicale de La Cenerentola s’impose-t-elle ici par sa nouveauté, par une approche qui serait presque dérangeante par certains côtés, tant le son produit modifie quelque peu nos habitudes d’écoute. Gianluca Capuano, on le sait, est un intellectuel, arrivé tardivement à la direction d’orchestre, lecteur chirurgical des partitions, qu’il analyse avec acuité, hors de sentiers battus : il ose là où d’autres se cachent derrière les habitudes et le stuc qui masque les structures portantes.
Et de fait, il montre d’abord un Rossini (qui, rappelons-le, a composé l’opéra en un peu plus de trois semaines) très au fait des musiques de son temps, et pas seulement italiennes. On sait par exemple sa connaissance de Mozart et de Haydn, on insiste moins sur son admiration pour Beethoven (qui fut une sorte de « rival » lors de son séjour à Vienne).
Il n’y a pas de hasard : si Rossini a dominé le monde de l’opéra, et bien après son renoncement à la scène en 1830–31, c’est qu’il est un compositeur suprêmement doué, et surtout capable d’une qualité d’orchestration, de savantes constructions des systèmes d ‘écho et d’écoute des pupitres entre eux, avec une remarquable utilisation des bois qui laisse souvent rêveur. Il est à l’opposé de cette superficialité qu’on lui reproche quelquefois ou qui marque certaines interprétations de ses opéras (notamment les pièces bouffes).
S’il a des facilités, c’est justement qu’il a une telle connaissance du contexte musical de son temps, et des partitions vues de l’intérieur qu’il est capable de tout : imitation, pastiche, hommage et innovation. De plus, dans la bonne tradition des tripatouillages chers au XVIIIe, il n’hésite pas à reprendre des airs, les transformer, réadapter de vieilles compositions, habiller l’existant oublié en un jeu de piste étourdissant …Il suffit de citer Non più mesta, l’air final d’Angelina dans Cenerentola, dans son rapport « filial » à l’air final d’Almaviva du Barbiere di Siviglia Ah il più lieto il più felice.
L’intérêt de la direction de Capuano est qu’elle révèle cette épaisseur « implicite » de Rossini. D’abord, le son de l’orchestre, notamment pour les vents, est plus âpre, presque dérangeant, sans rien du sourire aimable d’un Rossini fade ; c’est au contraire quelquefois heurté, et souvent étonnamment dramatique, plus dramma que giocoso dans une œuvre intitulée justement dramma giocoso. Ainsi derrière un ensemble apparemment bouffe, derrière les interventions de Don Magnifico entend-on des accents plus dramatiques, presque des sons qui annonceraient les opéras de la fin, comme si à l’orchestre Rossini rétablissait la vérité d’un personnage en réalité assez noir. On note aussi certains accents cherubiniens, mais surtout beethoveniens : la tempête de l’acte II est à ce titre particulièrement emblématique, dans ses allusions claires à la Pastorale et son étonnante respiration orchestrale.
Ce qui frappe dans le son de l’orchestre c’est d’abord cette relative rudesse ou cette âpreté de certains moments qui nous rappellent que l’œuvre n’est pas un opéra-bouffe, auxquels on n’est pas forcément habitué, souvent dues au son des instruments anciens, à la limite de la dissonance (notons au passage le continuo vif mené ici par Enrico Maria Cacciari qui remplaçait au pied levé le musicien prévu, souffrant), tout en ménageant une lecture très aérée.
C’est ensuite la tension permanente d’un orchestre tenu sous contrôle, une tension qui irrigue l’ensemble, et qui maintient intacte la vivacité et la respiration. Le rythme est souvent alerte, les tempi vifs, avec une discrète ironie, une franche gaieté, un vrai lyrisme aussi. Autant dire que cette direction soigne les couleurs orchestrales avec une attention jalouse, tout comme à Lucerne l’an dernier (avec un autre orchestre, peut-être d’ailleurs un poil plus fluide) et qu’elle accompagne les chanteurs avec le souci de ne jamais casser les rythmes du texte, les mouvements de la mise en scène, le jeu des chanteurs et leur expression.
Les principes de cette approche soucieuse de montrer la diversité et la richesse, et donc la profondeur d’une œuvre qu’on n’a pas habitude d’approcher de cette manière, constituent pour moi une référence de l’interprétation du Rossini souriant aujourd’hui. C’est une approche moderne, au sens où elle aurait sans doute été impossible il y a deux décennies. Elle montre simplement que Rossini (et avec lui le premier XIXe siècle) doit être relu à cette aune-là. La manière dont souvent notre vision du le Bel Canto privilégie à ce point la voix qu’elle en arrive à ignorer l’orchestre doit être l’objet d’un nouveau regard. Les expériences autour de Donizetti (qui doit tant à Rossini) à Bergamo en sont déjà l’indice. Capuano conçoit et réfléchit puis dirige : c'est un véritable analyste et cela s'entend.
Comme on le voit, cette Cenerentola est bien autre chose qu’un concerto pour Bartoli et orchestre : c’est ce qui a fait le prix d’une soirée où respirait un Rossini magnifiquement chanté par tous, et accompagné d’un orchestre au son, au rythme et à l’épaisseur neufs, dans une production qui demeure très juste et très prenante. Quel beau cadeau au seuil de 2020.


Bartoli est aussi étonnante. Elle est rigoureusement impeccable et géniale sur scène dans le cadre d un opera et évite les cabotinages insupportables de ses récitals. Le dernier à la philarmonie de Paris était navrant, voir un tel génie s abîmer dans des ponsifs de revue de province était consternant.