Pour le fréquenter régulièrement sur les scènes d'opéra, on en aurait presque oublié que Robert Carsen est également un metteur en scène de théâtre. Sa Tempête privilégie chez Shakespeare le mystère et les impasses narratives. L'intrigue est construite en forme de labyrinthe et d'interrogation autour d'un personnage unique – Prospero – qui gît sur un lit d'hôpital au moment où commence la pièce. Convalescent ou agonisant ? Il a peut-être franchi le seuil de la mort et nous parle depuis l'au-delà, peu importe. Vêtu d'un étrange pyjama qui évoque tout à la fois le rêve et la maladie, il forme avec l'esprit de l'air Ariel un étrange double personnage.
La Tempête est également l'histoire d'une narration en miettes – en pièce(s) oserait-on dire – réduite à des fragments par une dépression qui de météorologique devient psychologique. Un double naufrage précède l'action : Celui de Prospero et de sa fille Miranda tout d'abord. Contraint à l'exil par un coup d'Etat fomenté par son frère Antonio, l'ex-duc de Milan est livré aux flots et accoste sur une île où il passe douze ans à ressasser sa vengeance. Douze ans au cours desquels il exerce ses pouvoirs magiques en punissant et soumettant le monstrueux Caliban, fils de la sorcière Sycorax, pour avoir tenté de séduire Miranda et en libérant Ariel des griffes de la même sorcière.
Prospero provoque par magie un second naufrage qui voit Antonio et son comparse Alonso, le roi de Naples, s'échouer à leur tour sur l'île en compagnie de leurs conseillers. La mise en scène de Carsen interroge la question du pouvoir et de la perte du pouvoir. Prospero possède un pouvoir surnaturel en sus d'un pouvoir politique et d'un pouvoir paternel. La perte brutale du pouvoir politique fait céder dans son esprit les digues qui séparaient ces différents paramètres. Le voilà qui manipule ses ennemis, les isolant les uns des autres sur l'île. Même dans une situation où régner n'a guère de sens, chacun fomente et cherche à intriguer dans le seul but d'avoir le dessus, en oubliant leur condition de naufragés. Seuls Miranda et Ferdinand échappent à cette malédiction et la pureté de leur amour tranche avec la vilenie des adultes. Prospero lui-même demeure ambigu et le "pardon" qu'il accorde in extremis à ses anciens ennemis n'a rien du pardon d'Auguste dans Cinna. C'est Ariel qui souffle cette décision à son maître, juste avant de reprendre sa liberté.
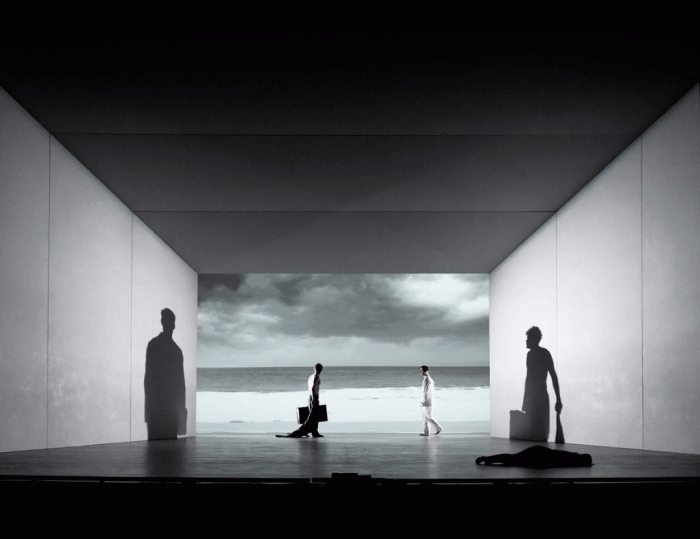 Le décor dessine un espace mental en noir et blanc, une scène aux dimensions d'une cellule de prison dont les lignes de fuite conduisent à un écran de projection. Au fond de cette caverne platonicienne, on voit défiler les mornes vidéos de Will Duke montrant des gros plans des protagonistes (pour s'assurer qu'on ait bien suivi l'intrigue) et puis une vague qui s'échoue sempiternellement sur le rivage. Pour tromper l'ennui qui guette, des détritus tombent du plafond dans la scène des ivrognes (merci Chéreau dans la Maison des Morts), tandis que les personnages font irruption par les côtés mais toujours en fond de scène.
Le décor dessine un espace mental en noir et blanc, une scène aux dimensions d'une cellule de prison dont les lignes de fuite conduisent à un écran de projection. Au fond de cette caverne platonicienne, on voit défiler les mornes vidéos de Will Duke montrant des gros plans des protagonistes (pour s'assurer qu'on ait bien suivi l'intrigue) et puis une vague qui s'échoue sempiternellement sur le rivage. Pour tromper l'ennui qui guette, des détritus tombent du plafond dans la scène des ivrognes (merci Chéreau dans la Maison des Morts), tandis que les personnages font irruption par les côtés mais toujours en fond de scène.
 On fera son deuil des aspects féériques et humoristiques, pourtant au cœur du matériel poétique de Shakespeare, pour se contenter d'une scénographie (Radu Boruzescu) qui fait la part belle au confinement et à l'angoisse intérieure. En témoigne par exemple, la scène où Ariel sort par le trou du souffleur et par l'effet conjugué d'un éclairage en contreplongée et d'une sonorisation réverbérée, effraie la troupe des conjurés. D'une sobriété hiératique et épurée, l'apparition mise en abîme de l'apparition des déesses illustre la pensée que "Nous sommes de la même étoffe que les songes. Et notre vie infime est cernée de sommeil"…
On fera son deuil des aspects féériques et humoristiques, pourtant au cœur du matériel poétique de Shakespeare, pour se contenter d'une scénographie (Radu Boruzescu) qui fait la part belle au confinement et à l'angoisse intérieure. En témoigne par exemple, la scène où Ariel sort par le trou du souffleur et par l'effet conjugué d'un éclairage en contreplongée et d'une sonorisation réverbérée, effraie la troupe des conjurés. D'une sobriété hiératique et épurée, l'apparition mise en abîme de l'apparition des déesses illustre la pensée que "Nous sommes de la même étoffe que les songes. Et notre vie infime est cernée de sommeil"…

La troupe alterne des mérites variés, avec une couleur d'ensemble qui donne à la traduction française de Jean-Claude Carrière une tension d'un lyrisme soutenu. Michel Vuillermoz retrouve des accents envoûtants et sonores pour camper un Prospero traversé d'une douleur et d'un ressentiment tenaces. Les deux amoureux Georgia Scalliet (Miranda) et Loïc Corbery (Ferdinand) parlent une langue aux accents véritables et sensibles, tout comme Elsa Lepoivre (à la fois Iris, Cérès, Junon et déesses), en définitive assez proche de l'Ariel de Christophe Montenez, candide adolescent au jeu édulcoré par les atermoiements psychologistes de la scénographie. Des trois rôles bouffons, c'est le Caliban de Stéphane Varupenne qui attire à lui tous les regards, tandis que Jérôme Pouly (Stephano) et Hervé Pierre (Trinculo) imitent en guise de bouffonnerie, l'un Gérard Depardieu, l'autre Michel Simon… La cohorte des conjurés est plombée par les accents compassés de Thierry Hancisse en Alonso, roi de Naples supplanté par la prestation de Gilles David en Gonzalo, alors que le duo Antonio-Sebastian (Serge Bagdassarian et Benjamin Lavernhe) se contentent de porter d'assez encombrantes et métaphoriques valises d'un coin à l'autre de la scène.


