À l’heure du jubilé de diamant des visites londoniennes, une compagnie en mutation
11 avril 2016 : choc dans la communauté balletomane mondiale. Chacun y va de son commentaire, de sa conjecture, de son interprétation. C’est que voilà : les distributions de la résidence du Ballet du Bolchoï au Royal Opera House viennent de paraître… 3 semaines, 5 ballets, 21 représentations, et, et c’est là le sujet de controverse, aucune première assurée par Svetlana Zakharova. Zéro. Nada pour le porte-drapeau de la Compagnie, celle qui, joyau plus ou moins incontesté du Bolchoï, y règne sans grand partage depuis une quinzaine d’années, celle qui a – contractuellement, dit-on – droit aux premières des ballets sur lesquels Elle apparaît. Derniers feux d’un glorieux imperium ? Signe de relative disgrâce alors que le nouveau directeur du Ballet, passé par le Mariinsky et la Scala, Makhar Vaziev, vient de marquer sa prise de fonction par des déclarations aussi martiales que remarquées sur sa volonté d’intensifier l’identité résolument classique de la Compagnie ? Simple conflit de calendrier, « La Zakh » étant déjà engagée fin juillet à Tokyo pour un de ces galas au programme gargantuesque dont les Japonais sont friands ? C’est en tout cas aux icônes des générations montante et émergente, Ekaterina Krysanova et Olga Smirnova, que revient l’honneur des soirées d’ouverture. Deux pour l’une, trois pour l’autre. Le choc, on vous dit !
En 1956, Galina Oulanova avait ouvert la première tournée londonienne de la Compagnie, le public occidental restant alors médusé par sa Juliette. Depuis 60 ans, une forme de rituel minutieusement orchestré par les producteurs Hochhauser oppose les deux emblèmes de la danse classique, le Mariinsky et le Bolchoï ; ils se livrent une guerre sans merci, trois semaines durant, chaque été ou presque, à Covent Garden. Une vitrine, cruciale dans le baromètre balletomane… Les enjeux sont forts car, si Vaziev clame dans une interview récente qu'une Compagnie ancre les fondamentaux de sa réputation par la qualité de ses saisons locales, il n’en demeure pas moins que ces tournées amirales, dont chaque soirée, chaque distribution, chaque œuvre est commentée, auscultée, disséquée, modèlent nécessairement la visibilité dont jouissent danseurs et ballet. Lors de son dernier passage, en 2013, le Bolchoï était plongé depuis des mois dans la tourmente médiatique dans laquelle l’avaient précipité les attaques contre Sergei Filin et le déballage spectaculaire qui s’en était suivi. Pour cette résidence de 2016, et son invariable taux de remplissage de 100%, en dépit d’une inflation douloureuse, le Bolchoï revient auréolé des succès répétés et retentissants de ses rediffusions cinématographiques et fort de trois générations de solistes, disons-le, exceptionnelles : les gloires emblématiques (Zakharova, Alexandrova), les cadres établis (Obraztsova – que de bonnes raisons ont tenue éloignée de cette tournée –, Lantratov, Lobukhin, Krysanova, Chudin, Lopatin, Kretova) et les pépites émergentes (Smirnova, Ovcharenko, Rodkhin, Tikhomirova, Savin, Tsvirko – et la liste est loin d’être exhaustive).
En cette deuxième semaine, un étalage de danseurs éblouissant et sans bavure assure six représentations au sommet, occasion de se livrer à un passage en revue, partielle, des forces en présence.
Un gâchis pour tant de talents : Le Lac des Cygnes (Yuri Grigorovitch)
Yuri Grigorovich a produit sa version du Lac en 1969, l’a moult fois légèrement remaniée, revendiquant une approche psychanalytique du livret, avec des actes blancs conçus comme le pendant fantasmé de la vraie vie du Prince Siegfried exposée dans les 1ères scènes de chaque acte, et accentue un refus du conte de fée. Tout cela se fait au détriment d’une fluidité narrative qu’on peine à goûter dans ce découpage sans grande cohérence et ces transitions de scènes hachées et abruptes. Voilà dépouillée de toute tension narrative la succession de tableaux qui nous est offerte – exemple sidérant : l’apparition des cygnes au début du I,2. On saura en revanche gré à Grigorovich d’avoir fini par renoncer au mielleux happy end qui concluait un des précédents avatars de la production. Dans la dernière mouture (2001), on ne sait que retenir : ces tentures au fusain et bavures noirâtres, ces éclairages de la scène introductive où le verdâtre tient lieu de mordoré, ces costumes de la cour à épaules bouffantes ornées de bubons au chromatisme douteux, la forme sidaïque des coupes des amis de Siegfried ? À ce jeu, chacun sa contribution ! Le Royal Ballet a annoncé en 2015 les adieux de la production d’Anthony Dowell ; le titre de production la plus hideuse du Lac des Cygnes pourrait donc désormais aisément revenir à celle de Grigorovich…

Reste, n’est-ce pas là le principal, les danseurs. Aux regards pénétrés d’amoureux absent qui vertèbrent l’interprétation de Vladislav Lantratov au I et au III, Denis Rodkin devant ses prétendantes affiche l’ennui du devoir et la désinvolture du salaud. L’ampleur de ses jetés, grande figure du Siegfried de Grigorovich, et la générosité de son élévation complètent une panoplie de prince plus équilibrée que celle de Lantratov, qui peine par ailleurs à établir une connexion satisfaisante avec Olga Smirnova. Smirnova, des bras délicieux, des arabesques uniques singularisent sa danse, sublimement irréelle. Un brin égoïste voire autiste toutefois, Smirnova semblant peiner à s’établir au sein d’un tout. Ce ne fut pas le cas de Yulia Stepanova, qui, alors danseuse au Mariinsky, avait eu l’occasion de déployer la beauté de ses lignes en Odette/Odile sur cette même scène en 2014. Elle dansait le 2 août le rôle pour la première fois avec le Bolchoï, portée par Denis Rodkin, et surtout Igor Tsvirko en Mauvais Génie (dans les grandes lignes, l’équivalent de Rothbart d’autres productions). Son épaisseur maléfique, la force de son regard, l’énergie de son incarnation impressionnent.
Difficile de ne pas mentionner le rôle du Bouffon incarné avec une virtuosité étourdissante par Vyacheslav Lopatin. C’est en effet au Bolchoï que ce personnage fut introduit : il s’agissait de la troisième production du Lac qu'Alexandre Gorski régla au Bolchoï, qui ne fut représentée que seize fois mais qui présentait par ailleurs la particularité, autre innovation, de faire danser Odette et Odile par deux ballerines différentes[1].
De la musique avant toute chose… On est frappé par la musicalité étonnante des 24 cygnes ! Oh, des impairs, il y en eut, notamment en matière de synchronisation. Mais ces battements et cette respiration communs forment un flux de figures si naturel que les « défauts » se fondent dans le mouvement. Nous goûtons bien peu les litanies de danses de caractère pour trop nous y attarder, mais il faut avouer que, dans la danse russe, les poignets délicats claquant alla Raymonda de Viktoria Yakusheva nous ont séduit. De la musique avant toute chose… Le Maestro Pavel Sorokin tire des couleurs inhabituellement vives de son orchestre, la harpe d’Alla Koroleva, en particulier avant la variation d’Odile, nous comblant de bonheur.

Les programmes de tournée, reflets fidèles de l’évolution du répertoire d’une compagnie ?
La composition des programmes de tournée est toujours un exercice délicat pour les directeurs de compagnie et les producteurs, qui s’exposent au risque de ne montrer que les blockblusters, dont on sait qu’ils attireront a priori la foule et garantiront une tournée sold out. Le cru 2016 joue la carte de la sécurité, mais en partie seulement ; il offre en effet, bon an mal an, un joli panachage. Il y avait là l’incontournable (?) Lac des cygnes « de Grigorovich ». Il y avait aussi des marques de fabrique dans lesquelles le Bolchoï peut afficher avec morgue les fondements de son style : Don Quichotte en programme d’ouverture, ainsi que Flammes de Paris et Le Corsaire, deux ballets remontés à Moscou par Alexei Ratmansky[2]. Mais, esprit chagrin, nous ne pouvons que regretter qu’une part plus grande n’ait pas été accordée dans cette programmation à la vitalité du répertoire dont le directorat de Sergei Filin aura enrichi le Bolchoï. On peste à l’idée que n’aient pas été présentées à Londres la reconstruction de Marco Spada par Pierre Lacotte, pour laquelle le public moscovite exulte depuis sa création en novembre 2013, ou Une vie de héros de Youri Possokhov, créée à l’été 2015. La pièce retenue pour donner une touche d’inédit à cette tournée est issue de l’invitation faite par Sergei Filin à Jean-Christophe Maillot, directeur des Ballets de Monte-Carlo et chorégraphe, de venir créer une œuvre au Ballet du Bolchoï. Astucieux et élégant clin d’œil aux 400 ans de la mort de Shakespeare, furent données à Londres deux (oui, seulement deux toutes petites) représentations de La Mégère apprivoisée qui en a résulté, déjà auréolée de gloire par les publics de Moscou, Monte-Carlo et Saint-Pétersbourg. Ivre du plaisir d’avoir eu la chance d’en découvrir deux distributions au Grimaldi Forum en ouverture de l'année de la Russie à Monaco, c’est avec gourmandise que nous nous pressions à ces soirées. Des semaines plus tard, la pièce continue d’éblouir, d’interpeler et d’interroger.
La Mégère apprivoisée (Jean-Christophe Maillot) : que de réflexions !
Œuvre littéraire et ballet ? Une première question a beaucoup agité les esprits des critiques anglais : celle de mesurer le degré de fidélité à la pièce originelle du déroulé imaginé par Maillot. Si la question de l’adaptation d’œuvres littéraires en ballet est passionnante (un objet de chronique en soi ?), au cas d’espèce, elle est selon nous secondaire – Maillot parvient, sur la base d’un matériau complexe (la pièce de Shakespeare est tout de même très touffue), à offrir un exemple de progression dramatique limpide, de narration dense et dégraissée. Deux actes emballés en 100 minutes denses, endiablées, qui se terminent sur une boutade réglée sur la musique Tea for two… 100 minutes nécessaires et suffisantes : moins serait trop peu, plus semblerait bavard.
Chorégraphe et interprètes ? Jean-Christophe Maillot, en artisan, sculpte la matière brute, dans le vif. Maillot ne sait, ne peut créer autrement qu’en adaptant sa grammaire à la matière dont il dispose et qu’il choisit, à commencer par la musique et par les danseurs. Une intuition qui lui fait puiser l’inspiration de l’évidence dans les qualités propres à l’artiste pour et sur lesquels il crée ; chacun se doit de sortir de soi-même. Nous acceptons l'augure d'une lecture qu'un passage en revue systématique des danseurs rendrait fastidieuse, mais enfin, il faut rendre grâce à ces artistes d’exception qui sous la férule du chorégraphe acceptent l’augure de livrer cette partie d’eux-mêmes qui d’ordinaire se cache sous le masque d’un académisme parfaitement assimilé.

Le résultat est singulièrement spectaculaire pour le couple principal : Ekaterina Krysanova, mé-ta-mor-pho-sée, met de côté son statut de ballerine en chef et se joue avec maestria du piège de l’hystérie monochrome pour accentuer une fragilité, un mal être presque. Son Petruchio, Vladislav Lantratov – le Solor, le Désiré tant aimé – perd ses bonnes manières de prince, on le retrouve en bad boy charmeur et violent, à la dégaine swagguée, à la vulgarité quasi-comique. La seconde distribution, d’aussi haut vol, offre une Kristina Kretova plus vulnérable et sans doute plus touchante et un Denis Savin tout en hormones, petite frappe bestiale et effrayante ; saisissants ! C’est sans doute dans la longue scène d’amour de l’acte II que se déploient toutes les nuances des jeux de ces artistes majuscules, se heurtant à la musique rugueuse du 8ème quatuor de Chostakovitch.
Pour Bianca et Lucentio, Jean-Christophe Maillot a su tirer d’Olga Smirnova et Semyon Chudin la quintessence de leur Art : danse tout en soupir, magie de l’effleurement, magnétisme de l’émoi. Il en résulte deux pas de deux (drague gauche et attendrissante en diable à l’acte I[3], apparition pudique et lyrique devant les invités des noces à l’acte II[4], sur le prélude de la suite tirée de la sublime musique du film Le Taon) d’une exquise orfèvrerie au moment desquels même les vieilles mamies expertes dans l’art de fouiller dans leurs sacs, de faire tinter leur verroterie et de défaire leurs bonbons se tiennent coites : exploit ! Le pas de deux de l’acte II – dont la beauté à pleurer a rendu noire de jalousie Ekaterina Krysanova, qui a réclamé à Maillot un morceau de bravoure d’une aussi belle trempe ! – exalte un lyrisme qui sied naturellement à Smirnova et Chudin, ingénuité incarnée.
Les comprimari ne sont pas en reste : pour chacun, Jean-Christophe Maillot cisèle des personnages impeccablement caractérisés. Igor Tsvirko, ce beau gosse d’Hortensio aux sauts étourdissants, au minois ravageur ; Vyacheslav Lopatin, ce mac de Gremio, libidineux avec ses mains épatantes de drôlerie. Et puis, et puis, bien sûr Anna Tikhomirova, à qui échoie un rôle de Gouvernante taillé à la mesure de sa présence piquante, de son charisme jubilatoire, de son abattage glamour ; il faut la voir débarquer, rideau fermé, avant même l’arrivée du chef en fosse, imposer sa silhouette de femme fatale en jetant des œillades arrogantes au public tout en se faisant les ongles ; du grand Art ! Le jeune Georgy Gusev, en serviteur pas si docile ni effacé de Petruchio, écope quant à lui d’enchaînements de pas drôlissimes.
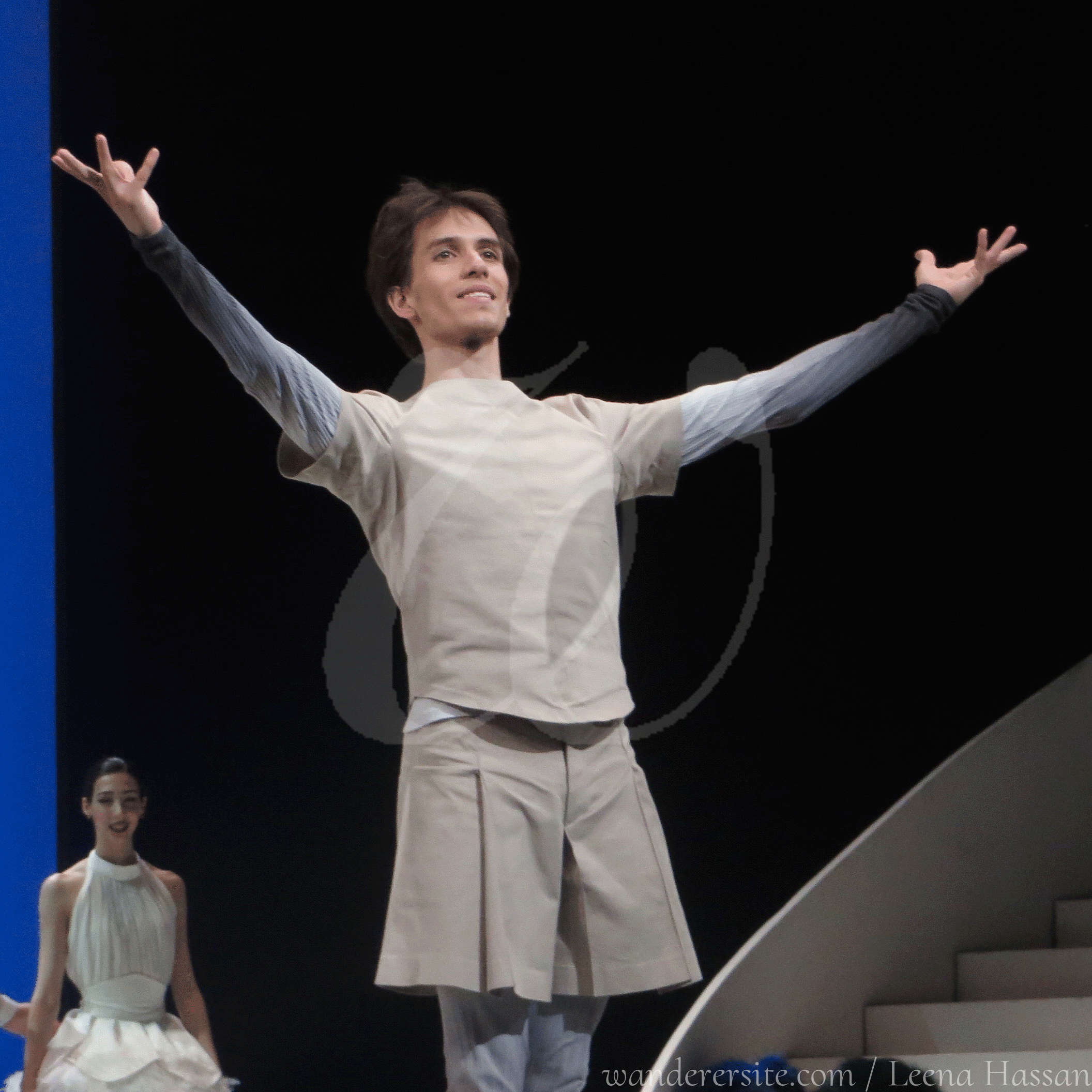
Création chorégraphique et interprètes ? À qui croit agonisante la forme du ballet narratif, Jean-Christophe Maillot apporte un cinglant, et rassurant, démenti. La question demeure en revanche de la pérennité d’une œuvre qui semble si tenacement ancrée dans la personnalité même de ses créateurs. La Mégère apprivoisée survivra-t-elle à ses créateurs ? Les débuts sont petit à petit distillés, c’est ainsi qu’en mai dernier, Nina Kaptsova reprenait le rôle de Bianca. Elle y imprime en ce 4 août un allant bienvenu et une mutinerie rafraîchissante plus marquée que Smirnova, et s’accorde à merveille à son Lucentio, Artem Ovcharenko, d’une virtuosité un soupçon plus démonstrative que Chudin. Comment évoluera ce compagnonnage entre une Compagnie et un chorégraphe qui semblent s’être aimés aussi intensément ? Nous ne pouvons en tout cas que lui souhaiter longue vie !
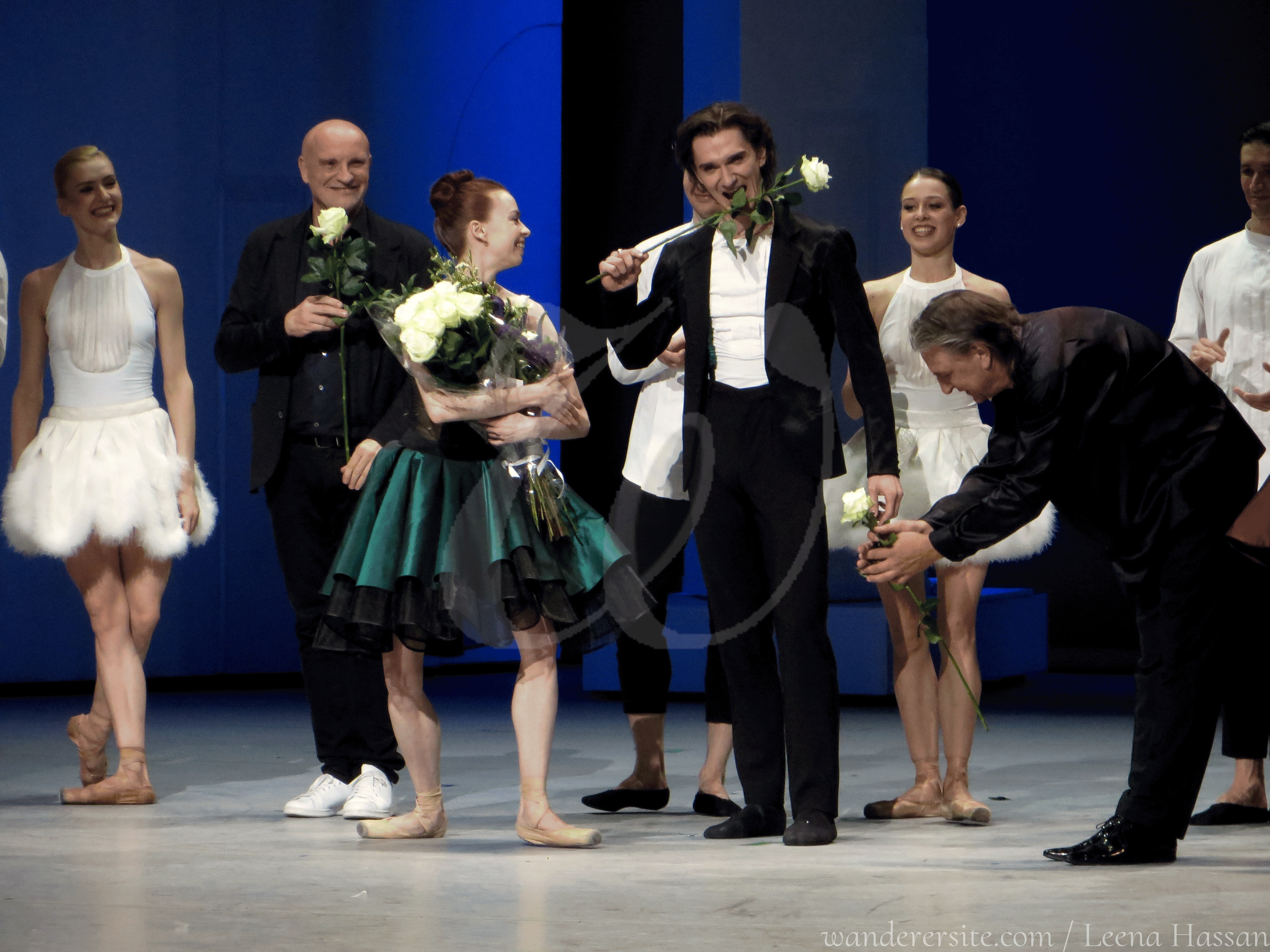
Incidemment, sur la question de la pérennité de l’œuvre à ses interprètes… Prononcez donc devant un balletomane les mots « Flammes de Paris », et vous pouvez être assuré(e) que, fébrile, ardent, agité, il vous renverra à la captation vidéo qui a été faite de ce ballet en 2011 avec Natalia Osipova dans le rôle de Jeanne et Ivan Vassiliev dans le rôle de Philippe[5]. Tel est le drame de la production que Ratmansky a réglée puis offerte à ces deux enfants terribles du Bolchoï de l’époque : leur rayonnement était tel – et leurs prestations si uniques et électrisantes – qu’ils semblaient épuiser l’œuvre, tout en dire. Le Palais Garnier résonne encore des hurlements pré-adolescents des balletomanes parisiens, dont on sait combien ils sont difficiles à sortir de leur torpeur et qui ont réservé à ces Flammes de Paris, des salves d’applaudissements et de stridences triomphales jamais plus vécues depuis. Le couple Osiliev a tellement marqué de son empreinte géniale ce ballet qui ne l’est pas tant que chacun est désormais condamné à être jugé à l’aune de ce partenariat princeps.

Flammes de Paris (Alexei Ratmansky), un défi impossible pourtant relevé !
C’est dire le défi, impossible, qui se pose à ceux qui s’y frottent. Oui mais voilà… Quand la alors jeune Natalia Osipova, aux dons exceptionnels qui caractérisent ces ballerines comme il n’en émerge que tous les 10, 15, 20 ans, était poussée sur le devant de la scène de la Compagnie, d’autres danseuses étaient tapies dans l’ombre. Ekaterina Krysanova – encore elle – en était et s’impose désormais comme l’une des figures de proue du Bolchoï, en particulier dans le répertoire le plus virtuose et brillant. Dans Flammes de Paris, rappelons que Jeanne est amoureuse de Philippe, et son frère Jérôme s’entiche d’Adeline, fille du Marquis Costa de Beauregard ; un pittoresque objet qui nous transporte de la province française qui gronde aux barricades, d’une prison aux ors de la Cour sous lesquels un ballet de circonstance se donne (Rinaldo et Armide, véritable ballet dans le ballet), le tout sur une musique caricaturalement tagada tssoin tssoin de Boris Asafiev.
On peut aimer ou pas, mais on ne peut qu’être admiratif de l’étalage de danseurs qu’offre en deux représentations (nous avons abandonné la troisième, l’indigestion guettant) le Ballet du Théâtre Bolchoï. Qu’il soit annoncé que Yulia Stepanova est blessée et ne peut assurer le rôle de Mireille de Poitiers aux côtés de Denis Rodkin ? Ce n’est pas grave, Anna Tikhomirova et Artem Ovcharenko sont là et assureront toutes les séances – et qu’il soit là permis de souligner le talent d’Anna Tikhomirova : Londres est tombé en pâmoison devant celle qui sera la révélation de cette tournée pour le grand public. Elle réussit à mettre le public à ses pieds avec un morceau de bravoure et un costume aussi ingrats, en y apportant son incomparable malice, et nous nous rappellerons longtemps encore comment, immobile sur le côté de la scène pendant que le corps de ballet s’agite au milieu, elle magnétise en jouant de ses cils et de ses minauderies délicieuses, presque cartoonesques ! Vous pensez que le rôle du Marquis est anecdotique ? Paf, on y colle Semyon Chudin, qui en exhausse les moindres subtilités et montre que lui aussi, le danseur noble par excellence, peut faire preuve de noirceur (révélation !). Vous êtes nostalgique d’Ivan Vassiliev, certes incomparable dans ce rôle ? Mikhail Lobukhin, abonné aux emplois soviétiques alla Spartacus ou Ivan Le Terrible, sort le grand jeu. Nous nous demandons pour autant s’il résistera longtemps dans Flammes de Paris à la génération suivante, celle notamment d’Igor Tsvirko, plus félin que jamais, qui se charge de nous éclabousser d’une série de double jeté entrelacé ahurissante.

Apothéose
Nous pourrions continuer longuement, tant les plateaux qui soir après soir nous sont présentés se laissent déguster sur l’ensemble de leur profondeur. Durant toute cette semaine, pas une seule seconde nous ne sommes demandés si tel ou telles était soliste, premier soliste, « leading solist » ou « principal ». Tous – tous, et nous n’avons pas vu d’exception – partagent cette rage de la scène, ce bonheur de la projection, cette ivresse de faire de l’Art, enchaînant soirées d’applaudissements nourris et véritables triomphes. Bon courage donc au Ballet du Théâtre Mariinsky pour sa prochaine résidence, qui devrait intervenir à l’été 2017 ; le Bolchoï a placé la barre au plus haut !

***
Nous remercions chaleureusement Leena Hassan, qui nous fait l’amitié de nous offrir les prises de vue magnifiques et sensibles qui ont permis de procéder à l’habillage iconographique de la présente chronique.
[1] Création le 29 février 1920, décors d'Arapov, Elena Iliouchtchenko et Maria Reizen dans les deux rôles de Cygne.
[2] Alexei Ratmansky, ci-devant directeur du Ballet du Bolchoï et aujourd’hui chorégraphe et archéologue de la danse parmi les plus courus
[3] https://www.youtube.com/watch?v=3PbwV8blm6c
