
Crowd est un spectacle collectif. À ce titre, c’est bien une équipe qui a présidé à son élaboration. On retrouve donc le cercle des habitués, réunis depuis le séminal Kindertotenlieder de 2007 : outre la présence de l’écrivain subversif américain Dennis Cooper, aux côtés de Gisèle Vienne depuis I Apologize (2004), on retrouve au son, l’américain Stephen O’Malley, guitariste métal, graphiste, patron du Label Southern Lord et fondateur du groupe culte de drone doom Sunn O))) ((groupe initialement formé du duo Stephen O’Malley et Greg Andersson, qui joue avec les codes stricts du doom metal, rock technique, souvent d’inspiration sataniste, basé sur la répétition et l’immersion dans le volume sonore. Le groupe étire les motifs, allonge les compositions, joue des feedbacks dans un volume extrême (les potentiomètres sont toujours au maximum, y compris live et à dépit de toute réglementation), créant une musique qui doit autant à la chorégraphie (le moindre mouvement entraînant le feedback, les déplacements se doivent d’être lents et extrêmement mesurés) qu’à la production pure de sons. Toute l’imagerie du métal (rituels rocks exacerbés, toges satanistes, abus de fumigènes, chants gutturaux) est à la fois conservée et tenue à une distance ironique. Leurs concerts tiennent ainsi de la performance sur scène comme dans le public, attirant « métalleux » stricts, amateurs de musiques expérimentales et de rock indépendant.)) accoquiné avec le viennois Peter Rehberg, aka Pita, tête de l’influent label Mego((au milieu des années 90, la ville de Vienne s’impose comme le renouveau de la scène électronique avec la création du label Mego par Peter Rehberg et la lente starification de Christian Fennesz. Le rock et la pop en bout de course sont revitalisés par des artistes qui, en bons punks, vont distordre les sons et méthodes de composition par laptops interposés. Pop hachée éthérée dans laquelle les guitares sont délavées avec Fennesz (Hotel Paral.lel, 1997, Endless Summer, 2001), bruitisme et terrorisme musical avec Pita (Get out, 1999, Get down, 2002), techno minimale avec les finlandais Väisänen et Vainio échappés de leur duo Pan Sonic. Sans compter d’autres légendes de la musique pop et/ou extrême, Jim O’Rourke, Merzbow ou Alan Vega…)), musicien électronique extrême. Cette rencontre des deux pôles, présents sur scène, voilà qui avait focalisé beaucoup d’énergies autour de Kindertotenlieder. Le duo avait tellement bien fusionné alors qu’un groupe, KTL, avait émergé de la collaboration scénique, sorti plusieurs disques et même réalisé la bande son de La Charrette Fantôme (Körkarlen, 1921)((film fantastique culte, un peu gothique, qui inspirera Ingmar Bergman et auquel ce dernier rendra hommage dans Les Fraises Sauvages en réutilisant le thème de la mystérieuse charrette dans une scène onirique et… en donnant le rôle principal à Victor Sjöström.)) de Victor Sjöström pour sa ressortie en DVD en 2007 chez Tartan, puis Criterion.
C’est ce même esprit de travail en commun que l’on retrouve dans Crowd, si ce n’est des images mêmes du spectacle fondateur qui ressurgissent dès l’entrée sur scène, au ralenti, des figures encapuchonnées, mystérieuses et inquiétantes qui peuplent souvent les scènes de Gisèle Vienne. On retrouve donc ici son activité de marionnettiste et on pourrait même imaginer que les mannequins de Kindertotenlieder sont de retour, tels les enfants/tumeurs qui revenaient comme autant de somatisations incarnées s’attaquer aux corps adultes dans Chromosome 3 (The Brood)(( cette image de l’enfant encapuchonné (de rouge !), mélange d’innocence, d’inquiétante étrangeté et de menace court dans le cinéma, du remake décalé de The Brood par Nicholas Roeg, Don’t Look Now (1973), jusqu’au personnage d’Eliott du E.T. de Steven Spielberg. Nul doute : ces contes fantastiques modernes font partie du recueil d’images mentales dans lequel puise Gisèle Vienne.)) de David Cronenberg (1979). Il y a, chez Gisèle Vienne, une véritable esthétique de la capuche (anonymat, repli sur soi, intériorité…) comme bien commun d’une certaine génération : de la bande de banlieue au black block, du raver au capuchon de la toge sataniste du black metal. Comme chez Sunn O))), Gisèle Vienne joue avec ces codes et ces images-là en tant que tels. La célèbre proposition de Guy Debord dans La Société du Spectacle (« le Spectacle n’est pas un ensemble d’images mais un rapport social entre des personnes médiatisé par des images ») est au cœur du processus créatif de Vienne mais l’opposition de la citation se transformerait en simple ajout : le Spectacle n’est pas seulement un ensemble d’images mais aussi un rapport social entre des personnes médiatisé par des images.
On assiste donc à un défilé (nous y reviendrons), à une entrée en scène au ralenti, de ces figures de la jeunesse d’une époque, caractérisées par leurs costumes (créés par Gisèle Vienne avec Camille Queval et la troupe) au sens théâtral du terme. Jean slim noir du rocker, sportswear commun à la Spice Girl Sporty et aux récents fluokids, chemise bûcheron sur pantalon large post grunge, t‑shirt délavé ironique (le tigre des céréales Kellogg’s((la marque Kellogg’s renvoie certainement aussi au produit céréalier Special K, mais aussi au nom de code discret de la Kétamine, produit anesthésiant et utilisé par les ravers comme hallucinogène.)) de consommateurs goguenards nés de la société de surconsommation.
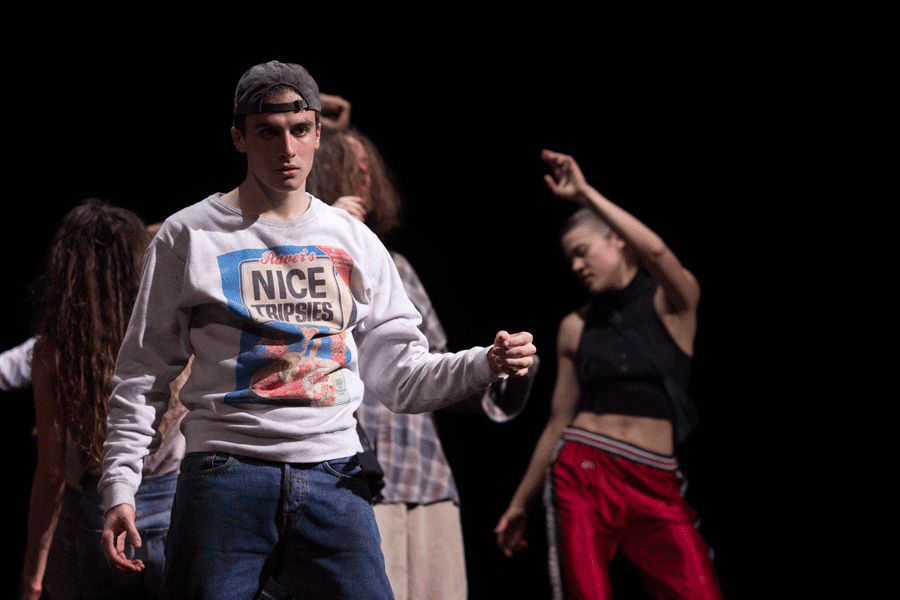
Nous sommes à la fois dans le présent, ces corps jeunes, cette génération-là, et l’histoire car c’est l’histoire de la jeunesse de ces trente dernières années qui nous est contée (avec un curseur très pointé vers les années 90) même si l’ensemble est réactualisé (bas de pantalon coupé aux chevilles etc.) et peut, en apparence, nous troubler dans ces rapports avec le présent((Si le mouvement raver/teufeur s’essouffle globalement, il reprend ces dernières années, notamment en Suède, par réaction au retour d’une culture club redevenue hors de prix, amplifiée par les difficultés économiques de la vie étudiante.)).
La musique, sélectionnée et mixée avec soin par Peter Rehberg, nous tire dans les eaux de ce passé. C’est un magnifique échantillon du meilleur de la techno (du début) des années 90, notamment du son de Detroit, qui fait le lien, historique, entre le krautrock((littéralement le rock choucroute, mouvement de rock expérimental, initié en Allemagne à la fin des années 60 et début 70, au carrefour des influences des musiques psychédélique, électronique et des expériences avant-gardistes.)) des années 70–80 (Manuel Göttshing, guitariste de Ash Ra Tempel avec le titre E2-E4, sorti en 1984), les musiques expérimentales (un titre de KTL et un autre de Pita, héritiers de ces transes-là), en passant par le renouveau électronique des musiques noires, notamment funk et soul, retrempées dans le bain froid des machines((Sur le mouvement techno et ses racines, on relira avec profit la bande dessinée Le chant de la Machine de David Blot et Mathias Cousin.)).
On assiste donc à une rave, fête gratuite ouverte à tous (par opposition aux clubs), financée par la participation libre, qui fut un espace de liberté et de danse collective dans la fin des années frics. Pas de stars à applaudir ou à honorer : c’est la musique diffusée sur des enceintes par des DJs qui est frontale, avec au centre, les corps.
Ce que nous rappelle Gisèle Vienne, c’est que la rave est une des dernières manifestations du rite. Même si elle n’y fait pas explicitement référence ici (quoique, nous y reviendrons), c’est un élément constitutif de son travail. Rappelons que la rave obéit à tout un tas de rituels comme la circulation de la main à la main de tracts, l’infoline qui permettait d’obtenir des informations sur le lieu de rendez-vous, l’attente, les rassemblement fébriles, les files de voitures qui se suivent, les jeux d’évitement avec le pouvoir et la police, les premières prises de substances…
Gisèle Vienne coupe le récit de cet ensemble de rites pour débuter par l’arrivée sur le champ de bataille (Dance floor, souvent un lieu désaffecté ou un espace naturel piraté devenant Zone d’Autonomie Temporaire), ici un champ de terre déjà dévasté et encombré de détritus : gobelets en plastique plus ou moins vides, sacs plastiques…
Le rituel est là, déjà commencé, par cette préparation hors scène, et se poursuit par des libations inconscientes, liquides versés sur le sol nourricier (bière, boisson énergisante, eau), dont le sens mythique se retrouve par le truchement du regard de la metteuse en scène.
Évidemment, la référence est Le Sacre du Printemps, en particulier celui de Pina Bausch((lire le compte-rendu du spectacle : https://wanderer.legalsphere.ch/2017/11/salonen-roi-etoiles/)), lointain ancêtre du Teknival du premier mai (aujourd’hui devenu véritable tradition française), mais alors que la terre battue, poudre fine rouge, était soigneusement ratissée comme pour un espace sacré, ici ce ne sont que mottes grumeleuses, stériles et salies par l’homme. D’autres « rituels » ont eu lieu, sans régénération semble-t-il.
C’est au récit de l’expérience de la transe collective que Gisèle Vienne s’attaque, à cet abandon des corps aux énergies telluriques qui les traversent malgré tout, comme un reste du cerveau reptilien, comme un geste reflexe. Pour voir et montrer cela, Vienne utilise le ralenti, comme Jean-Luc Godard et Anne Marie-Miéville découvrant les possibilités de révélation du réel avec leurs expérimentations sur les tables de montage vidéo à la fin des années 70. La référence au cinéma et à la vidéo n’est pas fortuite, elle est l’angle d’attaque privilégiée et l’essence de notre génération Spectaculaire.
Impossible également de ne pas voir de parallèle entre le travail de Vienne et celui du vidéaste Bill Viola, lui aussi cherchant à rendre compte d’un mysticisme perdu en Occident par le biais d’images ralenties, réactualisations modernes d’images sacrées mises en mouvement.
Les ralentis permettent de donner à voir en distordant nos perceptions temporelles habituelles tout en rendant compte des effets de prises de substances. Le réel et le temps sont subjectifs, on le sait depuis Proust, et la théorie de la relativité générale d’Einstein le prouve, pour autant, on utilise toujours aussi improprement dans la vie courante ces concepts. C’est aussi ce que la rave, ici mise à distance, révèle.
Les ralentis isolent des personnages, focalisent sur d’autres, figent des scènes comme autant de tableaux réellement vivants (cf Passion de Godard ou La Flûte Enchantée de Castellucci((Lire le compte-rendu ici : https://wanderer.legalsphere.ch/2019/05/lheure-du-loup/)). Toutes les techniques vidéo et cinématographiques sont là ainsi que celles des nouvelles technologies (boucles animées de type GIF, etc.) qui forgent la manière de rendre compte, sinon de voir tout simplement, des nouvelles générations.
Les ralentis ne sont pas dénués de sens car ils attirent toujours le récit sur une exploration de la psychè, des ressentis, des sentiments, des motivations profondes qui animent les personnages. Joie, extase, solitudes, violences, rencontres, accouplements, jalousies, bad trip… Giselle Vienne et Dennis Cooper racontent un drame en travaillant leur dramaturgie par soustraction. Comment dire, comment raconter sans mot ? Comment enlever les ressorts des actions et conserver l’histoire des âmes dans ces corps dansants ? C’est tout le travail de cette mise en scène.
Par exemple, un affrontement éclate, qu’on n’avait peut-être pas vu venir ‑difficile de garder les yeux sur une troupe de quinze interprètes en interaction- mais son point de tension, sans cesse repris en boucle, comme un GIF animé, permet de se refocaliser sur l’évènement, de reprendre son histoire, d’essayer d’appréhender tenants et aboutissants, du moins dans le canevas général et toujours dans une certaine indétermination, propre à ce genre de rassemblement et aux effets des substances. On joue ainsi à : qui connaît qui ? Qui est avec qui ? Et surtout qui a pris quoi ? Voire dans quel état on erre…On est alors dans des données bien factuelles et consuméristes du rite de transe collective et cette vacuité se ressent profondément.
Dans le jeu de références imagées, les accouplements nocturnes sauvages (et assez sages, ecstasy et MDMA obligent : tout reste dans la surface et les contacts), les désirs, les jalousies, les passages à l’acte transgressifs évoquent, dans leur silence et cette musique primitive, la scène troublante de la fête païenne du solstice qui renvoie à ses abîmes moraux le protagoniste d’Andreï Roublev (1969) de Tarkovski. Dennis Cooper fait dévier cela vers des attouchements homos à cour (encore une fois bien sages, mais on est ici dans le symbolique, moins dans le trash).
On rapprochera ce genre de symboles avec les sensations et images fortes que véhicule Crowd. Au bouleversement des sens déjà évoqué, on ajoutera aussi les cigarettes fumées sur scène, et leurs odeurs, qui rappellent une époque déjà bien révolue où l’on fumait dans les lieux de spectacle. Fumée, encens du pauvre dont les volutes se mêlent aux jets et aux gerbes de liquides. La référence est sans doute aussi langagière : les usagers de drogues sont « cramés ». La métaphore est filée jusqu’au bout avec ces moments de beauté suspendue (et d’inquiétude aussi) pendant lesquels de la fumée sort des vêtements, vaporisant le ou les personnages et créant un espace intermédiaire entre la terre et les hommes. Espace qu’on voyait déjà naître dans Le Sacre de Pina Bausch lorsque la poudre de terre battue rouge saturait progressivement l’atmosphère de la salle au cours du spectacle.
Toujours sur la piste Pina Bausch, Gisèle Vienne réactualise le travail de la chorégraphe allemande. Dans Kontakthof, les danses de salons désuètes du temps de la génération précédente donnaient à voir dans des petits gestes figés, répétés, les travers des corps et des âmes de la génération présente comme autant de comportements ataviques hérités du passé, Crowd travaille cette même veine. Elle détourne son Sacre, en nous montrant que l’essence sacrée du rituel est morte et qu’il ne reste que le désir physique de transe, que de vagues gestes fortuits qui ont perdu leur sens.
De manière assez intéressante, elle garde aussi, nous semble-t-il, la vague trame du Sacre, toujours dans ce projet d’effacement de la dramaturgie et du scénario (encore des pratiques et thèmes godardiens). Ainsi, l’élue, la victime sacrificielle, nous donne l’impression d’être incarnée dans le personnage de la jeune fille, déjà en bad trip au début de la pièce. Isolée, d’emblée déconnectée, comme une Pythie sous influence, en dehors de la joie régénératrice de la tribu, elle dénote dans le groupe et nous offre une sacrée performance physique, dans laquelle le jeu d’acteur devient une véritable chorégraphie des muscles du visage. Dans une mise à mort inversée – image mentale protectrice ? Very bad bad trip ?- elle se retrouve seule en scène, au centre des corps des autres allongés, inertes. Le sacrifice à la terre mère nourricière n’aura pas lieu. Gaïa se serait-elle vengée ?

Si on s’attache à chercher et finalement à abandonner la recherche de ces micro histoires, c’est que Crowd s’intéresse au spectacle de la foule, au mouvement global d’un corps composé d’individualités, traversé d’affects, d’énergies. Là encore, l’idée se rattache à l’histoire de la danse et à ses aventures collectives. Nous avons évoqué le Sacre, celui de Pina Bausch, œuvre de troupe, mais aussi le spectacle initial (1913) de Stravinsky/Nijinsky créé, à Paris, par les Ballets Russes dans une atmosphère de scandale. L’autre référence, nous semble-t-il, serait Parade, ballet de Massine sur une musique de Satie, poème de Cocteau et décors, costumes et rideaux de scène de Pablo Picasso, créé toujours à Paris, en 1917, car, outre la même atmosphère de Gesamtkunstwerk qui a présidé à sa naissance, c’est bel et bien à une parade que l’on assiste avec son entrée en scène, ses joutes, ses bravades, ses ratés même, constitutifs du rituel du spectacle. C’est la sortie de scène qui achève de nous convaincre de la possibilité de la référence avec la reprise, du moins pour un personnage (rouleur de clopes, en pause de fin de spectacle), du temps propre (le nôtre) avec ses mouvements à vitesse « normale » et le défilé des protagonistes vers le hors champ des coulisses. Le tout dans un fade out musical véritablement théâtral : on est loin de la fin des raves (des rêves ?), temps signalé par le lever du soleil qui annonce l’évanouissement dans la nature des participants… quelques heures plus tard (substances obligent, toujours).
La notion de spectacle est ainsi toujours fermement martelée. « Le vrai est un moment du faux », écrivait Debord. En créant du faux, on fait apparaître du vrai. Les lumières (signées Patrick Riou) très blanches, venues des cintres (procédé cher à Fassbinder, autre artiste toujours à cheval entre théâtre et cinéma), accentuent le rendu théâtral voire cinématographique de Crowd. Pas d’effet stroboscopique, qui hache les mouvements. Cet effet, c’est la danse qui le provoque et y fait référence. En revanche, on retrouve la même ciselure des corps que dans les parties dansées de 120 battements par minute (2017)((on remarquera que la bande son avait été confiée à Arnaud Rebotini, autre vétéran de la scène électronique, ici française.)) de Robin Campillo, qui étaient comme autant de respirations dans le film, de recentrage sur la vie des corps, ensembles mais (enfin ?) seuls, hors des tensions et des débats collectifs de la lutte LGBT principalement montrés.
C’est la fonction de la musique et du son dans Crowd. O’Malley passé maître de ce genre d’expériences sonores a hérité du titre de responsable sonore (le technicien est Adrien Michel) et joue sur les volumes de manière impériale. Le son se développe, enveloppe et crée une union, une véritable communion qui se retrouve dans les concerts de Sunn O))). On est véritablement pris dans la pâte sonore qui entraine une dissolution des « moi », à laquelle on peut ne pas prendre garde, tout comme on s’habitue inconsciemment au volume hyper puissant qui finit par nous englober. À un moment, le son s’arrête au cours du spectacle et entraîne une récupération (réintégration ?) des individualités dans le silence. Dans une sensation d’hyperacousie, on entend à nouveau son corps et ceux des autres (respirations, gargouillis) et on reprend conscience de soi et des autres, et de ce qui a été, un temps, perdu. Et peut-être gagné. Distorsion des sens sur scène mais aussi des sens du public. Expérience hautement cathartique pour tous.
 © Estelle Hanania
© Estelle Hanania
Si Crowd est mouvements, physicalité pure, corps libérés de leur Surmoi par l’intermédiaire du son, la musique est l’âme et le cortex du spectacle. Voir des corps en mouvement et être obligé de rester assis, enveloppé de ce son et de ces rythmiques diaboliques force à prêter davantage attention au mix, aux finesses d’invention d’une musique autant cérébrale que physique. C’est le premier aspect qui in fine prime dans le spectacle. Selon son degré d’intimité avec cette musique, on se souviendra ou on découvrira toute la pertinence et l’inventivité de cette époque assez inégalée, et ce dans toute son actualité. Là encore, le choix des titres ((une playlist YouTube a été réalisée par le TNB de Rennes- sans les titres créés par KTL et Rehberg pour le spectacle-:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcVAd9cLapLF6E_erVEuiPjHYZwegkpj )) est historique (entre 92 et 95 principalement et avec Detroit comme centre mais on note entre autres une belle incartade française, Paris toujours !, avec Laurent Garnier sous l’alias Choice pour le titre Acid Eiffel) mais toujours dans le jeu : on cherche à repérer les contributions contemporaines (KTL et Rehberg) cachées dans la sélection (pas facile car fort bien intégrées).
En ce sens, Crowd est le pendant techno de Detroit à la house/French Touch vue et relue par Mia Hansen Løve dans Eden (2014). Même époque bénie, héroïque même (c’est le sens du film de Hansen Løve, même si elle s’attache plutôt aux perdants), désormais mythique et aujourd’hui entrée dans l’histoire et dont on peut apprécier et valoriser la singularité et la permanence par le biais de l’œuvre d’art. En ce sens, Crowd, expérience sensorielle intense avant tout, devient une capsule temporelle absolument essentielle, qui dépasse largement le strict cadre de l’hommage au mouvement raver/free party.

Terre ravagée, post spectacle (Repr. de Stockholm)
