
En ces débats aussi passionnés qu’inutiles sur les reconstructions/reconstitutions de monuments de l’architecture à la suite du dramatique incendie de Notre Dame de Paris, ainsi que sur la notion de patrimoine, qui en art est une notion discutable, s’impose la question : la mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle de La Cenerentola, qui remonte à 1973, une éternité en matière de théâtre, fait-elle partie du patrimoine scaligère ? Faut-il la conserver et la reconstituer, déjà 30 ans après la mort de son créateur et 46 ans après sa création ? C’est une vraie question d’herméneutique. Plus au théâtre qu’ailleurs la relation entre scène et spectateur est une relation dans l’instant, dans le contexte et pas vraiment dans l’histoire. J’ai souvent défendu dans ce site et ailleurs les productions qui ont été conservées, pour marquer l’identité d’un théâtre ou le souvenir d’un grand artiste. On en reparle souvent à propos de la Lulu de Chéreau disparue corps et biens et de son Elektra, conservée et affichée encore, et pieusement remise sur le métier à chaque reprise alors que Patrice Chéreau détestait un théâtre qui ne fût pas vivant, inscrit dans l’instant, et a toujours refusé l’entrée de ses spectacles dans le répertoire ordinaire des théâtres, où l’œuvre (si l’on considère la mise en scène comme une œuvre) serait définitivement séparée de son créateur pour vivre une carrière de reprises infinies…
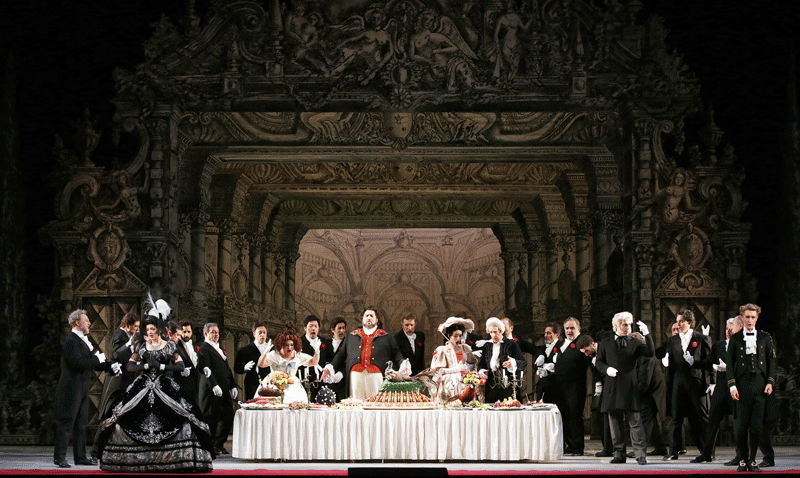
Inévitablement, ce que nous voyons n’est pas La Cenerentola originale puisque son créateur musical Claudio Abbado a disparu lui aussi, et que la création originale était un tissage entre les idées de Ponnelle et le rythme d’Abbado, qui se nourrissaient l’un l’autre, sans compter la personnalité déterminante de sa créatrice dans cette production la trop oubliée Lucia Valentini-Terrani et l’immense Teresa Berganza, bien heureusement encore parmi nous, qui prit le relais en 1975 pour marquer le rôle de la manière qu'on sait.
Alors, dans ces reprises « historiques », il faut accepter de voir une « resucée » qui ne ressemble pas forcément à la lettre à l’original, mais qui donne un parfum ou une odeur qui eux, survivent encore. J’admire les jeunes critiques qui se gaussent de ces spectacles « vieillis », les envoyant au placard et ironisant sur le manque de goût du public d’alors qui acceptait ces vieilleries … Certes, la création contemporaine doit s’adresser aux contemporains, comme toute création et je peux personnellement aimer ces reprises qui me rappellent les grands moments de mon jeune temps, mais qui en termes scéniques ne parlent plus au public du jour, il reste que les grands chefs d’œuvre de la mise en scène peuvent encore survivre et pas seulement dans le souvenir ou le mythe. Le public d’aujourd’hui encore applaudit à scène ouverte au deuxième tableau de Bohème, chez Momus, dans la mise en scène de Zeffirelli, âgée de plus d’un demi-siècle…
Par ailleurs, a‑t‑on vu récemment de grandes Cenerentola ? La tentative intéressante de Michieletto à Salzbourg, peut-être…L’Opéra de Paris quant à lui a raté l’entrée en répertoire en 1977 sous Liebermann avec une production en demi-teinte de Jacques Rosner, a proposé dernièrement une production Gallienne qui ne marquera pas les mémoires. Les plus réussies à Paris viennent d’ailleurs, la production Savary de Genève (sous Gall) et la reprise opérée par Joel de la production Ponnelle (celle de la Bayerische Staatsoper, pas de la Scala) ; on attend donc que le manager futur de la maison en propose une vraie production locale réussie en propre.

Il reste que la production Ponnelle est celle qui encore répond le mieux à la définition « dramma giocoso ». D’une part elle essaie de rendre l’atmosphère des contes de fées à la Disney, avec un décor presque dessiné, avec ses trompe‑l’œil, avec ses atmosphères plus suggestives que réalistes, avec ses personnages caricaturaux (le père et les deux sœurs) et les personnages positifs plus dans la « norme »… Souriante, mais jamais surjouée, mélancolique, mais jamais triste, l’intrigue se déroule avec une belle fluidité, et n’a jamais de chutes de régime dans un espace scénique particulièrement bien construit. Elle est restée au répertoire, à Munich aussi, depuis 1975, cela veut dire que le public, à Milan comme à Munich ne s’en lasse pas. Et de fait, c’est un plaisir toujours recommencé.
Du point de vue musical, il n’existe point aujourd’hui de chef incontestable pour Rossini, au moins le Rossini bouffe (le Rossini sérieux est mieux servi en général, mais peut-être aussi plus facile), pétillement, mélancolie, symphonisme ne trouvent pas toujours leur interprète favori. Depuis Abbado, il y a peu de chefs incontestés dans ce Rossini-là qui nécessite rythme transparence, suivi et soutien des chanteurs. Gianluca Capuano, peut-être, qui a signé une très belle Cenerentola avec Bartoli, qui a circulé en Europe, venue de Monte Carlo (voir ci-dessous) était peut-être récemment le plus convaincant.
On regrette d’autant plus que Riccardo Chailly qui signa au disque une Cenerentola fulgurante avec Bartoli ne s’intéresse pratiquement plus qu’aux versions princeps de Puccini… Il aurait pu fêter ici des retrouvailles avec Rossini qu’il a toujours bien servi.
Ottavio Dantone est un chef qui sert bien le répertoire baroque avec son Accademia Bizantina. Il est un accompagnateur efficace du plateau mais il n’a pas la créativité ni la vitalité débordante qu’on aimerait entendre. Peut-être d’ailleurs est-ce un choix que de refuser une couleur bouffe, à un opéra appelé dramma giocoso, le rythme est moins soutenu quelquefois, et il soigne la couleur des airs plus mélancoliques (una volta c’era un re). Le tout est de toute évidence très raffiné et très soigné. L’orchestre de la Scala, qui connaît son Rossini sur le bout des doigts fait sa part du travail en sonnant avec justesse notamment des bois tout à fait exceptionnels et bien mis en valeur par le chef. Une approche globale très élégante, très transparente et soutenant très bien le plateau même si on aurait pu souhaiter quelque chose de plus brillant.
Excellent évidemment le chœur d’hommes dirigé par le remarquable Bruno Casoni.
La distribution n’était pas celle de la première, ni Nicolà Alaimo, ni Erwin Schrott n’étaient affichés, mais ont laissé place dans Dandini et Alidoro à de jeunes et valeureux chanteurs de la nouvelle génération. Il reste que l’ensemble a constitué une soirée de qualité, une de ces soirées qu’on aime à la Scala ; d’ailleurs, surprise agréable, le public est resté à applaudir debout au lieu de fuir éperdument comme c’est son habitude.
La distribution de bon niveau proposait dans les deux sœurs la Clorinda de Sara Rossini, bien en place et scéniquement et vocalement et la Tisbe’ de Anna-Doris Capitelli, issue de l’Accademia della Scala ; scéniquement les deux sont désopilantes à souhait, et vocalement, les deux voix vont bien ensemble.
Alidoro était confié à Alessandro Spina, voix correcte, bien contrôlée, avec un joli phrasé, même la voix n’est pas d’une puissance marquante. On a entendu de meilleurs Alidoro, mais la prestation est très honorable. Le timbre est chaud, le ton est juste. Alessandro Spina polira mieux par le futur son rôle, mais son air Vasto teatro è il mondo montre une émission juste, une attention au phrasé, même si l’ensemble manque encore un peu de personnalité.

Dandini était Mattia Olivieri, qui chantait le rôle pour la première fois, en alternance avec le très expérimenté Nicolà Alaimo. Alors évidemment il n’a pas l’aisance ni le style consommé de son collègue, mais la voix est superbe, le timbre chaud, et la diction et l’émission vraiment remarquables. Il lui manque encore de la facilité dans les sillabati, et les parties qui demandent de la vélocité, mais il donne du poids aux mots, très soucieux de la clarté ; c’est vraiment un début très prometteur, car la voix a une assise et le timbre une magnifique couleur.

On ne présente plus Carlos Chausson, devenu ces dernières années LE Magnifico de référence, comme en son temps l’était Paolo Montarsolo. La voix est restée puissante, expressive, le jeu vraiment irrésistible et c’est un modèle de style rossinien avec ses variations de couleur, son expressivité unique, son humour.
Maxim Mironov est Ramiro, il m’est apparu un peu moins à l’aise que dans l’Almaviva de Barbiere di Siviglia à Pesaro l’été dernier. La voix est lisse, sans aspérités, mais si le registre central est sans problème, le passage à l’aigu a quelquefois montré des difficultés. Mais c’est plutôt l’interprétation générale qui déçoit : la personnalité scénique est fade, un peu plate et manque singulièrement d’intensité. Dommage pour cet artiste très appréciable.
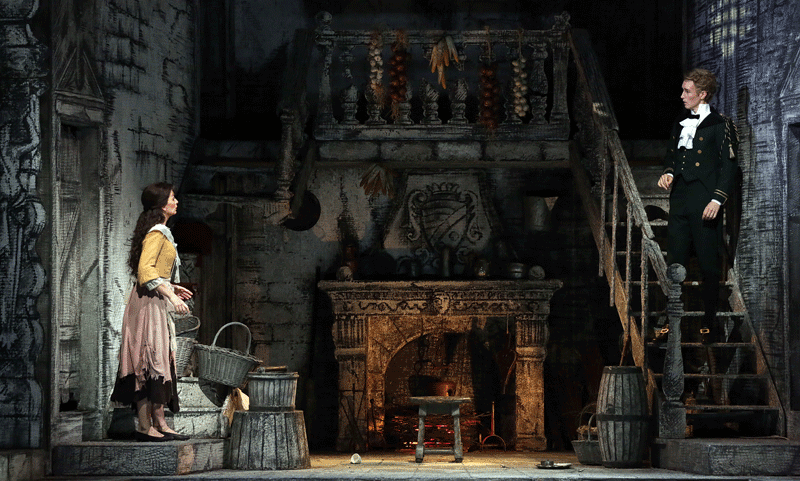
Marianne Crebassa était Angelina, et la prestation d’ensemble est apparue un peu contrastée : si du point de vue de la diction et des accents, la mezzosoprano française ne mérite que des éloges et si la personnalité scénique rappelle un peu Frederica von Stade, une des grandes des quarante dernières années, il manque encore de l’agilité, le souci de la diction semble primer sur la couleur, sur l’aisance, sur la rondeur. J’ai trouvé le style un peu raide et son rondo’ final non più mesta, techniquement appliqué mais pas totalement convaincant ; il n’a pas la poésie qu’on y attend, et ne provoque pas l'émotion. La voix est grande, large dans le registre central vraiment solide, mais elle semble annoncer bien plus une Charlotte de Werther que des héroïnes rossiniennes. Elle a remporté un grand succès et on est heureux pour elle.
Cette série de représentations était dédiée à Claudio Abbado à cinq ans de sa disparition, le fantôme est là, en nous et dans cette salle où il a offert tant de merveilles, dont cette Cenerentola qui porte sa marque. Cette représentation très digne ne l’a pas effacé, évidemment.
