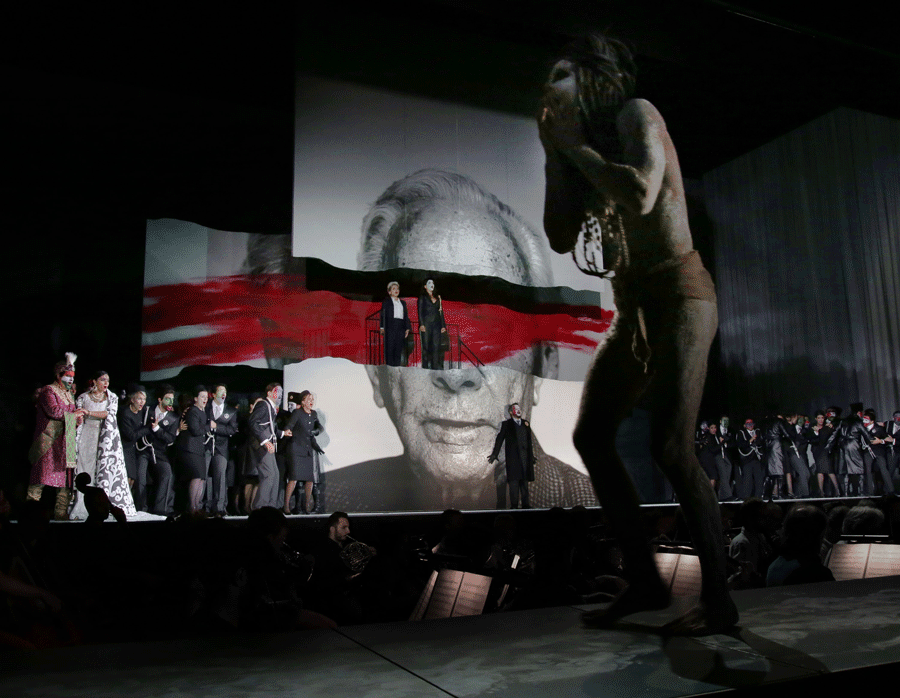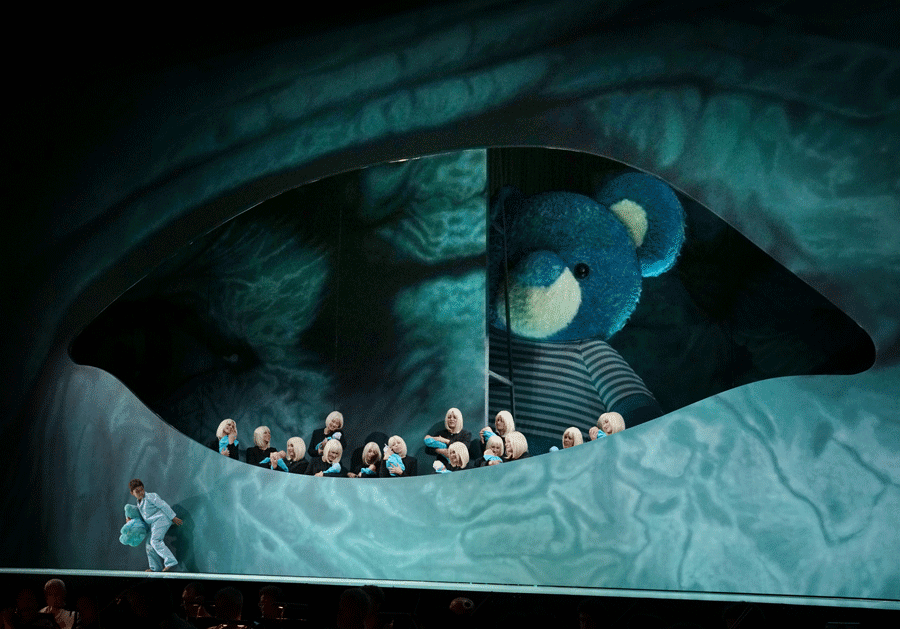
Face à deux œuvres de jeunesse, Demetrio e Polibio et L'Equivoco Stravagante le Rossini Opera Festival met en regard l’un des grands chefs d’œuvres de la maturité, Semiramide, si difficile à représenter tant les exigences vocales et musicales sont grandes. La monumentalité se lit en effet d’abord aux dimensions orchestrales non indifférentes, car les morceaux strictement orchestraux sont nombreux, avec de très longues introductions à certains airs, aux aspects choraux qui préparent au Grand-Opéra dontGuillaume Tell marque les débuts en 1829, et aux performances vocales qui demandent des chanteurs à l’expérience accomplie. On se souvient de l’édition aixoise de l’œuvre, signée Pier Luigi Pizzi, reprise au TCE à Paris (alors lieu de la saison de l’Opéra) en 1981, avec Caballé, Horne, Ramey, Araiza sous la direction de Jesus Lopez-Cobos.
À Pesaro, Semiramide a fait l’objet de deux autres productions, en 1992 (Hugo de Ana) reprise en 1994, et en 2003 (Dieter Kaegi). L’édition 1994 fut certainement la plus notable vocalement avec Cecilia Gasdia, Martine Dupuy, Michele Pertusi, Rockwell Blake.
Cette année, la production a été confiée à Graham Vick, assez populaire en Italie. Dans un pays où la question de la mise en scène ne se pose pas dans les mêmes termes qu’en Allemagne, il est considéré comme un novateur. On lui doit récemment une magnifique mise en scène de « Die tote Stadt » à la Scala. Trop novateur sans doute cette fois-ci vue la bordée de huées qui a accueilli son travail sur Semiramide.
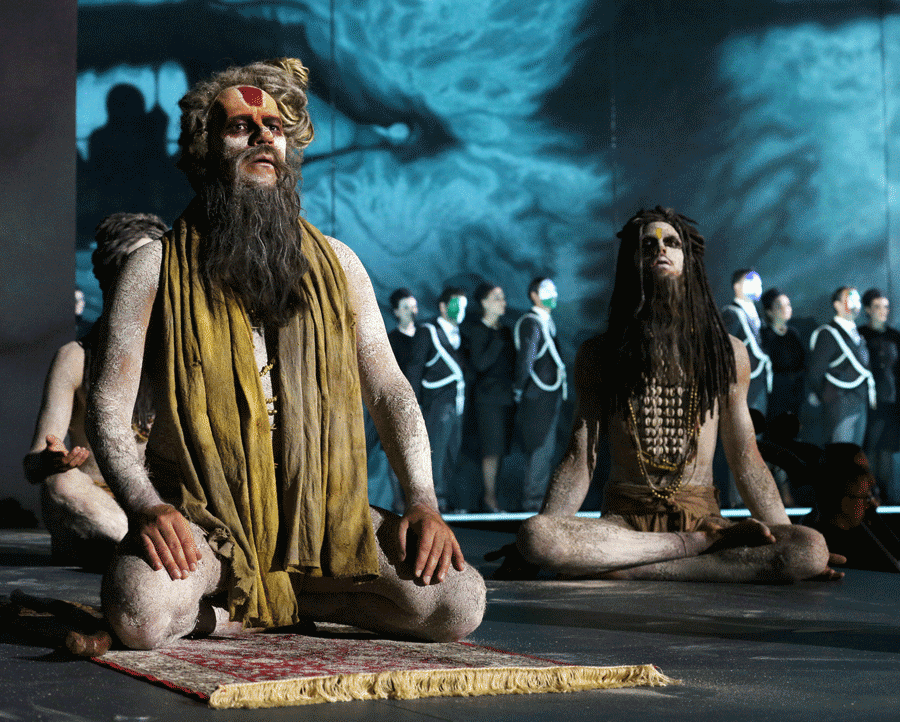
À moins que ce ne soient les décors abstraits de Stuart Nunn, et ses costumes plutôt contemporains, à l’exception des prêtres et d’Oroe, ayant plutôt l’allure de brahmanes sortis des Pêcheurs de perles, et ses maquillages étranges et colorés, autant de collections de drapeaux des nations diverses couvrant le visage du chœur, comme si le drame avait des proportions planétaires, ou qu’il concernait justement chaque coin de la planète.
Agaçant aussi l’apparition d’un nounours géant en peluche bleue, faisant écho coloré au lit d’enfant à cour, et au nounours que porte avec lui l’enfant qui sort du lit.
Car la question posée par l’opéra et par Vick est celle des origines, de l'enfant perdu, du petit Ninia, disparu au moment de la mort du roi Nino dont le regard gigantesque pèse sur la scène dès le départ.
Rappelons rapidement la trame : le Roi Nino est mort il y a une quinzaine d’année et c’est Semiramide son épouse qui règne, avec le prince Assur qui l’a aidée à assassiner son mari pour régner seule. Elle doit choisir un roi pour remplacer Nino, et son choix tombe sur Arsace, le vaillant guerrier, dont elle est amoureuse. Mais il se trouve qu’Arsace est son fils, Ninia, qu’on croyait disparu à la mort de Nino.
Arsace règnera, mais Semiramide mourra.
On comprend donc dès le départ la volonté de Graham Vick de montrer le regard de Nino pesant, comme un reproche continu de ce meurtre initial, et l’apparition du spectre, masque blanc et regard masqué de rouge, confirme cette présence du regard dont l’énormité écrase la scène. Le jeu essentiel de la mise en scène consiste à travailler sur le monde des adultes criminels et de l’enfance innocente, jeune enfant sorti du lit et traversant la scène, Arsace qui de temps à autre va s’y réfugier comme pour retourner à l'enfance, dessins d’enfants à la craie et nounours gigantesque. Manière de souligner pesamment qu’il s’agit d’une histoire de filiation, d’un fils perdu et retrouvé, d’un amour maternel que Semiramide croit d’une autre nature.
Ce fils est parcouru de doutes sur ses origines et de traumas infantiles, derrière le regard de Nino, quand les panneaux pivotent, ce ne sont que dessins d’enfants, reine au poignard ensanglanté, corps assassiné, oiseaux traversés de sang, des dessins qui non seulement tracent une histoire individuelle, d’un enfant sacrifié dès la naissance, mais pourrait aussi expliquer la nature androgyne de cet Arsace en talons aiguilles et costume masculin, comme parallèle au costume de sa mère, lui dans son ambiguïté de « travesti » et elle masculinisée par le pouvoir et sa gestion, presque en manager (pendant qu’Assur a la redingote grise de l’apparatchik officiel), comme si les corps se rapprochaient et se ressemblaient (et d’ailleurs, un peu les voix, dans cette version du moins).

Nous sommes à l’époque de la théorie du genre et il aurait été étonnant qu’elle ne se traduise pas quelque part dans une œuvre où sentiments masculins et féminins se mêlent chez un même personnage, sauf chez la princesse Azema, qui s’affiche une « vraie » femme et aussi chez Idreno, amoureux d’Azema et personnage inutile qui n’existe pas chez Voltaire, où la trame se concentre sur l’amour d’Azema (convoitée par Assur) pour Arsace (convoité par Sémiramis). Mais ces dessins d’enfant au-delà des traumas spécifiques d’Arsace/Ninia marquent aussi les mythes éternels du théâtre, meurtres, parents indignes, enfants perdus : on a souligné ailleurs comme l’histoire de Semiramide ressemble à celle d’Oedipe par certains côtés, ou à celle des Atrides, du meurtre de Clytemnestre par Oreste vengeant Agamemnon ((Nous écrivions dans notre compte rendu de la Semiramide munichoise : « L’idée est loin d’être sotte que de situer l’intrigue de cette Semiramide aux confins de l’Europe et de l’Asie, en réinvestissant cette histoire qui en rappelle singulièrement une autre, celle des Atrides, voire des Labdacides. Semiramide/Clytemnestre assassinant Nino/Agamemnon avec son amant Assur/Egisthe, à son tour tuée par son fils Arsace/Oreste revenu après une longue absence où on l’a cru mort. Il manque au tableau une Electre, mais il y a déjà de quoi remplir un livret d’opéra. On pourrait aussi voir Jocaste/Semiramide amoureuse de son fils Oedipe/Arsace. »)). Voltaire connaissait ses tragiques et d’ailleurs sa préface à Sémiramis s’intitule Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne.
On le voit, les idées de mise en scène ne manquent pas mais c’est leur traduction scénique qui quelquefois prête à sourire ou à agacement, par exemple le bleu turquoise du nounours, du lit d’enfant omniprésent, mais aussi du costume de Nino, comme pour tracer visuellement les filiations, en une esthétique aux couleurs agressives qui veulent faire moderne, mais qui ne réussissent pas à convaincre.
Vick s’est intéressé aux destins individuels plus qu’aux aspects strictement politiques que David Alden avait développés dans la production munichoise (sous la direction du même Mariotti en 2017) et aux méandres de la psychè, il souligne les ambiguïtés relationnelles de Semiramide avec Assur , avec une belle scène initiale de l’acte II dans le secret d’un salon moderne, mais aussi avec Arsace. Graham Vick réussit à montrer les complexités sentimentales, les désirs cachés (ou non) des personnages singuliers. Un seul exemple, Assur engoncé dans son costume « ministériel », dans sa scène de délire sur la tombe de Nino, devient presque pitoyable dans sa folie, en sous-vêtements, comme revenu à son être, défait de tout statut.

Ainsi ce travail est-il contrasté : les idées sont claires, et souvent justes, mais peut-être quelquefois mal traduites scéniquement et esthétiquement. Surtout, se superposent divers éléments, les destins, les caractères, le passé, la question du genre : pris singulièrement, tout est lisible, assez clair, mais dans sa globalité cela manque un peu de cohérence et surtout ne semble pas être allé suffisamment loin pour mener les (nombreuses) idées à leur terme. L’éclatante réussite du Guillaume Tell il y a quelques années avec Mariotti ne s’est pas répétée.
Il en va autrement du point de vue musical où il faut d’abord saluer le travail effectué en fosse par ce même Michele Mariotti. Nous avions déjà salué la manière dont la partition était fouillée, à Munich, avec un orchestre qui la découvrait. Ici avec l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, qui la découvre aussi car ce n’est pas son répertoire habituel, puisque c’est un orchestre symphonique qui fait très peu d’opéra, c’est justement ces qualités symphoniques, la qualité des pupitres singuliers (les cuivres, les bois) qui frappe dès les premières mesures de la fameuse ouverture où Mariotti met en place le drame. Jamais il n’exagère le volume, mais au contraire exalte la clarté de la partition et les subtilités de la composition ; et pour ce faire, l’orchestre de la RAI, l’un des meilleurs de la péninsule, est la phalange qu’il faut pour la qualité intrinsèque de ses pupitres, et pour la manière limpide dont est rendu le tissu orchestral.
Mais c’est aussi dans le corps de l’exécution que frappe une approche analytique de l’œuvre de Rossini, laissant une place particulière au texte : une fois de plus, il est démontré (avant Wagner) combien l’orchestre accompagne le mot ou le texte avec une attention soutenue, qui fait éclater la vérité de l’œuvre et sa complexité. Mariotti montre combien mots et notes se répondent et produisent du sens.
On a toujours tendance à considérer Rossini, et notamment le « Rossini serio » comme un simple écrin pour voix stratosphériques. En réalité, la direction de Mariotti (et l’édition complète pratiquement jamais exécutée sans coupures comme ici), met en valeur une écriture qui se tisse avec le texte et le chant, avec des variations de volume (interventions des chœurs), et d’intensité qui mettent les voix en exergue sans jamais faire oublier l’orchestre. Singulières aussi les variations de dynamique et de couleur qui émaillent toute la partition, qui a sans doute rarement été aussi mise en relief comme ce soir, au-delà des voix. Une fois encore, le génie de Rossini est ici démontré, qui sait tisser un système où les voix et les sons se répondent et se tissent avec une subtilité rarement atteinte. Ce travail est simplement admirable de profondeur.
La prestation du chœur du Teatro Ventidio Basso (Ascoli Piceno) particulièrement bien préparé par Giovanni Farina est aussi remarquable, avec une belle clarté dans l’émission, sans jamais exagérer le volume, et un très beau sens de la dynamique (notamment dans ses premières interventions assez virtuoses).
Du côté de la distribution, comme toujours à Pesaro, on remarque homogénéité et niveau général impeccables, où les rôles de complément sont très bien tenus, aussi bien le Mitrane d’Alessandro Luciano que l’Azema délicate de Martiniana Antonie.
Carlo Cigni campe un Oroe sonore, bien projeté, et homogène sur tout le spectre, qui s’impose par une présence vocale pleine d’autorité. Une belle prestation, impressionnante dès le départ (il ouvre le spectacle). L’ombre de Nino est aussi campée de manière solide par Sergey Artamonov, peut-être un peu moins impressionnant par la projection, mais parfait dans le phrasé et la diction.
Le rôle d’Idreno, sans grande fonction dramaturgique, sinon qu’il est l’un des rares personnages positifs de l’œuvre, a surtout une fonction « démonstrative » et permet au ténor des exploits stratosphériques à l’aigu. Dès ah, dov’è dov’è il cimento et surtout dans La speranza più soave au deuxième acte, Antonino Siragusa montre des suraigus impressionnants. Même si le timbre est ingrat, et notamment très (trop) nasal à l’aigu, il y a dans ce chant une précision, une absence de bavures et même des variations de nuances dans le suraigu qui laissent rêveur. C’est un chant démonstratif, sans doute, mais la démonstration technique est écrasante. Très aimé à Pesaro, il reçoit une ovation méritée.
On se souvient des prestations de Samuel Ramey, de Michele Pertusi, et plus récemment d’Alex Esposito dans le rôle d’Assur, avec des cadences pyrotechniques, une aisance du grave à l’aigu qui en faisaient le rôle le plus exposé et le plus virtuose de la représentation. Ils ont chacun laissé des traces notables dans la mémoire des représentations modernes de l’œuvre.
Le choix pour cette production s’est porté sur Nahuel di Pierro, qui chante pour la première fois à Pesaro d’une manière radicalement différente de ses grands prédécesseurs. Il n’a pas leurs moyens et la voix est presque celle, plus claire, d’un baryton-basse. Il n’a pas non plus leur puissance à l’aigu. Mais il a pour lui d’abord une musicalité exceptionnelle, un merveilleux phrasé et un sens du texte et du dire accompli, il a aussi un timbre chaleureux, qui lui donne une humanité (si visible dans la scène de la folie) qu’on n’imagine pas dans ce rôle. Il travaille sur la couleur, sur la subtilité, avec une belle intelligence des situations. Ainsi réussit-il une composition originale, très vécue, très sensible qui change notre vue sur le personnage et lui donne une identité nouvelle qui s’affirme peu à peu et qui en fait un des éléments les plus surprenants et intéressants de la représentation. Sans avoir les moyens apparents du rôle, il en a tout le reste, et il est passionnant.

Varduhi Abrahamyan est Arsace, et dès son entrée (la cavatine Eccomi alfine in Babilonia), on entend un vrai mezzo aux graves somptueux, aux aigus triomphants qui remplissent la salle ingrate de la Vitrifrigo Arena, avec un sens tout particulier de la dynamique et des agilités sans aucune bavure, et une ligne de chant impeccable. Ce qui frappe chez Varduhi Abrahamyan, c’est une musicalité qui s’impose, et un chant sans affèteries, naturel, juvénile, qui rend parfaitement le personnage et la situation. Il y a chez elle aussi un vrai sens du texte et une clarté impressionnante de l’expression. Nul doute qu’elle est l’Arsace du moment, et pour quelque temps sans doute.

La voix est parfaitement en phase avec celle de Semiramide, incarnée par Salome Jicia, jeune soprano géorgien encore au début de sa carrière, issue de l’Accademia Rossiniana où elle a chanté en 2015 dans Il Viaggio a Reims et invitée régulièrement depuis. C’est une des vertus de cette distribution que de mettre en relief le futur du chant rossinien. Salome Jicia est un soprano au timbre plutôt sombre (qui rappellerait un peu une Gencer par la couleur). La technique est parfaitement maîtrisée, aussi bien dans les variations que les agilités et qui est une belle interprète, très sensible, notamment dans les duos (Serbami ognor sì fido…alle più care immagini avec Arsace ou avec Assur Se la vita ancor ti è cara) où elle montre une personnalité scénique non indifférente. Peut-être dans bel raggio lusinghier’, n’a‑t‑elle pas encore le charisme nécessaire (le rôle est écrasant par l’histoire de ses interprètes), mais la mise en scène elle-même « banalise » le rôle par la tenue et les attitudes demandées non d’une reine de Babylone mythique, mais d’une sorte de manager moderne coiffée et vêtue à la garçonne…Il reste que la performance est déjà remarquable et qu’elle gagnera sans doute très vite en assurance (elle chantera Norma sous peu). C’est en tout cas déjà un coup de maître que de s’affirmer dans un tel rôle.
Malgré les huées qui ont accueilli l’équipe de mise en scène, cette Semiramide est un spectacle de grande facture, à cause d’une équipe de chanteurs qui sans être encore au sommet du chant rossinien, a su être à la hauteur de l’enjeu, soutenue par un Michele Mariotti quant à lui au sommet de l’interprétation de cette musique fascinante qui nous fait aller de surprise en surprise. C’est bien ce pourquoi Pesaro est irremplaçable.