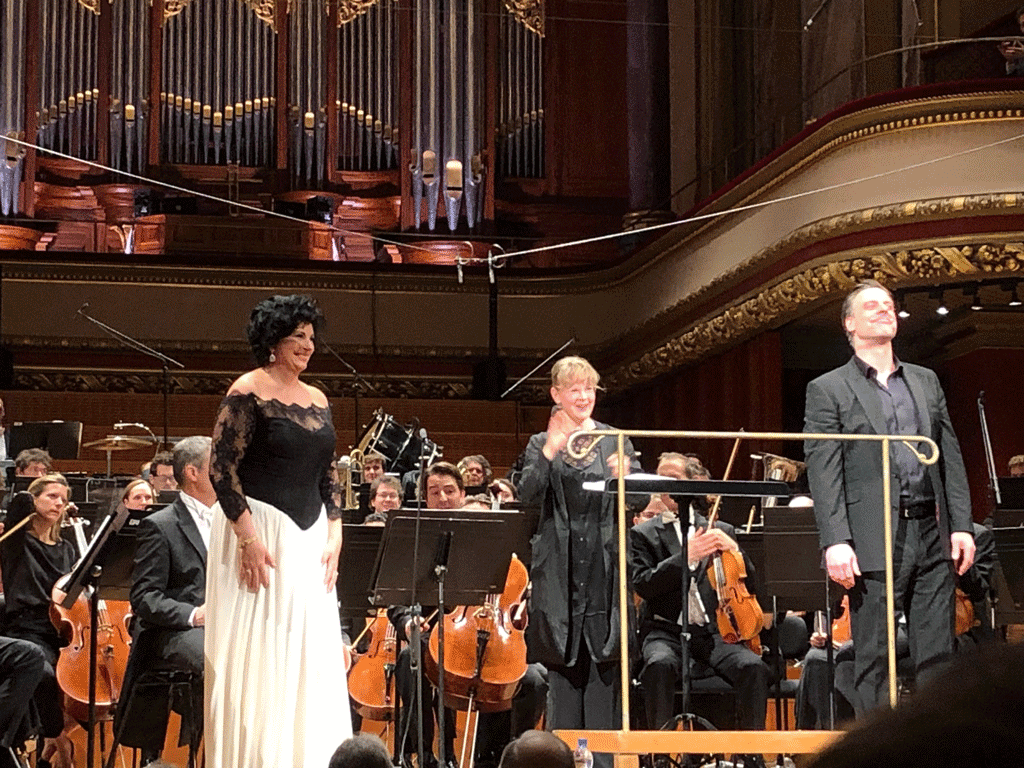Le programme était tout en contraste : une première partie dédiée à Mozart (ouverture de Don Giovanni, K.527, Concerto pour piano no 23 en la majeur, K. 488) avec la jeune coréenne Yeol Eum Son au piano, qui équilibre par un nom familier la deuxième partie Le Château de Barbe Bleue (A kékszakállú herceg vára) op.11, sz 48 de Bela Bartók, un « classique » qui sent encore le soufre pour un certain public. Cependant, une version de concert attire aussi le public par le côté exceptionnel d’un programme rare, notamment à Genève où l’opéra de Bartók manque à la programmation.
La surprise aussi vient du contraste dans l’approche des deux compositeurs : un Mozart plutôt classique, notamment dans une ouverture de Don Giovanni, énergique, un peu froide, très symphonique (ce qui est compréhensible dans un programme de concert où l’ouverture est finalisée à elle-même, d’où le final arrangé,et n’annonce pas l’opéra qui va suivre). Il y a comme une captatio benevolentiae en ouvrant par une musique partagée par la plus grande partie du public qui entend là un des hits du classique…
Le concerto pour piano n°23 est lui aussi une œuvre bien connue, et la curiosité venait ici de la pianiste coréenne de Yeol Eum Son, médaille d'argent aux concours Van Cliburn (2009) et Tchaikovski (2011), encore jeune, mais déjà bien engagée dans la carrière notamment aux Etats Unis. On a souvent l’image des pianistes asiatiques comme des virtuoses à la technique imparable et à la sensibilité glaciaire, et le profil ici, dans ce Mozart aux couleurs variées, est différent. La technique est évidemment imparable, mais il y a des moments particulièrement délicats et sensibles, une écoute attentive de l’orchestre pour jouer en osmose et non en autiste. L’adagio si fameux est à ce titre emblématique, avec une qualité de concentration et d’écoute remarquable, et un orchestre particulièrement délicat lui aussi.
En bis, la marche turque étourdissante dans l’arrangement de Volodos,, un des musts de Yuja Wang, pour démontrer sans doute qu’en matière de technique, la jeune coréenne n’a rien à envier à sa collègue chinoise et c’est le triomphe. Au total un Mozart sans surprise et bien mené.

Le grand moment du concert était Le Château de Barbe-Bleue, distribué à deux spécialistes des deux rôles, Barbe Bleue était la basse américaine John Relyea, qui le chante un peu partout (dont encore récemment au Palais Garnier dans la mise en scène de Warlikowski ) et la mezzo hongroise Ildikó Komlósi, moins connue en France mais familière de Vienne, qui a chanté Judit des dizaines et des dizaines de fois : de fait elle en est une des interprètes de référence, et bien entendu complètement idiomatique.
« Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour » dit Pierre Reverdy dans Nord-Sud, publié en 1918, justement l’année de la création à l’opéra de Budapest du Château de Barbe Bleue composé en 1911. C'est bien une succession de preuves d'amour qui s'accumulent, mais "preuves d'amour perdues" qui aboutissent au vide. L’histoire, librement inspirée du conte de Perrault détourne la morale du conte, où la femme curieuse est punie, pour donner une vision presque métaphysique de l’amour, une vision tragique qui s’achève sur l’aporie.
Chaque ouverture de porte est l’occasion de se projeter dans un futur qui est en fait un des replis de l’âme troublée de Barbe Bleue. Une âme à la fois tendre et tourmentée, où le sang est un fil rouge, ce qui donne à l’histoire cette aura de mystère et de suspens, mais aussi de vague inquiétude. Le librettiste Béla Balázs quitte et Perrault et Maeterlinck (qui a signé Ariane et Barbe Bleue de Dukas en 1907) pour évoquer une relation complexe de couple qui se clôt sur le vide. La première porte ouvre sur une chambre de torture, la seconde sur un entrepôt d’armes, la troisième sur un trésor où toutes les richesses de Barbe Bleue sont accumulées, la quatrième sur un jardin enchanté et la cinquième sur le royaume tout entier de Barbe Bleue, partout des traces ou des taches de sang prémonitoires, mais un climax est atteint et il ne faudrait pas passer outre ; pourtant Judit insiste et la sixième porte ouvre sur un lac de larmes prémonitoire lui aussi et fait des larmes de Barbe Bleue. Barbe Bleue supplie de pas aller au-delà, les larmes étant l'antichambre de la fin, mais la septième porte est ouverte et on y découvre les autres femmes, vivantes mais sans autre vie qu’un « être là » sans passé ni avenir. Judit les rejoint, dans ce mausolée vivant à l’amour qui marque l’espoir puis l’échec toujours recommencé. Car Barbe Bleue vit à chaque fois la même histoire, toutes les autres furent Judit sur le moment, et Barbe Bleue constate à chaque fois le même échec : impossibilité de "communiquer", impossibilité de se faire entendre, impossibilité d’échange et au total impossibilité de parier sur l’amour où la confiance doit étouffer toute curiosité. La tragédie de Judit et Barbe Bleue est celle du couple, incapable de vivre dans une osmose et qui montre à chaque fois deux êtres qui ne suivent pas le même chemin. Judith dans la Bible est celle qui assassine Holopherne, chez Bartók, elle assassine l’amour. Chaque femme est pour Barbe Bleue une petite mort.
On comprend dès lors cette musique qui prend à la fois au symbolisme et à Debussy, mais aussi aux débuts de l’expressionnisme, tout en s’appuyant comme toujours chez Bartók, sur la musique nationale, il en résulte des ambiances différentes, où chaque porte ouvre sur un univers différent y compris musical, qui vont de la mélancolie aux déchainements passionnels avec une richissime palette d’instrumentation et de couleurs
Les deux interprètes dominent le texte avec une maestria sans égale : John Relyea à la voix chaude, puissante, mais jamais noire, avec des inflexions souvent déchirantes, est un Barbe Bleue profondément humain, tendu, toujours dans le doute et la peur que Judit ne l’emmène plus avant : magnifiquement projetée, la voix affirme à la fois autorité mais aussi fragilité, comme si à chaque fois s’ouvrait une porte sur plus de fragilité, qui finit en désespérance.
Ildikó Komlósi possède à un point tel la partie de Judit qu’elle impose immédiatement une voix charnue, puissante, qui joue de manière virtuose sur les couleurs, de la séductrice insinuante à la femme autoritaire et décidée qui veut toujours aller plus avant, elle gagne en autorité et en décision ce que Barbe Bleue perd peu à peu en superbe au fur et à mesure qu’il comprend que la partie est perdue. Mais ce que nous dit l’œuvre c’est que la partie est toujours perdue, non à cause de la femme trop curieuse, mais à cause d’une impossibilité d’osmose, de fusion, voire de passion. La prestation de Komlósi est simplement exceptionnelle et les deux voix composent un des duos les plus extraordinaires dans cette œuvre.
Bien entendu, ils sont soutenus par un orchestre que j’avais rarement entendu sonner ainsi, notamment dans la fosse de l’opéra,avec une telle concentration et un tel engagement. L’acoustique généreuse du Victoria Hall y aide, évidemment : pas une scorie sur aucun pupitre, et l’orchestre épouse scrupuleusement les indications de la cheffe, qui pour son premier « Château de Barbe Bleue », signe là un coup de maître. Susanna Mälkki est une « rigoriste » de la partition, dont elle va chercher les moindre nuances, sans jamais prendre les libertés qu’on entend quelquefois chez certains chefs (y compris des légendes comme Toscanini). Par une science des dosages et une grande précision du geste, elle crée une dramaturgie musicale qui clarifie et approfondit la lecture, et qui à l’audition a produit des moments de pure stupéfaction. On se souviendra longtemps des quatrième et cinquième portes, où le déchainement sonore a quelque chose du déchainement qu’on pourrait entendre dans certains Dies Irae de Requiem, comme si dans ce climax, la musique quittait le chtonien des caves du Château pour respirer dans une autre dimension spatiale. Elle utilise d’ailleurs l’espace de la salle pour y disséminer des instruments. Elle rend à cette musique une authenticité qui n’est jamais froideur mais en même temps lui donne une portée tellurique par un savant jeu sur les volumes. Dans sa Rusalka à Paris, certains ont reproché une froideur qui n’était que volonté jalouse de respecter l’écriture sans jamais se laisser aller à un rubato de trop, et elle montre ici comment cette musique se déploie, comment elle dit l’émotion sans la surjouer, en soutenant le texte sans jamais le couvrir. C’est une performance vraiment exceptionnelle où se mêlent énergie, profondeur, mais aussi sensibilité (le jeu des couleurs, les moirures des reflets, sans rien de corseté ni de convenu), dans une œuvre pas toujours si bien servie. Comme son collègue Salonen, un spécialiste de cette œuvre, Susanna Mälkki confirme à la fois la qualité de l’école finlandaise, mais aussi que le marché l’a trop longtemps confinée dans le répertoire contemporain où elle est une référence, il est temps de la laisser nous surprendre…dans Wagner par exemple.