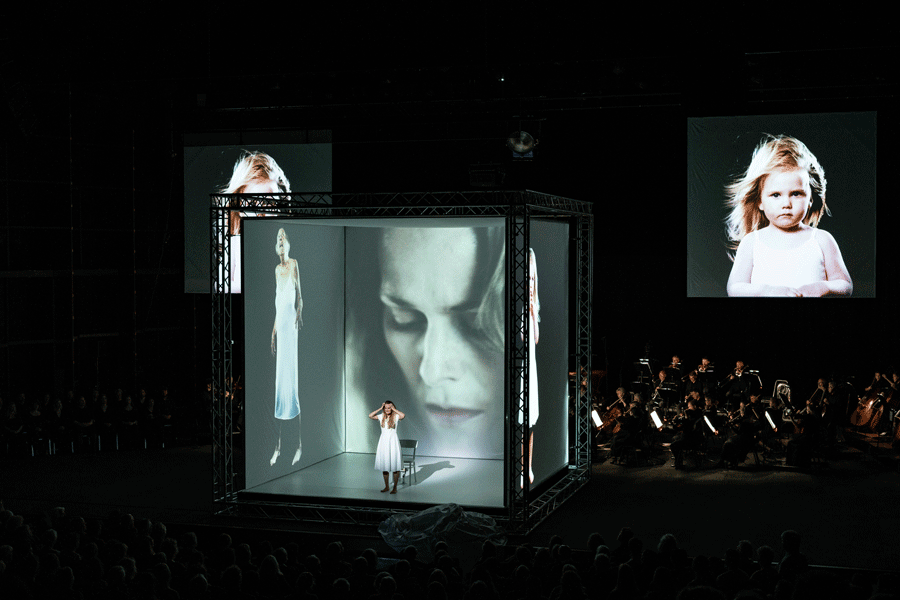
Intitulé "une passion symphonique", cette Solveig d'après Edvard Grieg a vu le jour au Festival International de Bergen en mai 2019. La production est le fruit de l'imagination commune de Calixto Bieito et du romancier norvégien Karl Ove Knausgård. Tous deux échafaudant le projet de substituer au personnage de Peer Gynt sa dimension d'épopée nationale, et déplaçant le spectacle du point de vue de Solveig, l'héroïne silencieuse qui passera sa vie à attendre le retour du héros vagabond. La scénographie ultra épurée joue sur les éléments d'une grammaire caractéristique des dernières productions de Calixto Bieito. On retrouve cet espace clos de murs blancs, maintenu par une structure métallique comme par exemple dans Les Bienveillantes à Anvers ou Die Gezeichneten à Berlin. Ces surfaces immaculées jouent la fonction d'écrans-espaces sur lesquels sont projetées des images vidéo en très haute définition, alternativement filmées en direct avec une caméra portative (on pense aux Soldats montés à Zürich, Berlin et Madrid) ou bien issues du somptueux album d'images que feuillette la vidéaste Sarah Derendinger, fidèle collaboratrice de Bieito depuis Los esclavos felices et Obabakoak.
La simplicité apparente de ce cube de papier posé sur scène est démultipliée à la façon d'un espace mental au milieu duquel se tient l'héroïne. Isolée du monde extérieur, elle est soumise à un feu croisé d'images dont l'apparence naturaliste pourrait prêter à confusion et faire oublier qu'il s'agit davantage d'images mentales – à la fois présence de l'univers environnant (animaux de la forêt comme le cerf, la chouette ou le rapace) ou bien pensées de Solveig. Ce dernier élément constitue un élément capital du livret de Karl Ove Knausgård, attaché à condenser et déplier dans le personnage de Solveig un ensemble de dimensions que le livret d'Ibsen laissait volontiers dans l'ombre. Le romancier norvégien a voulu une Solveig ancrée dans un monde résolument moderne, confrontée à ce thème de "l'attente" qui sert de sous-titre à cette Passion symphonique. Le terme de "Passion" est ici développé sous l'angle de la passion amoureuse de Solveig pour un Peer Gynt désespérément fuyant et oublieux, mais également la passion christique d'une femme résolue à tout sacrifier pour le salut du mauvais garçon.
Solveig est cette femme universelle qui incarne les souffrances d'une solitude à laquelle l'humanité ne peut se soustraire. C'est en mettant en scène successivement la pièce d'Ibsen et l'opéra Hanjo de Toshio Hosokawa sur un livret de Yukio Mishima que Calixto Bieito a perçu la relation entre les deux personnages féminins Solveig et la geisha Hanako, toutes deux abandonnées par un homme et attendant éternellement. Refusant l'idée de les confiner à des rôles de fiction, Bieito et Karl Ove Knausgård ont voulu que ces deux figures féminines s'incarnent dans une modernité brûlante et immédiate.
Pour sa première incursion à la scène, le romancier norvégien a imaginé un personnage pris dans les rets d'une saga familiale. Le prénom de Solveig fait allusion au drame d'Ibsen mais il faut l'imaginer isolément de l'épopée de Peer Gynt. Knausgård en fait une mère dont le mari est absent et qui se retrouve entre sa très jeune fille sa vieille mère mourante. Cette trilogie féminine concentre métaphoriquement les trois âges de la vie entre lesquels Solveig sert de trait d'union. Les trois femmes attendent : la plus âgée attend la mort et la plus jeune attend un enfant et Solveig est au centre, en position d'attente. Au terme de l'attente, il y aura la délivrance – une délivrance qui se trouve étymologiquement dans l'onomastique de ce prénom norvégien signifiant littéralement "le chemin du soleil" (Sólveig), mais dont le sens ancien de "querelle dans la maison" ou "force du Soleil" correspond davantage au profil de la douce Solveig, dans Peer Gynt.
Tout le travail de Karl Ove Knausgård a consisté à creuser cette thématique de l'attente – un travail qu'il décrit en ces termes : "Le propos se fonde sur le personnage de Solveig dans Peer Gynt d’Ibsen ; celle qui ne bouge pas, mais se souvient. Solveig est auto-extinguible, elle vit pour les autres, elle ressemble à un personnage qu’on pourrait considérer comme passif, tandis que l’homme qu’elle attend, celui qui est en voyage, lui, est actif. Mais elle est celle qui donne – alors que lui prend. Que signifie donner ? Que signifie attendre ? Qu’est-ce que cela a à voir avec notre attitude dans le monde ? Sur la base de ces questions, j’ai écrit une histoire qui s’étend sur trois générations de femme de notre temps"
L'attente de Solveig se double du don, le don absolu de soi qui confine au sacrifice, un thème repris d'une lecture de Kierkegaard : "Les Lys des champs et les oiseaux du ciel" (1849), dans laquelle Knausgård tire la leçon de tirer le meilleur de soi et de la vie en étant exactement là où l’on se trouve, ici et maintenant et sans savoir ce que l’on fait ou où l’on va. Sur ce plan, la psychologie du personnage central trouve dans l'épure du décor une consonance graphique très efficace : deux écrans latéraux qui forment un épanchement spatio-temporel de la scène centrale située à l'intérieur du cube, cette prison intérieur que ne quitte jamais Solveig, l'unique interprète de cette "passion".
Le spectacle débute avec l'intervention tout de noir vêtu, du chœur mixte a cappella Gud søn hor gjort meg fri (le fils de Dieu m'a délivré) extrait des Quatre psaumes pour op.74 n°2. Durant ce préambule, Solveig n'est perçue qu'à travers son ombre portée jusqu'au moment où elle déchire très littéralement la paroi de papier qui la séparait de la salle – déchirure initiale et très métaphorique qui fait écho à la naissance de l'enfant sur laquelle se referme le livre d'images. La puissance et l'extrême netteté des images filmées au ralenti font de ces longs plans séquences un écrin onirique qui accompagne le périple de Solveig. On suit pas à pas un étrange parcours de l'héroïne entre terre et ciel, qui réunit la dimension épique du Peer Gynt d'Ibsen et la philosophie de Kierkegaard dans les Quatre discours édifiants. C'est dans cette transition entre l'enfant au visage grave et le corps de la mère au seuil de sa vie, que se dessine la présence divine. Sur ce point, le spectacle de Calixto Bieito donne à voir l'irruption d'une beauté violente que ses détracteurs se contentent souvent de saisir en surface en la qualifiant de provocation. La structure générale joue sur un trompe‑l'œil qui associe la destinée de Solveig à celle d'un personnage biblique, triptyque encadré par deux interventions chorales (Gud søn hor gjort meg fri), Ave Maris Stella pour chœur mixte a cappella et I himmelen (Au Ciel). Trompe‑l'œil, car la très lente et très belle séquence de la mère qui donne la vie est donnée à lire dans une dimension qui soumet le divin à la réalité d'une création qui en souligne la beauté très littérale.

Bieito possède l'art d'isoler un interprète en lui donnant une dimension unique, au point qu'on n'imagine pas possible une substitution, sauf à amoindrir l'impact. La Solveig de Mari Eriksmoen appartient à cette catégorie, tout comme la Marie de Susanne Elmark ou la Katerina d'Aušrinė Stundytė. Voix éminemment mozartienne (elle a chanté notamment Susanna, Zerlina and Fiordiligi sous la direction d'Harnoncourt), la soprano norvégienne est ici dans un jardin intime qu'elle arpente avec talent. La fameuse Chanson trouve des accents et une ligne qu'on se prend à découvrir comme pour la première fois. L'absolue maîtrise des alternances voix parlée – voix chantée signe la présence d'une grande interprète, aussi à l'aise dans l'incarnation du personnage d'Ibsen que dans sa traduction lyrique. Réglé par Alessandro Zuppardo depuis le parterre, le Chœur de l’Opéra national du Rhin doit surmonter les contraintes de la distanciation sanitaire pour trouver une couleur et une homogénéité satisfaisantes, à l'exemple du baryton Laurent Koehler dont les interventions permettent à l'ensemble de trouver son équilibre.
Point de fosse mais un Orchestre philharmonique de Strasbourg placé en fond de plateau, à un par pupitre et derrière la structure scénique. Le chef norvégien Eivind Gullberg Jensen doit déployer tout son talent pour régler des plans sonores à l'équilibre rendu périlleux par la disposition et l'absence de contact direct entre le pupitre et les interprètes. L'oreille compense naturellement ces obstacles au fil de cette heure un quart sans entracte, en forme de voyage parmi un florilège de partitions de Grieg qui reconstituent autour des extraits de Peer Gynt, un ensemble dramatique très pertinent et en parfaite symbiose avec le texte de Karl Ove Knausgård – à ce niveau d'équilibre et de communion, le théâtre est résolument le plus beau des voyages intérieurs.

