
En théorie, les productions des Festivals devraient être exclusives, mais depuis une vingtaine d’années les coproductions se sont imposées par nécessité économique, notamment à Aix-en-Provence dont on a vu plusieurs productions les dernières années se promener dans certaines salles de France ou d’ailleurs. Cette saison, le Teatr Wielki de Varsovie présentait par exemple le Pelléas et Mélisande de Katie Mitchell. C’est la loi du genre que de partager les frais de productions toujours plus onéreuse, notamment pour un Festival qui en présente quatre ou cinq chaque année.
Pour cet Ange de Feu, coproduit avec le Teatr Wielki, le package a inclus aussi le metteur en scène Mariusz Trelinski, qui, comme par hasard est en aussi le directeur artistique.
Et le Teatr Wielki a proposé cet Ange de Feu en mai dernier dans la même distribution, ce qui signifie des coûts de production et de préparation (répétitions scéniques) partagés. Seule différence, l’orchestre (ici l’orchestre de Paris), et donc Aix a dû programmer les répétitions musicales complètes, même si le choeur est aussi celui de Varsovie. Mais dans l’ensemble, le montage économique de cette production est plutôt réussi, un exemple de gestion efficace, tout comme la production de Baden-Baden de Tristan und Isolde, coproduite par le MET, et aussi par le Teatr Wielki, et comme par hasard aussi mise en scène par Mariusz Treliński.
Il reste à savoir si Mariusz Treliński comme metteur en scène est alors un choix artistique, ou un choix qui « s’est imposé » par le montage économique, et c’est bien là la question de ces coproductions qui devraient avoir des motifs exclusivement économiques et qui influent quelquefois aussi sur les choix artistiques.
Cela n’enlève évidemment rien aux qualités individuelles de Mariusz Treliński, mais relativise l’autonomie artistique du directeur du Festival d’Aix, comme de celui de Baden-Baden par ailleurs.
L’Opéra de Prokofiev, a été créé à Paris en version de concert en 1954, un an après la mort du compositeur, et scéniquement en septembre 1955, dans le cadre du Festival de musique contemporaine, dans la production d’une équipe qui deviendra vite mythique, Giorgio Strehler (Mise en scène), Luciano Damiani (Décors), et Ezio Frigerio (Costumes), reprise à la Scala en 1956. De loin en loin on constate des reprises de l’œuvre, comme à la Scala en 1969 (Zoltan Pesko), 1994 (Riccardo Chailly), 1999 (Bruno Bartoletti), ou à l’Opéra de Paris en version de concert (!) en 1986 et en 1991–1992, au tout début de l’Opéra-Bastille en novembre 1991 dans une production d’Andrei Serban. Plus rien depuis.
Mais ces dernières années, dans la volonté d’élargissement du répertoire touchant toutes les institutions lyriques qui ne peuvent plus tourner sur 30 titres standards et qui ont besoin d’agrandir leur assise, on a vu dans plusieurs maisons européennes de grandes productions de l’œuvre de Prokofiev signées de metteurs en scène les plus en vue du moment ou par de jeunes metteurs en scènes surgis sur le marché lyrique comme Benedict Andrews à la Komische Oper et à Lyon.
Prokofiev a composé son opéra entre 1919 et 1927, à un moment où le théâtre osait des sujets subversifs, où l’influence de l’expressionnisme était encore forte. Mais la création de l’opéra en 1954 plus d'un quart de siècle après, alors que Prokofiev était mort, montre que les temps changèrent rapidement après les années 30 (voir les difficultés de Chostakovitch avec sa Lady Macbeth de Mzensk). Le roman original de Valery Brioussov est un roman « historique » qui se passe dans l’Allemagne médiévale, aux couleurs symbolistes, et fortement inspiré par ses déceptions amoureuses.
Aix, comme Lyon, comme Zurich, a fait appel à Aušrinė Stundytė, dont on connaît les qualités d’actrice, la plasticité et la voix impressionnante, et comme à Lyon c’est Kazushi Ono très à l’aise dans ce répertoire qui a porté l’œuvre à l’incandescence, en dirigeant un Orchestre de Paris survolté et bien plus à l’aise que la veille dans Ariadne auf Naxos.
Nous verrons plus loin que les qualités musicales de cette production ne manquent pas, et la production elle-même est impressionnante avec son décor en construction métallique à plusieurs niveaux, où chaque scène est inscrite comme dans une niche, donnant (un peu) l’impression de ces icônes russes qui présentent plusieurs scènes, à la manière de ce qu’avait fait Iouri Lioubimov dans Boris Godounov à la Scala en 1979, sauf qu’à la place centrale, c’est l’Ange de Feu qui apparaît au fond en contre-jour et non un ange protecteur…

C’est le monde psychologique de Renata qui fait tout le spectacle, un parcours dans l’âme agitée de la jeune femme au tréfonds de ses fantasmes et souvenirs, comme si le décor n’était que la métaphore d'une psychè dont on ne trouvait la clef qu'au dernier acte.
Alors Treliński réécrit l’histoire, au point que l’argument écrit dans le programme n’est pas celui de Prokofiev, mais ce que Treliński en fait.
Dans cette logique, il fait mourir Renata au quatrième acte (elle se suicide, aboutissement logique du processus), et le cinquième acte est une clef intemporelle, une sorte d’explication a posteriori de la situation (« rétrospection » dit le programme) : Renata a été jadis marquée par son précepteur que les autres appellent l’inquisiteur (aveugle, comme les grands inquisiteurs…), qui finit par la repousser en la promettant au bûcher. Ce précepteur est devenu dans son âme en fusion l'ange Madiel.
Il en découle une série de conséquences : Ruprecht est une sorte de représentant de commerce qui échoue dans un hôtel cheap, dans les ambiances à la David Lynch d’un décor impressionnant, muni d’espaces scéniques et costumes (de Kaspar Glarner) inspirés d’images des années 60 (couleurs, TV, costumes, pattes d’éléphant) : c’est une victime, un peu falote. Il en résulte aussi un effacement de tout ce qui pourrait apparaître comme blasphématoire, tout ce qui pourrait être une allusion à la religion, faisant de cette trame un travail presque exclusivement dédié à une sorte d’analyse psychanalytique de l’âme de Renata. Nous avons donc bien une parabole, l’image d’une irrémédiable chute individuelle, sans vraiment laisser de place au surnaturel, aplatissant quoi qu’on en dise la charge de l’œuvre, notamment contre la religion. Les transes des religieuses au cinquième acte (qui rappellent tant l’affaire Urbain Grandier à Loudun au XVIIe – cf : Les Diables de Ken Russell-) devenues bataille de polochons d’adolescentes en folie m’en semblent l’indice. La position officielle (Directeur artistique de l’Opéra National) du metteur en scène dans une Varsovie gouvernée par un gouvernement très catholique aurait-elle à voir avec ce choix et cette prudence ?
Il reste que Treliński est un bon professionnel, avec des scènes bien faites (l’apparition de Jakob Glock comme pourvoyeur de drogues, dealer en quelque sorte, la scène d’Agrippa également), des images fortes, un décor impressionnant (Boris Kudlička) multiscènes, avec planchers qui montent et descendent à plaisir, avec des visions multipliées, des regards qui peuvent se perdre, et puis des néons, des couleurs : voilà qui satisfait l'œil . Pour qui entendrait l’œuvre pour la première fois, cette mise en scène aux images plus frappantes que subversives fonctionne sans doute. Il reste que ce travail n’atteint pas, loin de là, aussi bien celui d’un Bieito à Zurich (avec un dispositif assez voisin), ou d’un Benedikt Andrews à Lyon, voire la très ironique et assez étouffante vision de Barrie Kosky à Munich. Cette mise en scène un peu tape‑à‑l’œil ne va pas bien loin : c’est plutôt Much ado about nothing .
C’est Kazushi Ono qui est en fosse, il l’était à Varsovie, il l’était à Lyon : il est dans son élément, dans son répertoire des premières années du XXe siècle, dont il est un grand exégète, maître dans la manière glaciale de reproduire une ambiance, de construire des contrastes, de créer les tensions. C’est un maître pour Stravinski, c’est aussi un maître pour ce Prokofiev-là, emmenant l’Orchestre de Paris cette fois-ci survolté, très au point, très bien préparé, aux sons particulièrement aiguisés, souvent chatoyants, laissant la place au lyrisme aussi, avec une limpidité rare permettant d’entendre tous les niveaux sonores, tous les pupitres, sans jamais malgré tout envahir tout l’espace.
On a reproché des déséquilibres acoustiques, c’est vrai : mais ils sont dus à l’acoustique de la salle qui n’a jamais été convaincante, à un décor très ouvert qui perd et dilue le son, plus qu’à la puissance de l’orchestre qui reste bien contrôlée.
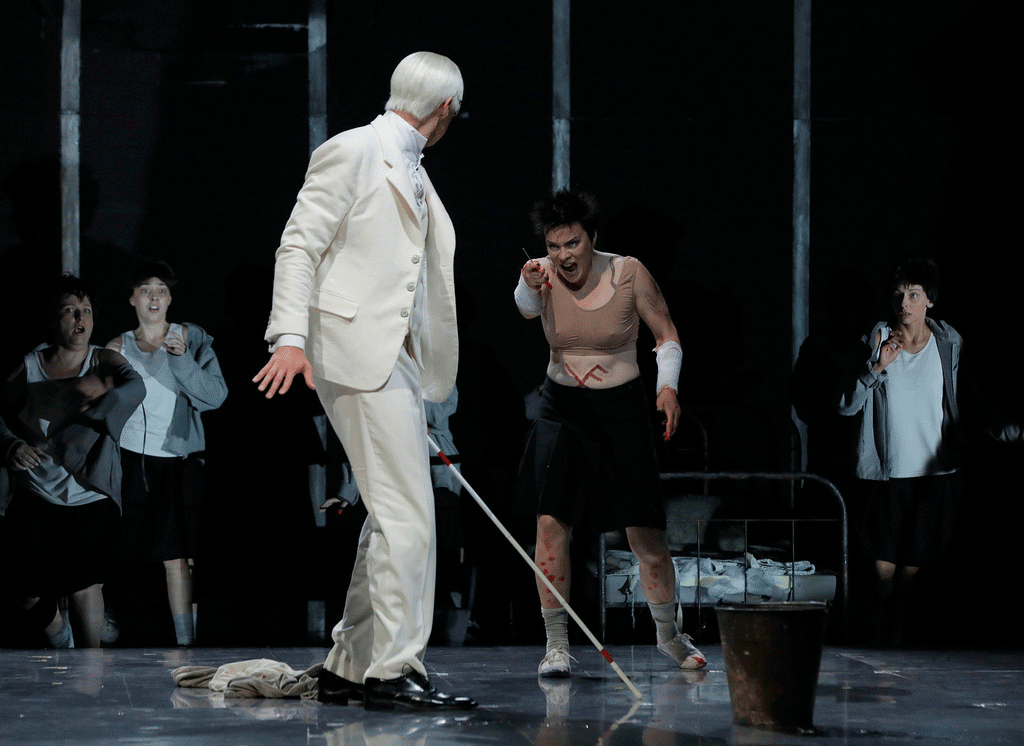
La distribution qui baigne dans l’œuvre depuis plusieurs mois est parfaitement en place à tous les niveaux : aussi bien l’inquisiteur (qui est aussi Heinrich et Faust) immense tout de blanc vêtu, plus image que réelle menace, de Krzysztof Bączyk à la voix profonde et sonore, à la présence forte que l’excellent Andreï Popov (Méphistophélès et Agrippa), excellent ténor de caractère, à la voix bien projetée, à l’émission claire, sans oublier le bon Jakob Glock de Pavlo Tolstoy. Jolies voix de mezzo, très homogènes, pour l’excellente Agnieszka Rehlis en voyante (qui est aussi la mère supérieure) et pour l’aubergiste de Bernadetta Grabias.

Ruprecht dans cette mise en scène est plutôt un être qui se perd, toujours en retrait, qui ne sait comment gérer sa relation à Renata, et Scott Hendricks rend bien ce personnage faible au total. Le timbre est beau, le chant est coloré, mais le volume reste en deçà de l’attendu et se perd dans les cintres du théâtre, c’est dommage. Son personnage ne frappe pas autant que certains Ruprecht d’autres productions (je pense à Leigh Melrose dans la production Bieito notamment).
Aušrinė Stundytė a toujours cette extraordinaire présence scénique et cet engagement qui la font rechercher par tous les théâtres dans des rôles extrêmes : le timbre n’est pas forcément séduisant, mais la voix est puissante, expressive, et le volume suffisant pour être entendu en salle malgré le dispositif scénique. L’engagement est tel que l’on passe sur telle ou telle faiblesse vocale (dans le médium ?) parce que le personnage fascine et envahit tout l’espace scénique avec ses exigences contradictoires, ses excès improbables. Elle est fascinante, mais on médite sur cette chanteuse sollicitée pour des rôles hors normes, très à la mode aujourd’hui, qui devra se préserver et peut-être alterner avec des parties plus lyriques : en alternant des Renata et des Katerina Ismailova, et en faisant de Tosca un simple rôle de repli, ne risque-t-elle pas à terme d’user ses impressionnants moyens ?
Que dire en conclusion, sinon que la production semble bien accueillie par le public, et que l’ensemble est musicalement particulièrement réussi. Mais Mariusz Treliński, pas plus à Baden-Baden pour son Tristan qu’à Aix pour cet Ange de feu n’a pas réussi à me convaincre ni sans doute marquer ma mémoire de spectateur.

