Nous avons déjà posé à propos de Lolita (voir notre article) des questions qui nous apparaissent essentielles sur la manière de rendre sur scène l’adaptation d’un très long roman, qui court sur des années, voire une vie. Guerre et Paix est évidemment de ceux-là, avec la difficulté supplémentaire de rendre ou d’évoquer les aspects épiques, les armées, les batailles, les personnages historiques.
La seule liste des personnages que nous avons scrupuleusement reprise ci-dessus donne un peu le tournis, le programme de salle donne plus de soixante personnages, et ils sont à une vingtaine d’exceptions près, tenus par des chanteurs différents. C’est dire le monument. Au roman fleuve de Tolstoï ne peut que correspondre une œuvre énorme (qu’on présente quelquefois en deux soirées) , qui d’ailleurs a été difficile à faire accepter, a subi des retouches, des coupures, des modifications, et qu’au total Prokofiev n’aura peut-être pas vue dans une réalisation incontestable.
En même temps, faire passer à l’opéra un roman aussi foisonnant, aussi fouillé dans les détails nécessite d’opérer des choix, pour lui donner une ligne, et que le spectateur en quatre heures puisse à la fois reconnaître le roman s’il l’a lu (et l’on peut supposer que le public russe en est familier) , mais aussi éviter de se perdre.
Ainsi, l’opéra est-il divisé en deux parties, l’une traite de la paix, et l’autre de la guerre et notamment de l’arrivée de Napoléon à Moscou, puis la retraite et la défaite. Ainsi toute la partie initiale du roman et la première guerre perdue avec Austerlitz, sont éliminées (réduites très schématiquement au prologue), pour se concentrer sur les années 1810. C’est donc les dernières parties du roman de Tolstoï qui sont mises en relief : L’opéra de Prokofiev commence à roman largement entamé…

Même simplification, même stylisation du côté des personnages où le Prince Andrei Bolkonsky et Natacha ont une position plus centrale, aux côtés de Pierre Bezoukhov, qui reste le personnage sinon principal, du moins le personnage permanent de l’œuvre. Par ailleurs, Prokofiev a construit des scènes un peu syncrétiques où l’on reconnaît par leur construction plusieurs scènes du roman sacrifiées. Un personnage disparaît ainsi complètement qui est celui du Prince Vassili, le père d’Anatole et d’Hélène, qui est un des personnages clés des premiers livres du roman.
Enfin, la multiplication des lieux impose des décors légers, plus évocatoires que réalistes, pour empêcher de longues interruptions et surtout donner au récit une plus grande fluidité. Ainsi Prokofiev a stylisé l’œuvre, pour montrer surtout la défaite napoléonienne à rapprocher de celle des armées allemandes, dans une illustration de l’adage « La roche Tarpéienne est près du Capitole ».

La production (coproduite par le MET, rappelons-le) d’Andrei Konchalovsky est conforme aux attentes : épique, spectaculaire, (des centaines de participants, 1200 costumes de Tatiana Nogikova) avec des décors de George Tsypin qui essaient de donner une unité stylistique à l’ensemble. La question de l’espace est en effet essentielle dans un opéra aussi monumental qui à l’instar du Grand-Opéra du XIXe, nécessite de nombreux changements de lieu. Konchalovsky et Tsypine sont en effet conscient de la nécessité de donner l’idée d’espace dans une œuvre qui traite d’une histoire universelle, d’une histoire-monde et qui se rapporte dans la tête de Prokofiev à la deuxième guerre mondiale. Il s’agit donc de suggérer à la fois les aventures individuelles prises dans le vent épique de l’histoire, et donc la confrontation dialectique de la vie mondaine et ses médiocrités, mais aussi de l’intimité, si importants dans le roman de Tolstoï, et du choc des titans, Koutouzov face à Napoléon. Le Tsar Alexandre 1er, pas très flatté par le roman, reste en effet un rôle muet (il apparait dans le bal du premier acte pour disparaître ensuite) et ne se confronte pas à Napoléon…Staline peut être assimilé à un chef de guerre, un père du peuple comme Koutouzov apparaît, sûrement pas à un Tsar, faible qui plus est…
Pour figurer le monde, les personnages évoluent, au premier comme au second acte, sur une surface bombée, comme sur le toit de la Terre…Cette surface est lisse comme le parquet des palais petersbourgeois ou moscovites au premier acte, accidentée comme un terrain rugueux au second, l’acte des batailles et de la guerre. L’élégance du parquet, matière domptée, contre la matière brute de la deuxième partie.

Du point de vue de la conduite d’acteurs, que dire d’une production vieille de deux décennies, qui a connu plusieurs distributions, et où à chaque reprise apparaissent de nouveaux chanteurs. Ce sont les assistants qui règlent, et les mouvements et expressions sont le plus souvent laissées aux qualités personnelles des artistes et à leur initiative ; mais on comprend bien que dans une telle production, ce sont les images, les mouvements de foule, le « look » qui comptent, et pas les parcours singuliers des personnages, alors il y a des moments particuliers d’ailleurs soulignés par la musique de Prokofiev, comme l’enlèvement raté de Natacha par Kouraguine et ses acolytes, où les qualités individuelles des interprètes sont interpellées, mais dans les grandes fresques, c’est plus discutable : la scène d’état-major de Koutouzov avec les interventions des généraux, peut-être un peu plus, mais les scènes où intervient Napoléon ne sont pas des chefs d’œuvre de raffinement psychologique (Napoléon est difficilement un personnage d’opéra…à part dans Madame Sans Gêne de Giordano). Ainsi donc on demande à cette production d’être impressionnante, et elle l’est, et de tenir dans la durée, ce qui est. Pour le reste, l’œuvre est plus réussie à l’opéra que les adaptations cinématographiques qui en ont été faites…

Le Mariinsky mobilise donc une distribution d’un très bon niveau et une troupe particulièrement homogène pour défendre cette partition monumentale. Comme on l’a dit, au centre le couple Natasha Rostova et Andreï Bolkonsky, dont la relation difficile est au le fil l’intrigue très simplifiée de l’opéra de Prokofiev et notamment du premier acte, . Cette relation est évidemment décrite chez Tolstoï, mais son importance y est relativisée par celle d’autres personnages et par la dilution de l’histoire qui se diffracte en nombre de relations secondaires et de couples divers. Chez Prokofiev, la plupart des personnages du roman apparaissent, mais par des interventions rapides, comme un défilé de figures fugaces. Andreï Bolkonsky ouvre l’opéra alors qu’il rencontre Natacha, le spectateur s’attend légitimement à ce que l’histoire du couple accompagne le récit. Et de fait Andreï Bolkonsky est en pratique le rôle principal, personnage respectable, digne, noble, courageux et follement amoureux de Natasha Rostova, plus légère, plus fantasque, qui n’a pas la ténacité ni la fidélité d’Andreï, et surtout victime de sa naïveté dans une société rouée.
Et le rôle d’Andreï est ce soir confié à Alexey Markov, dont le style vocal correspond exactement au personnage. Chant raffiné, diction impeccable, expressivité soignée : le côté un peu académique de cet artiste, qui peut gêner dans d’autres mises en scènes convient parfaitement à cette production. De plus Markov a la prestance et le physique de l’emploi, il est donc un Andreï Bolkonsky parfaitement idiomatique. Une très belle prestation.
Natacha n’est pas un rôle évident parce que le personnage évolue tout au long de l’œuvre.
La voix de Natacha doit coller aux évolutions du personnage, de toute jeune fille au départ un peu écervelée, elle finit femme, et femme souffrante. Psychologiquement, Andreï est plus mûr et plus clair dans ses sentiments. Natacha est plus légère, mais sans en avoir l’intention, c’est une jeune fille un peu perdue dans la société pétersbourgeoise et son entrée dans le monde lors du bal doit le souligner . Et Violetta Lukyanenko réussit à incarner cette versatilité, y compris vocalement. Le rôle, comme souvent dans les opéras russes et surtout pour ce type de personnage (dont le modèle est à l’évidence la Tatiana d’Eugène Onéguine) qui exige « plusieurs » voix, mais une assise large, un registre central bien placé, et aussi des capacités dramatiques marquées pour la scène finale. Elle sait être légère (elle rappelle en cela évidemment la Lolita de Shchedrin qui évolue de la même manière) et la voix de très beau soprano lyrique toujours bien posée et projetée fait que le personnage est très bien défendu, en particulier dans la scène finale avec Andreï, Elle obtient un joli succès et c’est justifié.

C’est sans doute des trois principaux personnages celui de Pierre Bezhoukov qui est le plus attachant, mais aussi le plus difficile à rendre, d’abord parce que c’est le personnage qui chez Tolstoï va traverser (ou accompagner) toute la période, ensuite dans le roman il épouse finalement Natacha (dans l’opéra, il avoue son amour à la fin du premier acte, quand Natacha découvre que l’homme dont elle est tombée amoureuse – Anatole Kouraguine- est marié, qu’elle a été trompée et doit donc de même coup rompre avec Andreï ). C’est aussi la voix de ténor qu’il faut puissante et pourtant retenue et délicate dont l’équilibre est difficile à trouver : ici le rôle est merveilleusement interprété par Yevgeny Akimov, à la fois sensible, tendre, et maladroit. Il s’agit ici d’une véritable incarnation, qui cadre bien avec la description physique du personnage chez Tolstoï, mais qui traduit très bien en même temps les contradictions qui ont assailli Prokofiev dans sa représentation du personnage, à la fois spectateur de l’Histoire, spectateur toujours marginal du récit : il est difficile d’en faire un héros, même si c’est le personnage central du roman. Et Akimov, triomphe tout à fait justement au rideau final et c’est peut-être lui qui colle le mieux au personnage du roman tel qu’on l’imagine : son entrée maladroite au bras de sa femme Hélène au bal du premier acte est vraiment une caractérisation impressionnante, tout comme son autorité maladroite face à Kouraguine quand il le contraint à quitter la ville.
Des autres protagonistes on retiendra Sonya, sœur de Natacha et amoureuse de Nikolaï Rostov (Ekaterina Krapivina), qui ressemble beaucoup, au début notamment, à la Olga de Eugène Onéguine (ou à Polina de la Dame de Pique) à la belle musicalité, et Hélène (Ekaterina Sergeyeva), qui est immédiatement présentée comme une coquette qui délaisse son mari, Pierre, aux jolis aigus et au timbre somptueux. On reconnaît aussi dans la distribution Olga Savova en Maria Dmitrievna Akhrosimova, l’un des mezzos de référence du Mariinsky, interprète des grands mezzos verdiens, elle est ici employée dans un plus petit rôle, une de ces figures du monde petersbougeois qu’elle caractérise avec beaucoup de justesse, avec Tatiana Kravtsova qui chante Madame Peronskaya, comme deux commères qui commentent la scène du bal.
Du côté masculin, c’est par ailleurs la basse Gennady Bezzubenkov en Koutouzov, impeccable caractérisation. La voix un peu voilée, un peu vieillie mais elle porte le rôle avec grande autorité qui convient parfaitement au vieux maréchal qui va porter la Russie à la victoire, distant, mais attentif, au phrasé impeccable (son grand air est vraiment impressionnant de subtilité), au chant coloré, intelligent dans sa manière de dire le texte et d’en communiquer les inflexions. Le succès est immédiat, par l’incarnation du rôle, et sans doute aussi par le passé de cette basse bien connue internationalement (on l’a vue formidable Staline dans Germania à Lyon en 2018). Grandiose prestation.
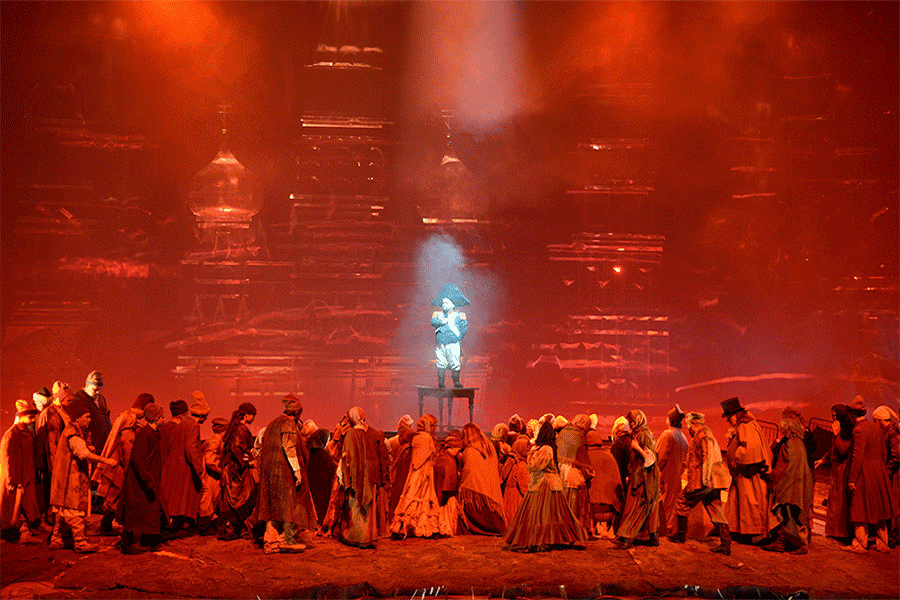
Le Napoléon d’Alexander Nikitin m’est apparu un peu plus pâle en revanche. Excellents en revanche Sergei Semishkur (Kouraguine) par un chant très expressif dessinant impeccablement ce caractère veule, minable et emporté par le plaisir, tout comme sont notables ses deux acolytes, Dolokhov ( Gleb Peryazev) et surtout le cocher Balaga, un des personnages les mieux dessinés par le livret (ici interprété par l’excellent Mikhail Kolelishvil).
Ce type de production permet plus qu’une autre de vérifier « l’état des troupes » sans aucun mauvais jeu sur le titre et l’histoire racontée dans l’opéra : par sa construction, par la nécessité de mobiliser à peu près toute la troupe, y compris le corps de ballet (une des scènes centrales de la première partie est un bal où l’on danse une valse une polonaise et une mazurka). Le chœur est évidemment très présent, selon des modalités très différentes dans la première partie, plus lyrique, plus futile, et dans la deuxième partie, où les interventions du chœur dans un moment plus épique rappellent les cantates de Prokofiev, et qui accompagnent ce moment où la Russie bat Napoléon comme les armées soviétiques vont battre les envahisseurs allemands : un chœur puissant préparé par Andreï Petrenko et particulièrement impressionnant.
L’orchestre est dirigé par Pavel Smelkov, chef d’orchestre et compositeur qui entre autres a participé à l’édition jouée au MET du Prince Igor de Borodine((Voir le compte rendu dans le Blog du Wanderer)), actuellement premier chef au Théâtre Mariinsky (Scène Primorski) de Vladivostok ((Le Mariinsky labellise en effet deux autres scènes en Russie, d’une part à Vladivostok, d’autre part en Ossétie du Nord, dans la direction opposée)). C’est une direction très tendue, très attentive, assez spectaculaire aussi, qui marque particulièrement la différence entre la première partie (la Paix) et la seconde (la Guerre). Dans la première, Prokofiev joue sur les lectures pouchkiniennes (dont Tolstoï est nourri aussi), mais aussi sur le répertoire Tchaïkovskien, et notamment Eugène Onéguine et La Dame de Pique ; c’est particulièrement lisible dans la première scène et dans la scène du bal. Les scènes de bal sont souvent dans les romans et dans les opéras des moments de rencontre ou de rupture, et Prokofiev fait remonter à la surface tout une culture musicale et poétique russe, élément essentiel en un moment où le pays est envahi et doit se retrouver dans ses racines, mais en même temps soigne une dramaturgie où il montre (comme Tolstoï de son côté) le jeu étroit où se tressent la futilité et les sentiments, les deux pôles de toute vie mondaine, en particulier de la vie pétersbourgeoise. Il s’agit donc d’alléger la musique, de lui donner au départ une couleur de fausse sérénité, où le drame se concentre autour du trio Andrei/Natacha/Pierre, et lorsque la rupture survient entre Andrei et Natacha, qui, rejetée par le père d’Andreï, s’est livrée au Prince Anatole Kouraguine, alors que Pierre lui apprend qu’il est marié : Natacha, honteuse, rompt avec Andrei, toujours amoureux fou, et Pierre en profite pour avouer son amour à la jeune femme. Il se noue donc une intrigue amoureuse, triste comme les amours romantiques. Ainsi dramaturgiquement l’acte se clôt sur une rupture, et on apprend parallèlement que Napoléon fonce sur Moscou.
Pavel Smelkov conduit l’orchestre en fonction du drame qui se noue, débutant dans le lyrisme, la légèreté et achevant l’acte par une tension plus affirmée, dans une lecture d’une grande clarté, qui révèle les couleurs et miroitements de l’orchestre, les cuivres plutôt discrets, mais des bois vraiment exceptionnels, des cordes charnues et souvent très raffinées. Ce sera très différent en seconde partie. C’est donc une lecture d’une grande intelligence et sensibilité qui montre les différents aspects d’une œuvre qui est guerre et paix, mais aussi passé et présent : un passé musical marqué par la fin du XIXe, tandis que la seconde partie par résolument s’appuyer sur le présent de la musique russe où la musique (comme chez Chostakovitch) est évocation de l’actualité guerrière : la musique de Prokofiev puise de ce côté-là, dans sa propre production, y compris récente. Mais cette musique est incontestablement un monument à la culture musicale russe. Prokofiev, revenu en URSS le devait…
C’est ainsi, nous l’avons déjà souligné que la seconde partie est forcément plus épique mettant en présence les géants de la guerre, Napoléon contre Koutouzov (Prokofiev élimine Alexandre 1er de sa vision, le Tsar est réduit à un rôle muet dans un bal). La deuxième partie est une Gigantomachie, où l’on va tour à tour voir les armées russes et françaises, la tactique de la terre brûlée de Koutouzov poussant Napoléon à Moscou, qui contemple horrifié la scène grandiose de l’incendie de la ville. Chœurs, mouvements de foule, sur un globe terrestre rugueux et accidenté, vont rendre cette musique épique, une musique presque statique quelquefois (on sait que la genèse de la version définitive a dû jouer avec la censure jdanovienne, qui a imposé aussi des scènes monumentales, écrasantes qui doit correspondre au choc que Prokofiev veut traduire. Il y a évidemment des réminiscences des grandes scènes épiques à la Moussorgsky, mais Prokofiev plonge aussi dans son propre répertoire, comme la cantate Alexandre Nevski composée peu d’années auparavant. Smelkov privilégie, toujours avec le même souci de la couleur, la fresque synthétique, le grand tableau sonore, sans jamais pourtant étouffer l’action sous un déluge sonore, bien au contraire, la scène est toujours privilégiée. Il en résulte une lecture vivante, variée, toujours claire et limpide, même dans les parties musicalement moins stimulantes. Voilà un chef à suivre. Les réserves musicales russes sont inépuisables
C’est le Mariinsky tout entier qui se présente dans une telle production, toute la troupe, où même les stars ou les rôles principaux d’hier occupent ici des rôles fugaces, des figures mineures qui pullulent (on pense par exemple à Pelageia Kurennaya, Lolita trois jours avant –rôle principal remarquable de l’opéra de Shchedrin – qui est ce soir Dunyasha la servante des Rostov. Et ce qui frappe une fois encore c’est l’extraordinaire homogénéité de l’ensemble, et une qualité musicale qu’il est difficile d’atteindre ailleurs dans la représentation de répertoire d’une œuvre donnée très irrégulièrement ailleurs. Tout est mobilisé, tout fonctionne, la salle est comble (avec de nombreuses classes de lycéens) et le spectateur est impressionné : la signature d’une maison saine.

