On a déjà abordé dans nos divers comptes rendus de l'œuvre la question de Fidelio, dont aujourd’hui on fait un message illuministe sur la liberté et l’humanité, et qui est aussi un des multiples avatars des pièces à sauvetage qui pullulent à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Die Entführung aus dem Serail, Die Zauberflöte en sont des exemples chez Mozart, et l’auteur de ces lignes aime à rappeler la magnifique Lodoïska de Cherubini, le plus gros succès de la révolution française (plus de 200 représentations) qui a inspiré des copies chez Storace (1794) et chez Mayr (1796) sous le même titre Lodoïska (dont le nom du héros Floreski, est bien proche par la consonance de Florestan)… Et chez Rossini en 1815 (Torvaldo et Dorliska).
Beethoven connaissait la Lodoïska de Cherubini dont le succès immense avait dépassé largement les frontières (Brahms en fera une partition fétiche). L’œuvre originale de Bouilly (« Leonore ou l’amour conjugal » mise en musique en 1798 par Pierre Gaveaux) va servir de base au livret. Et il apparaît immédiatement que les sources beethovéniennes sont des sources françaises de la période révolutionnaire, ce que le metteur en scène Tobias Kratzer va utiliser…
Plusieurs problèmes dans le livret de Fidelio, qu’on a déjà évoqués : la profonde différence entre le théâtre presque marivaudien (ou presque stendhalien) qui exalte l’amour en prison de la première partie, et la portée héroïque puis idéologique de la seconde partie, qui a été notée par des mises en scène aussi différentes que celle de Harry Kupfer à la Staatsoper de Berlin, accueillie fraîchement à sa création, mais qui représente un effort pour sortir « par le haut » de la difficulté en s’appuyant sur la portée… musicale de l’œuvre. On se souviendra aussi il y a plus longtemps de la magnifique approche « libératoire » de Herbert Wernicke (Avec Solti, Ben Heppner, Cheryl Studer en 1996) qui s’achevait en Missa Solemnis en ayant commencé en opérette, comme l’écrivait Libération lors d’une reprise en 1998.
Souvenons-nous de cette manière de faire de Wernicke, parce que Kratzer n’en est pas si loin. Souvenons-nous aussi des échecs cuisants de l’histoire de la mise en scène de Fidelio, au premier rang desquels Giorgio Strehler au Châtelet et de la tripotée de mises en scène sans intérêt du chef d’œuvre qui pullulent dans les théâtres d’opéra, pleines de ces grilles de prison qui se lèvent à la fin, pour marquer la libération…
Le deuxième écueil est aussi une singulière manière de gérer les personnages et leur psychologie, dans un opéra à sauvetage donc à « objectif unique » : Leonore doit libérer Florestan, et pour cela faire feu de tout bois. Et le bois à faire brûler au service de l’objectif, c’est les autres, c’est d’abord Rocco qu’elle doit circonvenir, séduire et convaincre, et pour cela se travestir en garçon à tout faire. Comme évidemment Leonore/Fidelio est noble et séduisant, un vrai καλὸς κἀγαθός, beau et bon, ou beau et donc bon selon la bonne loi de l’être et l’apparence, il/elle trouble la jeune Marzelline, une finaude qui sans doute est lasse de son Jaquino un peu terne, jusqu’à tomber amoureuse de Fidelio, un amour impossible qui se résout au premier acte par une promesse de mariage scellée par Rocco.
Mais, Florestan libéré, Fidelio redevenue Leonore, épouse de Florestan, Marzelline à la fin reste seule, trompée et abandonnée, dans une solitude d’autant plus forte que tous se réjouissent dans le chœur final et qu’il n’est plus question non plus de retrouver Jaquino. L’amour pour Fidelio ayant évidemment pour effet de révéler l’absence de vrai lien à Jaquino.
Rocco de même est-il un être vénal et lâche qui cherche à se faire un peu d’argent ou un brave type forcé par la crainte de gérer le prisonnier d’État ?
Dernier mystère, le chœur final, comme sorti de nulle part. Mahler (et d'autres avant lui déjà) avait résolu musicalement cette aporie par l’introduction de l’ouverture Leonore III qui séparait clairement la pièce à sauvetage de l’hymne final et en faisait une ouverture à la scène finale d’une autre nature.
Aujourd’hui on en revient à l’œuvre originale sans Leonore III (ou alors Leonore III remplace l’ouverture de Fidelio) et donc la question dramaturgique se repose dans son acuité et son invraisemblance.
Cette population qui assiste à la libération de Florestan et à la résolution, c’est le peuple, partout présent et issu de nulle part, alors que le chœur de la première partie (chœur des prisonniers) était clairement motivé. Il y a dans la seconde partie un relâchement dramaturgique : on passe du style épique (la libération) à la Missa Solemnis (ou à la Neuvième), on passe de la trame enracinée dans une histoire à l’abstraction pure de l’expression de la joie populaire et de la libération presque métaphysique.
Un premier acte réaliste, dans le style de l’opéra historique du « fait historique et historié »
Ces trois questions : la structure en deux parties très différentes, la psychologie des personnages, et la question de la partie finale, Kratzer a décidé de les affronter et de proposer des solutions ou des réponses. En adaptant le texte original, il donne une logique interne et externe à l’œuvre.
C’est cet effort pour construire une logique à ce qui n’en a pas vraiment qui frappe, et qui va donner une très grande cohérence à l’ensemble : il va en effet proposer une réponse à une œuvre qui puise clairement ses sources dans des succès d’œuvres de la révolution française. Aussi bien Lodoiska qui se passe dans la lointaine Pologne que Leonore ou l’amour conjugal qui se passe en Espagne évitent de représenter la France comme lieu de la prison où Florestan serait enfermé. La France révolutionnaire ne saurait être une France de l’arbitraire et de l’injustice…
Or Tobias Kratzer replace l’intrigue en France, sous le motto (en première partie) Liberté, égalité, fraternité dans une cour de prison étouffante qui semblerait le contredire, où flotte un drapeau tricolore gigantesque. Dans une France révolutionnaire où règne la Terreur et où il existe des prisonniers politiques. Car cette première partie est très historiée, très réaliste, hyper réaliste même comme dans la tradition de l’Opéra-Comique, et elle s’appuie sur le texte de Bouilly qui fonde le livret de Joseph Sonnleithner, appelé par Bouilly lui-même « fait historique ». Il faut en effet rappeler que Bouilly dans ses mémoires souligne que son « fait historique » devenu opéra-comique sur une musique de Pierre Gaveaux représenté au Théâtre Feydeau (là-même où fut créé Lodoïska en 1791) en 1798 est basé effectivement sur l’histoire d’une femme qui à Tours risqua sa vie pour libérer son mari aristocrate injustement enfermé dans les geôles révolutionnaires. Bouilly était alors en effet fonctionnaire révolutionnaire en Touraine.
Kratzer va donc clairement imposer comme décor une prison française, décor très réaliste (jusqu’au lit de Marzelline inspiré d’un lit qui se trouvait à la Conciergerie) extérieur et intérieur de Rainer Sellmaier, avec cadre de scène souligné d'un cadre lumineux, pour marquer la séparation du quatrième mur, comme dans le Guillaume Tell de Lyon. Un décor avec l’inévitable grille, la petite fenêtre au sommet qui s’éclaire et qui est celle de l'espion qui regarde, toujours présent, et un malheureux arbre qui est trace de vie dans cet univers pétrifié. Un décor et certains mouvements qui rappellent nettement la mise en scène historique d'Otto Schenk à Vienne.
J’ai évoqué Stendhal plus haut parce que l’image de la vie en prison est un des thèmes importants de la Chartreuse de Parme, où Fabrice prisonnier tombe amoureux de Clelia la fille de son geôlier et vit le « bonheur en prison ». il y a évidemment de ça dans ces scènes de genre que construit Tobias Kratzer, qui dans les faits, loin de faire une pièce d'imitation, crée des déviations essentielles par rapport au Singspiel linéaire à la Schenk.
Sa volonté de réalisme lui fait élargir le nombre de personnages aux autres gardiens de la prison, compagnons de Jaquino. La plupart du temps en effet, les personnages de cette première partie se limitent aux cinq personnages principaux et aux prisonniers qui apparaissent. Ici, il y a une vie du groupe (autour de Jaquino) qui voit d’un mauvais œil l’intrusion de ce Fidelio inconnu, dont pendant l’ouverture on voit l’engagement par Rocco. Kratzer en effet tient à « circonstancier » chaque moment, à soigner les effets de causalité : Jaquino a été supplanté dans le cœur de Marzelline par Fidelio, mais sans doute aussi par son efficacité dans le cœur de Rocco qui a réduit Jaquino aux utilités… D’où sans doute des jalousies, des effets de groupe, et d’où la haine de Jaquino qui ne le quittera pas jusqu’au rideau final. Tout cela n’est pas dans le livret de Bouilly, mais aide à contextualiser un livret et des dialogues originellement un peu élémentaires et seulement utilitaires, qui ne correspondent pas au profil final de l’œuvre et créent la difficulté à homogénéiser les deux parties très différentes.

Quant à Marzelline, qui n’existe dans le livret sinon que pour ajouter un peu de sel (dépit amoureux, jeu de séduction, scènes de ménage) c'est un rôle vécu comme décoratif. Kratzer au contraire la fait exister (n’oublions pas que la musique lui donne l’air initial de l’opéra) et donne à sa relation avec Fidelio un aspect plus réaliste qui respecte l’esprit du livret en lui donnant chair : Marzelline, moins oie blanche que dans la plupart des productions, entraine Fidelio dans sa chambre, essaie de le déshabiller et va suffisamment loin pour déstabiliser Fidelio/Leonore, dont la réaction pourrait passer pour une peur de dépucelage.
C’est très bien fabriqué, c’est très juste psychologiquement et peut être lu au double niveau du spectateur (qui sait pourquoi Fidelio fuit) et de Marzelline (qui peut s’imaginer un autre motif). C’est là ce que j’appelle la finesse de Kratzer qui tient à montrer une logique de livret, à réhabiliter les personnages à la psychologie un peu frustre dans le livret original. Il aménage les dialogues en rajoutant des répliques, en transformant les textes en donnant consistance aux personnages et en justifiant leur comportement. Ce n’est pas trahison, tout est possible dans le Singspiel et d’autres metteurs en scène y compris à Londres (Adolf Dresen) sont déjà intervenus dans les dialogues. Il fait aussi évoluer les caractères.
Ainsi de Jaquino, dont la jalousie est motivée par l’attitude de Marzelline, par celle de Rocco et aussi de ses collègues qui le raillent.

Ainsi aussi de Rocco, bien plus élégant et moins pataud que dans d’autres productions, costume fin XVIIIe culotte et bas, perruque grise très en ordre, c’est un personnage qui respire un certain raffinement et surtout une certaine culture (il y a dans son bureau une bibliothèque), il apparaît donc plutôt comme un bourgeois plus qu’un ouvrier. Tout est ici donc motivé et sa préférence pour Fidelio semble mieux correspondre à ce qu’il veut pour sa fille. Il est donc réfléchi, et politiquement préparé : on le voit à l’arrivée de Pizarro. Il connaît les enjeux politiques qui justifient l’enfermement de Florestan. Par ailleurs, installant en période révolutionnaire l’intrigue, c’est à dire dans son cadre effectif de référence à l’origine (Bouilly), il utilise le texte de La mort de Danton de Büchner qui a mis en littérature l’opposition entre Danton et Robespierre pour montrer en Pizarro non pas le totalitaire qui enferme Florestan pour d’obscures raisons de vengeances personnelles, mais pour des raisons idéologiques, tout le dialogue avec Rocco le montre. Il s’agit d’un enfermement politique, dans une période de terreur.
Kratzer le précise lui-même, il y a dans l’opposition Pizarro/Florestan quelque chose de l’opposition Robespierre/Danton. La (les) révolution(s) ont leurs scories, et la révolution française, en dépit des idéaux, a son côté obscur. Cette première partie « fait historique », souligne quelque chose du réel, et pas du tout une quelconque utopie, ainsi en est-il du chœur des prisonniers, libérés sur initiative de Fidelio/Leonore, qui montrent les dessous, les caniveaux de la révolution. Tout ce qui dans ce nadir livide est à l’opposé de l’utopie.

Et Fidelio/Leonore ? Le personnage est traité lui aussi avec un certain réalisme, le metteur en scène est aidé en cela par la taille imposante de Lise Davidsen, qui permet de lui donner cette stature, et de donner au personnage un profil qui n’est pas celui de simple travesti d’opéra. On la voit fouiller dans les affaires, voler un pistolet, qui lui sera repris lors d’une fouille par Pizarro sans conséquence d’ailleurs, sinon qu’on se demande comment elle réussira à libérer Florestan.
Ainsi les quatre personnages qui gèrent cette première partie (Pizarro arrive ensuite) ont chacun une charge psychologique plus forte, qui donne de l’épaisseur à l’ensemble. Et c’est aussi le quatuor « Mir ist so wunderbar » qui loin d’être présenté comme souvent avec les quatre personnages en rang d’oignon, devient une sorte de pantomime dramatisée, qui annonce la suite où chaque personnage est dessiné et qui rend au quatuor sa valeur de quatre monologues entrecroisés.
Mais Kratzer sait qu’il est à l’opéra-comique, qu’il lui faut aussi alterner des effets comiques ou au moins ironiques avec le fil d’une histoire qu’on n’arrive pas toujours à identifier dans la version originale.

D’abord l’entrée de Pizarro se fait à cheval, très spectaculaire et surprenante (gloussements dans la salle), à l'instar de l’entrée des souverains, en tout cas des chefs : il est celui qui exerce la force immédiate, au nom de la révolution (il est entouré de soldats en uniforme, comme chez Schenk), il est la force devant laquelle on obéit. Et il partage avec Rocco des secrets politiques dont Fidelio et Marzelline sont exclus.
Ensuite l’air Abscheulicher, où Fidelio/Leonore expose enfin sa vérité est lui aussi non pas un air « abstrait » chanté comme un pezzo chiuso, mais un air qui sera résolutif et pour elle et pour Marzelline, air essentiel qui va expliquer le coup de théâtre final de l’acte II. Kratzer construit une causalité dramatique qui n’en avait pas dans le livret avec sa fin en Deus ex machina. Il tisse des motifs, des causes, et des ressorts psychologiques rendant aux personnages une véritable existence, en premier lieu Marzelline.
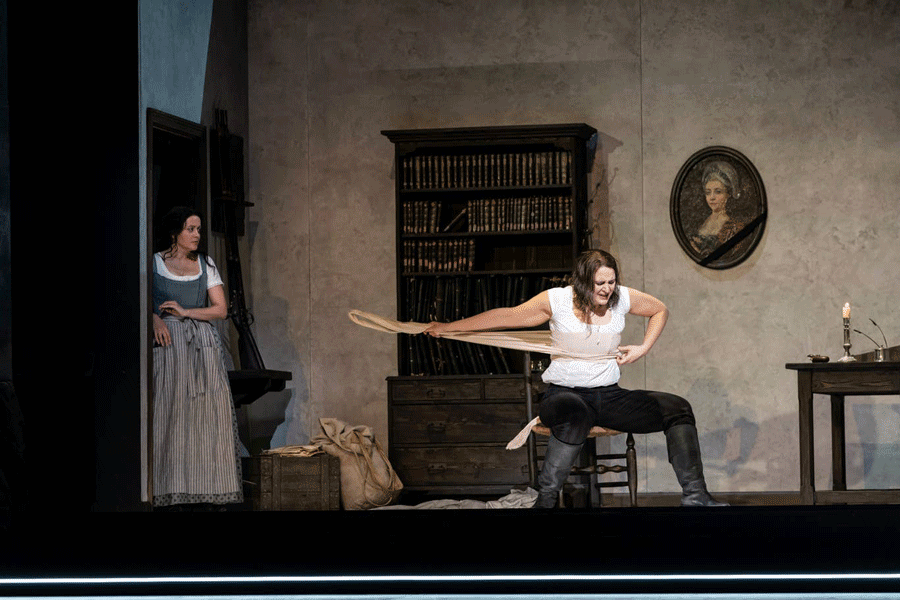
En effet pendant son air Abscheulicher, Fidelio redevient Leonore, dans un monologue où elle est enfin seule et elle-même. Elle se débarrasse donc de ses habits d’homme, enlève le tissu qui lui comprime la poitrine et redevient femme… Mais elle est surprise par Marzelline, qui découvre son secret, son mensonge, et la supercherie…
Contrairement à l’opéra original où Marzelline reste ébahie de surprise dans la scène finale, Kratzer la montre découvrant l’étendue de sa déception à la fin du premier acte, qu’elle achève en disant du lügst…du lügst… (tu mens), ce qui va permettre au personnage de mûrir et de transcender sa douleur. Par cette trouvaille, Kratzer donne au personnage encore une existence plus forte, il fait du monologue de Fidelio non un air « pour le spectateur » mais un air dramatique qui crée entre Fidelio/Leonore et Marzelline un autre type de relation, motivé par ce que Marzelline a quasiment tout entendu de l’air et qu’elle devient du même coup non l’amante délaissée mais la seule dépositaire du secret de Fidelio et presque sa "complice".
J’entends le spectateur grommeler « et pourquoi ? ».
En redonnant au premier acte une valence, un réseau de motivations et de caractères, il lui donne aussi son histoire. Il y a une histoire qui se clôt, celle de Marzelline et de Fidelio – seule véritable histoire avec un début et une fin de cet acte‑, il y a une autre histoire qui est la grande (et quelquefois noire) histoire des révolutions, vue à travers Pizarro-Robespierre et Rocco, le fonctionnaire discret et qui n’en pense pas moins (et si Rocco figurait Bouilly?), et il donne à cet opéra mal fichu dramatiquement même si merveilleux musicalement, une tenue dramatique qui relance l’intérêt du spectateur, et rend les choses non pas fonctionnelles (le premier acte pour beaucoup de spectateurs est une salle d’attente pour le second) mais historiées, précises, référencées. Ce réalisme du décor, cette abondance de petits détails dans les costumes, le mobilier, les rapports enrichis entre les personnages, les caractères plus affirmés, rendent au Singspiel sa fonction initiale et aussi sa noblesse.

Un second acte dans l’abstraction et l’utopie
Mais Kratzer sait que Fidelio, ce sont deux parties radicalement différentes, et quand le rideau se lève dans la seconde partie, l’espace initial a disparu, il se fait plus abstrait, un peu structuré comme son Guillaume Tell lyonnais, dans la même couleur en noir gris et blanc avec un chœur habillé en habits modernes et disposé autour de l’espace de jeu, non plus en rectangle comme à Lyon, mais en cercle, comme des spectateurs d’un drame antique.
Tobias Kratzer est un dramaturge d’une grande finesse, et constatant la différence radicale entre l’esprit et la lettre des deux parties de l’œuvre, au lieu d’essayer de s’en accommoder, comme souvent, et de construire une continuité, il montre la radicalité d’une rupture qu’il rend évidente au spectateur, comme si il y avait en quelque sorte deux œuvres en une, d’une manière particulièrement didactique. Et d’abord il en change le motto, qui est cette fois « Wer immer du bist, werde ich dich retten » (Qui que tu sois, je te sauverai) qui est un motto plus individuel à connotation religieuse, mais aussi à connotation héroïque. C’est ici le geste individuel qui est invoqué… et tout le monde pense à Leonore… Mais…
Kratzer établit évidemment des liens entre les deux parties, l’une étant plus enracinée à la terre, à notre réel ou à sa représentation historique, plus aristotélicienne en quelque sorte toute en imitation, l’autre, plus abstraite, plus brechtienne, plus distanciée, renvoyant aux idéaux affirmés de la révolution dont il a développé au premier acte les zone d’ombre, mais en même temps un théâtre plus didactique, et donc plus brechtien comme déjà dit. La première partie est aussi plus attachée à un genre, le Singspiel, l’autre peut-être plus attachée à d'autres genres, plus extérieurs à l'opéra, une œuvre chorale comme la Neuvième, une messe (Missa solemnis) : il y a quelque chose comme la résolution d’une Passion, celle de Florestan et il est donc nécessaire de montrer le chœur présent dès le début, comme il le serait chez Bach – et comme on a mis en scène récemment les Passions de Bach. Car la différence entre acte I et II n’est pas seulement dramaturgique, elle est aussi musicale. Concret/abstrait, récit factuel/motif parabolique, deux modes de faire du théâtre et de la musique se partagent la même œuvre, traduisant d’une certaine manière l’aporie qui avait frappé Beethoven au point de ne pas réussir à résoudre entre 1805 et 1814 le drame qu’il voulait écrire…

La disposition du public-chœur autour d’un espace où se trouve Florestan (un rocher où il est attaché) a plusieurs motivations et effets.
D’une part c’est la disposition du théâtre antique, avec un espace de jeu circulaire au centre, comme si l’on assistait à la représentation d’un drame sacré, avec ses effets cathartiques, les spectateurs prenant part directement à ce qui se passe, des projections vidéo présentant les visages tendus et les réactions individuelles effrayées, tendues, affligées de tel ou tel spectateur, illustrant la pitié, l’horreur, la terreur chers à la définition de la tragédie.
D'autre part, ce peuple en costume contemporain, c’est évidemment nous, avec nos attitudes et nos travers, et nos modes aussi (les bouteilles d’eau qu’on boit pendant le spectacle, une mode très récente… Les gens ont étrangement plus soif qu’auparavant…), et nous sommes spectateurs d’une souffrance, d’une injustice, de la mort lente d’un prisonnier arbitrairement jeté dans les fers. Nous regardons, mais nous ne faisons rien. Il n’y rien là qui définirait l’intemporel, le drame de toutes les époques, c’est au contraire l’inscription dans notre temps, hic et nunc, qui est ici affirmée.
Car c’est cela aussi, le schéma de cet acte : nous assistons au drame, mais à l’extérieur, incapables d’intervenir, incapables d’agir, comme devant l’écran des chaines d’information continue, comme les peuples d’aujourd’hui effrayés et paralysés par les peurs qui les traversent, en un inconscient collectif qui pleure pour les victimes des larmes infertiles.
Florestan dans son monologue initial est conscient de ce regard collectif sans effet et son monologue au milieu de cette foule qui regarde apeurée le condamné en est d’autant plus solitaire et désespéré.
Une disposition théâtrale, d’un théâtre figurant d’une certaine manière le théâtre du monde, et le drame des sociétés lâches, confortables, n’osant pas intervenir, donnant mandat aux héros pour faire les révolutions et agir, puis éventuellement les suivre si ça marche. Terrible vision du monde d’aujourd’hui.
Alors, même le jeu devient plus abstrait, plus dépouillé… Plus d’objets, plus d’accessoires, les personnages interviennent sans armes, comme l’intervention de Leonore qui s’interpose sans armes (le pistolet qu’elle avait volé lui avait été soustrait par Pizarro), c’est donc presque une pantomime qui paralyse Pizarro, dont l’intervention est interrompue par la sonnerie de trompette. Au coup de trompette, Il se précipite avec un couteau et se trouve arrêté par un coup de feu qui le blesse et interrompt le mouvement pour assassiner Florestan.
Et c’est alors le coup de théâtre.
Entre en effet dans l’espace Marzelline, portant la trompette en bandoulière et le fusil qui a blessé Pizarro. Marzelline, qu’on a laissée au premier acte désespérée par le « mensonge » de Fidelio (du lügst !…) revient en scène en libératrice. Le Deus ex machina artificiel représenté par le Ministre, lointain et substitut d’un quelconque souverain, est ainsi supprimé : l’intervention de Marzelline étant « motivée ». Rendant au personnage une psychologie et une histoire, il la fait « mûrir » entre la première et la deuxième partie : la douleur mais aussi le fait de savoir la cause de la présence de Fidelio/Leonore a produit son effet, effet humain, effet de courage : le personnage ainsi acquiert un rôle et se réalise, il a grandi, il s’est grandi. C’est Marzelline qui sonne la trompette (elle a entendu l’avertissement de Pizarro au premier acte), c’est Marzelline qui tire sur Pizarro, et c’est Marzelline qui sauve et Leonore et Florestan. Réponse noble à la douleur individuelle ressentie, transfiguration de l’amour en héroïsme. En somme, Marzelline est une seconde Leonore qui prend ici la première place : c’est à elle que le motto (Qui que tu sois, je te sauverai) s’applique, parce qu’elle agit pour l’humanité et non pas seulement pour ses intérêts particuliers (ce que fait Leonore au contraire, dont la position est plus individuelle qu’idéologique).

Honneur aux femmes héroïques qui marquèrent les révolutions. Ou qui en furent victimes.
Plusieurs éléments à souligner : en donnant à Marzelline un rôle actif, Tobias Kratzer ne trahit rien du livret, bien au contraire, il montre que l’héroïsme peut être partagé face à l’oppression, et il donne ainsi un rôle précis à chaque personnage. Si Leonore retrouve son mari (en lui chantant une berceuse, extraite elle-même de la Mort de Danton ((Il s'agit de la berceuse "Es stehn zwei Sternlein an dem Himmel / Scheinen heller als der Mond" que Lucile Desmoulins chante à Camille en prison, une berceuse d'ailleurs que Büchner a pris à la tradition allemande)) superbe moment où elle reconquiert par ce geste maternel son mari disparu), c’est Marzelline qui résout le drame, elle passe des utilités au rôle de protagoniste, elle acquiert une histoire, une psychologie, une maturité : comme les héros, et notamment les héros de roman, elle a vécu un apprentissage. Bref, elle existe enfin.
En doublant le geste d’amour de Leonore par celui de Marzelline, Kratzer souligne en même temps que Marzelline offre un superbe geste d’amour à ce Fidelio qui lui a menti, elle répond à la douleur par l’amour, mais par un amour élargi, « l’amour de l’humanité », si la pièce s’appelle « Fidelio ou l’amour conjugal ». Kratzer signe ici « Marzelline ou l’amour de l’humanité » qui est amour transcendé. L’idée est d’autant plus juste qu’elle enrichit encore si c’est possible le message humaniste de l’œuvre que tout le monde ne cesse de souligner.
Dès lors, les choses peuvent reprendre une autre logique dramaturgique. Le peuple, le chœur présent autour du drame sacré de la libération de Florestan, d’abord effrayé par l’intervention de la jeune fille, peut désormais respirer, et chanter la libération. Certes, c’est du « suivisme » motivé par cet exemple héroïque. Dans la vision habituelle le chœur intervient un peu de manière incongrue dans la scène finale, sans qu’on sache vraiment d’où il vient et ce qu’il fait là, Kratzer lui donne une histoire, qui est histoire traditionnelle des peuples, entrainés par les héros à la révolte et à l’affirmation de soi. De spectateur passif, il devient actif, et communicatif.
Alors les personnages qui vivaient le drame en protagonistes peuvent « rentrer dans le rang », reprendre des habits « civils », se fondre dans la foule pendant que le « Ministre » sort du rang de la foule, comme non plus ministre tombé du ciel, mais émergeant de la foule, comme mandaté par elle pour édicter la loi nouvelle : le chœur final en effet privilégie le collectif, et noie les héros dans cette foule des anonymes. Alors le chœur peut avancer au proscenium, chanter la liberté, et la salle s’illumine (bon, c’est une facilité théâtrale qu’on voit souvent pour célébrer les fins « collectives » qui doivent marquer une joie ou une utopie, mais qui marche toujours bien cathartiquement…) ((Rappelons que c’est Giorgio Strehler en 1973 qui utilise le premier cet artifice dans l’ensemble final des Nozze di Figaro)).
Tout est bien qui finit bien ? Non.
Non car tout aussi subtilement, Kratzer montre un personnage qui n’a pas compris la leçon, engoncé dans sa jalousie ou sa haine. Un personnage qui ramasse le couteau laissé par Pizarro et qui va se précipiter pour se venger sans doute. C’est Jaquino, qui n’a pas compris la leçon humaniste, la leçon d’héroïsme, la leçon sacrificielle de Marzelline. Il va agir avec son couteau, mais la foule lui échappe, il reste seul, au milieu de la scène, le seul qui garde son costume original, costume XVIIIe de geôlier, le seul qui n’a pas compris et qui n’a pas accès à l’utopie. Marzelline avait bien raison de ne plus l’aimer. Ce n’est pas une grande âme et pourra devenir un danger futur…
Voilà ce qu’il en est par cette mise en scène qui s’efforce de donner une logique à la trame brinquebalante de Fidelio. Est-ce l’hybris du metteur en scène qui cherche à enrichir une œuvre en soi déjà culte ? Justement pas. Le metteur en scène intervient pour pallier des faiblesses d’un livret que tout le monde admet, il intervient pour mettre TOUS les personnages en ordre de marche dans l’utopie marquée du second acte, il intervient dans la logique de l’œuvre, sans jamais la trahir, et sous les apparences trompeuses, notamment en première partie, d’un Singspiel traditionnel, en en reprenant les lois, les habitudes, le décor historié. Il soigne tout particulièrement les interactions entre les acteurs-chanteurs, le profil des personnages, chacun très caractérisé, c’est à ce titre un travail de pur théâtre exemplaire, d’une très grande précision dans les mouvements, d’une grande rigueur dans le jeu, dans les gestes et les expressions. C’est un travail qui donne de la respiration à la trame, sans étouffer sous des trouvailles gênantes un opéra qui reste culte, par delà tout le reste.
L’esprit de cette production me touche enfin parce qu’il est profondément stendhalien, au sens où sont mises en scène des grandes âmes qui doivent survivre face à l’oppression. Il y a chez Stendhal une profonde conscience de la Révolution Française, des idéaux qu’elle a véhiculés, et des âmes qu’elle a réveillées. Le roman stendhalien est le roman tendre des utopies perdues ((Stendhal, cité par Béatrice Didier, la célèbre spécialiste de Stendhal, dans un article sur Stendhal et le romantisme musical, a écrit que les musiques de Beethoven, Weber, Mozart bouleversent « les cœurs faits pour la musique et pour l’amour »)).
Ici, le spectacle nous entraîne dans la tendresse, l’utopie, l’avenir radieux. En ces temps d’une grisaille angoissante, c’est plutôt merveilleusement beethovénien.
Une distribution solide dominée par la Leonore de Lise Davidsen
La musique de Beethoven en revanche n’a jamais été contestée (voir la mise en scène de Harry Kupfer à la Staatsoper de Berlin qui en fait l’héroïne), même si le spectateur en général attend plutôt la deuxième partie, la première apparaissant, malgré le merveilleux quatuor, l’air « Abscheulicher » et le chœur des prisonniers, comme un hors d’œuvre. Nous avons montré comment la mise en scène a redonné sens au fil théâtral de la première partie, donnant à tous les personnages une épaisseur psychologique qu’ils n’ont pas toujours. Musicalement, nous savons que Beethoven parsème de difficultés son écriture vocale. Aussi bien les rôles de Leonore que celui de Florestan ont des difficultés à trouver leur « juste » voix/voie. Le rôle de Leonore/Fidelio est aujourd’hui distribué à des sopranos dramatiques, Nina Stemme, Anja Kampe, il y a quelques années Hildegard Behrens, Gwyneth Jones ou plus loin encore la Nilsson, mais on a entendu aussi Cheryl Studer, qui ne fut jamais un soprano dramatique, ou Gundula Janowitz, qui après avoir été Marzelline avec Karajan, fut Fidelio avec Bernstein. Les Fidelio/Leonore vont de Kirsten Flagstad à Christa Ludwig ou Elisabeth Söderström.
Même versatilité du côté des Florestan où l’on relève aussi bien Jon Vickers qu’Anton Dermota, Julius Patzak que Siegfried Jerusalem ou Peter Hoffmann. Il y a bien longtemps, j’entendis sous la direction de Barenboim à Paris un Siegfried Jerusalem en début de carrière qui n’était pas encore le ténor dramatique qui chantait Tristan, mais encore Froh de la production Chéreau et il ne se sortait pas des aigus de la cabalette meurtrière de son air du second acte.
En 1805 comme en 1814, le concept de soprano dramatique ou celui de fort ténor n’est pas assis : les voix sont beaucoup plus ductiles, adaptables. Des chanteurs aujourd’hui considérés comme mozartiens pouvaient aborder ces rôles (comme un Dermota ou une Edda Moser il y a quelques dizaines d’années). La voix forte et large doit être aussi souple, savoir assurer et dominer des agilités. Des chanteurs comme Ben Heppner ou Jonas Kaufmann, ayant chanté Mozart, sont adaptés à Florestan, un rôle que de grands futurs Lohengrin ont chanté. Largeur vocale d’un soprano ou d’un ténor dramatique avec agilité et finesses mozartiennes, cela ressemble un peu aujourd’hui à la quadrature du cercle, tant les voix sont catégorisées. Les sopranos dramatiques d’agilité ne courent pas les rues, et les ténors capables aussi bien d’héroïsme que de subtilités vocales ne sont pas légion non plus.
De ce point de vue, la distribution choisie à Londres est plutôt solide et judicieuse.
Jonas Kaufmann promène son Florestan depuis bien des années, il l’a enregistré avec Abbado à Lucerne et le chante assez souvent. Le rôle est assez court, mais il ouvre par un air redoutable, où tout le spectre est sollicité, en deux parties dont la seconde, la cabalette est parsemée d’embûches et d’aigus ravageurs. Jonas Kaufmann ici se sort avec suprême élégance et grande maîtrise de la première partie, son « Gott » est comme d’habitude complètement tourneboulant, il se sort un peu plus à la limite des aigus de la cabalette. C’est plus tendu, moins éclatant, on l’a connu plus en forme dans le rôle. De même ses interventions finales sont-elles « à la limite », on note un léger manque d’éclat, de la difficulté ou de la fatigue. Nous n’en concluons rien, car nous l’avons entendu il y a peu dans des conditions tellement éblouissantes (Die Tote Stadt à Munich) qu’il s’agit sans doute d’une fatigue passagère : le chanteur est d’une intelligence telle qu’il se sort de la difficulté avec professionnalisme, voire maestria. Il reste qu’on l’a connu plus définitif C’est un rôle qui convient à sa voix, à son style de chant, qui privilégie le phrasé, la sculpture du mot et l’intelligence de l’expression aux effets gratuits. D’ailleurs, la polymorphie du rôle interdit de souligner les effets. Une prestation légèrement en dessous de l’habituel, mais très respectable et d’une intelligence hors du commun, comme toujours avec lui.
En face de lui, et des autres, une Leonore au contraire toute jeune et ayant déboulé sur le marché international il y a deux ou trois ans, Lise Davidsen, qu’on va s’habituer désormais à voir sur toutes les scènes du monde. Norvégienne comme Flagstad, elle frappe immédiatement par la santé, l’aisance et la puissance de la voix, large, souple, techniquement très soucieuse de respecter l’écriture difficile de Beethoven (« Abscheulicher » impeccable, où tout est maîtrisé les aigus, les graves, les agilités, l’expression). Au-delà d’une voix exceptionnelle qui frappe immédiatement, elle impose aussi un personnage de "grand-garçon-ayant-trop-grandi" en première partie. Sa très grande taille pourrait être un obstacle, il n’en est rien grâce à la manière dont le personnage est généré par la mise en scène et grâce à la manière dont elle maîtrise aussi son jeu, tour à tour juvénile, gêné, direct, tendre, et souvent très émouvant. Elle apparaît immédiatement comme une grande Leonore, un rôle qu’elle aborde en scène après l’avoir chanté en concert avec Nézet-Séguin à Montréal. C’est le plus grand triomphe de la soirée, et c’est amplement mérité.
La Marzelline de la jeune américaine Amanda Forsythe assure aussi une performance très honorable. La voix est peut-être un poil trop petite notamment au début et surtout ensuite face à l’ouragan Davidsen, mais l’impression initiale est bientôt effacée par des airs bien maîtrisés, une technique dominée, une expressivité qui montre que le texte a été travaillé. Son jeu frais, direct, répond aussi à celui de Davidsen. Dans les scènes « intimes », elles sont très engagées toutes les deux et son personnage prend sans cesse de l’assise. Son intervention finale, au second acte, ses dernières paroles en chœur avec Rocco ou en quatuor se détachent de l’ensemble, comme si elle chantait pour elle-même (« Wer ein solches Weib/Stimm' in unsern Jubel ein!…» ). Elle est la première à la fin à revêtir un habit « civil » (elle est en veste), et à rentrer dans l’anonymat dont il était question plus haut. Elle occupe bien la scène, assume son « nouveau » personnage. L’impression est largement positive.
Georg Zeppenfeld est Rocco. Un Rocco qui, nous l’avons noté, tranche avec les figures habituelles, du genre brave papa un peu rond et un peu ambigu. Ici le personnage est élégant, cultivé, et cela cadre parfaitement avec la personnalité de Zeppenfeld et un chant toujours élégant, au phrasé et au timbre clairs, très expressif et très attentif aux paroles. Zeppenfeld compose un Rocco vraiment inhabituel, comme à contre-emploi dans cette prison. Et la composition est très réussie : il remporte lui aussi un beau succès.

L’impression est plus contrastée pour Simon Neal en Pizarro. Nous connaissons le chanteur, intelligent, et souvent expressif. Il est toujours ici expressif, mais la mise en scène exige de lui une noirceur non caricaturale, mâtinée de « motivations idéologiques ». Il pourrait répondre à ces exigences mais la voix a perdu en aigus, a perdu en éclat, et au total il n’impressionne pas vocalement et ne réussit pas à frapper par son jeu. Et c’est donc une déception
Jaquino est le ténor Robin Tritschler. On a connu de (rares) Jaquino plus marquants vocalement. Le personnage de mal aimé reste pâle et sans grand intérêt. Pourtant la mise en scène, qui prend soin de donner à chacun un rôle et de ne laisser personne sur le chemin, lui donne une personnalité plus marquée, essentiellement au premier acte où il fait partie de la « bande » des travailleurs de la prison, et où il a été visiblement évincé à tous les niveaux par Fidelio, d'une part Rocco lui préfère Fidelio pour le travail et d'autre part Marzelline par les sentiments . C’est le seul à ne rien gagner et à la fin du second acte, il le montre. Kratzer le fait rester seul et désemparé, laissé au bord du chemin par le cours de l’histoire, dernière image de l’opéra. Tritschler est efficace scéniquement, vocalement plus pâle.
Le ministre est Egils Siliņš qu'on a vu souvent dans les opéras wagnériens (dans Wotan notamment). Comme il ne s'agit plus d'un substitut de souverain triomphant que pourrait chanter un Peter Mattei au timbre noble et à la projection parfaite. Il est individu sorti du peuple, mandataire anonyme, et ce timbre opaque, cette voix un peu fatiguée convient à ce personnage devenu du même coup plus pâle. La mise en scène d'une certaine manière justifie la voix voilée et fatiguée du chanteur letton.
Saluons enfin les deux prisonniers Felipe Manu et Timothy Dawkins, ce dernier à la voix de basse assez marquante.
Des forces locales vigoureuses et une direction seulement fonctionnelle
Belle prestation du chœur du Royal Opera House, dirigé par William Spaulding, de grande tradition, qui joue bien le « chœur antique » dans la deuxième partie, avec un réel effort de jeu presque individualisé, et puissant et vigoureux à la fin.
Du côté de la direction musicale, Antonio Pappano est comme on sait particulièrement apprécié du public britannique, au vu du triomphe remporté. Il propose un travail de soutien scénique efficace, dynamique, attentif aux voix (c’est un chef d’opéra exemplaire), c’est un ensemble très fonctionnel, mais sans particulière couleur et ni toujours le relief voulu. Certains moments restent plats. On n’entend pas dans cette direction le grand jeu symphonique de Beethoven qu’on perçoit immédiatement la plupart du temps lors de l’introduction du deuxième acte, souvent l’indice d’une direction à la grande personnalité, aussi bien Abbado jadis que Barenboim ou Petrenko aujourd’hui ne laissent pas passer ce moment et en font un intense moment dramatique plein de relief et un prélude impressionnant à l’apparition de Florestan ; Antonio Pappano n’en fait pas grand-chose, ne théâtralise pas vraiment le moment. Que dans la première partie (le Singspiel), sa direction ne fasse qu'accompagner un plateau dynamique et varié, cela peut s’entendre, moins lors de la deuxième partie, où il laisse les voix s’épanouir, mais fait entendre une voix d’orchestre trop timide, là où au contraire on attend Beethoven tel qu’en lui-même… La direction est efficace, fonctionnelle, l’orchestre sans scorie, mais le son reste assez banal. Du côté de la fosse, c’est donc une petite déception, dans une soirée qui reste marquante par d’autres éléments. On en sort donc heureux.
