Vasco chez les Martiens
Le rideau une fois ouvert on découvre un couloir d’administration moderne avec sa photocopieuse, un salon d’attente (décors et costumes de Rainer Sellmaier) et des employées éplorées et angoissées, on attend des nouvelle d’une expédition spatiale aux confins de l’Univers, et l’on se demande ce qu’il en est des cosmonautes partis…Et quand Vasco apparaît c’est un coup de théâtre.
Quand Vasco de Gama entre en effet en scène au premier acte dans une combinaison de cosmonaute tenant son casque à la main, le public murmure. Quand quelques minutes après, entrent Selika et Nelusko, deux êtres bleus aux corps difformes, Selika toute menue et Nelusko énorme réplique de Hulk (en bleu), le public rit franchement. Et pourtant, nous ne sommes pas dans une comédie, ni dans une parodie. C’est bien l’histoire de L’Africaine, transposée dans le futur, dans le monde de Star Trek, et c’est bien ce qu’on faisait à l’âge classique quand on ramenait en Europe des spécimens de sauvages.
Encore une lubie de metteur en scène, diront certains. Et pourtant, rien de plus rigoureux que le travail de Tobias Kratzer l’audacieux. Il avait déjà transposé Le Prophète dans nos banlieues et avec quelle maestria. Il s’inspire maintenant des épopées futuristes du cinéma et de la TV pour montrer la permanence des comportements conquérants, et colonisateurs et le recul de l’humanité, malgré les bonnes intentions.

Le rideau s’ouvre sur le silence de l’orchestre et la projection de la plaque des sondes Pioneer envoyées dans l’espace en 1972 et 1973 ainsi que des dizaines de manières de saluer dans toutes les langues : message de fraternité universelle que tout le spectacle va contredire.
Une mythologie des années 70
Telle une bande dessinée pour adultes, le spectacle va ainsi se dérouler alternant moments cyniques, ironiques, émouvants et évidemment rempli des références, Star Trek, 2001 Odyssée de l’Espace (vidéos de Manuel Braun). Une imagerie qui se réfère à celle de l’Espace déjà dépassée, celle de la conquête de la Lune, vers les années 70 et celle des films de l’époque, en tous cas en rien contemporaine : l’histoire a besoin d’être un peu distanciée et lointaine.

On va sourire lorsqu’au troisième acte, devant la vaste baie qui ouvre sur l’espace, et sur la musique de ballet, on voit apparaître un cosmonaute, puis deux (Simone Kyeltika et Susanna Beschorner) en un ballet aérien désopilant : ce sont deux réparateurs qui se refilent…une clé anglaise.On sourira aussi à la scène où les épouses restées à terre communiquent avec leurs époux par une sorte de Skype interposé sur l'immense écran…On sera en revanche plus ému par le ballet final des deux amants Selika et Vasco dans une sorte de Liebestod spatiale à laquelle on finit par croire.Tobias Kratzer est un metteur en scène d’une intelligence lumineuse, et toujours très distancié dans son regard plutôt acéré sur le monde ; et il trouve étrangement dans les livrets de Scribe un terrain de jeu favorable, adapté et cohérent.Le livret s’insère parfaitement dans cette transposition dans un espace mythique à la Kubrick, les personnages sont tous à leur place, rien n’est escamoté et Kratzer veut coller à Scribe pour démontrer la permanence de la problématique de la conquête, de la colonisation, mais aussi de la tolérance et de l’humanité.
De fait, après les surprises des deux premiers actes, après le ballet du troisième acte : on finit par se laisser prendre et croire à cette histoire d’amour entre une humanoïde bleu-avatar et un humain.
Mais Kratzer fait clairement voir dans le personnage de Vasco l’égoïsme du héros, celui d’un seul but, et aussi l’absence totale de regard envers Selika, la scène de la prison où elle cherche à le servir (Acte II) où elle ne cesse de le regarder et où il l’écarte symptomatique. Le héros n’est pas très sympathique, il ne fait pas partie de cette humanité ouverte qu’on prêche.
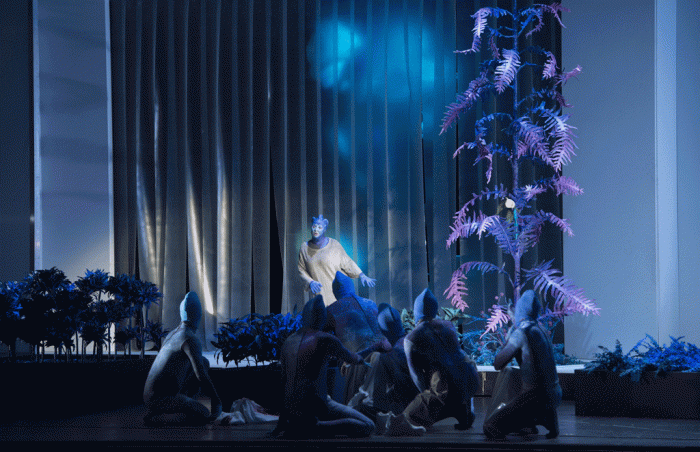
Le quatrième acte est à ce titre singulier : tout bleu, dans la planète des semblables de Selika et Nelusko, qui ont piégé les conquérants, dans une sorte de profusion bleutée (tout bleu l’amour est bleu, dit un air célèbre de l’Auberge du Cheval Blanc ((Die ganze Welt ist himmelblau, air de Robert Stolz)) d’une « île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux », un exotisme qui provoque le grand air de Vasco Pays merveilleux… , un paradis où l’on meurt au milieu des parfums enivrants et mortels du mancenillier, l’arbre qui va provoquer au cinquième acte le délire final de Selika, vivant une Liebestod en apesanteur. Une Liebestod en effet puisque l’Africaine est créée la même année que Tristan (1865). Claudia Mahnke réussit à rendre le personnage profondément émouvant, le physique ingrat et la manière de se mouvoir par leur étrangeté même deviennent des éléments de compassion.
Nelusko est dans l’opéra le mal aimé tout en étant celui qui veille sur l’étanchéité de leur civilisation et de leur culture. Opposé physiquement à Selika toute menue, il a quelque chose de volontairement monstrueux, ressemblant à un personnage de la Cendrillon de Maguy Marin jadis. Et sa voix plutôt chaleureux et claire de baryton tranche et donne évidemment la touche d’humanité qui manquait au monstre.
La vision d’un futur déjà dépassé
On va beaucoup discuter de la mise en scène de Tobias Kratzer, qui a le charme des épopées disparues, d’un univers dépassé, mais en même temps direct et présent, avec son histoire qui se déroule conforme au livret dans un univers qui à la fois frappe et fait sourire, avec ses projections intercalées et surannées, La plaque de Pioneer, le défilé des voix humaines qui saluent, les déclarations des scientifiques (un peu vieillottes), tout cela a le parfum des histoires et des rêves, et presque des contes de fées qui se termineraient par la très belle scène de la Liebestod, magnifique musicalement, mais qui en réalité, quand Selika et Nelusko sont morts empoisonnés par le Mancenillier, se termine par un chœur où les voix masculine martiales se mêlent à celles féminines, lyriques, pendant qu’au milieu des petits hommes bleus une armée de cosmonautes vient planter le drapeau de la conquête. Volontairement brutal et démonstratif, et donc huées…
L’intelligence de Kratzer consiste à offrir une histoire qui a du sens, parfaitement fidèle au livret, mais qui n’est aussi qu’une succession d’images de notre mythologie, médiatisées par le cinéma, par nos souvenirs aussi, qui fait vivre l’œuvre au total bien plus fortement que si Vasco nous apparaissait sur sa Caravelle et que Selika était sa Jeanne Duval. Kratzer nous rend cette histoire sensible et en même temps rend le Grand Opéra à sa diversité : grand spectacle, tragique, émouvant, comique. Il s’appuie sur un livret de Scribe comme souvent bien fait, et revendiquant un humanisme qu’on n’a pas souvent relevé : Scribe, dans La Juive, Les Huguenots, Le Prophète et L’Africaine et dans d’autres œuvres exalte les valeurs de tolérance, d’ouverture, d’humanité et utilise son succès à l’affirmation de valeurs non encore toujours installées dans le monde. A l’ère commençante de la colonisation au nom de valeurs humanistes bientôt battues en brèche par l’exploitation des peuples, Scribe dénonce notamment dans L’Africaine, les ambiguïtés des valeurs de notre civilisation, ce que Kratzer a saisi au vol. C’est décidément un très grand metteur en scène, plus grand que bien d’autres à la mode qui ne font que se répéter. Chaque opéra vu de Kratzer jusqu’ici partait d’un parti pris différent, et racontait notre monde, selon les points de vue les plus divers.
Une question musicale complexe
La question musicale est plus complexe encore. Outre que la version originale rééditée, présentée pour la troisième fois en Allemagne (on attend en France que quelqu’un se décide) présente un Meyerbeer moins tonitruant, plus tendu, plus tendre aussi, dans un drame d’individus plus que collectif (le chœur est présent, mais moins actif et plus illustratif que dans Les Huguenots ou Le Prophète) : c’est bien le drame intime de trois ou quatre personnages, qui nous est présenté ici, les autres restant des utilités. Voilà une œuvre surprenante, plus lyrique, dont la composition, on le sait, a duré environ 25 ans, commencée dans les années 40, au cœur du triomphe du Grand Opéra, et terminée dans les années soixante, à la fin du genre : Faust, Les Troyens, Don Carlos, L’Africaine sont tous à peu près contemporains et chacun dans leur genre est un chant du cygne. Ce soir, c’est Mort et Transfiguration du Grand Opéra.
Il va être encore plus difficile de parler d’un style meyerbeerien. Le diable d’homme savait se renouveler et n’était pas coincé entre style italien (Rossini qu’il admirait tant), et style français : la disparition de Meyerbeer des répertoires depuis les années 50, dont on peine à trouver une explication claire, certains arguent qu’il a été trop joué auparavant et donc objet de lassitude, d’autres accusent le passage du nazisme et l’ostracisme des certains juifs allemands trop fameux. Il reste que la conséquence en a été un discours critique un peu distancié, allant jusqu’à taxer cette musique de médiocre et sans intérêt. L’extraordinaire engouement que Meyerbeer a connu au XIXe ne peut se justifier si cette musique était uniformément médiocre. Du coup, un autre discours critique cherche à montrer que Meyerbeer n’a aucune personnalité, et qu’il imite qui Rossini, qui Auber, qui Verdi (même à l’époque où Verdi n’écrivait pas puisqu’on a pu lire que Les Huguenots (1838) ressemblaient à du Verdi ). Que Meyerbeer sache saisir les modes, et ait une intuition des goûts du public, qui le nierait ? Mais Meyerbeer, allemand, qui a vécu toute la première partie de sa vie créatrice en Italie et la seconde partie en France, est un authentique européen, qui a traversé les trois grandes nations de l’opéra à l’époque, et s’en est nourri. Son retour sur les scènes, encore timide, suffit pour montrer les qualités de cette musique, qui peut largement rivaliser avec des valeurs que nous avons consacrées. Avec L’Africaine, il est lui aussi comme son héros à des confins qui auraient annoncé un ailleurs s’il n’avait disparu avant même la Première. Et pour rendre cette complexité et ce style : L’Africaine, plus que les autres, a un style propre, peu réductible à autre chose qu’à lui-même.
Une direction peu concernée et plate
On est d’autant plus triste de la prestation bien pâle de l’orchestre dirigé par Antonello Manacorda. Nous connaissons ce chef, qui fut le premier violon du MCO, puis du LFO avant de décider de s’orienter vers la direction et que dont nous avons suivi l’évolution avec sympathie. La direction est précise, accompagne comme-il-faut les chanteurs et le plateau. Elle est techniquement acceptable : les chanteurs sont rarement couverts et le plateau est valorisé. Mais rien de plus.
Car la musique en soi reste un peu en marge : une couleur uniforme, peu de nervosité et de tension en rendent l’approche très pâle, avec un tempo souvent lent sans qu’on puisse en expliquer la raison. La lenteur n’est pas un problème si elle prend sens. Ici, elle n’est souvent qu’ennui tant la platitude de l’approche est évidente. Peu de relief, peu de solutions de continuité avec des scènes juxtaposées qui ne montrent aucune unité musicale ou stylistique. L’orchestre de Francfort, le Frankfurter Opern-und Museumorchester, est en général un orchestre de qualité, avec de bons solistes, mais on l’a entendu ici sans trop de caractère, avec un son affadi dans une musique pourtant où la couleur est si importante, à cause des ambiances différentes, à cause de variations fortes entre le spectaculaire, le drame, le lyrisme, le romantisme aussi. Il n’en sort qu’une homogénéité propre sans accroche. Cet univers semble étranger à Manacorda, et c’est dommage.
Un ensemble de chanteurs homogène et à la hauteur
C’est assez différent du côté de la distribution et du chœur, un chœur pléthorique (Chor et Extrachor) dirigé par Tilman Michael, qui a visiblement travaillé le phrasé et la langue parce qu’il est plein de relief et parfaitement compréhensible. Belle prestation.
La qualité de la troupe de Francfort une fois de plus est ici mise en relief, vu que la plupart des rôles sont portés par ses membres, que ce soit l’excellent Pedro d’Andreas Bauer, à la voix claire, bien posée, projetée, et tendue, le Diego (père d’inès) de Thomas Faulkner, à la voix chaude, ou le très bon Alvar du ténor Michael McCown (beau phrasé) et l’inquisiteur (et qui chante aussi le prêtre de Brahma) Magnùs Baldvinsson : tous constituent une équipe homogène, soudée, engagée, même avec une jeune membre du studio (Bianca Andrews) qui chante Anna…Seuls quelques artistes du chœur employés comme solistes ont quelque difficulté avec la langue française et surtout le phrasé (Hyun Ouk Cho) mais il faut surtout saluer dans cette troupe de vrai niveau Claudia Mahnke en Selika, qui m’est apparue particulièrement engagée, émouvante et juste.

On la connaissait notamment dans ses prestations à Bayreuth où elle fut une magnifique Waltraute dans la production Castorf. On apprécie cette voix claire, expressive, aux aigus solides, à la présence scénique notable, même affligée d’un costume ridicule fait pour gêner le contact direct avec le spectateur et marquer l’altérité. Elle réussit néanmoins à émouvoir surtout pendant les scènes finales, lorsqu’elle rêve sa Liebestod avec Vasco sur une musique vraiment raffinée et subtile, mais aussi dans les scènes de la prison (Acte II, sc. II et III) : c’est à la fois une composition naïve voire adolescente, et en même temps affirmée (notamment quand elle s’adresse à Nelusko, ou dans toute la seconde partie. Sans être pyrotechnique (mais le rôle de Selika exige moins d’agilités), en ne chargeant jamais le chant, en restant régulière dans l’expression et les accents, elle réussit vraiment sa prestation et touche le spectateur.
Face à elle l’Inès de Kirsten McKinnon, qui entrera dans la troupe de Francfort l’an prochain, voix lyrique, très contrôlée, qui maîtrise bien les agilités du rôle, émouvante elle aussi, avec un beau phrasé et un français correct. Une découverte, et sans doute une belle recrue pour l’Oper Frankfurt qui tient là un soprano très adapté au bel canto et techniquement sans reproche.
À part Michael Spyres au français impeccable, peu de chanteurs font défaut de ce côté-là et la langue est dans l’ensemble claire, même si quelquefois on regarde le surtitrage : le nombre de chanteurs anglo-saxons y est sans doute pour quelque chose et c’est le cas de Brian Mulligan, magnifique Nelusko. La voix de baryton est claire, avec un beau volume et surtout une expressivité et des accents en français notables. C’est un chanteur en permanence juste et souvent émouvant, comme le veulent les figures de mal aimé.

Et pourtant, son costume de Hulk bleu, monstrueux et ridicule, pourrait le desservir (tout comme pour Selika), mais c’est la force de la musique et du théâtre qui nous fait oublier après un premier impact son alterité ou son alienité. C’est aussi la force de la mise en scène que de nous faire rire ou sourire de personnages ridicules en apparence et qui finalement nous apparaissent sensibles et humains : sa ballade d’Adamastor est magnifiquement chantée. Là aussi, nous tenons un baryton d’avenir.
Michael Spyres est Vasco da Gama, cosmonaute perdu dans les espaces interstellaires, capitaine d’un vaisseau (comme l’Enterprise dans Star Trek) c’est à dire à vrai dire un rôle auquel il ne nous a pas habitués. La voix est claire, l’émission impeccable le français parfait, accents, émission, phrasé : il n’y a rien à dire. On connaît les éminentes qualités de ce chanteur.
Vasco est pour lui une prise de rôle, et peut-être n’arrive-il pas à rendre tous les aspects héroïques du rôle, qui requièrent un volume plus grand, un timbre plus brillant, une affirmation vocale qu’il n’a pas. Il reste un peu pâle avec des suraigus trop tendus et criés quelquefois. Vasco n’est pas Raoul des Huguenots, il est plus héroïque aussi que Jean de Leyde dans Le Prophète, même si les deux rôles par les exigences vocales peuvent se ressembler. Michael Spyres a relevé le défi, mais en tirera-t-il avantage ? J’ai mes doutes.
Ce Vasco existe, mais la voix réussit paradoxalement à en rendre les fragilités et les ambiguïtés plus que les forces dans lesquelles il est moins crédible. Vasco n’est pas très sympathique, notamment avec une Selika, qu’il a à peine regardée, puis qu’il prend et jette. C’est la force du livret que de montrer que les deux sauvages ou les deux aliens dans cette mise en scène, sont les plus humains : ils ont droit chacun à la mort, qui pour Nelusko est une vraie mort d’amour et qui est toujours plus héroïque que de rester vivant : Vasco conserve la vie. Mauvais signe.
On discutera sans doute une direction musicale qui a mon avis passe à côté, et on glosera sans doute aussi sur la mise en scène et son parti pris à la fois radical et en même temps si respectueux de l’esprit d’un livret qu’il suit à la lettre, rendant à Scribe un hommage appuyé. Pourtant après quelque jour, ces images nous séduisent. Kratzer réussit à divertir et émouvoir, par un humour décalé de bande dessinée, et par des allusions à une époque, les années 70 où l’on croyait à l’humanité en paroles, et où on continuait dans l’Espace à employer le mot conquête.
C’est Jean Jacques Rousseau à qui on va donner le cynique dernier mot par cette loi des hommes : « Il ne coûte rien de prescrire l’impossible quand on se dispense de le pratiquer » (Confessions, VIII) .

