 En guise de Prélude
En guise de Prélude
Enfin Don Carlos vint. Il fallait bien un jour que la première maison concernée par une œuvre qu'elle a vu naître (mais pas à Garnier ‑qui n’existait pas en 1867- comme je l’ai lu sous des plumes ignorantes) et qu'elle a laissé s'échapper rendît enfin à César ce qui appartient à César. Il n'y a qu'un Don Carlo, et c'est Don Carlos dont la fortune littéraire naît en France. Car Don Carlos est d’abord une nouvelle de Saint-Réal publiée en 1672 qui va inspirer le drame de Schiller Don Carlos, de 1787. Verdi a d’ailleurs puisé quatre sujets d’opéras ((Don Carlos, Luisa Miller, Giovanna d’Arco, I Masnadieri)) chez Schiller.
Au-delà des effets de communication qui font de cette production comme une renaissance de musiques inconnues, il faut avant tout rétablir quelques faits qui montrent que Paris dans cette affaire a plutôt fait grise mine. Rendons grâce à Stéphane Lissner d'avoir été le premier (mais au Châtelet) à proposer à Paris la version originale (mais pas vraiment complète) dans une belle distribution dominée par un jeune et lumineux Roberto Alagna avec le non moins jeune Antonio Pappano au pupitre : il en reste un bel enregistrement qui fait référence moderne en attendant plus complet. Mais il existe un enregistrement antérieur de John Matheson à Londres avec la BBC (1976), plus complet encore et très proche de ce qu’on entend aujourd’hui à Paris.
A la scène une fois de plus il faut rendre grâce à Claudio Abbado, qui soutenait (comme beaucoup de chefs italiens aujourd'hui) que l'original français est plus intéressant et plus beau que sa traduction italienne avec tous ses avatars, mais qui n'a pas trouvé les chanteurs pour une version française à la scène. Il s'est donc rabattu sur les musiques originales dans la traduction italienne dont il reste des enregistrements live dans les deux distributions (Carreras/Freni ou Domingo/Price, rien que ça). Il y a déjà là plein de musiques nouvelles, y compris le final avec chœurs (il avait suivi comme tout le monde les travaux d'Ursula Gunther). D'ailleurs son unique enregistrement officiel de Don Carlos est en français, mais il n’a pas choisi la version originale mais la version en cinq actes de Modène laissant les musiques originales dans un disque supplémentaire. Un choix bancal qui ne rend pas justice à l'œuvre. Il reste qu'il a fait entendre à la Scala en 1977 les musiques que pour le coup on n'avait quasiment jamais entendues, et qui révélaient un tout autre Don Carlo(s).
Le Teatro Regio de Turin a ensuite proposé une production de la version originale française sous la direction de Gustav Kuhn en 1991 qui se revendiquait elle-aussi la plus complète.
Plus récemment, Barcelone et Vienne (Peter Konwitschny), puis Bâle (Production acérée de Calixto Bieito) ont proposé des Don Carlos qui ont marqué.
Paris
Paris arrive enfin, le dernier, mais pas le plus misérable. Merci donc à Stéphane Lissner d'offrir enfin au public la version de la maison créée pour la maison, et pas vraiment entendue depuis 150 ans en France…Et quant à savoir quelle est la version la plus originale, la plus authentique, la plus plus…laissons là le débat puisque chaque Don Carlo/Don Carlos représenté jusqu'à la mort de Verdi l'a été sous la responsabilité du compositeur qui a lui-même taillé dans le vif, et fait la dentelle que l'on sait dans la forêt des reprises à Naples, Bologne, Milan, Modène et ailleurs. Le reste aujourd’hui est choix de chefs.
Et pour marquer ce Don Carlos on a réuni une distribution exceptionnelle, un metteur en scène à la mode et toujours intelligent, et le directeur musical au pupitre de l'événement, avec retransmission sur Arte et dans les cinémas et sans doute un futur DVD.
Distribution exceptionnelle parce qu'elle réunit quatre des plus grands du monde lyrique, à commencer par Jonas Kaufmann, qui a déjà chanté (Munich et Salzbourg notamment) le rôle de l'infant malheureux ; Ludovic Tézier, grand baryton pour Verdi, avec sa voix sonore, son timbre charnu, son énergie, est naturel à Paris pour Rodrigue ; Elina Garanča, le mezzo vedette du monde lyrique, qui a déjà beaucoup marqué dans le bel canto aborde maintenant Eboli-qui chante mieux qu’elle la partie de mezzo du Requiem de Verdi ?-, et enfin Sonya Yoncheva, aborde ici son premier grand rôle de lirico spinto.
Que demande le peuple ? Il s'est précipité à juste titre pour écouter dans les conditions optimales cette œuvre qui reste pour moi l'une des plus grandes de Verdi, aux aspects multiples : réflexion sur le pouvoir, sur le désir, sur la religion (et assez violemment anticléricale : il fallait oser cette histoire en 1867 avec une impératrice espagnole bigote comme Eugénie de Montijo) et en même temps dernier avatar d'un genre qui eut une trentaine d'années de fortunes parisiennes, le Grand Opéra. C'est pourquoi on peut regretter l'absence du ballet : certes Verdi n'en voulait pas et a tardé à l'intégrer, mais c'était la marque de Paris, et son originalité par laquelle même les plus réticents (Wagner) sont passés. Il faudra attendre la version lyonnaise ce printemps pour en entendre une large partie.
La mise en scène de Warlikowski : des finesses et des déceptions
Le spectacle qui est proposé est sans contexte de grande tenue, sans être totalement convaincant notamment au niveau scénique et au niveau musical, mais absolument étonnant du point de vue du chant, au moins pour quatre des protagonistes déjà cités.
Il est difficile de proposer le Grand Opéra aujourd'hui, sans tomber dans le double écueil de la reconstitution historique kitsch, ou l’interprétation moderne qui peut subir le danger de l’anachronisme. La Juive de Py à Lyon n'était pas convaincante, le Don Carlo de la Scala (Peter Stein) manquait de vie et d’invention. Il faut rendre grâce à Peter Konwitschny (bien inconnu en France) à Vienne et à Barcelone (en coproduction) d'avoir trouvé des solutions spectaculaires et séduisantes, et surtout d'avoir su régler avec brio la question du ballet dans le Don Carlos présenté, mais la production la plus forte reste pour moi celle de Bâle de Calixto Bieito (2006), parce qu’elle fut la plus audacieuse, si audacieuse qu’on n’a pas osé la reprendre.
Plus loin, il faudrait remonter à Ronconi à la Scala (Don Carlo mais avec les musiques originales) qui reste référentielle, à voir et à revoir sur you tube.
Dans cette longue litanie de productions, celle de Warlikowski ne comptera pas parmi les plus grandes, même si son travail n'est pas médiocre. D'abord, il résout le premier problème du Grand Opéra, celui de l'espace et des différents lieux : il travaille comme toujours sur un lieu unique, sur une boite à l'intérieur de laquelle tout se noue et se dénoue. Comme il refuse les aspects épiques du Grand Opéra pour n'en faire presque qu'un drame intime, cela se justifie sans doute. Les deux premiers actes sont vus comme des réminiscences d'un Carlos désespéré, au bord du suicide : le rideau s'ouvre sur la tête du héros plongée dans le lavabo traditionnel des mises en scènes Warlikowskiennes, un Carlos dans une sorte de cellule avec bureau, cheminée et lit. L'acte de Fontainebleau est donc vu à travers le prisme du souvenir amer, comme à travers un film (projeté avec les taches et les brouillages): Don Carlos refait le film de sa rencontre avec Elisabeth, ces dix minutes de bonheur où les deux héros se parlèrent et surtout furent eux-mêmes. Dans ce contexte, pas d'hiver ni paysans dans la plainte : le chœur est concentré sur un coin du décor séparé des protagonistes par des cordes ; ainsi, si Verdi voulait ouvrir sur la misère du peuple écrasé par l’hiver et la guerre, Warlikowski fait du peuple un écrin qui ne compte pas – ou très peu. Au milieu du décor un beau cheval blanc de contes de fées, symbole du rêve des deux héros et de leur mariage projeté.
 Plusieurs fois la reine regarde ce cheval comme vers l’image d’un bel espoir perdu, comme son bel habit blanc de mariée ou de princesse de rêve. Cela permet de donner à cette scène à la fois la justesse et la distance voulue, celle de l'irréel.
Plusieurs fois la reine regarde ce cheval comme vers l’image d’un bel espoir perdu, comme son bel habit blanc de mariée ou de princesse de rêve. Cela permet de donner à cette scène à la fois la justesse et la distance voulue, celle de l'irréel.
L’acte de Fontainebleau est bien justement ce moment suspendu du bonheur au fond d’une forêt qui isole et singularise, un lieu idéal du romantisme finissant. Même système dans l'acte II ou le duo Posa/Carlos est vu sous ce prisme. Puis le second tableau (l'air du voile) revient vers "le direct".
 Refusant le côté convenu du chœur des courtisanes qui entourent Eboli, Warlikowski souligne le décalage de cette scène (qui l'est tout autant dans une mise en scène traditionnelle) présentant Eboli sous un jour (y compris vocal) qu'elle n'aura pas dans le reste de l'opéra. Manière de souligner le côté hybride du personnage, qui n'est pas seulement la méchante du melodramma italien. Warlikowski souligne d'ailleurs sa relation affectueuse (un peu trop ? les penchants d'Eboli sont nettement suggérés) avec la reine. Mais il l'insère dans un monde étrange, celui de l'escrime, des épées, des duels, monde de codes où ces femmes s'amusent à ferrailler sous la direction de cette "maître d'armes" dont le voile est le masque d'escrime qui cache les visages ; ce monde du combat sportif permet de marquer – un peu comme Fontainebleau précédemment‑, une sorte d’écart ( qui est aussi musical d’ailleurs pour son aspect exceptionnellement virtuose dans cette œuvre d’où la virtuosité belcantiste est absente) mais qui montre les relations entre les êtres comme une sorte de combat singulier, comme le soulignera la magnifique scène de Philippe avec Posa, qui pose le personnage de Philippe dans son désespoir et sa faiblesse.
Refusant le côté convenu du chœur des courtisanes qui entourent Eboli, Warlikowski souligne le décalage de cette scène (qui l'est tout autant dans une mise en scène traditionnelle) présentant Eboli sous un jour (y compris vocal) qu'elle n'aura pas dans le reste de l'opéra. Manière de souligner le côté hybride du personnage, qui n'est pas seulement la méchante du melodramma italien. Warlikowski souligne d'ailleurs sa relation affectueuse (un peu trop ? les penchants d'Eboli sont nettement suggérés) avec la reine. Mais il l'insère dans un monde étrange, celui de l'escrime, des épées, des duels, monde de codes où ces femmes s'amusent à ferrailler sous la direction de cette "maître d'armes" dont le voile est le masque d'escrime qui cache les visages ; ce monde du combat sportif permet de marquer – un peu comme Fontainebleau précédemment‑, une sorte d’écart ( qui est aussi musical d’ailleurs pour son aspect exceptionnellement virtuose dans cette œuvre d’où la virtuosité belcantiste est absente) mais qui montre les relations entre les êtres comme une sorte de combat singulier, comme le soulignera la magnifique scène de Philippe avec Posa, qui pose le personnage de Philippe dans son désespoir et sa faiblesse.
 C’est sans doute là que réside le principal axe du travail de Warlikowski : insister sur les personnages et leurs faiblesses, sur les relations entre les individus pris dans le vent de l’Histoire, qui semble compter bien peu face aux problèmes singuliers : la pantomime bien faite qui commence la scène de l’autodafé où une fois de plus Philippe apparaît sous le jour de la faiblesse et du désespoir en est le signe, un Philippe débraillé, alcoolique, qui visiblement n’a pas envie d’apparaître comme le roi, que l’on va couronner – comme le rappelle le livret- mais qui voudrait seulement être regardé par sa femme. Un Philippe moins statufié, plus jeune aussi (en dépit d’un livret qui ne cesse de souligner ses cheveux blancs et sa vieillesse), dans la force de l’âge et donc plus atteint encore d’être mal-aimé et plus violent dans ses soupçons envers Elisabeth.
C’est sans doute là que réside le principal axe du travail de Warlikowski : insister sur les personnages et leurs faiblesses, sur les relations entre les individus pris dans le vent de l’Histoire, qui semble compter bien peu face aux problèmes singuliers : la pantomime bien faite qui commence la scène de l’autodafé où une fois de plus Philippe apparaît sous le jour de la faiblesse et du désespoir en est le signe, un Philippe débraillé, alcoolique, qui visiblement n’a pas envie d’apparaître comme le roi, que l’on va couronner – comme le rappelle le livret- mais qui voudrait seulement être regardé par sa femme. Un Philippe moins statufié, plus jeune aussi (en dépit d’un livret qui ne cesse de souligner ses cheveux blancs et sa vieillesse), dans la force de l’âge et donc plus atteint encore d’être mal-aimé et plus violent dans ses soupçons envers Elisabeth.
La scène de l’autodafé est chez Verdi d’abord scène du couronnement (Elisabeth : Acte III, sc1 le roi que demain l’on couronne.) Ce qui rend la pantomime encore plus signifiante : le Roi veut fuir son devoir politique au profit de son bonheur personnel – est-il si loin de Carlos ? Du même coup l’intervention de Carlos dans la scène devient un crime de lèse-majesté initial qui doit être immédiatement puni, sinon le pouvoir de Philippe II vacille dès l’avènement.
 Et l’autodafé qui conclut la scène n’est que le pendant noir du pouvoir et marque la puissance de l’Inquisiteur représenté en projection vidéo comme un monstre dévoreur d’hommes. Philippe II ne tient son pouvoir que du bon vouloir de la religion. Encore une marque de faiblesse.
Et l’autodafé qui conclut la scène n’est que le pendant noir du pouvoir et marque la puissance de l’Inquisiteur représenté en projection vidéo comme un monstre dévoreur d’hommes. Philippe II ne tient son pouvoir que du bon vouloir de la religion. Encore une marque de faiblesse.
Elisabeth est construite comme un personnage plus bourgeois que royal qui ne communique pas vers l’extérieur et qui garde ses secrets derrière des lunettes noires (une excellente idée), qui la séparent du monde et en font une sorte d’abstraction : il faudra attendre l’acte V – pendant de l’acte I où les deux héros se parlent vraiment, pour que le cœur se dévoile à nouveau. Mais de tous les protagonistes, c’est sans doute avec Posa la plus noble.
Eboli est traitée de manière sans doute un peu plus bienveillante dans ce travail, elle fait partie des personnages déchirés dont la lecture est difficile : intrigante chez Schiller et ici amoureuse de Carlos et maîtresse du père (ça c’est historique), comme elle apparaît au début de l’acte IV avant la visite de l’inquisiteur (une idée qui existait déjà chez Bieito) : déchirée, dépassée par ses passions, mais pas foncièrement méchante : ainsi apparaît-elle dans l’acte II plutôt sympathique, ouverte disponible, et dans l’acte IV lacérée, étouffée par le remords…
Ce qui transparaît de Carlos n’est pas incohérent avec l’histoire ni avec le livret : l’interprétation magnifique du personnage par Jonas Kaufmann en fait un héros romantique ombrageux, un succédané de Werther – rôle fétiche du ténor allemand- , incapable de gérer sa misère amoureuse et son isolement politique. Le livret d’ailleurs souligne sans cesse que toutes ses demandes politiques envers son père sont des fuites destinées à échapper à cet amour désespéré qu’au contraire d’Elisabeth, il ne réussit pas à intérioriser. Il manque de contrôle sur lui-même (scène de l’autodafé) démontrant ainsi qu’il est tout sauf un politique avec des gestes presque enfantins notamment à l'acte IV quand il exprime son désespoir en se jetant maladivement d’un coin à l’autre de sa cellule lorsque Posa lui annonce qu’il va mourir pour lui.
Posa constitue un exemple singulier : on peut toujours le considérer comme une sorte de chevalier blanc défendant la veuve et l’orphelin, y compris en affrontant son roi ; il est aussi l’exemple d’une amitié avec Carlos sans failles pour lequel il finit par se sacrifier. Bieito avait suggéré les restes d’un amour homosexuel d’adolescents. Posa existe assez peu chez Saint-Réal, bien plus chez Schiller où il est une figure voisine à celle développée par Verdi, même si c’est quand même Verdi qui lui donne son statut définitif de héros et de protagoniste : mais le personnage est ambigu dans sa perfection héroïque. Posa va en Flandres sans doute s’opposer en sous-main aux exactions du Duc d’Albe, un personnage qui apparaît aussi bien chez Saint-Réal que chez Schiller, complètement absent chez Verdi où il n’est même pas cité – la preuve que le politique dans le Don Carlos de Verdi n’est peut-être pas importante-; en réalité, il ne peut ignorer l’incapacité structurelle de Carlos à affronter la situation politique en Flandres, Philippe II pense d’ailleurs de même. Que cache par ailleurs chez Posa cette volonté de rester en Espagne au poste envié et jalousé de favori du roi (pour protéger Carlos ?), et en même temps d’ami privilégié du fils (pour guider Carlos ?), de Grand d’Espagne marginal et libre et en tant que tel menacé par l’Inquisition. Lui aussi masque une déchirure (qui s’appellerait Carlos ?) que chaque metteur en scène s’emploiera à expliciter.
Eh bien pas chez Warlikowski qui garde au personnage son mystère : Ludovic Tézier reste toujours un peu à distance, en ordre (face à un Carlos souvent débraillé), mais parlant à tous et donc au roi un langage de vérité qui en fait son égal. Figure sacrificielle qui va garder son secret jusqu’à la mort.
On le voit, le travail de Warlikowski sur les personnages est loin d’être méprisable et superficiel, il est plutôt fin et pose les justes questions.
Ce qui est plus faible, c’est le travail de mise en scène plutôt conforme, sans véritable invention, même un peu ennuyeux et attendu vu que Warlikowski se répète d’une mise en scène à l’autre ou se cite ; dès le 2ème acte en effet, le spectre de Charles Quint intervient auprès de lui comme un élément tutélaire et protecteur : un spectre qui ressemble à s’y méprendre au Keikobad de sa Frau ohne Schatten, père lointain et terrible de l’impératrice. Inévitablement l’esthétique de Małgorzata Szczęśniak fait aussi répétition (on pense au Château de barbe bleue). Bref on est en univers connu, se tissent des échos mais ça ne prend plus parce qu’il y peu de choses neuves.
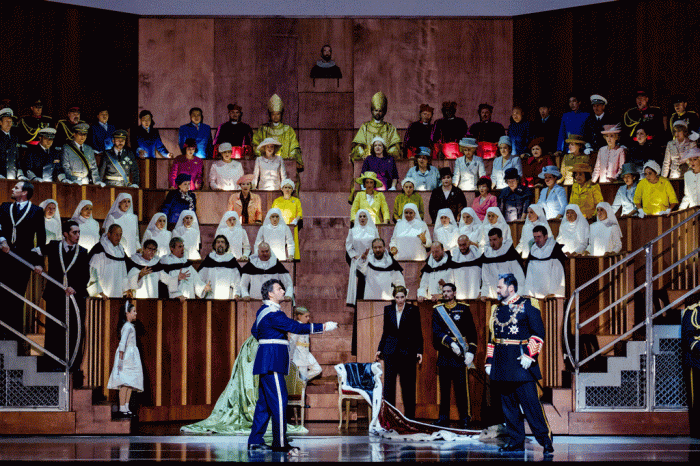 La scène de l’autodafé, avec cet hémicycle presque « parlementaire » et une sorte de distribution des « ordres » souligne l’aspect convenu et formel du couronnement « politique » et surtout fossilisé : le chœur paraît être un ensemble de marionnettes : l’idée se défend et la scène perd complètement son aspect spectaculaire si typique du genre. Ici Warlikowski casse les codes, notamment par la pantomime initiale autour du Roi, et c’est heureux et digne d’intérêt mais en revanche, l'acte IV est médiocre, et rarement scène de l’Inquisiteur fut plus faible, pas plus que les scènes suivantes qui opposent la reine au roi et qui isolent définitivement Eboli sans aucune originalité ni invention. Même la scène de la prison et le « lacrimosa » qui suit restent extérieures (alors qu’elles sont les plus émouvantes de l’œuvre) ou ont un air de déjà vu, tout comme l’ensemble du cinquième acte, même si Elisabeth avale du poison au baisser de rideau…
La scène de l’autodafé, avec cet hémicycle presque « parlementaire » et une sorte de distribution des « ordres » souligne l’aspect convenu et formel du couronnement « politique » et surtout fossilisé : le chœur paraît être un ensemble de marionnettes : l’idée se défend et la scène perd complètement son aspect spectaculaire si typique du genre. Ici Warlikowski casse les codes, notamment par la pantomime initiale autour du Roi, et c’est heureux et digne d’intérêt mais en revanche, l'acte IV est médiocre, et rarement scène de l’Inquisiteur fut plus faible, pas plus que les scènes suivantes qui opposent la reine au roi et qui isolent définitivement Eboli sans aucune originalité ni invention. Même la scène de la prison et le « lacrimosa » qui suit restent extérieures (alors qu’elles sont les plus émouvantes de l’œuvre) ou ont un air de déjà vu, tout comme l’ensemble du cinquième acte, même si Elisabeth avale du poison au baisser de rideau…
Warlikowski semble s’être plus intéressé aux caractères qu’au déroulé ; la longueur de l’opéra fait qu’il s’essouffle, et ne fait même plus de Warlikowski…à la fin, on finit par se lasser de tant de vacuité.
Une direction musicale sans âme
Face à ce travail, Philippe Jordan comme la plupart du temps propose une direction musicale d’une grande propreté, très précise, très en place, claire, sans bavures (de très légères aux cuivres au début). C’est un indubitable technicien de l’orchestre, un orchestre qui sous son règne aura sans doute progressé. Il parle d’ailleurs en des termes très justes de ce Don Carlos dans le programme.
Mais ne cherchons pas une âme dans un travail qui dans sa propreté ne laisse que peu d’espace à une vision, une interprétation, une vibration. Certes les chanteurs sont le plus souvent bien accompagnés, mais on se demande où est le cœur : l’orchestre est fort, quitte à couvrir les chanteurs (Kaufmann plus d’une fois), mais surtout on n’entend rien de sensible, même si certaines scènes sont mieux réussies que d’autres (acte II dans l’ensemble par exemple)
On soigne ce qui dans le Grand Opéra est éclat et rutilance, mais il faudra repasser pour ce qui est palpitation (et Meyerbeer qui avait écouté Rossini, tout comme l’avait fait Verdi avait une vraie science des accents et des rythmes et savait faire et rutiler et palpiter).
Il ne se dégage de cette approche aucune espèce d’émotion dans cette totale incapacité à créer un univers qui tant soit peu frémisse. Le cinquième acte, avec son introduction orchestrale longue et si théâtrale en fosse, et tout son duo si émouvant de l’adieu à la vie, reste à l’orchestre un accompagnement sans couleur : là où l’orchestre doit pleurer avec les chanteurs (duo Carlos/Elisabeth), il passe imperturbable, sans relief, sans accents, sans vie presque : impeccable et sans un pli, mais sans une larme ni une once de sensibilité. Et il ne s’agit pas de parler d’italianità là où Verdi s’est ingénié avec insistance à proposer une francité dans sa musique appuyée sur l’un des plus beaux livrets qui soient. Il y a là quelque chose de géométrique et monumental, comme si le Grand Opéra ne devait pas vibrer, mais simplement se faire entendre et quelquefois écraser. Parfait et propre comme une magnifique autoroute sans végétation et seulement bétonnée. Jordan s’est trompé d’univers et celui-là n’est pas le sien.

C’est tout le contraire pour le chœur magnifique de bout en bout, puissant, émouvant (début), préparé par José Luis Basso d’une rare présence sonore et néanmoins toujours à sa place sans jamais écraser, à la diction très claire ; saluons à ce propos la jolie prestation de la voix d’en haut particulièrement présente et marquante de Silga Tiruma, artiste du chœur.
Des voix en feu d'artifice
Car s’il y a une âme dans ce Don Carlos, elle est dans la présence des voix, et d’une distribution introuvable composée de très grandes vedettes du chant qui font aujourd’hui partie des références de l’opéra et toutes engagées à corps perdu dans l’aventure : on sent dans cette équipe justement un esprit d’équipe et une vraie solidarité, ce qui n’est pas si fréquent dans un art où les luttes d’ego sont légion.
Et c’est aussi heureux pour l’œuvre : on a désormais une double distribution qui connaît Don Carlos : avec les autres chanteurs qui ont déjà chanté ailleurs l’original, il est à espérer que les directeurs d’opéra s’en souviendront.
Commençons par les déceptions : les basses aussi bien Belosselskiy (l’Inquisiteur) que Abdrazakov pour des raisons différentes ne sont pas à l’aise dans leurs rôles. Belosselskiy est même totalement en dehors de ce qui est attendu. Certes, il y a le personnage à lunettes noires, théoriquement aveugle, mais trottinant à l’aise entre les fauteuils et les marches du salon où la scène se passe (on dirait un lounge d’aéroport) assez bien rendu : il a plus l’air d’un personnage de Kosta Gavras dans l’Aveu ou Z que du grand Inquisiteur, mais la mise en scène et les costumes qui font une discrète allusion à l’Espagne franquiste rendent ce profil cohérent. Il a du mal avec le français, avec le placement de la voix trop claire pour la partie et ne se distinguant pas suffisamment de celle de Philippe II. Il est simplement hors de propos.
Ildar Abdrazakov est aujourd’hui la basse de référence dans le chant verdien. Dans la force de l’âge, la voix n’a aucun problème, et le personnage double d’un Philippe Roi et Homme lui convient bien. Mais son Philippe, qui est très bien joué et conduit par le metteur en scène, reste extérieur dans le monologue Elle ne m’aime pas : il joue certes, mais n’incarne pas et c’est toujours là qu’on attend un Philippe II. En revanche il est parfaitement le personnage dans la scène avec Posa, théâtralement la plus réussie et exprime une intensité qui paradoxalement lui manque au quatrième acte.
Warlikowski veut un Philippe jeune et non vieillard, mais ce monologue exige une intériorité qu’Abdrazakov ne sait transmettre et qui laisse un peu sur sa faim. On est très loin d’un Furlanetto ou évidemment, d’un Ghiaurov totalement insurpassable dans ce rôle.
 Jonas Kaufmann était très attendu, le ténor sur le nom duquel se remplissent les salles est guetté désormais à chacune de ses apparitions notamment depuis qu’il a repris son activité la saison dernière. Et les aficionados qui aiment les corridas semblent attendre la mise à mort. On l’a sûrement entendu plus à l’aise vocalement dans des prestations antérieures, à Munich par exemple avec Harteros. Mais qu’importe : cet artiste est d’abord une intelligence, une finesse, une humanité, une générosité. Il incarne Carlos et le Carlos ébranlé voulu par la mise en scène. Bien sûr il savonne le si du 3ème acte où Pavarotti lui-même (exemple illustre s’il en est) à la Scala en 1992 s’était autrement écrabouillé. Mais pour une note approximative, que de belles qualités de phrasé, de diction, d’expression. Qui peut chanter mezza voce comme lui ? Le dernier acte et le duo avec Elisabeth est tout simplement un morceau d‘anthologie. Alors on pourra gloser pour savoir s’il est meilleur dans le répertoire allemand ou dans le répertoire italien ou français : ce n’est justement que de la glose. En expressivité, en présence scénique, il est au sommet. Et surpasse d’autres chanteurs peut-être plus en voix. Et qu’on nous épargne les remarques sur sa voix de baryton. Il a une voix de couleur sombre, mais une vraie voix de ténor : son dernier Chénier sublime l’a montré. On ne nous rendra ni Domingo ni Carreras ni même Alagna dans ce rôle, alors tenons-nous bien au chaud Kaufmann.
Jonas Kaufmann était très attendu, le ténor sur le nom duquel se remplissent les salles est guetté désormais à chacune de ses apparitions notamment depuis qu’il a repris son activité la saison dernière. Et les aficionados qui aiment les corridas semblent attendre la mise à mort. On l’a sûrement entendu plus à l’aise vocalement dans des prestations antérieures, à Munich par exemple avec Harteros. Mais qu’importe : cet artiste est d’abord une intelligence, une finesse, une humanité, une générosité. Il incarne Carlos et le Carlos ébranlé voulu par la mise en scène. Bien sûr il savonne le si du 3ème acte où Pavarotti lui-même (exemple illustre s’il en est) à la Scala en 1992 s’était autrement écrabouillé. Mais pour une note approximative, que de belles qualités de phrasé, de diction, d’expression. Qui peut chanter mezza voce comme lui ? Le dernier acte et le duo avec Elisabeth est tout simplement un morceau d‘anthologie. Alors on pourra gloser pour savoir s’il est meilleur dans le répertoire allemand ou dans le répertoire italien ou français : ce n’est justement que de la glose. En expressivité, en présence scénique, il est au sommet. Et surpasse d’autres chanteurs peut-être plus en voix. Et qu’on nous épargne les remarques sur sa voix de baryton. Il a une voix de couleur sombre, mais une vraie voix de ténor : son dernier Chénier sublime l’a montré. On ne nous rendra ni Domingo ni Carreras ni même Alagna dans ce rôle, alors tenons-nous bien au chaud Kaufmann.
Sonya Yoncheva abordait pour la première fois Elisabeth, et une tessiture de « gra

nd lyrique » (lirico spinto) : le dernier acte à lui seul avec son air si long et si tendu Toi qui sus le néant des grandeurs de ce monde mit à l’épreuve bien d’autres sopranos glorieux (Daniela Dessi dans la version italienne Tu che le vanità). Il faut admirer d’abord la science consommée de la projection, de l’appui sur le souffle, la technique, la maîtrise du volume, même s’il faudra sans doute encore travailler plus vigoureusement l’émotion, mais sans conteste elle se place d’emblée au niveau des plus grandes aujourd’hui. Elle a cette sûreté dans toute la tessiture qui frise quelquefois la perfection. Un peu plus fatiguée au dernier acte, elle laisse échapper quelques aigus un peu criés ou métalliques. Mais là encore, l’arbre cache la forêt riche, feuillue, séduisante avec des moments éblouissants (premier acte). Et puis elle assume son personnage à la fois distant et intérieurement frémissant, même s’il frémira sans doute un peu plus en mûrissant dans le futur, à l’égal d’une Freni, d’une Margaret Price ou d’une Tebaldi. Elle remporte un immense succès mérité qui va sans doute constituer un tournant dans une carrière déjà riche.
Mais c’est sans doute du côté du baryton et du mezzo qu’il faut chercher cette fois l’approbation et l’enthousiasme sans l’ombre d’une faille.
Ludovic Tézier a l’avantage de chanter dans sa langue, avec un phrasé impeccable, une diction d’une clarté cristalline, et surtout une expressivité bouleversante. La voix est claire, le volume parfaitement maîtrisé, la moindre inflexion contrôlée. Le duo initial avec Carlos, la prodigieuse scène avec Philippe II, climax de la mise en scène de Warlikowski, où le chant se fait authentique dialogue et évidemment la scène de la prison sont autant de sommets où il montre à la fois de la retenue et une immense humanité. Je ne cesse de le répéter, par le timbre, par le phrasé, par l’expression, par une présence théâtrale qu’il sait rendre intense, par le volume aussi, il ne cesse d’évoquer à mes oreilles le grand Cappuccilli, que j’entendis jadis si souvent dont il a ce brillant et ce relief qui manquent à tant de ses collègues pourtant valeureux. On l’attend dans Boccanegra dans une très grande production ((Il l'a fait à Montecarlo et en concert au TCE))! Dans Posa, il a cette distance aristocratique, ce maintien, même dans la scène de la prison qui le rend d’autant plus bouleversant comme si sa bonne éducation l’empêchait de se laisser totalement aller. Quelle émotion il sait dispenser par un art vocal complètement dominé !

Reste, pour compléter ce tableau unique dans les annales récentes de l’Opéra de Paris, l’Eboli d’Elina Garanča. C’est elle qui remporte la palme à l’applaudimètre et c’est ô combien justifié. Eboli ne doit pas seulement se lire à l’aune de Ô Don fatal et détesté qui est le morceau de bravoure évidemment de référence, mais plutôt à l’aune de l’air du voile (la Sarrasine), qui demande une voix rompue à la gymnastique belcantiste, avec ses trilles, ses aigus, ses agilités, sa souplesse, certaines Eboli sont choisies pour leur aptitude à remplir la salle de leur volume dans le Don fatal, or le premier air dit beaucoup du personnage, un peu léger, un peu courtisan, et surtout dit beaucoup sur la volonté de Verdi de lui donner une couleur qui en 1867 n’est déjà plus de mode. Cette technique qui vient directement du bel canto n’est pas donnée à toutes : or Garanča a affronté et Mozart (qui se souvient encore qu’elle était Dorabella dans le Così de Chéreau à Aix) et le bel canto (elle fut une grande Seymour d’Anna Bolena à Vienne) qui ont donné à la voix l’élasticité nécessaire. Son air du voile déjoue tous les pièges, avec de vrais trilles, avec une notable agilité et une grande facilité à l’aigu sans graves détimbrés. A cela s’ajoute une aisance scénique et une véritable adhésion au personnage voulu par Warlikowski, sportive, à l’aise, démonstrative, à l'opposé d’une Reine distante derrière ses lunettes. Alors évidemment, elle se joue du Don fatal, avec des aigus triomphants et une largeur vocale qui emplit sans effort le difficile vaisseau bastillais. Et c’est le délire.
Certains lui ont reproché une diction problématique en français. Admettons que parmi les protagonistes de ce Don Carlos, elle n’est peut-être pas celle qui maîtrise le mieux le phrasé français, mais à ce niveau d’exécution, à ce niveau de perfection vocale, peut-on faire la fine bouche ? Qui depuis Verrett ou Obraztsova a su créer en salle cette intensité ? Enfin on tient une Eboli authentique et surtout un vrai personnage : elle est déchirante dans le Don fatal et dans toutes les scènes qui précèdent, mais elle est aussi émouvante au troisième acte quand elle découvre son infortune (une infortune toute relative car elle occupe quand même le lit du roi…), tout en montrant une grande légèreté au 2ème acte ; elle sait affirmer une présence et une justesse dans toutes les facettes d’un personnage qui ne sait maîtriser ses passions.
Rien que pour Garanča, ce Don Carlos vaut le voyage.
Et comme dans toute distribution parfaitement calibrée, les rôles de complément sont tenus sans reproches, les députés flamands sont magnifiques de grandeur sombre, Julien Dran dans Lerme tient bien son rang, le Thibault de Eve-Maud Hubeaux lui aussi est un personnage qui tient la scène vocalement (on peut supposer qu’elle a dû intensément écouter Garanča, elle qui sera Eboli à Lyon) et le Moine de Krzysztof Bączyk a un beau timbre de basse, à peine un peu clair pour le rôle, mais il est très jeune.
Il reste à se demander quel sera le destin d’une production qui à ce qu’on dit prochainement servira pour le Don Carlo italien, un moyen de faire quelques économies et d’éviter une nouvelle production de Don Carlo. Vienne a une production pour Don Carlo (Daniele Abbado) et pour Don Carlos (Peter Konwitschny) et c’est une bonne solution. Je soutiens donc que Paris devrait tenir ce Don Carlos à son répertoire comme signature identitaire et le reprendre régulièrement quitte à garder le Don Carlo de Graham Vick pour les reprises italiennes. Il serait stupide que cette production tant attendue du chef d’œuvre original de Verdi, même discutable, ne vive que le temps des feuilles d’automne.
à revoir ici : https://www.arte.tv/fr/videos/074587–001‑A/don-carlos-a-l-opera-de-paris/

Très belle critique, hormis pour l'orchestre et le chef… j'ai assisté à ce Don Carlos 3 fois et j'ai bien apprécié l'orchestre et la direction de Philippe Jordan, qui accompagnent parfaitement les chanteurs, bien qu'en effet les nuances de l'orchestre couvrent parfois un peu les voix solistes
je suis d'accord avec la critique du chef, j'ai trouvé sa direction insipide. Pour ce qui est de la mise en scène, tout est parfaitement analysé et juste, j'ai fini également par m'ennuyer quelque peu.
Pour Jordan la meilleure nouvelle de l année est son départ pour Vienne . The right man at the right place.
Yoncheva m' a semblé surtout au premier acte plus proche des pêcheurs de perle que du monde verdien. Surtout elle ne fait jamais un couple avec Kaufmann, il lui manque toute allure, elle n'a rien de royale. La voix est superbe, mais elle est trop bourgeoise. Ce qui par absurde permet à Kaufmann de faire de son personnage un drame de la solitude comme vous le dites à la Werther.
Harteros et Kaufmann brûlaient les planches à Munich .
Garanca vous avez tout dit et on peut seulement rêver d elle et Harteros ensemble. A votre avis ont elles déjà chanté ensemble ?
Yoncheva interprète n'est pas encore parfaite, mais elle a un chemin devant elle.
Oui Harteros brûle les planches parce qu'elle est brûlante ce que Yoncheva n'est pas ;
Pour Garanca et Harteros, je ne crois pas, Garanca c'est avec Netrebko qu'elle a chanté.
Bien à vous
GC
Cher Guy j ai trouvé !
Elles ont chanté ensemble dans le plus bel opéra de Verdi, le requiem dirigé par Barenboim .
Condivido quasi tutto quello che è stato scritto in questo commento. La regia in effetti tende a trasformare l'opera in un dramma borghese o meglio nel dramma dei conflitti di potere e degli amori impossibili come si potrebbero vivere nei nostri tempi. In questo senso la mancanza di regalità della Yoncheva ci può stare benissimo. Ho pensato che si potrebbe ulteriormente attualizzare pensando a Filippo II che diventa l'attuale Filippo VI alle prese con le istanze indipendentiste catalane, e Carlo come Carles Puidgemont che guida la delegazione secessionista catalana al posto dei delegati della Fiandra. Rajoy , conservatore e cattolico, potrebbe essere il moderno inquisitore.
Di tutte le idee registiche, ho apprezzato in particolare la scena della canzone del velo, spogliata di tutti i vezzi e le mossette spagnoleggianti che ho sempre trovato insopportabili, scena dominata dalla magistrale interpretazione della Garanca, perfetta nel ruolo di spadaccina, aitante sportiva e non leziosa cortigiana.
Alla lunga è vero che le idee del regista si impoveriscono e non reggono la durata dell'opera, resta un impatto visivo povero, ripetitivo, stancante e pure deprimente. Ad ogni modo, anche nelle pecche della messa in scena, la bravura e la perfezione nei loro ruoli dei protagonisti, ha reso questa edizione di Don Carlos indimenticabile !
Tres interessant.….je suis en train de regarder ce DON CARLOS sur YouTube (malheureusement, je n'ai pas pu aller a Paris!) Mais je dois indiquer une erreur. .…..c'est Schiller, et non pas Verdi, qui fait de Posa le heros!! Il faudrait lire les BRIEFE UEBER DON CARLOS (Lettres sur DON CARLOS), ou il explique comme il a vu le personnage de Posa, qu'il nomme DER HELD DIESES STUECKES (le heros de ce drame).
Vous avez tout à fait raison et votre observation m'a fait modifier ma remarque, où je pensais bien plus à Saint-Réal. Il reste que l'opéra, parce qu'il allège la dramaturgie de Schiller (notamment par la disparition du Duc d'Albe) donne sans doute au personnage son relief définitif. C'est pourquoi, et malgré les remarques de Schiller sur le héros de la pièce – en soi justifiées bien sûr- le relief de Posa me semble plus marquant chez Verdi que chez Schiller.
Je me demande si cet article pourrait vous interesser.…(c'est en Anglais!!)
https://www.academia.edu/1578705/Verdi_and_Schiller_Chapter_1_DON_CARLOS
Merci je vais le lire.
GC
Vous avez tout (très bien) dit. Quelques remarques subjectives.
Tout d'abord la mise en scène : les décors de M.Szczesniak sont beaux, ce qui a son importance ; les rapports entre les personnages sont très fouillés et "expliquent" l'histoire ; évidemment nous sommes loin du débordement d'idées originales des travaux précédents (Femme sans ombres, Affaire Makropoulos…) mais Warlikowski commençait à s'auto-plagier (cf.Die Gezeichneten à Munich); et puis, exploit sans précédent, on a enfin vu un Ludovic Tezier bouger et interpréter son personnage et plus seulement être une voix merveilleuse (en effet on attend son Boccanegra après sa remarquable prise de rôle en concert au TCE).
Les voix (et la direction): Abdrazakov est très bien sauf, faute irréparable,dans son air de la lettre, mais il n'est vraiment pas aidé par la direction d'orchestre de P. Jordan-pas sûr qu'on le regrette en effet-on attend toujours la chair de poule du solo de violoncelle précédent le chant ou l'émotion de la musique qui accompagne la voix, les deux liées dans la douleur du personnage nous chamboulant (au moins là ne la couvre t elle pas!). Je trouve que Yoncheva (elle crie régulièrement avec des aigus métalliques en effet) a un chant et un jeu qui ne fonctionnent pas avec ceux de Kaufmann (d'une justesse et d'une musicalité et d'une puissance parfaites) d'où des duo manquant d'émotion (on se moque bien qu'elle se suicide à la fin, notre coeur va tout à la souffrance de Carlos/Kaufmann). Kaufmann que j'ai entendu 2 reprèsentations, la première très bon et la seconde extraordinaire (s'appropriant le rôle de mieux en mieux) ce qui a tout changé ; quelle chance de pouvoir voir et écouter un tel chanteur (oui, je suis Kaufmannolâtre et Harterosolâtre!).
Merci donc à S.Lissner de nous permettre de voir d'aussi enthousiasmant spectacles à Paris.