
Si l’on analyse le succès de George Benjamin à l’opéra, on trouve plusieurs ingrédients dont le premier est indiscutablement la qualité des livrets de Martin Crimp, l’un des auteurs de théâtre les plus importants des dernières décennies, mondialement admiré. Car l’un des problèmes de la création contemporaine à l’opéra a souvent été la faiblesse des livrets et leur absence de ressort dramatique. Aussi bien dans Written on skin (peut-être plus original) que dans Lessons in Love and Violence, il y a un drame, une intrigue, des rapports vifs entre les personnages, pour faire bref il y a du théâtre.
Le deuxième ingrédient est la capacité de George Benjamin à écrire une musique accessible, destinée à être écoutée non plus par des happy few, mais par un large public, et surtout à écrire pour les voix. Bien sûr, il l’a souligné dans l’interview qu’il a accordée à Wanderer (voir ci-dessous), il compose pour des voix bien précises, avec qui il a pu travailler, dont il a pu tester l’étendue, et en retour, le chanteur se retrouve parfaitement à l’aise dans une écriture qui s’est construite à partir de ses propres possibilités. Ici, le rôle de Stéphane Degout (le Roi) a été écrit en fonction des caractères de cette voix, et cela s’entend.
Le problème peut se poser quand les chanteurs pour qui le rôle a été écrit ne peuvent pour des raisons d’agenda être présents. C’était le cas à Hambourg où Degout n’a pas chanté, remplacé par Evan Hughes. C’est le cas à Lyon pour Georgia Jarman, qui succède comme à Hambourg à Barbara Hannigan, interprète fétiche, rompue à la musique contemporaine pour qui le rôle d’Isabel a été conçu. On n’a pas à regretter ces absences ni ces changements, parce qu’ils sont la garantie (et la condition) de la pérennité de l’œuvre qui pourra s’appuyer sur des chanteurs différents qui l’auront apprise. Plus les chanteurs sont différents et changent et plus l’œuvre a la capacité de survivre dans n’importe quel théâtre. Cela signifie simplement qu’un théâtre qui voudrait monter cette œuvre a désormais deux Isabel ou deux Rois à disposition.
Dernier ingrédient, la présence de Katie Mitchell pour la mise en scène, très liée à Martin Crimp et proche de son univers : l’équipe Benjamin-Crimp-Mitchell aura produit un spectacle qui sera vu, à l’instar de Written on skin, dans plusieurs pays, Grande Bretagne, Pays Bas, Allemagne, France, USA, Espagne. Mais si l’on se fonde sur Written on skin, d’autres théâtres ont monté désormais leur propre production, ce qui signifie que la carrière de l’œuvre est assurée.
C’est donc une opération réussie, au bénéfice de la création contemporaine, et le succès remporté à Lyon montre que Lessons in Love and Violence rencontrera le même succès et aura probablement le même destin.

L’intrigue de Lessons in Love and Violence est connue, elle raconte l’histoire de la fin d’Edouard II et de l’avènement d’Edouard III, dont les prétentions sur le trône de France (il est le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle) déclenchèrent la Guerre de Cent ans.
Rappelons brièvement les faits : Philippe le Bel envoie sa fille Isabelle épouser le roi d’Angleterre Edouard II. Celui-ci néglige la reine qui prend un amant, Mortimer, tandis que le roi Edouard II favorise un jeune chevalier originaire de Gascogne, Pierre de Gaveston d’une manière tellement outrancière que la rumeur leur attribue une relation homosexuelle, discutée par les historiens, mais installée par la tragédie de Christopher Marlowe The Troublesome Reign and Lamentable Death of Edward the Second, King of England, with the Tragical Fall of Proud Mortimer . Le livret de Martin Crimp reprend d’une manière particulièrement concentrée (1H25) l’histoire dans son ensemble, fin d’Edouard II et de Gaveston, régence d’Isabelle et de son amant Mortimer qui se termine par l’avènement d’Edouard III, qui enlève le pouvoir au couple Isabelle-Mortimer qui le menaçait en condamnant Mortimer à mort.
Dans la pièce de Martin Crimp, Edouard II est nommé « le roi », mais les autres personnages gardent leur nom historique, sauf le fils du Roi appelé « le jeune garçon » ou « le jeune roi »..
Il s’agit d’une sorte de Huis clos infernal où dans le même espace, la tragédie se consume, en un enchainement de violence où tous ou presque disparaissent, sous les yeux d’un chœur muet, la fille du Roi, rôle muet, et du fils, qui ne prendra la parole qu’à la fin, pour prendre le pouvoir.

Nous sommes dans l’univers tragique pur, où une crise explose après une longue maturation : comme dans la tragédie classique, on y trouve un espace unique, un temps réel ramassé, une action unique. Le décor pourrait presque convenir à une tragédie de palais comme Britannicus.
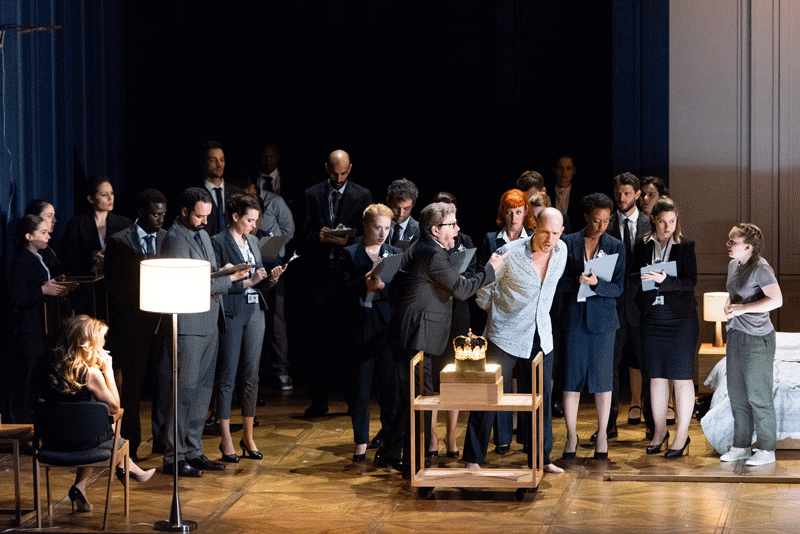
En fait je vois moins dans cette tragédie Shakespeare, malgré les allusions à Hamlet (les comédiens amenés par Isabel pour faire tomber Gaveston dans un piège) que Racine : Lessons of Love and Violence, c’est le titre générique de tout tragédie racinienne dont l’œuvre de Martin Crimp reprend la concentration et la profonde humanité des personnages, au-delà de tous les aspects moraux (en fait, pas un rachète l’autre, mais c’est souvent le cas chez Racine…)
C’est la volonté de Katie Mitchell de toujours travailler dans un espace très réaliste, très défini, d’où les personnages ne peuvent échapper, un espace qui est à la fois intime (le lit, une chambre à coucher, comme dans son Pelléas et Mélisande à Aix) et sous les yeux de tous (les rois vivent sous le regard de tous), un espace riche qui se délite peu à peu, le bel ordonnancement des meubles fait place au désordre, et surtout un grand aquarium, vivant coloré et poissonneux au départ, est réduit à un univers pierreux complètement mort à la fin. L’aquarium est évidemment la métaphore de l’univers dans lequel évoluent les personnages, une vie dans un bocal, où chacun finit par étouffer puis mourir. Lessons in Love and Violence, c’est un drame dans un aquarium.

Katie Mitchell aime ces univers pesants et étouffants et travaille sur les méandres psychologiques des personnages, sur les émotions de l’intime, portant à son paroxysme les théories de Constantin Stanislawski, mais aussi montrant ce que peut-être aujourd’hui l’univers de la tragédie tel qu'il a été défini par Aristote. Ici pas de distanciation, pas même d’analyse politique : nous lisons la politique à travers les réactions des personnages, leur positionnement intime qui est au fond la seule donnée réelle. Même l’amour entre Gaveston et le Roi n’est ni central ni déterminant. Ce qui est en jeu, ce sont les désirs et le bon plaisir des personnages moins que leur posture.

Intéressant à ce titre la vision d’un Mortimer (Peter Hoare, exceptionnel) pas vraiment séduisant en haut fonctionnaire qui se cache derrière ses épaisses lunettes, apparatchik d’un Etat délabré, qui au départ semble être le seul qui se préoccupe du peuple, et faire reproche à Edouard de son égoïsme outrancier. Mais ce faisant, il sert évidemment ses propres intérêts politiques et son couple avec la reine…
Edouard est le Roi, et donc il suit son bon plaisir, caractéristique de l’absolutisme et de l’aristocrate. Ce bon plaisir s’appelle Gaveston, superbement interprété par le jeune Gyula Orendt, déjà remarqué dans d’autres productions, à Berlin notamment ((Il fut un remarquable Zurga dans Les Pêcheurs de perles, une production signée Wim Wenders)). C’est un baryton, dans une fraternité vocale avec le Roi certes, mais pas une fraternité de couleur, les deux voix sont très différentes, et face au très sensible Roi de Degout, il a un côté plus « mauvais garçon » et un peu plus provocateur. C’est pour moi peut-être le rôle le plus trouble et plus intéressant ; George Benjamin lui réserve d'ailleurs les parties les plus lyriques (quand il revient « enlever » à la vie le Roi Edouard) en une scène parmi les plus fortes de la soirée.
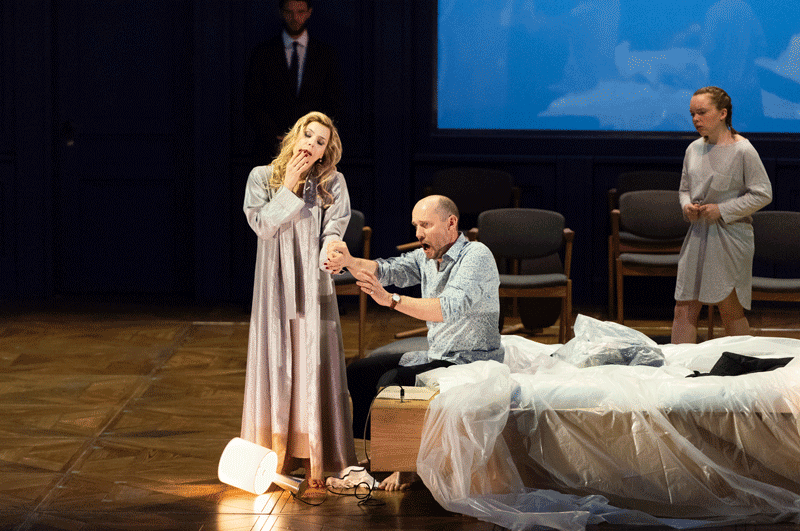
Au milieu de ces hommes, une femme, superbe, altière, distanciée, Isabel, la reine interprétée par Giorgia Jarman qui ne mime pas Barbara Hannigan, bien que la ressemblance physique soit marquée. Son port, sa démarche, son élégance, imposent une silhouette dès le départ, et même dans les moments de crise (sauf peut-être dans la scène où le roi apprend la mort de Gaveston), elle garde cet aspect aristocratique que son mari a un peu abdiqué (le déshabillage initial où il se retrouve en caleçon avec Gaveston).
Et puis, spectateurs de tout le drame, les deux enfants, la fille (rôle muet interprétée par l’actrice Ocean Barrington-Cook) et le fils ( Samuel Boden) qui ne quittent pas la scène et qui assistent à tout, méfaits, crimes, mouvements de tendresse.
L’œuvre est divisée en scènes, séparées par des intermèdes musicaux brefs, rideau baissé, un peu à la Wozzeck, sorte de stations qui progressent vers la catastrophe où personne ne se sauve, scandées par deux dispositifs visibles : un décor constitué de cloisons qui tournent, représentant à chaque fois un pan différent du mur d’un même espace, que le spectateur repère par le déplacement de l’aquarium, d’abord au fond, puis à cour, puis invisible parce qu’à la place du public, puis à jardin.
Ces espaces délimitent aussi un espace-temps, étendu (plusieurs mois séparent chaque scène) et en même temps si terriblement concentré que c’est véritablement la concentration de la crise qu’on lit, ces mois qui passent si vite, c’est l’ultime journée de crise de la tragédie. Et d’ailleurs on savait au XVIIe s’arranger avec le ciel pour respecter les trois unités et notamment l’unité de temps (voir Le Cid). Et même si l’espace bouge, il est lui aussi toujours le même, parce que l’univers mental des personnages ne bouge pas.
Katie Mitchell a su parfaitement montrer cette vérité toute racinienne des personnages prêts à tout pour sauver leur peau, leurs désirs, leur destin, exclusivement tournés vers eux-mêmes en dépit des apparences. Et la violence des scènes, qui est tout sauf démonstrative (ou à peine), porte d’autant plus qu’elle est essentiellement portée sur la parole, à laquelle George Benjamin donne une énorme importance. Il y a peu de chant pur (peut-être Gaveston ou « l’étranger » quand il vient prendre la vie d’Edouard, faisant ainsi de Gaveston la personnification de la mort, Eros et Thanatos à la fois), comme une sorte de chant du cygne. Tout le reste est essentiellement dialogue ou conversation, que la musique éclaire, par ses variations extrêmes de couleurs, jouant sur une palette instrumentale d’une largeur inédite, utilisant des instruments d’autres continents ou horizons. La musique de Benjamin traduit tous les méandres et les non-dits de la conversation : il y a là quelque chose de très classiquement wagnérien, qui fonctionne merveilleusement et qui fait de ce livret une pièce en musique. Ainsi le jeune Roi de chœur muet s’affirme par une parole immédiatement performative il est le Roi qui parle et qui fait que ses paroles sont actes. Il s’oppose terme à terme à son père, dont la parole n’avait plus d’effet quand Gaveston est enlevé, et qui est évidemment le début de sa fin. « I order the arrest of Mortimer » (no one moves) I command you to listen to your king » (no one moves) etc…Un roi qui exige d’être écouté n’est plus roi.
Le jeune roi d’ailleurs s’affirme être un vrai politique : Mortimer meurt parce qu’il a assassiné le roi son père, le régicide qui a nié la personne royale doit disparaître.

La mise en scène de Katie Mitchell impose cette atmosphère étouffante, implosive, qui rend l’œuvre si tendue, dès le début ; elle gère au mieux les rapports des personnages entre eux, dose parfaitement les moments de retenue et les explosions de violence rentrée. Mais son travail reste assez « conforme » à l’attendu et ne représente pas une nouveauté ni une avancée par rapport à ce qu’on sait d’elle, ce décor, on l’a vu ailleurs, ce lit qui est lit, qui est « ring », qui est lieu du crime, on l’a vu aussi ailleurs (dans Alcina ou dans Pelléas)…c’est la même performance dans le même type de décor de Vicki Mortimer. Cela fonctionne, mais c’est peut-être plus dû à la musique de Benjamin et au texte de Crimp qu’à la mise en scène proprement dite qui finit par faire système. Indiscutablement, le travail théâtral est précis, juste, mais pas neuf.
On est plus séduit par les aspects musicaux, et d’abord par la direction très limpide du jeune chef Alexandre Bloch, qui succède à George Benjamin (Londres et Amsterdam) et à Kent Nagano (Hambourg), une direction précise, qui sait rendre les couleurs diverses de la partition, également grâce à un orchestre de l’opéra particulièrement concerné. Sans jamais prendre le pas sur le plateau, soutenant les chanteurs, il s’affirme d’emblée comme un chef qui devrait compter dans le paysage lyrique, lui qui souligne être « nouveau dans le business », parce qu’il est très attentif au texte, à la prosodie, et qu’il fait de l’orchestre un accompagnateur, au sens pianistique du terme, faisant de l’œuvre un grand Lied désespéré. C’est particulièrement vrai quand il accompagne Gyula Orendt dans la scène où le roi est emporté par la mort. Un vrai travail de ciselure, intelligent et sensible.
Giorgia Jarman en Isabel montre une ligne de chant impeccable, une élégance et un contrôle de tous les instants, avec une maîtrise du registre aigu impressionnante. Moins acérée qu’une Barbara Hannigan, mais glaciale à souhait, elle est douée elle aussi, dans un style différent, d’une notable présence scénique.
Peter Hoare est Mortimer. Il est surprenant dans un rôle qu’on verrait plus personnifié par un physique de séducteur : il apparaît volontairement plus pâle, moins brillant. C’est un remarquable ténor de caractère qui sait habiller un rôle. Ici il exhale à la fois la fausseté, une certaine médiocrité, et endosse les habits du haut fonctionnaire ou du ministre, de l’apparatchik (sauf dans l’intimité avec Isabel), la voix est solide, et sonne parfaitement dans l’espace de l’opéra, avec une notable expressivité.
Stéphane Degout domine le rôle du roi de bout en bout, il arrive par le simple jeu expressif, de faire comprendre dès le départ, malgré son ton affirmé, tout l’avenir du personnage : notamment dans ses « King, I am King, I am I am » initiaux, il y a là une sorte d’énergie creuse qu’il sait parfaitement rendre. La voix n’a aucun problème sur l’étendue du registre avec des aigus puissants et tenus, et en même temps une volonté de colorer le texte qui montre combien il illustre ce « grand Lied » dont il était question plus haut. Degout est un chanteur tout en nuances, qui en chantant n’est jamais démonstratif, mais toujours intérieur (voir son Rodrigue de Don Carlos l’an dernier), il a lui-aussi une science du mot, une capacité à donner du poids à chaque parole qui font de son Edouard ce personnage ambigu, détestable et en même temps terriblement humain et fragile, d’une très grande justesse, voire d’une tendresse qui n’est pas sans rappeler son magnifique Pelléas à Aix.
Face à lui, le Gaveston de Gyula Orendt n’est pas en reste. Même si les personnages sont vêtus comme deux jumeaux, en vrai couple d’opéra, ils ne sont pas « identiques » et le timbre est très différent, moins d’harmoniques, un peu plus mat, mais en même temps avec quelque chose d’envoûtant et de séduisant. Il n’y a pas de faiblesse perceptible dans cette manière de dire le texte, il y a même quelque chose d’effronté, et c’est dans ce caractère même que la voix séduit, belle et tendre à la fois. C’est une performance très prenante que celle de ce jeune chanteur en troupe à la Staatsoper de Berlin, qui a peut-être les moments les plus lyriques à dire dans ce personnage qui n’est pas si loin d’un univers à la Genet. Il réussit à donner au personnage qui serait détestable une profondeur aimable, séduisante comme la beauté d’un diable tendre. A suivre…
L’ensemble de la distribution réuni n’est pas en reste, où chacun est à sa place, la fille du roi (Ocean Barrington-Cook) muette mais aux gestes à la fois spontanés et tendres, qui apparaît fragile, à l’ombre de son grand frère, avec son jeu très frais. Quant au frère (Samuel Boden), à la voix de ténor mal déterminée, entre ténor et contre-ténor, comme celle d’un adolescent en mue et qui frappe par contraste avec celle des deux barytons affirmés Degout et Orendt, mais aussi face à celle de Hoare, une voix de ténor « adulte ». Une diction impeccable, une limpidité de timbre, une belle projection, ce jeune ténor est déjà impressionnant de maîtrise technique. Parfaitement en place aussi Andri Björn Robertsson (témoin 3, fou) et Hannah Sawle (témoin 1, chanteuse 1, femme 1) et Katherine Aitken (témoin 2, chanteuse 2 , femme 2). Un plateau qui ne mérite que des éloges.
On doit louer l’Opéra de Lyon d’avoir saisi au bond cette coproduction, aux côtés d’autres grands théâtres internationaux tout en donnant à cette reprise (c’est la quatrième série de représentations) une personnalité spécifique par le choix d’un jeune chef peu connu, mais doué, qui a su donner cohérence à l’ensemble, avec une rigueur notable et en même temps une assurance et une autorité qui laissent bien augurer de la suite de sa carrière.
L’œuvre de George Benjamin, tout comme le livret de Martin Crimp montre que la leçon d’amour et de violence de toute tragédie n’abdique jamais, ni l’humain, ni la tendresse, et que ces Lessons in Love and Violence ne traduisent que des Lessons in humanity.
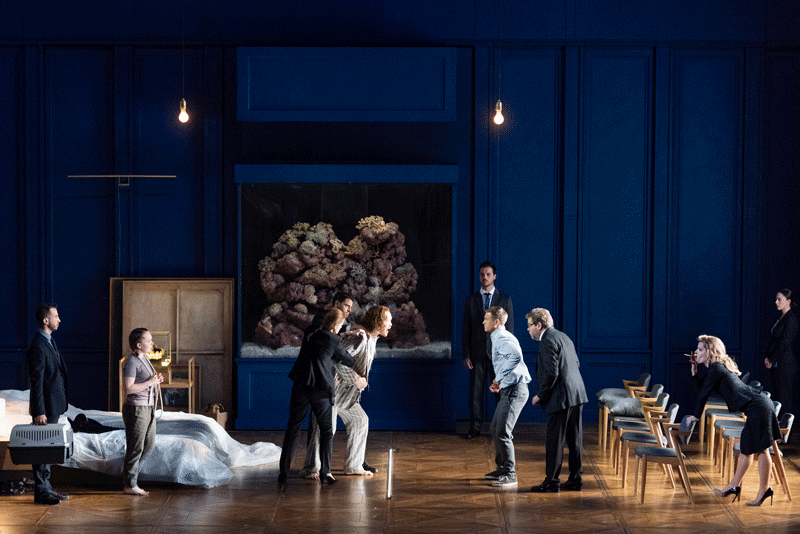

Tout est magnifique, la partition de G Benjamin, bien sûr, mais aussi l'interprétation, l’incarnation des personnages par tous les chanteurs engagés vocalement et scéniquement, et une mise en scène tirée au cordeau comme sait le faire si souvent Katie Mitchell.…
Beau et émouvant…
Et impossible de voir une telle production à Paris.…! Cela changerait des éternelles Tosca et Traviatta.
Merci encore une fois à l’Opera de Lyon pour ses choix.