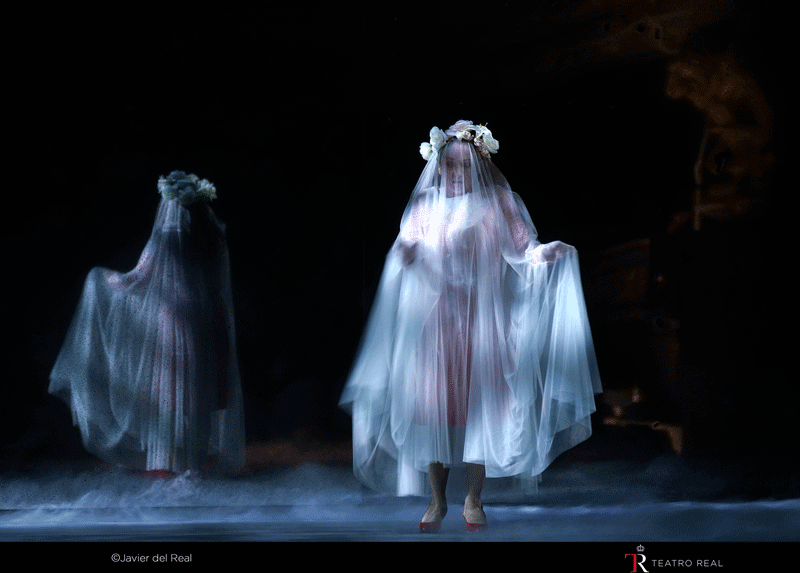En cherchant toujours le drame dans la comédie et en veillant à ce que le burlesque n’occulte jamais l’émotion, Laurent Pelly parvient depuis toujours à équilibrer ses nombreuses mises en scène entre rire et nostalgie, comique et mélancolie. A son palmarès des Offenbach à l’humour ravageur (La Belle Hélène, La Grande Duchesse de Gérolstein conçues pour l’inoubliable Felicity Lott), un Rameau qui a fait date (Platée) et une Fille du régiment anthologique, que tous les grands théâtres s’arrachent depuis sa création en 2007. Si le metteur en scène français a toujours eu à cœur d’alterner les répertoires et les sujets, traitant avec une certaine habileté Les Contes d’Hoffmann et La Traviata, celui-ci manie plus aisément l’humour et la fantaisie, sa lecture de L’elisir d’amore étant supérieure à sa vision d’I Puritani… Il n’est pas étonnant que pour sa seconde incursion verdienne après La Traviata celui-ci se soit intéressé à Falstaff, comédie pleine de sensibilité où la farce shakespearienne est d’autant plus émouvante dès lors qu’elle s’éloigne de la caricature et se teinte d’une douce mélancolie.

Homme d’images, adepte de décors extravagants où il aime raconter des histoires – les bottes de foins érigées en pyramide de L’elisir d’amore, les toits de Paris de La Traviata, les armoires de Gianni Schicchi ou encore le magnifique théâtre abandonné transformé an parking de Viva la Mamma – Pelly s’est entouré cette fois de la scénographe Barbara de Limburg. Pour répondre aux besoins de l’intrigue cette dernière a imaginé un café tantôt réduit, tantôt déployé sur toute la largeur du plateau, un intérieur tout en étages et en escaliers et une clairière stylisée, qui permettent de relier les scènes entre elle avec la plus grande fluidité, sans aucun temps mort.

Clochard bienheureux porté sur la bouteille, ce Falstaff énorme et crasseux, hâbleur et sans gêne à l’image de Boudu sauvé des eaux, est à la fois ridicule et touchant. Personnalité à part, il détonne dans cette communauté où tout le monde se connaît, s’épie et se méfie de l’un et de l’autre. Dès lors que cet original se permet de séduire deux « respectables » commères, celui-ci va être prestement remis à sa place, comme pour lui rappeler que l’on veut bien se distraire en sa compagnie à condition qu’une fois l’épisode terminé, il reprenne rapidement sa place. Rythmé par d’incessants déplacements où chaque personnage trouve sa place comme dans un étrange ballet, ce Falstaff fait rire, sourire et au final réfléchir sur la condition humaine et la vie en société.
Roberto de Candia en alternance avec le jeune baryton géorgien Misha Kiria, connaît son Falstaff sur le bout des doigts et se prête de bonne grâce aux indications scéniques demandées par Laurent Pelly. La voix est toujours vigoureuse et le verbe déclamé avec ce qu’il faut d’emphase, mais le ton général n’est pourtant pas exempt d’une certaine monochromie et l’on s’étonne que pareil interprète ne cherche pas à créer davantage de nuances avec un rôle aussi bien écrit. Ses acolytes, Pistola et Bardolfo alias Valeriano Lanchas et Mikeldi Atxalandabaso sont au contraire très expressifs, tout comme le Dr Caius survolté de Christophe Mortagne, le Ford dessiné avec force détails et beaucoup de saveur par Simone Piazzola et le charmant Fenton du ténor Joel Prieto.
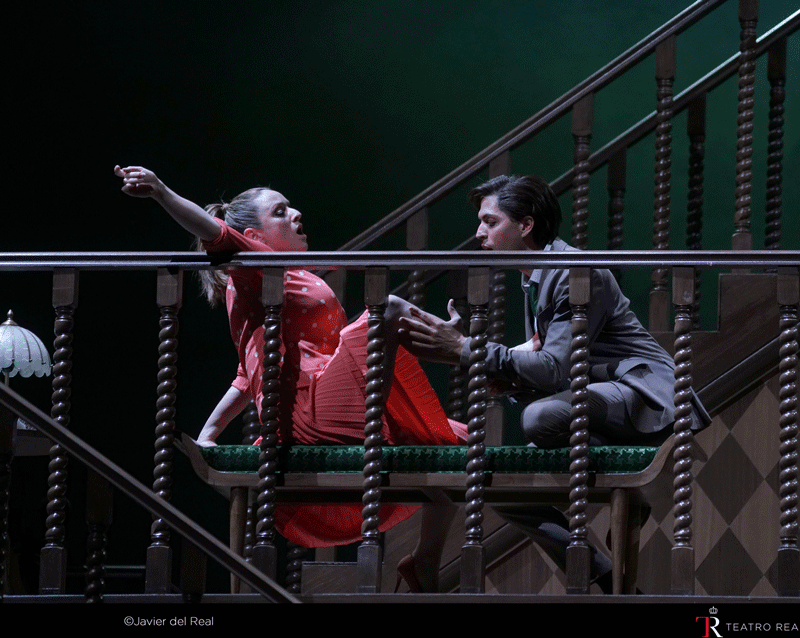
Hier gracieuse Nanetta (notamment au Châtelet sous la direction de John-Eliot Gardiner), Rebecca Evans est aujourd’hui une Alice pleine d’allure, maitresse-femme qui se plait à prendre l’initiative et à diriger ses comparses : sa fille Nanetta en premier lieu, joliment campée par Ruth Iniesta, mais également ses voisines Meg, excellente Maité Beaumont et Quickly, Daniela Barcellona dont les moyens vocaux sont insuffisants pour s’accorder dignement à la tessiture du personnage.
Le Chœur et l’Orchestre du Teatro Real font honneur à leur réputation en répondant aux attentes du maestro Rustioni qui propose une direction acérée de la partition, avec une attention particulière à la tenue des ensembles et aux différents clins d’œil espiègles dont l’œuvre est parsemée.