
Encore un Dostoievski pour Frank Castorf
On sait la passion de Frank Castorf pour Dostoïevski dont il a mis en scène au théâtre un certain nombre de textes dont Les Possédés, Les frères Karamazov, l’Idiot. Avec De la Maison des morts, c’est un autre pan de l’œuvre de Dostoïevski auquel Frank Castorf se frotte, qui ne semble pas forcément convenir à l’univers du metteur en scène : un univers aussi clos que celui de ce texte ne convient pas forcément à un artiste aussi épique que Castorf. Dès le prélude, un film muet inspiré du Joueur est montré dans le style d’Eisenstein, car Castorf et son décorateur Aleksandar Denić réussissent encore à faire de cet univers apparemment clos un atout, en construisant le travail sur deux piliers, d’une part le titre : De la maison des morts et d’autre par l’interrogation sur l’expression « maison des morts » elle-même : qu’est-ce qu’une maison des morts ? une maison de la mort et la forme du décor qui rappelle sur la façade de l’entrée d’Auschwitz nous introduit directement dans la question carcérale, souligné aussi par l’écran qui affiche le mot каторга (bagne), une maison de la mort aussi par l’affiche de cinéma renvoyant à Amityville, une maison du crime devenue maison de la mort, ou bien une maison macabre, et alors la sarabande des masques dansant une danse macabre prend tout son sens dans une mise en scène qui se conclut par une allusion à l’Enfer dantesque…
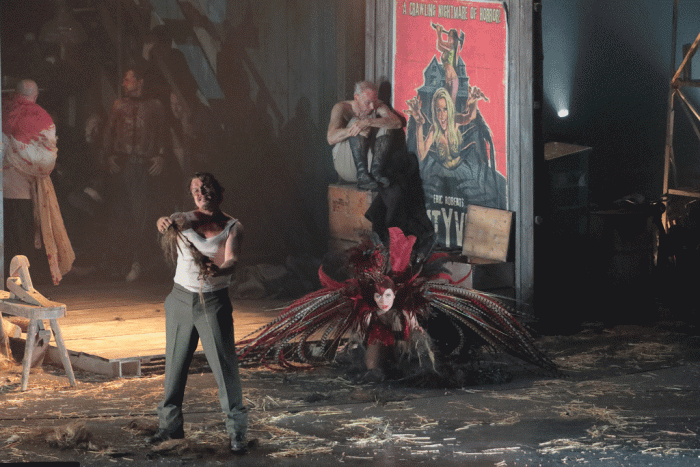
Un univers en abyme
En fait l’absence d’action dans l’œuvre et les interventions successives des uns et des autres, presque fragmentaires, servent le propos de Castorf qui ainsi peut mieux asseoir son univers d’allusions diverses et de références philosophiques (Nietzsche), littéraires (Schiller, Dante) et les références à son propre théâtre.
Il y a tous ces niveaux de lecture, on va ajouter une coupole orthodoxe, pour marquer la présence de l’église dans cet univers russe, ainsi que l’histoire que raconte Castorf sur lui-même, semant son travail d’objets désormais rituels, baril de pétrole qui brûle comme dans Götterdämmerung, cage à lapins qui rappelle la cage à dindons de Walküre, publicité pour Pepsi-Cola en cyrillique (Coca cola dans d’autres travaux, comme d’ailleurs Les frères Karamazov ou Judith), oiseau rutilant et géant qui renvoie évidemment à l’oiseau de Siegfried, avec le même genre de costume superbe dont Adriana Braga a le secret.
Un secret de famille, qui sème ses allusions dans une ambiance cependant légèrement différente, avec une présence de la vidéo (toujours les fidèles Jens Crull et Andreas Deinert), peut-être moins insistante que dans d’autres travaux, mais le propos est clair et particulièrement pessimiste : la maison des morts, c’est dedans, c’est dehors, c’est la clôture, mais c’est aussi le monde, d’aujourd’hui et d’hier, tout est maison des morts, le monde est la mort, jusqu'à ces projecteurs qui ressemblent à ceux des stades d'aujourd'hui qui éclairent le camp. D’où ces personnages qui semblent défiler en un cortège carnavalesque (et le carnaval c’est aussi la mort), dehors, d’où ces mêmes personnages derrière des grilles, derrière des fenêtres, serrés à s’en étouffer : personne n’échappe, et la mort est partout, dans un monde à la fois fantasmagorique et coloré, comme si tout se donnait en spectacle : d’où ces éclairages splendides (de Rainer Casper) , ces ciels orange et crépusculaires, ces nuages tourmentés et tourmentant, ces costumes variés aux couleurs quelquefois vives, tranchant avec d’autres, gris, ensanglantés.
Chants et danses de la mort traversent le monde, dans un ordonnancement presque ritualisé, comme si c’était la dernière danse avant l’apocalypse.
Étrangement, et en contraste avec bien d’autres mises en scène de cette œuvre, le spectacle n’est pas forcément oppressant, mais il est terriblement sarcastique. Dans une dramaturgie presque fragmentaire, dans un lieu où des histoires de misère se croise, aucun de ceux qui veulent parler ne le peuvent pleinement, il est impossible de se raconter (aussi bien Skuratov que Šiškov par exemple) ou d’aller au bout de son histoire. Tout est fragment, comme des éléments qui remontent de la mémoire, plus évocatoires que précis et il est refusé à ces humains leur humanité, même si Janáček à la veille de la mort se lance dans un opéra sur la désespérance. Ici l’art peut-il encore sauver le monde, comme le pense Schiller ?
Castorf ici travaille en temps limité, une heure trente sans entracte, lui qui programme toujours de très longs spectacles : tout est donc un concentré de monde, d’Auschwitz au Coca, et tout se superpose dans son habituelle approche "hyperthéâtrale" avec ses renvois multiples aux textes, au cinéma, à ses propres productions passées, comme si la même histoire du monde ne cessait de s'offrir à lui. Pour un artiste de l’ex DDR dont l’histoire est si profondément liée à l’histoire du stalinisme et de ses suites, la question de la каторга (la condamnation la plus forte après la mort dans la Russie tsariste) et de son héritier le Goulag est évidemment centrale dans sa lecture sans concession du monde d’alors et de celui d’aujourd’hui dans leur simultanéité. Au spectateur d’en tirer leçon.
De grands interprètes
Du point de vue musical, les choses se tissent tout aussi intimement. Le travail des chanteurs dans la mise en scène et leur implication sont exemplaires, ils s’intègrent tout particulièrement dans l’esprit voulu par Franck Castorf. Le choix de la distribution est aussi singulièrement adapté puisque la plupart des rôles principaux (si tant est que dans cette œuvre il y ait une trame ou un rôle dominant, et c’est aussi l’un des postulats de départ de Castorf de pas identifier de « rôle » principal et de faire de ces souvenirs dostoïevskiens comme des surgissements, des éléments qui apparaissent et disparaissent au milieu d’un spectacle unifié dont le propos n’est pas la trame mais le contexte.

Parmi tous les chanteurs, excellents au demeurant émerge sans conteste Charles Workman, dont les dernières prestations ne nous avaient pas tout à fait convaincues, et qui trouve en Skuratov un rôle scéniquement et vocalement à sa mesure, d’une rare intensité et avec une projection et un phrasé exemplaires. Workman a toujours été un modèle de contrôle et de style. Il trouve ici peut-être un répertoire nouveau, qui correspond peut-être mieux à sa vocalité actuelle, en tous cas il s’impose comme l’un des triomphateurs de la soirée.

Le Šiškov de Bo Skovhus confirme l’aisance de l’artiste à s’emparer d’un rôle et d’un contexte, à rendre cohérent sa prestation avec une ambiance et un univers, son timbre un peu mat convient parfaitement au profil voulu, au personnage de cet amoureux violent qui égorgea sa femme pour être restée amoureuse de Filka Morozov (Aleš Briscein, lui aussi notable) qui l’avait faussement accusée de s’être donnée à lui. Il retrouve Filka dans le personnage de Luka, qui meurt sous ses yeux et sur le cadavre duquel il va cracher .
Ces récits de meurtres ordinaires sont partagés par Skuratov, une sorte d’innocent moussorgskien qui traverse l’œuvre en racontant son histoire : il tua le riche fiancée de celle qu’il aimait. Au milieu de ces récits de meurtres et de misère ordinaire, émerge le personnage de Gorjančikov, le prisonnier politique qui chez Castorf est Dostoïevski lui-même, magnifiquement interprété par Peter Rose, dans un rôle inhabituel pour lui (c’est le baron Ochs des dix dernières années…), mais d’une composition humaine et émouvante, aux côtés du jeune Aljeja (ici interprété par un soprano quelquefois comme chez Chéreau, il est un ténor), à qui il va apprendre à lire, lui-même interprété par Evgueniya Sotnikova, vêtue en oiseau qui rappelle tellement le Siegfried du même Castorf, emblème de liberté, de poésie, d’altérité (Aljeja est un espace d’humanité dans ce monde de mort et de misère) qui croise le symbole de l’aigle qui traverse l’œuvre, trônant au sommet de l’édifice, comme symbole de pouvoir tsariste, mais aussi symbole de la liberté et de l’avenir radieux.
En faisant d’Aljeja un oiseau, Castorf personnifie cette image de futur possible pour le jeune Aljeja, qui a entre-temps appris à lire, le temps du séjour de Gorjančikov qui va, comme Dostoïevski, sortir du bagne (le seul de tous les personnages). C’est la flaque de poésie, dans cet univers où se mêlent fantasmes, fantômes, figures de carnaval, prostituées, des ombres portées de la misère universelle interprétées par l’excellente troupe de Munich, Manuel Günther, Johannes Kammler Tim Kuypers, Christian Rieger, Ulrich Reß, Galeano Salas (ténor mexicain qui récite un extrait de l’Evangile selon saint Luc , utilisé par Dostoïevski dans Les Possédés, au moment où la mise en scène évoque l’assassinat de Trotski…au Mexique)

ainsi que Peter Lobert, Matthew Grills, Kevin Conners, Dean Power, Alexander Milev ou du studio de l’Opéra de Munich comme Long Long, Niamh O’Sullivan, Boris Prýgl. L’architecture de l’œuvre et l’abondance de « petits » rôles qui sont autant de figures permet d’employer une bonne partie de la troupe masculine de Munich (l’œuvre est très pauvre en figures féminines, sinon une prostituée).
C’est une œuvre qui exige une très grande homogénéité et aussi bien la composition de la distribution que la mise en scène permet de ne voir émerger tel ou tel de manière fugace, laissant plutôt une impression d’ensemble auquel le chœur excellent préparé par Sören Eckhoff contribue largement en se fondant dans la foule des personnages.
Une direction précise, mais un peu linéaire
Comme souvent Simone Young montre qu’elle est un vrai chef d’opéra, (une vraie cheffe ?) attentive aux équilibres, à la mise en valeur des voix sans jamais les couvrir, elle a en main le Bayerisches Staatsorchester, qui affiche encore un vrai niveau d’excellence, par le relief des parties solistes et la précision et la netteté du son. C’est une lecture limpide et claire qui fait entendre la partition.
Il lui manque cependant ce qui faisait le prix d’autres chefs dans cette œuvre (à commencer par Boulez, mais on pense aussi à Rattle et Salonen), à savoir un sens des nuances, des sons plus raffinés et une recherche de la couleur. C’est une direction techniquement précise, mais relativement uniforme, trop linéaire, ce qui dans cette musique où la couleur joue un rôle si important est regrettable et ne reflète pas la variété des situations, des personnages. Si la scène est si colorée, par les ciels, par les images et leur diversité, la fosse reste un peu trop uniformément forte et brutale. L’art de Leoš Janáček est justement un art de la couleur et du miroitement orchestral, et ici cela ne miroite pas vraiment.
Il reste que ce spectacle, qui marquait l’entrée au répertoire de cet opéra de Leoš Janáček, restera marqué par la première mise en scène de Frank Castorf à Munich, à l’approche moins inattendue, même si toujours forte et même si demandant comme toujours de fortes lectures post-spectacle, ainsi que par une distribution de haute tenue qui a remporté un grand succès. Il y a désormais sur le marché européen trois grandes productions du chef d’œuvre de Janáček, Chéreau, devenue culte, qui a fait le tour des grandes scènes, Warlikowski, à Londres et bientôt à Lyon, et Castorf à Munich : on peut dire que De la maison des morts est plutôt bien servi.


Je sors extrêmement déçu de la représentation du 30 juillet.
Jamais une direction d orchestre et une mise en scène ont été autant aux antipodes l une de l autre.
La sécheresse de Young est exacerbé par le côté rococo décoratif de Casdorf, qui ne devient plus qu' une somptueuse boîte vide.
Aljeja chanté par un soprano m a toujours extrêmement gêné.
Il s agit à part la prostituée d un huis clos masculin.
Hier skovus avait une voix blanche seul Workmann à sauvé la soirée .
Vous appréciez énormément Casdorf. Pour moi c est un excellent metteur de théâtre mais sa surcharge constante d images crée pour moi un effet de suffocation avec la musique.
Il est évident qu'il est difficile de voir un aussi beau décor et des lumières aussi sublimes, mais un poète comme Kriegenburg laisse travailler votre imagination, Casdorf la muselle.
Ce soir Parsi.…..