
"Tout est plein de menace, hélas ! tout est plein d'ombre"
Louisa Siefert, Rayons perdus, Inquiétude (1869)
Kirill Petrenko investit sur son avenir proche : dans un peu plus d’un an il prendra les rênes des Berliner Philharmoniker et sans doute la première saison est-elle déjà bouclée. On le voit rôder des programmes en Israël, à Bregenz avec son ancien orchestre du Vorarlberg, l’an prochain à Rome et à Turin, avec Santa Cecilia et l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, deux orchestres qui lui sont assez familiers. La Septième symphonie de Mahler avait été au programme de l’Orchestre Symphonique du Vorarlberg cet automne, la voilà reprogrammée avec son orchestre actuel, le Bayerisches Staatsorchester, l’orchestre de fosse du Bayerische Staatsoper.
Inutile de revenir sur les qualités de Kirill Petrenko à la tête d’un orchestre : précision du geste, clarté du rendu, transparence des sons et surtout une partition fouillée jusqu’à l’impossible. Kirill Petrenko est non seulement un analyste pointilleux des partitions, mais encore un technicien hors pair, un mécanicien des sons qu’il obtient où triomphent l’ineffable et le presque rien. Avec Yuja Wang et les Berlinois, il a démontré une respiration technique unique dans le concerto pour piano de Prokofiev déchaînant des applaudissements spontanés d’un des publics les plus avertis du monde à la fin du premier mouvement, rompant le rite qui veut qu’on n’applaudisse pas entre les mouvements.
Une symphonie difficile à classer
Il en va autrement dans cette Septième, un monument en cinq mouvements, une des symphonies les plus impressionnantes et les plus cryptiques de Mahler, faite de tout et son contraire, de gravité, de tension, d’amertume et de grotesque, mais aussi d’espoir, de joie dans un paysage contrasté qui reste un point d’interrogation qui ouvre à des points de vue interprétatifs très différents. Par référence à son surnom « Chant de la nuit », parce qu’elle s’organise entre deux nocturnes (Nachtmusik I et Nachtmusik II) composés en premier, c’est effectivement à une nuit interprétative qu’il nous convie, commençant en mode mineur (si mineur)et finissant en mode majeur (ut majeur) presque triomphal.
Ce qui frappe dans ce concert, c’est une réception par le spectateur qui est d’abord physique : au bout de quelques minutes, le corps et le cœur se mettent à ressentir les effets de cette approche d’une incroyable prise sur le public, bouffées de chaleur, cœur au rythme accéléré, un effet physique rarissime qui place la réception musicale non pas au niveau intellectuel, ni émotionnel, mais simplement physique, j’oserais dire objectivement physique. Ce climat qui saisit le spectateur au niveau physique, c’est donc la première impression qui reste de ce moment exceptionnel, difficilement oubliable tant il fut singulier.
Celui qui écrit reste pour les interprétations de Gustav Mahler marqué sans doute pour longtemps sinon pour toujours par l’approche de Claudio Abbado, dont la Septième, aussi bien avec les Berlinois qu’avec le LFO((sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=QdxvC7NNSLQ)), reste un des moments clés d’une existence d’auditeur, construite autour de l’idée d’un Mahler souffrant, alternant moments de respiration indicible et résolument optimiste, et moments noirs où le monde est ressenti avec les yeux du sarcasme et du grotesque, mais dans une sorte d’équilibre où l’élégie garde sa place . Jean-Marc Navarro récemment dans un texte vibrant sur l’approche de Mariss Jansons, en concert un mois auparavant à la Elbphilharmonie de Hambourg, relevait néanmoins à propos du scherzo « Beaucoup d’huile dans cette mécanique qui peine en conséquence à pleinement traduire ce que ce mouvement a d’inquiet, d’étrange, de terrifiant, de berliozien. »
Une approche énergique et sans concession
Déterminant chez Petrenko, c'est une approche résolue, presque unidirectionnelle : il n’y a presque pas d’huile dans ce regard où se heurtent des masses telluriques, c’est une approche qui refuse la concession et qui refuserait presque à l’auditeur ces moments élégiaques qui chez Mahler deviennent des plages de paradis, ces « flaques d’éternité » chères à Rimbaud. Cette approche est d’abord une force qui va, dont le moteur est une énergie presque sans limites, communiquée à un orchestre avec lequel se lit d’abord une complicité affective indéniable, mais aussi le résultat d’un travail au millimètre qui permet des effets de congruence simplement technique à la fois spectaculaires et impensables, tellement ils stupéfient. C’est le cas du final du premier mouvement.

Premier mouvement : Allegro risoluto, ma non troppo
Un premier mouvement qui commence dans une inquiétude noire, pesante sans être lourde, car aucun instrument ne prend la main, même pas le cor ténor. Le rythme de marche est installé par les cordes, qu’on a assimilé à une marche funèbre. La tension s’installe très vite à son comble, bientôt avec un rythme qui rappelle la Sixième « tragique ». En effet, comme dans le premier mouvement de la Sixième le tempo est toujours soutenu, comme s’il s’agissait déjà et encore, de course à l’abîme. Petrenko ne donne aucune alternative, il ne s’agit pas de s’attarder sur ce qui serait joli ou qui reposerait l’âme, c’est l’agitation et l’inquiétude qui dominent, c’est une ligne qui s’impose, avec une limpidité inouïe, sans espace de repos ni de doute. Et ainsi les thématiques se heurtent sans se résoudre, déjà dans ce premier mouvement dont les contrastes annoncent les couleurs opposées des autres mouvements. On peut s’attarder sur l’extraordinaire prestation de l’orchestre dont on devine le travail acharné en répétition pour répondre aux demandes du chef en matière de nuances, d’allègement, et en même temps de clarté pour permettre d’entendre tous les instruments, (les harpes !!), mais aussi les moments d’indicible respiration qui durent quelques secondes avec d’incroyables tremolos de violons, pour retomber dans la noirceur qui illustrent cette tempête sous un crâne, ce voyage alternant ténèbres et lumière allant vers une lumière qui reste encore un point d’interrogation. Dissonances, ruptures d’harmonie, successions des tonalités en anacoluthe : tout montre une écriture singulièrement moderne que Petrenko exalte. Ainsi des moments d’apaisement qui ne sont que répits très momentanés, car ils contiennent eux-mêmes la tension qui accompagne tout le mouvement qui deviennent danse macabre (Petrenko est un maître des rythmes dansants). Les effets physiques évoqués plus haut s’expliquent par l’impossibilité du repos : Petrenko par son approche « sauvage » ne laisse aucun espace de liberté, il contraint l’auditeur à la concentration et à la tension, ensemble, comme cette course finale explosive à la limite du supportable qui clôt le mouvement.
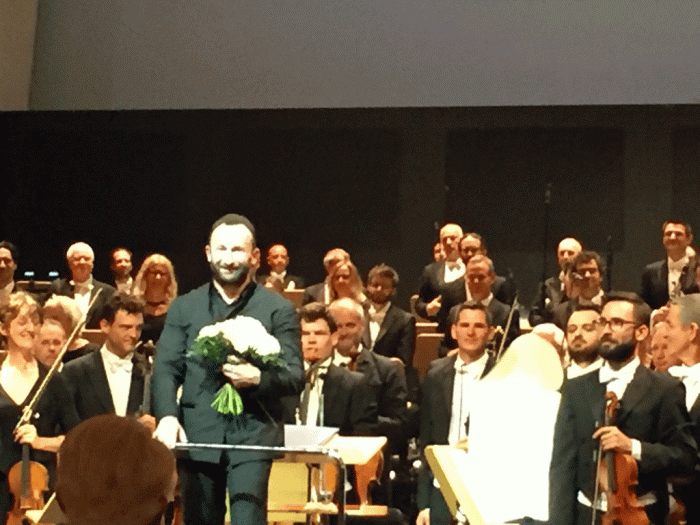
Nachtmusik : Allegro moderato
Le nom du deuxième mouvement Nachtmusik, vient de Mahler, au contraire du surnom « Chant de la Nuit ». Lointain souvenir de la Fantastique de Berlioz (Scène aux champs) que le dialogue initial des cors, l’apparente sérénité qui marque au départ cette première Nachtmusik, est soulignée par le rythme apparemment dansant imprimé par Petrenko. Mais bientôt il se tend, presque militaire, au point que Mengelberg aurait dit que cette musique avait été inspirée par la Ronde de Nuit de Rembrandt. Il y a une scansion relativement rapide de l’ensemble, avec des bois vraiment exceptionnels (le hautbois), et une science des volumes qui alternent, aux cuivres ici exceptionnels (les cors, avec au loin les cloches à vache) qui donnent à la fois un sentiment bucolique (les cloches) tout en maintenant cette inquiétude première (cuivres aux sons presque grinçants) qui va préparer le scherzo qui suit. Ce qui frappe c’est à la fois la cohérence sonore, la légèreté, face à l’inquiétude latente à la Rembrandt, une sorte de mélange des genres, de superposition d’ambiances et de couleurs vraiment stupéfiantes dans un faux laisser-aller du son.
Scherzo : schattenhaft
Le scherzo central est sans doute le moment le plus ambigu et le plus inquiétant du concert, qui commence par ces coups sourds à la timbale qui vont marquer la couleur de l’ensemble. La fluidité du tempo prolonge l’impression du mouvement précédent sans aucune concession : schattenhaft, dit la partition, plein d’ombre.
Un poème de la poétesse Louisa Siefert , Inquiétude, contient ce vers « Tout est plein de menace, hélas ! tout est plein d'ombre » ((Louisa Siefert, Rayons perdus, Inquiétude, Lemerre 1868)) qui évoque avec tant de précision l’ambiance de ce scherzo, une sorte de faux sourire menaçant et sarcastique, au rythme de valse inquiétante. Petrenko rythme cette valse-rictus avec les coups sourds de timbale, les contrebasses en sourdine, et un tourbillon glaçant, presque métallique : si c’est une ambiance nocturne, ce serait une nuit de longs couteaux, avec une absence totale de concession à ce qui serait joli et serein. « Questo scherzo non scherza » ((Cette blague ne plaisante pas, avec un jeu sur scherzo qui en italien signifie blague, plaisanterie)) diraient les italiens, avec ces coups d’archers effilés, presque une image de reflets nocturnes inquiétants. L’image d’une course à l’abîme, qui ne laisse pas une lueur s’échapper, trouve ici un point d’orgue. Abbado laissait l’espace à une insondable poésie, Jansons était peut-être trop lisse, mais ici, l’image de sons effilés comme des lames fait de ce moment l’un des plus pesants de la symphonie, sous un rythme qui n’est jamais heurté : fluidité « sous un ciel bas et lourd », rarement musique et poésie n’ont autant dialogué avec un orchestre (des cordes !) à son sommet. Le Bayerisches Staatsorchester qui à l’opéra a un parcours semé de noms comme Bruno Walter, Hans Knappertsbusch, Wolfgang Sawallisch, Carlos Kleiber et tant d’autres gloires va bientôt fêter ses cent ans sous ce nom, a été fondé en réalité en 1523, et son histoire est faite de gloires comme Ludwig Senfl son fondateur ou Roland de Lassus. C’est dire qu’il y a là une longue tradition, et que cette formation est l’orchestre historique de Munich. Kirill Petrenko désormais l’emmène en tournée depuis quelques années et sous sa baguette il a reconquis une place particulière dans les trois orchestres munichois (les autres sont les Münchner Philharmoniker de Gergiev et le BRSO de Mariss Jansons) et ce Mahler exécuté sans aucune scorie, en est l’éclatante preuve.
Nachtmusik : Andante amoroso
La seconde Nachtmusik avec ses cordes solistes, guitare, mandoline, harpe, devrait être un moment d’apaisement réel avec une couleur chambriste évidente, qui va faire contraste avec le mouvement final. Alma Mahler citait Eichendorff comme source d’inspiration probable. Mais derrière cette paix apparente et crépusculaire, il y a toujours cette nuit, qu’on sent dans les seconds plans, quand en premier plan émerge un relatif sourire ou du moins un suspens : les contrebasses en sourdine rappellent l’angoisse existentielle qui a régné, et la danse reste inquiétante, vaguement grinçante, comme une lutte entre deux univers opposés qui s’unissent dans l’âme mahlérienne et qui font tout le mystère et le prix de cette symphonie : Petrenko donne ici une leçon de profondeur de lecture, qui ne cède jamais rien à l’apparence, avec un raffinement expressif rare…on est même quelquefois au seuil de l'expressionnisme. Il y a dans cette Nachtmusik le côté amoroso, et le côté Aufschwung, les élans qui donnent du volume, en contraste avec les sons plus allégés, les bois, le violon esquissé, mais en arrière-plan on semble l’espérer sans y croire, et il se dégage alors une infinie mélancolie qui finit avec ce son final mourant de la clarinette : sublime.
Rondo finale : tempo I (allegro ordinario)
Le mouvement final, engagé avec un tempo rapide, qui tranche avec d’autres interprétations, s’ouvre avec des percussions et des cuivres en majesté qui jamais cependant n’écrasent, il y a quelque chose d’une course déjà esquissée au premier mouvement. N’oublions pas que la symphonie est un parcours de la nuit au jour, un jour qui n’efface pas le poids de la nuit. Et Petrenko reste âpre dans sa manière d’aborder cette partie plus lumineuse, il n’y pas de rondeur mais des chocs de volumes, des moments éclatants, des sons aigus et encore effilés, qui voisinent avec des points plus obscurs, dans un rythme toujours dansant d’une valse en vertige pas si langoureux. Le tout reste scandé par des percussions sourdes comme nous rappelant d’où l’on vient. Cette joie est imposée voire un peu forcée, imposée par une énergie folle et tourbillonnante qui écrase, dans une vision triomphale peut-être, mais qui l’est trop pour être honnête. Et l’ensemble techniquement ahurissant crée un enchainement sonore auquel personne ne peut résister qui vous emporte physiquement, sans que l’âme n’ait presque rien à dire. Épuisante félicité.

