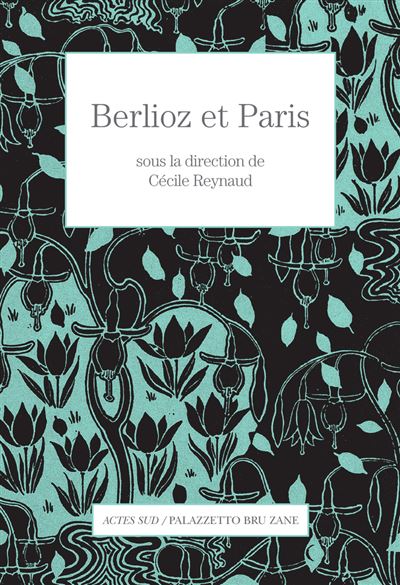
« Je me suis demandé plus d’une fois comment je pourrais m’y prendre pour miner le Théâtre-Italien et le faire sauter un soir de représentation avec toute sa population rossinienne ». En écrivant cette phrase dans ses Mémoires publiés à titre posthume en 1870, Hector Berlioz ne pouvait évidemment imaginer qu’il préfigurait les déclarations provocatrices d’un autre compositeur français qui, environ un siècle plus tard, inviterait à dynamiter les maisons d’opéra. Pourtant, à la lecture du volume Berlioz et Paris, on est plus d’une fois frappé par les similitudes entre les deux hommes, qui cultivèrent tous deux l’art de se faire des ennemis, par leur intransigeance et par leur langue acérée, et qui n’eurent de cesse que d’explorer des formes musicales inédites. Outre la citation ci-dessus, qui figure dans l’article de Stella Rollet intitulé « Berlioz et l’administration des théâtres parisiens ou Un emploi au théâtre ? », le livre publié par Actes Sud et le Palazzetto Bru Zane laisse entrevoir d’autres rapprochements possibles. Très curieux de facture instrumentale, Berlioz s’intéressait lui aussi aux moyens les plus modernes en son temps. Détail qui parachève le rapprochement : si Berlioz fut le premier des compositeurs auxquels Paris consacra une statue dans un lieu public, comme nous l’apprend Jacqueline Lalouette dans son article sur « le plus statufié des musiciens français », la quatrième de ses effigies monumentales, après la capitale en 1886, suivie par sa ville natale en 1890 et par Grenoble en 1903, fut érigée en 1923 dans la bonne ville de Montbrison, là même où, deux ans plus tard, devait naître Pierre Boulez. Détail ultime, on pourrait même évoquer une proximité sonore entre les patronymes Berlioz et Boulez (même s’il semble bien qu’au XIXe siècle, on ne prononçait pas le Z final du premier).
Plus sérieusement, Berlioz et Paris est une invitation à enrichir notre connaissance du père de la Symphonie fantastique à travers une trentaine de textes qui sont le reflet d’un colloque tenu à Paris en décembre 2019, à l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la mort du compositeur. Réunis par Cécile Reynaud, l’organisatrice de cette manifestation, qui codirige également les colloques régulièrement organisés à La Côte-Saint-André en parallèle avec le festival Berlioz, ces articles se répartissent selon six grands thèmes : « Les concerts parisiens », « Les œuvres de Berlioz à l’épreuve de Paris », « Institutions parisiennes », « Soutiens parisiens », « Berlioz et Paris depuis la province et l’étranger » et « Berlioz et Paris entre XIXe et XXe siècles ». Les vingt-huit articles sont dus à des chercheurs français et étrangers et, naturellement, comme c’est la règle dans tout colloque, les différents auteurs ont pu jouer avec le sujet imposé pour le tirer dans un sens qui reflète leurs préoccupations du moment, le rapport avec Paris n’étant pas toujours des plus flagrants. Quant aux lecteurs, chacun pourra trouver dans ces textes extrêmement variés de quoi satisfaire sa curiosité, qu’il s’agisse de points de détail la carrière de Berlioz, d’études statistiques avec graphiques à l’appui, de subtils problèmes de datation ou de questions plus générales.
Après l’introduction, où la coordinatrice compare les impressions de Berlioz à son arrivée dans la capitale en 1821 avec celles recueillies une quinzaine d’années plus tard par Fanny Trollope, mère du romancier victorien Anthony Trollope, dans son ouvrage Paris et les Parisiens en 1835, la première partie permet notamment de rappeler l’existence d’une salle de concert disparue, bâtie par le pianiste et compositeur Henri Herz, où furent créés le Carnaval romain et L’Enfance du Christ (texte de Frédérick Sendra). Etienne Jardin retrace la trajectoire de Berlioz au cours des dix-huit premières années de sa carrière, le concert étant « l’espace musical qu’il occupe le plus fréquemment pour faire entendre ses œuvres et [le] terrain d’expérimentation idéal pour développer sa pensée esthétique », sans perdre de vue son « entreprise de séduction du monde lyrique ».
Ouvrant la partie qui montre le compositeur « à l’épreuve de Paris », Anastasiia Syreishchikova-Horn rappelle que, vu de Russie, Berlioz fut celui grâce auquel on put entendre dans notre capitale la musique de Glinka, qui avait recherché le soutien de son confrère français, « une des puissances musicales les plus influentes de Paris », selon lui. Si Berlioz inscrivit des extraits de La Vie pour le tsar et de Rousslan et Ludmilla au programme de deux concerts qu’il dirigea en avril 1845 au Cirque des Champs-Elysées, c’était peut-être à charge de revanche, en prévision de son voyage à Saint-Pétersbourg deux ans après ; en 1850–51, il devait aussi arranger sur des paroles en latin deux chœurs de Dmitri Bortnianski. Jennifer Walker s’intéresse aux œuvres religieuses que Berlioz fit jouer à Saint-Eustache, « manifestations sonores de sa recherche d’une esthétique musicale sacrée s’élaborant en fonction des espaces spécifiques pour lesquels elle est destinée ». Cécile Reynaud se penche sur un document acquis en 2014 par la Bibliothèque nationale de France, le manuscrit autographe du piano-chant des Troyens, chef‑d’œuvre que Berlioz eut tant de mal à faire donner à Paris (et pour la réduction duquel il put bénéficier de la collaboration de Pauline Viardot, meilleure pianiste que lui, comme cela s’entend fort bien, à en croire Saint-Saëns, dans sa transcription de la Chasse royale).
La partie consacrée aux « institutions parisiennes » est la plus fournie, avec huit articles (les autres n’en comptent qu’entre trois et cinq). Dans son étude sur la présence berliozienne dans les salons, Rosalba Agresta déplore une situation paradoxale, les sources étant « à la fois très nombreuses et pauvres en informations » ; elle montre néanmoins que Berlioz était attiré par ces lieux de sociabilité afin d’y tester ses œuvres, en tant que critique musical et pour sa recherche de contacts (même s’il n’appréciait réellement que les salons où l’on jouait du Gluck et du Beethoven plutôt que « les fades cavatines de ces messieurs en etti et en ani »). Examinant la participation de Berlioz aux expositions universelles à l’heure de la révolution industrielle, auxquelles il s’intéressait comme chroniqueur, dans le cadre de jury de concours et en tant qu’organisateur de concerts, Emmanuel Reibel souligne toute l’ambiguïté de celui qui semble souscrire à l’idéologie du progrès tout en dénonçant le mercantilisme ambiant, qui s’oppose à la « bruyante hystérie » de ces grands rassemblements tout en proposant des « concerts-monstres » où « il industrialise pour ainsi dire l’orchestre qu’il transforme en vaste machine dont il règle chaque rouage ».
Parmi les « soutiens parisiens » figurent Isaac Strauss, le « Strauss de Paris » défendu par Berlioz à une époque où, rappelle Laure Schnapper, la frontière entre concert sérieux et concert de divertissement était moins tranchée ; Joseph-Esprit Duchêne, maire de Vervins dans l’Aisne et critique musical qui assura l’intérim au Journal des Débats lorsque Berlioz était indisponible ; et Charles Lamoureux, certes plus wagnérien que berliozien, mais qui dirigea en 1890 la création française de Béatrice et Bénédict.
Dans la partie abordant Paris vu depuis la province ou l’étranger, Bruno Messina identifie ses « pays » que Berlioz fréquentait à Paris, lui qui semble pourtant avoir fui tout rassemblement officiel de Dauphinois exilés. Dans la dernière partie, à cheval sur deux siècles, Yves Rassendren dresse le bilan de la réputation posthume de Berlioz auprès des compositeurs plus jeunes, qu’ils soient ses admirateurs, comme Chausson et Chabrier, ou ses détracteurs comme Fauré ou Debussy, même s’il faut distinguer entre les déclarations publiques plus mesurées et les formules destinées à une lecture privée, souvent plus virulentes (« de même que le Soleil, le génie de Berlioz a des taches », écrivit Fauré à Alfred Bruneau en 1919). Alban Ramaut, enfin, décrit les curieux avatars de la tombe du compositeur au cimetière Montmartre, déplacée et entièrement reconstruite en 1970.

