 Avant d'en venir au sujet principal, il faut bien parler du reste du concert, parce que cela se fait. Non que la première partie fût dénuée d'intérêt, mais écrasée rétrospectivement par la seconde, sans doute que si. Je dois dire que c'est du reste en vain que j'ai cherché à percer le mystère de la cohérence du programme d'ensemble. Qu'importe, je ne tiens pas à ce que les programmes soient cohérents, et suis même pour leur incohérence, si c'est ce qui correspond à ce que les interprètes ont envie de jouer. Les solistes du Philhar avaient-ils envie de jouer le rare Septuor de Stravinsky ? C'était peu évident. Placide, la direction de Franck vise demeurer dans les limites d'un néoclassicisme très sérieux, où l'on cherche en vain des accents d'ironie ou de mise en abîme de procédés. Il ne se passe alors, disons-le, pas grand chose, et une part de responsabilité semble en revenir au chef. Les timbres sont flatteurs, notamment ceux du violon, du basson de et de la clarinette, et dans la passacaille le relief polyphonique jusqu'alors manquant se fait jour. Mais dans l'ensemble l'exécution reste frustrée de perspective expressive, et la sophistication technique paraît sans objet. L'équilibre de texture fait défaut aussi – le piano est quasiment inaudible. Cette musique ne présente sans doute pas les enjeux d'autres oeuvres contemporaines de Stravinsky, mais mérite cependant un peu mieux.
Avant d'en venir au sujet principal, il faut bien parler du reste du concert, parce que cela se fait. Non que la première partie fût dénuée d'intérêt, mais écrasée rétrospectivement par la seconde, sans doute que si. Je dois dire que c'est du reste en vain que j'ai cherché à percer le mystère de la cohérence du programme d'ensemble. Qu'importe, je ne tiens pas à ce que les programmes soient cohérents, et suis même pour leur incohérence, si c'est ce qui correspond à ce que les interprètes ont envie de jouer. Les solistes du Philhar avaient-ils envie de jouer le rare Septuor de Stravinsky ? C'était peu évident. Placide, la direction de Franck vise demeurer dans les limites d'un néoclassicisme très sérieux, où l'on cherche en vain des accents d'ironie ou de mise en abîme de procédés. Il ne se passe alors, disons-le, pas grand chose, et une part de responsabilité semble en revenir au chef. Les timbres sont flatteurs, notamment ceux du violon, du basson de et de la clarinette, et dans la passacaille le relief polyphonique jusqu'alors manquant se fait jour. Mais dans l'ensemble l'exécution reste frustrée de perspective expressive, et la sophistication technique paraît sans objet. L'équilibre de texture fait défaut aussi – le piano est quasiment inaudible. Cette musique ne présente sans doute pas les enjeux d'autres oeuvres contemporaines de Stravinsky, mais mérite cependant un peu mieux.
L'ambitieux 5e concerto grosso de Schnittke est pris tout à fait au sérieux par l'ensemble des protagonistes. Il est incertain que le concerto soit aussi grosso que d'autres du compositeur, avec son piano caché qui ne se manifeste que par des espèces d'irruptions oraculaires (d'une efficacité théâtrale incontestable) à la fin de chaque mouvement, la dernière exagérant de façon prévisible l'esthétique soviétique tardive de la dépression nostalgique stylisée et vaguement cinématographique (se maintenant, tout de même, comme souvent avec Schnittke, au-dessus des trivialités mélodiques et harmoniques de la 7e Symphonie de Silvestrov que l'orchestre jouait le mois dernier). L'implication de l'orchestre rend semble-t-il justice à la grande densité de la pâte orchestrale, la partition se rapprochant parfois d'une symphonie avec violon obligé. Dans ce rôle alternant avec des cadences tortueuses plus conventionnelles, Vadim Gluzman donne de sa personne et parvient à convaincre que l'oeuvre comporte un véritable enjeu, même dans ses aspects un peu kitsch. Si ce caractère est certain, au moins la complexité de l'écriture ne se résume-t-elle pas à des jeux de collages de matériau et de juxtapositions de langages en forme de semi-pastiche : l'ambition d'un propos unitaire existe et se fait sentir. Inscrivant la prestation d'ensemble dans la tradition concertante, Gluzman nous gratifie d'une sarabande de la partita en ré mineur, ce qui est bien entendu proscrit par le Code pénal, le Code général des impôts ainsi que la Convention de Genève.
L'ambition d'un propos unitaire, s'agissant de la 1e de Brahms, n'est pas si évidente à satisfaire par l'interprète, même muni d'une expérience avancée et de phalanges de prestige. L'excellence dans la réalisation est courante ici, la transcendance particulièrement rare. On peut l'expliquer, classiquement, par la prévalence marquée de conventions d'interprétation devenues plus ou moins automatiques, molles, routinières, voire zombies, ainsi qu'à l'image choisie par un médiatique anthropologue à propos du peuple conservateur, rural et catholique du ponant. Au début de notre théâtre de boulevard présidentiel, côté cour, un candidat qui depuis a connu quelques déconvenues parvenait triomphalement à remobiliser ceux-ci, grâce à une force oratoire que d'aucuns avaient sous-estimé : il finissait alors tous ses discours en scandant d'une belle voix grave : "Foncez vers la grandeur !". Personne ne savait ce que ça voulait dire, et aujourd'hui tout le monde sait que ça ne voulait rien dire, mais sur le plan esthétique, ça avait de l'allure ! Parce que cela allait droit à une idée, certes purement formelle, mais simple, et belle.
S'ajoutent le fait qu'ici les partisans d'un dépoussiérage par la réduction des effectifs et l'aération des textures, le resserrement des phrasés et le recours à un instrumentarium verdoyant, n'ont jamais convaincu grand monde. Le besoin de clarification, de naturel, de spontanéité, en somme de fraîcheur de regard porté sur le monument, n'en reste pas moins réel. Parmi bien des grands noms, je n'avais guère de grand souvenir, à ce jour, que de Dohnanyi, dans son infini sagesse, lors de son intégrale avec le Philharmonia au TCE.
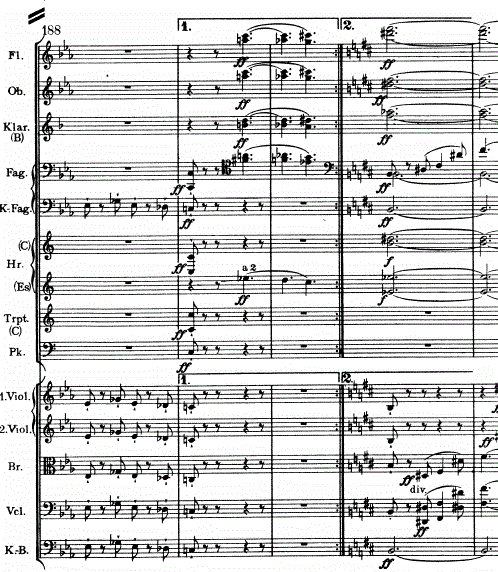 Mikko Franck et le Philhar n'ont ni cinquante ans de direction au compteur pour l'un, ni le pedigree de grand orchestre international de répertoire pour l'autre. Et pourtant, le miracle a eu lieu de nouveau, comme dans la Rhénane et Tristan. Il y eut, d'abord, dans le premier mouvement, cet événement considérable qu'a été l'observance de la répétition de l'exposition. Qu'on sentait, mystérieusement, arriver. Il allait le faire : le caractère tranquillement assuré de l'avancée laissait entrevoir un dessein net, rendant donc justice à un aspect formel du chef d'œuvre dont la nécessité, étrangement, ne s'est jamais imposée dans l'histoire. Cette reprise me paraît néanmoins, de loin, la plus indispensable des trois des symphonies de Brahms. La plus évidente à la simple lecture, au vue de l'écart entre prima et secunda volta. La plus dramatique dans l'effet qu'elle vise et produit, compte tenu de ce que dit cet écart, qui est double : entre les deux enchaînements de part et d'autre de la double barre, qui mènent chacun à deux tonalités extrêmement éloignées, et entre les deux commencements de l'allegro, l'un sur la tonique entendue dans sa consonance, dans sa vérité, l'autre sur la même tonique entendue comme extrême dissonance, comme doute et déséquilibre brutaux, blessure, balafre. C'est l'aspectualité même de la musique, l'une de ses propriétés essentielles à l'œuvre. Et on ne peut pas avoir saisi une seule fois cette nécessité et ne pas ensuite souffrir un peu en arrivant, comme c'est le cas d'ordinaire, dans la lumière brûlante de si majeur sans qu'elle ne soit d'abord refusée à nous. Tout ceci n'altère en rien l'héritage et les hiérarchies consacrées dans l'interprétation de cette symphonie, qui ont à peu près entièrement biffé cette reprise (sur une bonne cinquantaine de versions, je ne vois guère que Muti…). Mais le futur doit lui appartenir, car il y a d'utiles dépoussiérage d'habitudes, et celui-ci est de salut public : démonstration magistrale en a été donnée à ce concert.
Mikko Franck et le Philhar n'ont ni cinquante ans de direction au compteur pour l'un, ni le pedigree de grand orchestre international de répertoire pour l'autre. Et pourtant, le miracle a eu lieu de nouveau, comme dans la Rhénane et Tristan. Il y eut, d'abord, dans le premier mouvement, cet événement considérable qu'a été l'observance de la répétition de l'exposition. Qu'on sentait, mystérieusement, arriver. Il allait le faire : le caractère tranquillement assuré de l'avancée laissait entrevoir un dessein net, rendant donc justice à un aspect formel du chef d'œuvre dont la nécessité, étrangement, ne s'est jamais imposée dans l'histoire. Cette reprise me paraît néanmoins, de loin, la plus indispensable des trois des symphonies de Brahms. La plus évidente à la simple lecture, au vue de l'écart entre prima et secunda volta. La plus dramatique dans l'effet qu'elle vise et produit, compte tenu de ce que dit cet écart, qui est double : entre les deux enchaînements de part et d'autre de la double barre, qui mènent chacun à deux tonalités extrêmement éloignées, et entre les deux commencements de l'allegro, l'un sur la tonique entendue dans sa consonance, dans sa vérité, l'autre sur la même tonique entendue comme extrême dissonance, comme doute et déséquilibre brutaux, blessure, balafre. C'est l'aspectualité même de la musique, l'une de ses propriétés essentielles à l'œuvre. Et on ne peut pas avoir saisi une seule fois cette nécessité et ne pas ensuite souffrir un peu en arrivant, comme c'est le cas d'ordinaire, dans la lumière brûlante de si majeur sans qu'elle ne soit d'abord refusée à nous. Tout ceci n'altère en rien l'héritage et les hiérarchies consacrées dans l'interprétation de cette symphonie, qui ont à peu près entièrement biffé cette reprise (sur une bonne cinquantaine de versions, je ne vois guère que Muti…). Mais le futur doit lui appartenir, car il y a d'utiles dépoussiérage d'habitudes, et celui-ci est de salut public : démonstration magistrale en a été donnée à ce concert.
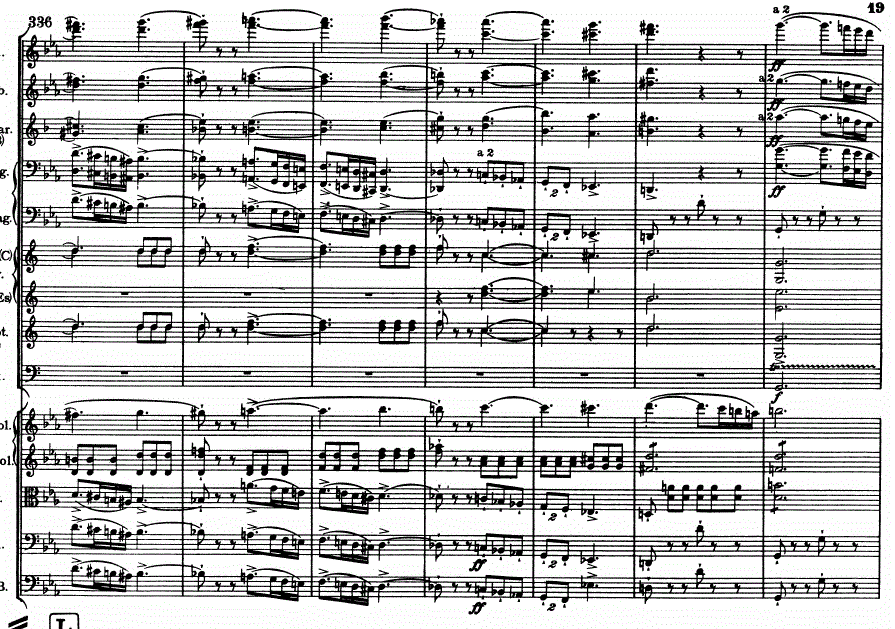 La vigueur rythmique tenue par Franck ne se dément jamais de tout l'allegro, pris dans une battue pourtant pile dans la norme. C'est que dans ce répertoire le prodige finlandais à un don pour la transition juste, rapide, articulée à l'instant exact qui rend l'avancée nécessaire et évidente : et dieu sait que dans ce mouvement, les pièges, les menaces d'enlisement sont nombreux aux transitions, entre changement de mètre, marches harmoniques elliptiques en pizz… A son habitude, il ne paraît pas se soucier outre mesure des entrées, fait confiance à ses troupes, se préoccupe du geste global, du trait, de la pâte, parfaitement équilibrée entre netteté contrapuntique et puissance de masse. Le détail, il ne s'en soucie que s'il tue ! Maître des moments décisifs, il frappe encore à l'amorce de la réexposition, en portant l'attention sur cette indication fortissimo portée par Brahms aux seules basses. Bien calé sur son siège, Franck pivote soudainement vers elles, le geste se fait impérieux et la réponse jaillit au quart de tour : le son se jette avec sauvagerie dans une hypogée qui est l'apogée de la tension, physique et discursive, d'où rejaillit le thème principal, émotionnellement saturé de tout ce qu'il a traversé. Tétanisante, c'est, libérée, la "force de pensée" de Brahms qui fascinait Wittgenstein.
La vigueur rythmique tenue par Franck ne se dément jamais de tout l'allegro, pris dans une battue pourtant pile dans la norme. C'est que dans ce répertoire le prodige finlandais à un don pour la transition juste, rapide, articulée à l'instant exact qui rend l'avancée nécessaire et évidente : et dieu sait que dans ce mouvement, les pièges, les menaces d'enlisement sont nombreux aux transitions, entre changement de mètre, marches harmoniques elliptiques en pizz… A son habitude, il ne paraît pas se soucier outre mesure des entrées, fait confiance à ses troupes, se préoccupe du geste global, du trait, de la pâte, parfaitement équilibrée entre netteté contrapuntique et puissance de masse. Le détail, il ne s'en soucie que s'il tue ! Maître des moments décisifs, il frappe encore à l'amorce de la réexposition, en portant l'attention sur cette indication fortissimo portée par Brahms aux seules basses. Bien calé sur son siège, Franck pivote soudainement vers elles, le geste se fait impérieux et la réponse jaillit au quart de tour : le son se jette avec sauvagerie dans une hypogée qui est l'apogée de la tension, physique et discursive, d'où rejaillit le thème principal, émotionnellement saturé de tout ce qu'il a traversé. Tétanisante, c'est, libérée, la "force de pensée" de Brahms qui fascinait Wittgenstein.
Sans être aussi immensément marquants, les mouvements centraux ne montrent guère de faiblesses, ce qui prolonge l'exploit tant la chose est peu commune encore. Seule le tout début du II manque d'une légère aération de texture pour créer un climat suffisamment défini. L'acoustique du nouvel auditorium, nette mais si peu propice à l'intimité, au recueillement ou à la solennité, n'y aide pas. Dans l'irrésistible arabesque prolongeant le second thème, j'ai le souvenir d'un instant de poésie infinie offert en 2012 par le duo d'Hélène Devilleneuve et Nicolas Baldeyrou aux hautbois et clarinette. Les deux, qui feraient le bonheur de n'importe quel orchestre de luxe du monde, officient de nouveau, et se relaient avec la même grâce, mais la magie opère moins qu'à Pleyel : ce n'est manifestement par de leur fait. La suite sera en revanche mieux tenue que sous la baguette de Dudamel (qui, sobre et raffinée, était pourtant à son meilleur ce soir-là). La séquence concertante finale convainc par son peu de caractère concertant, rendant justice à l'écriture d'orgue violon-hautbois-cor. Le III est le plus difficile à réussir sans la signature sonore d'un orchestre d'exception, mais le Philhar fait mieux que se défendre ici, préservant les équilibres de textures si délicats du crescendo central, évitant la trivialité à défaut de parvenir à une grandeur nostalgique absolue. Les cordes restent un peu en deçà de ce qu'il est possible de réaliser en puissance de phrasé, les bois sont, eux impeccables. Il faut bien, même si c'est devenu proverbial, tresser une énième couronne à Devilleneuve, qui dans cette partition plus riche que toute autre, peut-être, en longues phrases de hautbois (et pas que solo), est d'une générosité et d'un rayonnement indescriptible, de tous les instants, notamment dans le finale, qui ne contient peut-être pas les traits le plus lyriques pour l'instrument, mais où certains d'entre eux ont la responsabilité de toute la continuité du discours, comme cette ligne faisant le lien entre la deuxième et la troisième idée, où la barre de mesure s'abolit, et où la liberté passionnée et l'éloquence rhétorique ne font plus qu'une.
Franck mène la grande barque de ce finale en père tranquille, avec un métier qui, bien que l'on s'y soit habitué, laisse encore stupéfait, à une semaine de son 38e anniversaire. Il laisse simplement s'ébrouer l'expression dans un espace qu'il habite, qu'il balise de certitudes simples. Le largamente du début de la réexposition s'observe justement dans l'expression apaisée d'un vaste for intérieur, plutôt que dans un alanguissement pâteux. L'imitation de fugue ne se voit en rien sollicitée, de fouetté et excessivement velléitaire comme trop souvent, et, dans sa clarté des respiration naturelle, se fait classique, belle comme l'antique. Dans l'état d'esprit au moins, on songe aux grands maîtres de cette manière hautaine, hellénistique, romantique sens germanique premier, du style et de la forme – Böhm, Sanderling… On va droit à l'essentiel, qui est la grandeur, et on y parvient sereinement. Longue vie !


