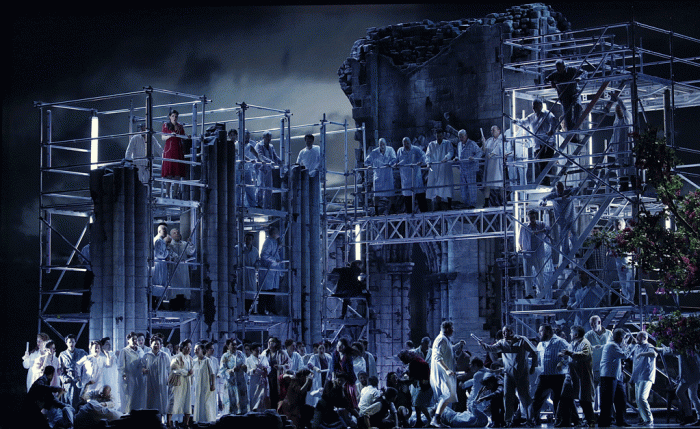
Cette production attendue de Die Meistersinger von Nürnberg a été victime de quelques aventures. D’abord, il devait s’agir de la production de Stefan Herheim coproduite par Salzbourg, le MET, Paris et la Scala, mais des questions techniques d’adaptation scénique ont obligé à y renoncer, et au MET et à Milan. Alexander Pereira a donc repris pour Milan la production qu’il avait montée à Zurich, mise en scène par Harry Kupfer, en 2011–2012, déjà avec Daniele Gatti. Et puis le ténor Michael Schade prévu dans Walther est tombé malade et a été remplacé pour toutes les représentations par Erin Caves qui chante Walther et d’autres rôles wagnériens notamment à l’Opéra de Stuttgart.
Monter Die Meistersinger von Nürnberg, 4h30 de musique pour une durée complète de 5h30, après 28 ans d’absence signifie pour les forces du théâtre un gros défi. C’est une des pièces les plus longues du répertoire, mal connue de la plupart des musiciens de l’orchestre qui ont beaucoup travaillé Wagner avec Daniel Barenboim, mais pas cet opéra-là. Or, sans doute est-ce l’œuvre dans laquelle il est le plus difficile d’entrer, parce que c’est une comédie, où le texte a une importance égale à la musique, tout simplement parce que le thème central est l’élaboration d’un poème qui puisse trouver sa musique et qu'on ne peut faire sonner Meistersinger comme les autres oeuvres de Wagner.
Tout le livret est plein de jeux de mots, de jeux sonores souvent ironiques en écho, dans lequel un public non germanophone peut difficilement entrer. Le tout au rythme de la comédie, de la conversation, du dialogue. La musique souligne et accompagne les paroles avec tant de raffinement que la partition est l’une des plus complexes et des plus foisonnantes de Wagner, tellement elle colle à l’action, voire la définit, comme lors de l’entrée de Beckmesser au troisième acte, long intermède sans paroles où la musique définit le mouvement scénique, chef d’œuvre de musique descriptive qui ouvre la voie à la musique d’accompagnement d’un dessin animé.
Du côté de la distribution, lourde (une trentaine de personnes si l’on compte aussi le groupe des apprentis), il s’agit de trouver d’abord 12 maîtres, quatre sont des rôles principaux (Sachs, Beckmesser, Pogner, Kothner) et les 8 autres de tout petits rôles a interventions presque uniques, mais avec chacun une personnalité, une attitude à trouver en scène, une expression particulière. Les autres rôles, même les plus importants, ne paraissent pas spectaculaires : ce ne sont pas de ces rôles qui sont le socle d’une carrière, comme Tristan, Sieglinde ou Siegmund. Ce qui ne signifie pas qu’ils soient faciles à chanter et surtout plus faciles à distribuer : ils sont rares, les grands Walther. C’est pourtant un rôle pour une grande voix et beaucoup de relief, parce que le rôle est celui d’un chanteur qui doit chanter comme un maître et il faut que ça s’entende. Elles sont rarissimes, les Eva dont on se souvient dans la période la plus récente. Eva n’est pas une voix légère et elle doit avoir une forte personnalité. Souvenons –nous que bien des grandes Maréchales furent de grandes Eva (Elisabeth Schwartzkopf, Gwyneth Jones et aujourd’hui Anja Harteros). La même question se pose pour Magdalene, qui est un second plan, mais très présent vocalement notamment au premier acte et qui exige là aussi une voix qui ait couleur et expression.
Quant à David, il a peut-être le texte le plus important à dire (au premier acte) pour faire comprendre la correspondance chant-artisanat qui est l’une des lignes de force de l’œuvre. David a été souvent interprété par un ténor de caractère (Heinz Zednik, Erwin Wohlfahrt qui furent aussi de grands Mime) et qu’on donne désormais à des ténors plus « mozartiens » (ce qui ne veut pas dire fragile, mais qui définit un style, un phrasé, une couleur) à la voix claire, mais aussi à la forte présence et au volume non indifférent. Enfin, on doit aussi distribuer la garde de nuit (Ein Nachtwächter) à une basse prometteuse, voire à une basse bien engagée dans la carrière. Deux phrases à dire, mais dont l’économie dramatique est essentielle et l’effet sonore définitif. Cela veut dire pour ce rôle, une vraie personnalité vocale.
Hans Sachs, le rôle principal, est le rôle wagnérien (et pas seulement) le plus long du répertoire, parce qu’il est presque toujours en scène, avec des monologues lourds (sans compter les duos), au deuxième et surtout au troisième acte où il en chante trois dont deux à l’extrême fin, avec le Euch macht ihr’s leicht, mir macht ihr’s schwer où la tessiture et tendue et où il doit néanmoins garder de la réserve pour Verachtet mir die Meister nicht. C’est d’ailleurs souvent dans cet air que l’on perçoit une fatigue vocale bien compréhensible. Mais en plus de la mise en danger vocale, le rôle exige un chanteur qui ait une grande familiarité avec la langue, avec ses rythmes et ses accents, pour affronter de la manière la plus fluide possible les longues scènes « conversées » qui nécessitent et sens du théâtre et musicalité.
La mise en scène d’Harry Kupfer, ultra-octogénaire qui garde un œil et un sens de la scène étonnants, frappe à deux niveaux :
- D’une part elle établit un pont entre reconstruction de l’Allemagne d’après-guerre et construction d’un futur maître, en affirmant que l’année zéro n’est jamais l’année zéro, parce que le pays retrouve sa personnalité profonde et ses traditions, et construit le futur en s’appuyant sur le passé. Le dispositif scénique est simple : l’action se passe dans les ruines bombardées de l’église Sainte Catherine installées sur une tournette entourée d’échafaudages, dont on comprend d’acte en acte qu’elle ne sera pas reconstruite, et restera une ruine témoin, une « Gedächtniskirche » ((Eglise du souvenir)) sur le modèle berlinois . En fond de scène, un cadre qui évolue quant à lui d’acte en acte, évoquant au premier acte la Nuremberg en ruines, au deuxième acte la reconstruction (avec ses nombreuses grues), et au troisième la ville reconstruite et ses tours. Le cadre de l’action au milieu des échafaudages figure bien cette construction parallèle de la ville et du chanteur, dans laquelle se déroule tout l’opéra.
- D’autre part, cette comédie vive, qui souvent fait sourire ou rire le spectateur, reste dans la vision de Kupfer un peu plus retenue. On sourit souvent, mais on rit très rarement parce qu’aucun personnage n’est vraiment ridicule, à commencer par Beckmesser, une figure plutôt digne, jamais vraiment aux prises avec la vis comica, jamais vraiment caricaturale, défendue par un Markus Werba plutôt jeune et élégant, qui change beaucoup l’idée rendue par le personnage.
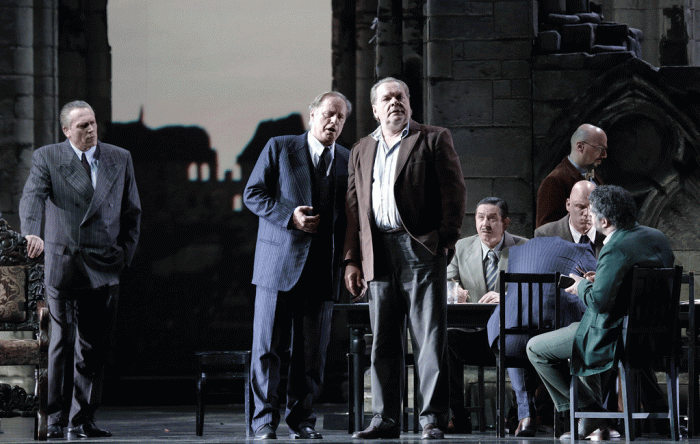
Comme souvent chez Kupfer, le travail sur les personnages et sur les mouvements est à la fois très précis et plein de sens. Il accompagne en particulier au premier acte l’art de la conversation, typique du théâtre parlé, avec des gestes précis, expressifs, qui accompagnent les mots, des attitudes naturelles, détendues, jamais exagérées, loin des clichés de l’opéra : il suffit de regarder le mouvement autour de la table au premier acte, ceux qui se lèvent, ceux qui s’assoient, ceux qui bougent debout, qui marchent de long en large, qui essaient de quitter la réunion et qu’on retient, et comment aux moments importants ils se retrouvent rassemblés autour de Kothner et Pogner, ainsi que les mouvements de Sachs, toujours dans la réunion et toujours un peu en marge.
Enfin, et encore au premier acte, le mouvement des apprentis est à l’opposé de cette géométrie chorégraphique qu’on voit souvent dans les productions, on y voit jeunesse, vivacité, avec un grain de violence même (bagarres avec David) et tout cela donne un évident effet de naturel et de fraîcheur qui irrigue l’ensemble de la soirée.
La présence permanente des échafaudages, signe de la construction, d’un « work in progress » qui est le sujet même de l’œuvre, permet en même temps techniquement de répondre aux exigences du livret, avec son jeu sur les fenêtres, sur les personnages dissimulés derrière les rideaux des maisons (ici dissimulés par un tulle qui les fait se dessiner derrière). On va utiliser le jeu sur les niveaux à chaque acte pour y mettre une fois les apprentis, l’autre fois Magdalene mais aussi le couple Walther-Eva, et au troisième acte pendant la Festwiese, peuple et musiciens, ce qui permet toujours d’avoir un œil multipolaire sur tout l’espace scénique, complètement utilisé, et permet des jeux dramaturgiques qui contribuent à enrichir le signifié de l’œuvre et montrent les raffinements de la mise en scène.
Un seul exemple : durant le second acte, au moment du duo Beckmesser/Sachs, le couple Eva/Walther est dissimulé au premier niveau d’un échafaudage et écoute attentivement ce qui se passe ; de son côté Sachs pendant la conversation jette vers les deux jeunes gens des regards furtifs. Les jeunes cachés pourraient en profiter pour flirter un peu. En revanche, ils écoutent attentivement la scène qui constitue aussi pour Walther la première leçon de chant, d’autant plus symbolique qu’elle est donnée à celui qui l’a noté (et refusé) au premier acte. Il est donc d’autant plus attentif au discours de Sachs. Kupfer souligne l’évolution de l’artiste par divers aspects : dans cette œuvre, la question du maître est centrale, dans le double sens de celui qui est un maestro et de celui qui enseigne, nous sommes dans un travail dialectique au sens platonicien du terme, et Sachs est un Socrate à la mode de la Nuremberg rêvée par Wagner. Ainsi de l’évolution de Walther, artiste libre au premier acte, inspiré la nature et par la « Fureur divine », concept cher aux poètes de la Pléiade, venu de Platon et de Marsile Ficin. Il apprend au deuxième acte la nécessité du travail, à laquelle nul n’échappe, ni le Maître amoureux Beckmesser, ni l’artisan chausseur Sachs, et il est prêt au troisième acte à accepter la leçon, et retravailler son poème. Leçon wagnérienne sur « l’artisanat de l’art ».
Kupfer au deuxième acte rend très clair le rôle de Sachs, celui qui fait mouvoir et les êtres et la ville, le démiurge qui déchaîne le charivari final dans le seul but de soustraire le couple à l’idée de la fuite, mais aussi de contraindre le jeune aristocrate Walther à se mettre au travail, un concept loin de la morale aristocratique, et à le conduire au magistère. Dans la ville de Nuremberg, être Maître, c’est se soumettre aux valeurs d’une bourgeoisie travailleuse et besogneuse (« l’artisanat »), et renoncer à certains caractères des valeurs de l’aristocratie. Walther est aussi un transfuge social. Sachs à la manœuvre soumet les personnages et la ville à ses objectifs, mais sans jamais user du pouvoir pour soi-même (au contraire d’autres mises en scène) en cela, le travail de Kupfer est profondément optimiste.
Les qualités de cette mise en scène se lisent aussi à la Festwiese : la manière virtuose avec laquelle la scène est mise en place, et l’utilisation habile du décor tournant sur lui-même et du chœur courant montant et s’installant à droite à gauche et au-dessus pour donner l’illusion d’un joyeux désordre, donnant une image de vie, de joie, de jeunesse, bien loin de certaines visions fossilisées d’autres mises en scène. Il n’y a rien d’exagéré, rien d’excessif, rien de pittoresque au sens poussiéreux du mot, et ainsi le sens de la musique est souligné et amplifié par la mise en scène, qui souligne que la fête est bien la Saint Jean « Johannistag », mais aussi celui d’un peuple qui se retrouve lui-même et qui retrouve ses valeurs.
La Nuremberg de Wagner est gouvernée par les poètes comme la cité idéale de la République de Platon l’est par les philosophes. Mais Wagner en s’appuyant sur Platon qui refusait de donner la cité aux poètes, le contredit en même temps. Wagner se pose ainsi en nouveau Platon, sur lequel il s’appuie, et dont il s’éloigne, montrant que les poètes peuvent être ceux qui gouvernent. L’utopie des Meistersinger est celle d’une poésie créative qui crée le monde nouveau et les conditions du bonheur futur. De là la mise en évidence par Kupfer de l’adéquation de la petite République de Nuremberg à l’Allemagne nouvelle issue de la guerre, une Allemagne pacifique et ouverte sur l’autre (Walther est cet autre, cet étranger venu d’ailleurs et d’une autre classe sociale). A la fin, volens nolens, Beckmesser est réadmis dans la collectivité, Walther est très fortement invité à devenir Maître, c'est-à-dire soumis à la constitution de l’Athènes nurembergeoise, et Sachs couronne la statue du bon pasteur, par la couronne dont on voulait le ceindre, marquant ainsi sa soumission à un ordre plus haut, se plaçant lui- aussi comme le bon guide (on n’ose dire le bon Führer).
Et tout cela est lié à l’idée de construction, celle de l’artiste inspiré mais soumis au travail, celle d’une Allemagne de l’après-guerre, mais aussi cette Allemagne à laquelle Wagner ne pouvait pas ne pas penser, cette Allemagne en gestation qui allait naître trois ans plus tard, en 1871, sur les ruines de l’Empire Français, et dont il était un des poètes créateurs (certes auprès du souverain-artiste Louis II de Bavière, le mauvais cheval en l’occurrence). Ce n’est pas un hasard si la lecture de Kupfer est assez ouverte pour répondre à ces idées, mais il le fait sans insister, par petites touches, parce qu’il s’adresse à un public averti : n’oublions pas que l’œuvre wagnérienne n’est jamais exempte d’idéologie, de politique, mais aussi de profonde humanité et que Kupfer vient de l'école de Brecht d'un théâtre didactique.
A cette lecture si ouverte, doit correspondre une direction musicale qui puisse laisser un espace à l’intime, au politique/philosophique, et à l’humain. Die Meistersinger von Nürnberg est une œuvre singulière parce qu’à part trois moments clefs, l’ouverture, le charivari du deuxième acte, et la Festwiese du troisième, et deux moments d’ensemble, au final du premier acte et pendant le quintette du troisième, tout le reste n’est que conversation et dialogue. Le piège de cet opéra est l’absence apparente de spectaculaire pendant une bonne partie de la représentation, toute faite d’échanges entre personnages, entre texte et musique qui se tissent en systèmes d’échos construisant des correspondances, et des contrastes souvent ironiques. Il s’agit d’une comédie, avec un rythme de comédie, avec une priorité au dialogue et au théâtre, souvent par ses formes plus proche du théâtre que de l’opéra, d’où la surprise du spectateur novice. Dans le monde du drame musical et de la mélodie infinie, il y a place pour la comédie, qui cherche elle aussi par son sujet même la mélodie infinie. Wagner s’était essayé à la comédie avec Das Liebesverbot, authentique « Komische Oper » à la Auber, avec Die Meistersinger von Nürnberg c’est en fait à un Grand-Opéra-Comique qu’il s’essaie.
La nature du livret demande une étude très particulière du phrasé de la part des chanteurs, de la ligne musicale, et des équilibres entre paroles et musique. Même si en même temps la musique peut être pompeuse (l’ouverture), d’une pompe qui peut être ironique (les maîtres), elle souligne aussi la noblesse de l’enjeu : identifier une ville gouvernée par l’art, parce que ce qui fait lien social (comme on dirait aujourd’hui), c’est la poésie, c'est-à-dire l’art. Alors la direction musicale doit illustrer ces deux aspects du spectre, à la fois la grandeur, mais aussi l’intimité, la légèreté, et mettre en relief l’extraordinaire humanité de l’œuvre, cette bonhommie souriante qui fait qu’on ne peut douter du dénouement, qui est synthèse. Si certaines mises en scènes tirent l’opéra vers les périls (nazisme compris qui avait fait de Meistersinger le seul opéra acceptable de Wagner à la fin de la deuxième guerre mondiale), celle de Kupfer est optimiste et affiche une croyance en l’homme et aux valeurs humanistes. Stefan Herheim à Salzbourg en faisait un drame utopique et individuel : le créateur (Sachs) face à son rêve d’une Nuremberg-Disneyland, monde fermé sans rapport avec le réel. Kupfer fait respirer l’opéra d’une manière différente, et la musique doit refléter cette respiration proposée par la mise en scène. C’est ainsi que Daniele Gatti réussit à faire naviguer la direction musicale entre les deux pôles de la légèreté et de la pompe, entre le spectaculaire et l’intime : le travail sur la Festwiese, avec le chœur magnifique préparé par Bruno Casoni (Wach’auf exemplaire !) est d’une phénoménale précision, d’une clarté lumineuse ; non seulement on entend toute la complexité de l’écriture, mais on entend aussi le travail sur les équilibres, l’attention aux voix, notamment celle de Sachs, à dure épreuve, avec un son qui ne sature jamais, jamais trop fort, parfaitement contrôlé. Moins spectaculaire et plus singulier le travail d’horloger sur les parties parlées, sur les ensembles aussi (fin du premier acte), où se lit la volonté de donner une ligne, de s’appuyer sur certains instruments pour donner sens aux ensembles et aux échos évoqués plus haut entre voix et instruments : à la conversation des personnages répond celle des instruments et un tissage d’une légèreté étonnante entre voix et fosse. C’est à cela qu’on lit la culture italienne du chef, et surtout sa fréquentation de Rossini, un Rossini léger, fluide, où l’instrument prend place aux côtés de la parole pour faire musique ensemble : il y a une légèreté rossinienne dans certains passages.
Mais il y a surtout une sensibilité extraordinaire. Cette direction est sensible parce qu’elle écoute, sans jamais rien de démonstratif, avec juste le pathos nécessaire au drame, mais pas plus, rien d’exagéré, rien de trop : rien d’extérieur et de superficiel, mais de l’intériorité et de la profondeur. Gatti fait sonner, fait accompagner, fait dire, mais ne pousse jamais au trop plein. Et l’orchestre de la Scala, qui n’a ni l’expérience ni la pratique fréquente des orchestres d’opéras allemands, a pour lui la fraîcheur et l’enthousiasme, la joie de jouer et la fascination de la découverte. Et cette joie, ce sourire permanent, cela se sent, à l’orchestre et au pupitre.
La profondeur du travail se lit dans la perfection des attaques, l’exactitude des rythmes, la rondeur du son, le rendu magnifique des cuivres et des bois et dans le sens dramatique d‘une direction qui sait rendre de la tension et de la couleur. Le charivari final du deuxième acte, construit en crescendo rigoureux qui joue sur les volumes et des voix et de l’orchestre, mais aussi du marteau de Sachs (Wagner aime le marteau et l’enclume…), joue ici sur la ligne des bois et des cuivres, toute en ironie, et sur la réponse du chœur, tout est dans cet écho ligne de chœur/ligne de cuivres et bois et se construit sans cesse par référence à cette ligne, d’une très grande clarté qui préserve et le côté spectaculaire du moment, mais aussi son extraordinaire ironie. Si bien que la tension scénique (les bagarres, les mouvements etc..) n’est jamais prise au sérieux, parce qu’il y a une petite musique dans la fosse qui sourit et nous dit que tout cela n’est qu’apparence, et n’est qu’une mise en scène voulue (de Sachs). Quant aux dernières mesures du 2ème acte, elles sont simplement miraculeuses.
Une direction exceptionnelle, et un orchestre transfiguré, qui fait corps avec le chef (voir avec quelle énergie ils l’applaudissent à la fin et ils battent du pied quand il monte au pupitre) : Daniele Gatti compte sans aucune hésitation parmi les très grands chefs wagnériens de l’époque, continuant une grande tradition commencée par Toscanini, De Sabata, continuée par Abbado. Quand Wagner a un parfum italien, c’est tout le rêve goethéen (Kennst du das Land…) du charme profond et animé du sud qui transparaît, mais c’est aussi un son d’une si grande sensibilité et humanité qui bouleverse l’auditeur et qui rend ce Wagner-là vraiment universel.
J’ai souligné plus haut la difficulté de trouver une distribution idoine pour Die Meistersinger von Nürnberg, vu le nombre de personnages, et les exigences vocales si diversifiées, sans être toujours spectaculaires, et donc « payantes » pour le chanteur. Celle de la Scala, avec ses imperfections et ses qualités, ne fait pas exception. Le Walther d’Erin Caves, qui sauve la représentation ‑ne pas l’oublier !-, est tout sauf spectaculaire, plutôt pâle scéniquement, avec une voix mal projetée, dans une salle au volume si important : elle est donc souvent couverte dans les ensembles (quintette…) et se perd. En soi, le timbre est clair, la diction correcte, mais dès que la voix passe à l’aigu, elle connaît des problèmes de stabilité et de justesse. Le chant est contrôlé, l’orchestre et le chef cherchent à l’accompagner en l’aidant aux moments plus critiques, mais cela manque de vie, d’accents, de personnalité, de couleur. N’importe, il mène la représentation à sa fin, et le public lui fait un accueil sympathique.
Le Walther d’Erin Caves, qui sauve la représentation ‑ne pas l’oublier !-, est tout sauf spectaculaire, plutôt pâle scéniquement, avec une voix mal projetée, dans une salle au volume si important : elle est donc souvent couverte dans les ensembles (quintette…) et se perd. En soi, le timbre est clair, la diction correcte, mais dès que la voix passe à l’aigu, elle connaît des problèmes de stabilité et de justesse. Le chant est contrôlé, l’orchestre et le chef cherchent à l’accompagner en l’aidant aux moments plus critiques, mais cela manque de vie, d’accents, de personnalité, de couleur. N’importe, il mène la représentation à sa fin, et le public lui fait un accueil sympathique.
La jeune américaine Jacquelyn Wagner (Eva) fait carrière en Allemagne. Elle est plutôt bien préparée, avec style, belle diction, chant très contrôlé, élégant, comme souvent chez les chanteurs anglo-saxons. Mais la voix reste en retrait, notamment dans les deux premiers actes où le volume et le corps font un peu défaut. En revanche, le troisième acte montre voix plus ouverte et une personnalité plus affirmée et, comme le montre la mise en scène du quintette où Eva est assise, dont elle est vraiment le centre et qu’elle exécute et domine avec beaucoup d’engagement et de poésie – elle y est vraiment intéressante – mais sur l’ensemble de la prestation, elle n’a pas le sens dramatique voulu : Eva n’est pas fragile, c’est une jeune femme, qui sait ce qu’elle veut, décidée à construire son avenir sans être soumise ou (trop) obéissante. Voix et artiste de très grande qualité, sans aucun doute mais peut-être pas une Eva.
Anna Lapkovskaia en revanche est une Magdalene très présente, avec une voix bien structurée et contrôlée, très expressive, au timbre sombre, mais sans problème d’émission ni de projection. Le rôle n’est pas spectaculaire et il reste difficile de lui donner du relief, même si le personnage est important pour l’équilibre des voix. Anna Lapkovskaia y réussit tout en finesse, et c’est bien.
Plus important encore David : une voix de ténor au timbre clair qui doit être forte, et chanter avec élégance et expressivité. La tradition est double, celle d’un ténor de caractère (Heinz Zednik, ou Erwin Wohlfahrt l’ont chanté et ce furent aussi des Mime) ou celle d’une voix plus lyrique (comme Norbert Ernst ou Daniel Behle qui le chantera à Bayreuth cette année), de couleur mozartienne. Peter Sonn qui le chante souvent, est plutôt de ceux-là, toujours avec un résultat impeccable : la voix est présente, stylée, élégante. Le personnage existe, très expressif, au chant intelligent, plein de nuances, même si on a pu l’entendre encore plus raffiné. Le rôle exige en effet une grande intelligence du texte, dans la mesure où son dialogue initial avec Walther pose des principes de l’art du chant, comparé au travail de l’artisan, qui sont des éléments fondamentaux de la compréhension de la problématique wagnérienne dans cette œuvre.
Detlef Roth (Kothner) est l’une des belles voix allemandes du jour, un de ces barytons-basse qui rassurent un théâtre, à la carrière très régulière. Son Kothner est très présent, jamais caricatural, la voix est claire et sonore : belle prestation.
Une note aussi pour le Nachwächter de Wilhelm Schwinghammer, une basse en pleine carrière qu’on a entendu dans Fasolt et König Heinrich à Bayreuth. Voilà quoi confirme l’importance vocale de ce tout petit rôle dans l’économie de la représentation puisqu’il est confié ici à un artiste éprouvé.
 Beckmesser (Markus Werba) & Sachs (Michael Volle) Acte II
Beckmesser (Markus Werba) & Sachs (Michael Volle) Acte II
Markus Werba est Beckmesser. Pour ce personnage aussi il y a deux traditions, l’une plutôt ancienne d’un Beckmesser ridicule « à vue », caricatural dans lequel beaucoup voyaient l’image du juif, et une autre, plus récente, d’un Beckmesser peut-être psychologiquement problématique, mais à l’aspect neutre, ou même élégant, en tous cas pas ridicule. Déjà le Beckmesser de Wolfgang Wagner à Bayreuth en 1979 (Hermann Prey) ouvrait la voie, Michael Volle fut un immense Beckmesser, Dietrich Henschel fut grand aussi ; très souvent les Beckmesser sont (par contraste ?) d’excellents chanteurs de Lieder. Markus Werba n’est jamais une caricature, mais seulement un personnage rigide, solitaire et peu sûr de lui. Werba est n’a d’ailleurs physiquement rien d’une caricature et pourrait même être séduisant, mais il s’autodétruit par le caractère. Il séduit néanmoins par le chant, très éduqué, très contrôlé, construit par la longue fréquentation de Mozart, avec une magnifique expressivité, même dans le dernier Lied, absurde certes, mais un chef d’œuvre surréaliste qui pourrait trouver un espace dans l’écriture du premier XXème siècle, où Beckmesser pourrait être le subversif, comme le dépeignait Katharina Wagner dans sa mise en scène à Bayreuth. Moins destructrice, la mise en scène le réintègre dans la communauté de la petite république de Nuremberg, image de cette nouvelle Allemagne qui veut être accueillante à l’autre (voir l’accueil des réfugiés aujourd’hui).
Tout le paradoxe de cette œuvre est dans le débat sur poésie et chant, plus que sur le bien ou mal chanter…
La question est celle d’une écriture qui doit trouver sa musique, sous la même plume (on reconnaît là Wagner) alors que l’échec de Beckmesser vient qu’il n’y a pas adéquation entre un texte qui n’est pas de lui et une musique qu'il y plaque. Beckmesser doit être ce chanteur excellent (il fait partie des maîtres chanteurs) trahi par l’écriture qui doit néanmoins chanter dans une forme impeccable.
La synthèse finale, synthèse dialectique à la mode de Platon, de laquelle toute l’œuvre est l’illustration, c’est celle de la musique qui trouve son texte et vice versa, c’est la pure synthèse wagnérienne, qui répond par anticipation au débat bien connu du Capriccio de Richard Strauss.
Albert Dohmen, qui fut un grand Sachs, est un très grand Pogner. Présence scénique comme toujours imposante, chant sculpté, très clair, émission parfaite, volume, diction, expression, tenue de ligne. Grand art d’un grand artiste. Le personnage lui-même, retenu, discrètement humain, un peu en retrait, qui dissimule sa fragilité, est très bien dessiné par la mise en scène dans son face à face avec Sachs.
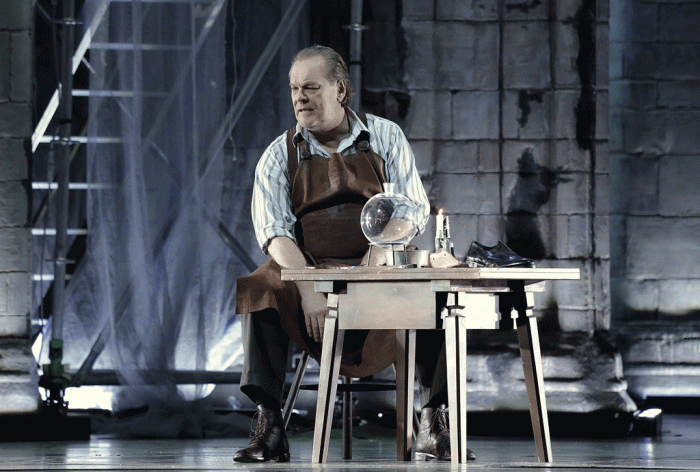 Sachs enfin est bien ce personnage qui opère une autre synthèse, celle du public et du privé, où public et privé sont tressés entre eux. Le personnage renonce pour lui-même au nom de la réalité, au nom de l’art aussi puisqu’il cherche dans l’art ses modèles (citation de Tristan et du Roi Marke), mais, et c’est toujours moins clair, il renonce aussi au nom de l’art du futur, qui est porté par Walther. Certes, on comprend comment la Maréchale de Strauss est l’héritière de Sachs et le trio final du Rosenkavalier fils du quintette des Meistersinger, mais la renonciation de la Maréchale est d'ordre privé. Celle de Sachs porte sur l’individu et l’artiste, c’est la renonciation d’une vie, qui explique aussi les discours ultimes sur la transmission à Walther et sa signification. Chaque synthèse est renonciation : celle de Sachs est celle du démiurge (politique ?) qui renonce pour faire aller de l’avant la communauté et la porter vers le futur.
Sachs enfin est bien ce personnage qui opère une autre synthèse, celle du public et du privé, où public et privé sont tressés entre eux. Le personnage renonce pour lui-même au nom de la réalité, au nom de l’art aussi puisqu’il cherche dans l’art ses modèles (citation de Tristan et du Roi Marke), mais, et c’est toujours moins clair, il renonce aussi au nom de l’art du futur, qui est porté par Walther. Certes, on comprend comment la Maréchale de Strauss est l’héritière de Sachs et le trio final du Rosenkavalier fils du quintette des Meistersinger, mais la renonciation de la Maréchale est d'ordre privé. Celle de Sachs porte sur l’individu et l’artiste, c’est la renonciation d’une vie, qui explique aussi les discours ultimes sur la transmission à Walther et sa signification. Chaque synthèse est renonciation : celle de Sachs est celle du démiurge (politique ?) qui renonce pour faire aller de l’avant la communauté et la porter vers le futur.
Pour faire percevoir ces éléments assez raffinés, le chanteur qui interprète Sachs doit être lui-aussi un maître-interprète. Le rôle est l’un des plus difficiles du répertoire, d’abord par la résistance physique, énorme, que l’on peut ne pas percevoir tellement l’opéra est fluide dans la conversation permanente, où même les monologues sont des conversations avec soi-même, tellement l’impression qui domine est plus celle de l’évidence que celle de l’effort. Mais le rôle est terrible, parce que souvent ceux qui sont des maîtres dans l’art de la conversation chantée (Franz Hawlata par exemple) ont des difficultés dans les parties plus tendues, et ceux qui n’ont pas de difficulté à l’aigu peuvent ne pas soutenir le ton continu de la conversation et du discours. Michael Volle est fascinant parce qu’il a un naturel incroyable dans le dire, parce que ses gestes et ses mouvements sont dictés par le discours, le texte et que cela donne une intelligibilité incroyable à l’ensemble. Volle donne aussi à son Sachs une sorte de distance intellectuelle, là où Wolfgang Koch, l’autre Sachs du moment, tient à maintenir une image plus populaire, plus « artisan » qu’artiste. Volle a donc une manière de noblesse dans l’expression presque innée, une attitude non pas altière, mais l’attitude du maître qui masque sa sensibilité. Il a pu quelquefois être très fatigué à la fin, mais ce 2 avril, le rôle a été dominé de bout en bout et c’est une interprétation monumentale : nous avons droit à une sorte de résumé de ce que doit être l’art du chant, l’intelligence scénique et textuelle, où se mêlent harmonieusement dire, faire, chanter, tout en faisant percevoir l’effort, la douleur, la sensibilité. Chapeau bas devant cette extraordinaire performance.
Il faut saluer tout le théâtre pour cette représentation si engagée pour tous et qui montre un spectacle de très grand niveau : preuve ultime, le groupe des apprentis, issus de l’académie de la Scala et du Mozarteum, juvénile, très à l’aise en scène, et incroyablement précis dans le chant, avec une limpidité de la parole étonnante, et des voix dont on devine qu’elles sont intéressantes. Le futur est assuré !
Je voudrais seulement faire remarquer enfin qu’Alexander Pereira, dans les trois productions de Meistersinger qu’il a montées depuis 2011, à Zurich, à Salzbourg et à Milan, n’a pas su distribuer Walther, ni d’une certaine manière Eva…fatalité ou erreur ? Malgré tout cette soirée fut de celles qu'on emporte avec soi.
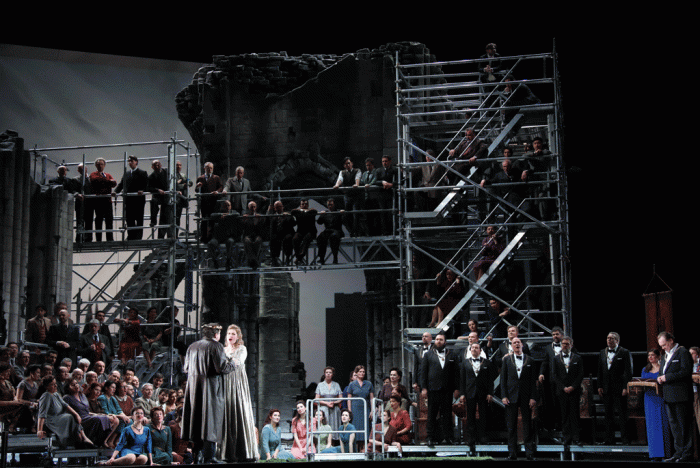

J ai vu ce spectacle le jeudi avant vous.
Une atmosphère sureale reignait.
Au parterre seulement les quinze premier rangs étaient occupés soit la moitié de la salle et une loge sur trois et seulement le premier rang de chaque.
Situation presque habituelle de ce théâtre déserté par son public.
Le public d'abonnenent n avait aucun intérêt pour le spectacle seulement présent pour revoir les amis .
Le cas habituel où orchestre chanteur et appariteurs bâclent le spectacle pour sortir plus tôt.
A la première mesure de l' opéra un miracle survint, les membres de l orchestre les choristes et les chanteurs saisient d une énergie folle offriront une des plus belles soirées de la Scala.
Le miracle d un homme Gatti.
Il est reconnu que Gatti était le favori de l orchestre à la dernière nomination qui vit vainqueur Chailly le chantre de Puccini. ..Gatti était ce soir là comme le fifre de Hamelin nous enmenont dans une ronde émerveillée.
J ai vu les meistersinger cette année à Paris, Munich et Milan.
Jourdan ne sera jamais un directeur mythique. Petrenko transcende mais Gatti est l humanité heureuse.