Castorf a fait du Ring une sorte d’illustration de l’histoire du monde et de l’Allemagne en faisant du pétrole l’Or du Ring, faisant de Wall Street le Walhalla, conformément à l’idée exprimée par Wieland Wagner dans les années 60 (("Ich bin ja ganz präzise", sagt Wieland Wagner, "Walhall ist Wall Street."in http://www.spiegel.de/spiegel/print/d‑46273447.html, 21/07/1965)).
Andreas Kriegenburg a pris l’option du conte presque moral, avec ses images à la fois fraîches et terribles, et une fin optimiste, en utilisant comme leitmotiv les dizaines de figurants qui font décor : Walhalla, Rhin, meubles, arbres sont des compositions humaines, évoquant un univers lointain et souvent souriant (le début de Rheingold, vision paradisiaque de l’amour universel) et qui à partir de la fin de l’amour, va systématiquement montrer les successifs échecs de toute tentative amoureuse, jusqu’à la perversion absolue du monde du Götterdämmerung, qui est notre monde, où le sentiment n’a plus aucune valeur puisque la seule valeur est marchande.
Même si certains font bizarrement la fine bouche, cette production est une grande mise en scène, qui de reprise en reprise continue de tenir la route avec ses images originales et sa rigueur. C’est à un journal de Ring, que le lecteur est convié, à lire au fil de l’eau, au rythme du tempo d’un Petrenko de chambre et de feu.
__________
20/07/2018 : DAS RHEINGOLD
L'apothéose du mot
Quelles que soient les circonstances et les lieux, le début d'un Ring est toujours le début d'une aventure, dans laquelle on s'installe, qui va être scandée par quatre représentations, des échanges, des interrogations, des agacements, des surprises, des émotions. Ce Ring ne fait pas exception, dans une Munich au soleil pâle, où le petit monde mélomane et wagnérien s'est donné rendez-vous, avant de passer à Bayreuth, la maison d'en face. Sous la colonnade d'entrée, on cherche des places ("Suche Karte") . C'est l'urgence des dernières minutes…
De l’amour à la chute : chronique d’une parabole
Dans la parabole presque rousseauiste qui va d’un état de nature où règne l’amour à un monde sans foi ni loi géré par l'argent et donc l'or, Das Rheingold constitue la chute initiale qui détruit l’amour.
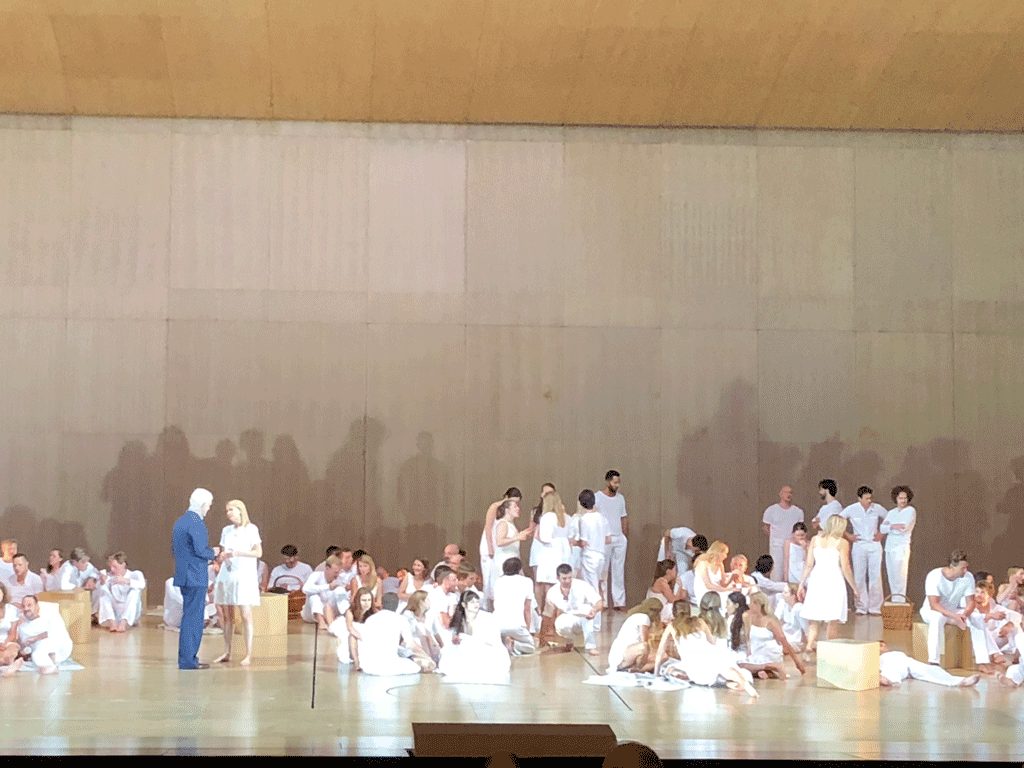
Les premières images de ce Ring, montrent un monde d’innocence, une humanité tout de blanc vêtue, en attente, à rideau ouvert, avant toute musique. Dès que le premier accord se lève, cette humanité se constitue en couples, sorte de démultiplication d’Adam et Eve qui bientôt donne une image du Rhin agité par les fornications diverses et les corps qui s’enlacent et se pénètrent. Un Rhin d’amour nourri par l’or. OR/amOR.
Dès qu’Alberich renonce à l’amour et vole l’or, ce Rhin vivant ne vomit plus que des corps désemparés.
Et l’histoire commence, avec ces Dieux inconscients aux cheveux blancs, très blancs (signe distinctif qui rappelle ce que Kupfer faisait à Bayreuth avec des cheveux roux) couleurd’un vieillissement arrêté pour l’éternité. Et un Wotan qui déjà médite de rompre les contrats des géants et de faire ce que disait Wieland Wagner de Rheingold « Tragödie der Baufirma Fafner und Fasolt » ((la tragédie de l’entreprise de BTP Fafner und Fasolt)) …
Dès lors, et pour sauver Freia, les Dieux se donnent à Loge, qui va aider à voler l’or détenu par Alberich. En bref, Rheingold n’est qu’une longue suite de roueries, de tromperies, la chute a débuté quand chacun a commencé d'affirmer son droit de propriété, qui sur le Walhalla, qui sur l’Or. Nous sommes bien dans une sorte de parabole rousseauiste de la chute, où les Dieux ne valent pas mieux que les hommes (ce qu’on verra dans Götterdämmerung).
Ce Rheingold – c’est là l’option de Kriegenburg – se déroule dans une immense boite en bois où les personnages comme des pantins s’agitent (la boite fermée est d’ailleurs une merveilleuse caisse de résonance pour les voix) les Dieux en noir (sauf Loge en magnifique costume rouge – comme chez Castorf), les Nibelungen en noir aussi, quant à eux jusqu’aux cheveux, des anti-dieux en somme, et des géants en bleu (de travail) déambulant sur des

cubes faits d’humanité enchevêtrée : ils exploitent eux aussi, et les filles du Rhin, sorte de nymphes en vert pâle, pieds nus, seuls résidus d’un monde innocent. Le travail sur les personnages n’est pas vraiment ce qui domine dans ce travail qui préfère s'intéresser aux images (Le Rhin en agitation frénétique de corps enlacés, la transformation du dragon avec des projecteurs puissants, braqués sur les spectateurs aveuglés au moment où Alberich devient invisible, le Walhalla en rempart de figurants) . Quant à l'or d'Alberich, il est bien rangé dans un coffre-fort : Alberich, comme Fafner plus tard n’en fait rien.

Une des belles trouvailles de ce Rheingold est la manière dont Loge, comme un manipulateur de marionnettes, va exciter Fasolt contre Fafner, puis donner à Fafner le poignard fatal qui éliminera le frère devenu gêneur.
Un travail visuellement souvent réussi, avec quelques chutes de tension parfois, mais le récit est logique, construit et clair.
Une distribution qui fête le texte de Wagner
La distribution réunie dans son ensemble est de très haut niveau. Le spectateur sait que ce n’est pas dans Rheingold que les voix sont mises à l’épreuve du feu, mais dans Walküre où les stars arrivent. Seuls Wotan et Fricka font en quelque sorte fil rouge. Rheingold est plus théâtral, plus conversatif, dans un style de comédie dramatique où ces dieux (et les autres) sont terriblement humains (Chéreau l’avait si bien perçu !). Il faut donc des chanteurs qui sachent se glisser dans cette humanité-là.
Wolfgang Koch est Wotan. Ce n’est pas un Wotan spectaculaire, mais un Wotan plus intérieur, plus calculateur ; la voix se plie au texte avec une science éblouissante. Le texte est dit, de manière incroyablement expressive, avec chaque accent, chaque couleur. Wolfgang Koch est un chanteur à tête, plus qu’à voix, et cela convient de manière idéale à l’option de Kirill Petrenko si attentive au texte. Son Wotan est un joyau aux multiples facettes, qui révèle des détails masqués avec une incroyable intelligence, utilisant la richesse d’un timbre chaleureux plus qu’un volume imposant (et le chemin est encore long pour Wotan, jusqu’à Siegfried…).

Face à lui, l’un des Alberich les plus impressionnants, sinon le plus impressionnant du jour. Loin des éructations et des aboiements sauvages, nous sommes en face d’un Alberich chantant, de manière impressionnante son rôle, en faisant sans doute la voix la plus marquante du plateau. John Lundgren est Alberich, jusqu’au tréfonds de sa voix. Il est lui-aussi un grand Wotan, mais il est un irremplaçable Alberich. Enfin un Alberich pourrait-on dire. Car il sont peu nombreux, ceux qui marquent le rôle.
Celui qui écrit reste marqué par Zoltan Kélemen avec Chéreau en 1977 et 1978, trop vite disparu (il est mort en 1979 à Zurich) une voix oubliée aujourd’hui mais inoubliable pour ceux qui l’ont entendue en scène. Et John Lundgren produit sur moi la même impression, depuis Kélemen il y a quarante ans, je n’avais entendu un Alberich aussi définitif : il réussit à rendre un personnage à la fois déchiré, féroce, revanchard et terriblement humain. Simplement prodigieux.

Norbert Ernst est un Loge lui aussi doué d’une rare finesse. On a peu de Loge impressionnants depuis Heinz Zednik chez Chéreau, c’est à dire des chanteurs qui restituent l’acteur et le personnage seulement par leur manière de dire un texte essentiel pour celui qui manipule tout le plateau. Norbert Ernst (qui rappelons-le faisait aussi un Loge un peu levantin chez Castorf à Bayreuth en 2014) réussit à être à la fois distancié et glacial, disant le texte avec une certaine distinction, avec les justes accents et une expression jamais caricaturale. Lui non plus n’est pas un Loge « à voix » (Klaus Florian Vogt le fut, avec brio), il est un Loge qui comme Wotan, privilégie l’intelligence du texte, privilégie l’expressivité, avec juste ce qu’il faut d’histrionisme au personnage. Miracle du « rien de trop » qui a tout.
Wolfgang Ablinger Sperrhacke retrouve Mime, dont il est un spécialiste et qui promène son personnage dans tant de mises en scène du Ring. De nouveau ce ténor de caractère construit un Mime juste, mais il n'est jamais lui-non plus trop caricatural. La mise en scène de Kriegenburg évite toute caricature. Et il en ressort comme toujours avec les faveurs justifiées du public.
Fafner (Ain Anger) et Fasolt (Alexander Tsymbaliuk) sont deux voix très différentes, celle d’Anger (Fafner) frappe plus par la puissance que par l’élégance, et reste un peu monocolore. Le Fasolt d’Alexander Tsymbaliuk en revanche avec son timbre chaud et un chant expressif et aux couleurs variées est très émouvant et représente cette part d’humanité que l’or va détruire. Grand artiste.
Le Donner de Markus Eiche laisse entendre son magnifique timbre et la voix expressive, mais le rôle ne permet pas de laisser embrasser toute une psychologie, et Dean Power en Froh est très acceptable, même si Froh peut être distribué à un futur Tristan (Siegfried Jerusalem chez Chéreau) ce que Power ne sera sans doute pas. Il reste que les deux rôles sont un peu coincés entre deux typologies, personnages de complément et personnalités. Ici, plutôt la première option, alors que chez Castorf, ils étaient magnifiquement caractérisés en personnages de feuilletons américains.
Ekaterina Gubanova est une Fricka noble, assez effacée, mais la Fricka de Rheingold est moins en vue que celle de Walküre. C’est dans le discours et la mise en valeur du texte que le personnage trouve son statut. C’est une chanteuse de Lied qui convient à mon avis, seule capable d’expressivité continue et de variations de couleur (Christa Ludwig, Elisabeth Kuhlmann, on pourrait aussi oser rêver à Waltaud Meier qui ne l’a pas à son répertoire). Gubanova, chanteuse valeureuse, est ici un peu plate pour mon goût, même avec son timbre velouté.
Golda Schultz est Freia. J’ai souvent écrit que derrière Freia se cache Sieglinde (il faudrait oser Anja Kampe, rêvons un peu d'un Rheingold avec Meier, Vogt et Kampe dans Fricka, Loge, Freia), et Golda Schultz ne sera probablement jamais Sieglinde. La voix est claire, mais l’aigu manque de corps, et le personnage reste trop fragile vocalement, avec une certaine difficulté à exister. Dans ce journal d’un Ring, qu’on me permette d’évoquer ma plus belle Freia entendue sur une scène, l’immense Helga Dernesch…
Très belle apparition d’Okka von der Damerau en Erda : la voix s’est élargie, est devenue encore plus charnue et vibrante, le timbre est riche, l’expression très juste. Nous tenons encore-là une artiste intelligente, prudente, qui reste dans la troupe de la Bayerische Staatsoper dont elle est évidemment un joyau.

Les filles du Rhin Rachael Wilson, Jennifer Johnston et Hanna Elisabeth Müller sont un ensemble de luxe, très sonore, émouvant même. Mais les aigus d’Hanna Elisabeth Müller (Woglinde) sont trop stridents et cassent un peu l’ensemble… Autant j’adore cette chanteuse depuis ses débuts, autant je ne suis pas convaincu du son de sa voix aujourd’hui à l’aigu, entre stridence et cri. Elle a perdu un peu de cette fraîcheur et du velours qui faisait sa qualité.
Que dire de l’orchestre dirigé par Kirill Petrenko qui n’ait déjà été dit. Et pourtant, force est de nous répéter à l’envi que nous tenons là une interprétation historique, par la nouveauté des choix et par la volonté de coller aux voix et à la mise en scène. En cela, Petrenko est un incroyable chef d’opéra. Il fait un choix (critiqué par certains) d’enlever aux moments spectaculaires toute rutilance inutile, pour se consacrer à l’accompagnement pointilleux et pointilliste des dialogues, avec ses qualités habituelles de clarté et de précision. Il refuse ce que ce Wagner pourrait avoir de spectaculaire et de m’as-tu vu, pour être un écrin pour la voix qui « parle » en chantant, pour le parlar-cantando des chanteurs, une option plutôt retenue (chambriste, dit Frank Castorf) qui est particulièrement théâtrale. Le moment incroyable du prélude, sorte de lave en fusion qui peu à peu envahit l’espace est totalement exceptionnel : plus encore qu’il y a trois ans en 2015, il réussit à obtenir dans cette salle classique un son (presque) « Bayreuth ». C’est totalement phénoménal.
Seule exception, la scène finale et l’entrée des dieux au Walhalla, frappe parce qu’elle est éclatante, incroyablement énergique, et procure une émotion musicale rarement atteinte, tout simplement parce qu’il faut lancer là l’orchestre à toute volée, pour marquer l’incroyable ironie de Wagner qui construit une musique triomphante pour accompagner une entrée au Walhalla où Wotan – qui le sait – a déjà tout perdu. Chéreau et Boulez l’avaient saisi en leur temps. Et Petrenko sert une entrée qui secoue, superlative et triomphale, pour un groupe de loosers. Stratosphérique. On en sort sonné.

______________________________________________________________
22/07/2018 : DIE WALKÜRE
Traité du sublime
Il y a des soirs où il se passe des choses. La fièvre est montée sous la colonnade : des dizaines et des dizaines de personnes avec l'affichette "Suche Karte" sont dispersées jusqu'aux confins de la Max Joseph Platz : tout le monde attend cette soirée qui promet d'être exceptionnelle par la distribution réunie et la première apparition de Jonas Kaufmann en Siegmund après des années.
Die Walküre, pour beaucoup, c'est le début des choses sérieuses, l'apparition de Brünnhilde, le duo Siegmund-Sieglinde, la chevauchée, l'embrasement final. On rentre, comme dit l'autre, dans le dur après un Rheingold que beaucoup considèrent comme un apéritif. Il est 16h30, un café au bar du sous-sol, quelques saluts entendus entre mélomanes, un passage au vestiaire pour se débarrasser d'un parapluie bienvenu (il pleut de manière continue), mais pas d'orage prémonitoire à ce début de premier acte.

Cette Walküre très attendue pour la distribution exceptionnelle qu’elle réunit et notamment pour le retour à Siegmund de Jonas Kaufmann après plusieurs années d’abstinence a répondu aux attentes, mais peut-être pas à ces attentes qu’on attendait, si l’on peut me permettre ce jeu de mots… Elle marque pour moi un évident passage d’un Wagner tonnant à un Wagner presque belcantiste, et en tous cas délicat. Elle marque le passage de voix dramatiques à des voix plus lyriques, ou du moins à des voix dramatiques qui savent alléger et qui mettent en avant d’abord la subtilité avant les décibels.
Est-ce le résultat d’un manque de voix wagnériennes ? Sûrement pas puisque le plateau réuni était l’un de ceux qui alimentent le marché wagnérien mondial.
C’est bien plutôt l’approche de Kirill Petrenko qui travaille dans l’accompagnement musical en se pliant aux exigences des voix qu’il a à disposition, ou plutôt en adaptant sa direction au ton vocal obtenu sur scène et en lisant la partition en fonction des paroles qu’il rend toujours audibles et claires (et à cette occasion on redécouvre le texte de Wagner tellement théâtral), mais aussi toujours en fonction des possibilité vocales et stylistiques des chanteurs. C’est une recherche permanente de la plus grande subtilité et du plus grand raffinement, là où on ne l’attend pas toujours.
L’acte I comme un Lied

Avec Jonas Kaufmann en Siegmund, Petrenko a travaillé dans l’extrême douceur, et le premier acte devient une sorte de long Lied sublime, avec un orchestre jamais envahissant, et un tempo d’une lenteur marquée, qui loin d’atténuer la tension au contraire la multiplie : la première partie de l’acte (avant le duo) est une attente qui créée vraiment une ambiance lourde, permettant d’ailleurs d’entendre les prouesses de l’orchestre (les bois notamment, et bien sûr les cuivres). On est à des années lumières d’un Wagner écrasant, on est dans un univers profondément angoissé : le crescendo d’orchestre précédant « Ein Schwert verhieß mir der Vater » (avec les appels à Wälse) avec un silence appuyé, est à la limite du supportable…
Jonas Kaufmann sculpte chaque mot, avec une délicatesse confondante qu’on n’a jamais entendue ainsi. Ce Siegmund est d’une mélancolie marquée, un Siegmund tragique plus qu’héroïque qui porte dans la voix l’échec final. On en reste interdit. Les « Wälse » tenus jusqu’à l’extrême montrent en même temps de quoi la voix est capable. On reste fasciné dans l’orchestre par l’utilisation des cordes graves (violoncelles !) en sourdine qui obscurcissent l’ambiance, y compris lorsque le duo commence, ce qui reste le seul moment d’espoir vrai de tout le Ring (pour qui ne croit pas au couple Siegfried-Brünnhilde), et « Winterstürme » est vraiment chanté comme une mélodie et non un « air », de quoi en être éberlué.
Anja Kampe n’est pas en reste, la voix a gagné en puissance, en homogénéité mais garde les qualités d’intensité et d’expressivité qui font son prix, ligne de chant impeccable, explosions de couleurs, incroyable intelligence du mot, mais aussi un engagement scénique proprement stupéfiant. On sait qu’Anja Kampe était en Argentine il y a peu, pour Isolde, et elle n’a pu répéter longtemps, mais il y a entre les trois, Kaufmann, Kampe, Petrenko une telle alchimie que l’on a l’impression de longues semaines de travail…L’évocation de ces moments à eux seuls font ré-émerger les émotions…
Tout cela rend le premier acte le plus poétique, le plus fébrile, le plus tendre, le plus étonnant jamais entendu. Étonnant parce que même quand la musique accélère, on revient aussitôt à cette tension pesante. Il n’y a pas de joie explosive mais une tendresse permanente et à l’orchestre et dans les voix : c’est proprement hallucinant. C’est vraiment un Wagner, au sens propre inouï, jamais entendu.

La mise en scène, avec cet arbre central où pourrissent des cadavres en décomposition, qui semble soutenir le plafond reste assez classique sans être traditionnelle et d'une grande beauté plastique. L’armée de servantes qui préparent une table riche, comme les tables de festins médiévaux avec d’un côté Siegmund et de l’autre le Hunding de Ain Anger (à la voix vraiment puissante et profonde, mais sans toujours être si expressive) entourent les protagonistes, comme des prêtresses qui prépareraient une cérémonie, munies de lampes qui éclairent tour à tour la table, ou l’épée. Ce ballet des servantes est esthétiquement réussi, et notamment certaines scènes initiales comme ce verre que Sieglinde (à cour) tend à Siegmund (à jardin) et qui passe de main en main jusqu’à arriver au destinataire, comme pour empêcher que les deux se rapprochent, et la lenteur de ce rituel répond avec à propos à la lenteur du tempo, mais aussi à l’atmosphère vaguement religieuse de cette rencontre, qui devient une sorte d’union divine.
Et la musique ne s’accélère qu’à l’ultime moment, les dernières mesures sont prises à un tempo étourdissant (les cordes !!), créant un contraste aux limites. Explosion finale d’un public sens dessus dessous.
Acte II : le chant de la désespérance
Évidemment, après pareil acte I, le reste risquait d’apparaître peut-être plus entendu, plus habituel. Difficile démettre là-dessus un jugement définitif.
Peut-on faire la fine bouche avec pareil plateau : nous nous situons à un niveau qui aujourd’hui peut difficilement être atteint ailleurs.
Le deuxième acte contient évidemment d’autres sommets, même si Nina Stemme au départ a quelque difficulté avec des « Hojotoho » au souffle un peu court.

Ekaterina Gubanova s’affirme dans la scène avec Wotan (avec la mise en scène étrange de cette cloison qui rétrécit l’espace à mesure que Wotan se rend compte qu’il est coincé, avec ces figurants qui se transforment en fauteuils), c'est ici évidemment le moment de Fricka (bien plus que dans Rheingold); voix homogène, beau timbre, belle présence scénique, Gubanova y st particulièrement spectaculaire, et Wolfgang Koch montre les qualités de toujours, à savoir une interprétation ciselée, un travail du texte sans doute unique, donnant à chaque mot son poids et sa couleur, avec un timbre velouté. Ce Wotan, qui fait de son récit « Als junger Liebe Lust mir verblich,» le moment éblouissant du rôle tout en intériorité, tout en amertume, est d’ailleurs aidé par la mise en scène de Andreas Kriegenburg : elle en fait à ce moment un monologue intérieur avec Brünnhilde en fond de scène un peu désemparée. Car Wotan comprend bien que tout est perdu. Wolfgang Koch est lui aussi un chanteur d’une rare intelligence, qui sait s’adapter à toutes les mises en scène, et qui n’est jamais aussi étonnant qu’avec Kirill Petrenko avec qui il partage la passion du mot. Ce n’est pas un Wotan vocal au sens où il s’imposerait par une puissance notable. La voix n’est pas énorme, mais c’est aujourd’hui pour moi le meilleur interprète de Wotan, qui fait ressortir tout le personnage, avec ses espoirs, ses faiblesses, ses explosions aussi.

Dans cet acte Anja Kampe se montre hallucinée, presque somnambule, avec une intensité vocale qui continue de bouleverser, tandis que l’annonce de la mort (la Todesverkündigung) montre une fois de plus un Kaufmann d’une douceur inédite, ineffable, un chant "ailleurs", bouleversant de vérité. Nina Stemme en Brünnhilde est en revanche un peu plus plate, même si la voix est somptueuse. On reste tellement fasciné par la prestation de Jonas Kaufmann que Brünnhilde s’efface derrière ce Siegmund tout intérieur et méditatif dans un chant du cygne qui étreint.
Ce n’est pas le meilleur moment de la mise en scène que ce deuxième acte, au moins la deuxième partie, le combat et la fin de l’acte sont assez banalement réglés et on reste un peu scéniquement sur sa faim, mais il y a des moments de vocalité qui tiennent du joyau.
Acte III : bouleversant , au final bouleversé

Le troisième acte a connu ses « événements » inattendus qui ont surpris, voire angoissé.
D’abord, le fameux ballet initial où les danseuses miment des chevaux a mis en colère un public impatient qui comme d’habitude a hué ce moment (c’est traditionnel), mais avec plus d’intensité qu’attendu. Kriegenburg traite les Walkyries comme des animaux machines, qui existent pour un seul job, sans grande psychologie, elles lancent leurs répliques au public (chez Castorf, elles dialoguent dans une sorte de conversation un peu éperdue) avec une belle puissance (la Helmwige de Daniela Köhler est, au bas mot, somptueuse), la scène est relativement spectaculaire et un peu ironique, avec les danseuses-chevaux presque à l’écurie en fond de scène, et les Walkyries qui jouent avec rênes qui s’entrecroisent emprisonnant Brünnhilde et Sieglinde, au milieu des cadavres des héros au bout d’une pique. Assez banal au total.
Et là aussi bien Anja Kampe que Nina Stemme vont montrer ce que sont des voix en majesté : Anja Kampe fait de « O hehrstes Wunder ! Herrlichste Maid ! » un moment incroyable d’énergie qui bouleverse, la voix est magnifiquement posée, l’ensemble est fluide, le passage est homogène, la puissance est réelle : c’est exceptionnel, inoubliable même.
Nina Stemme pour sa part semble avoir réservé ses meilleurs moments pour le troisième acte : on retrouve cette voix charnue et puissante, on retrouve l’intensité, la couleur, l’engagement, on retrouve aussi un volume qui remplit la vaste nef du Nationaltheater. Un moment de chant grandiose, qui tranche nettement avec la relative pâleur du deuxième acte.
Wolfgang Koch nous a gratifiés tout au long de l’acte des qualités d’émission et de phrasé déjà développées au deuxième acte, avec des moments de grande intensité : le chant est formidable d’ambiguïté : il sait montrer une colère née de la déception et communiquer ce drame intérieur un peu désespéré qui le contraint à abandonner Brünnhilde par un chant vraiment habité. Ici il devient vraiment un personnage tragique.
Mais voilà, à la toute fin du dialogue avec Brünnhilde, au moment de l’adieu :
« Denn einer nur freie die Braut,
der freier als ich, der Gott ! »
la voix s’est affaissée, a perdu toute projection et a fait entendre un dangereux enrouement. Quand le spectateur sait ce qui reste encore au personnage à chanter, avec les notes aiguës de l’appel à Loge (« Loge ! Loge ! hierher !»), l’angoisse de voir un tel artiste en difficulté étreint. Certes, le chanteur n’est jamais une machine et la voix est un instrument bien délicat et terriblement humain, mais lorsqu’au moment le plus intense de l’acte un accident arrive, il y a de quoi frémir.
C'est compter sans les miracles de l’intelligence et l’incroyable ductilité de Kirill Petrenko en fosse, qui a immédiatement fait en sorte que volume et tempo permettent au chanteur de retrouver son chemin. Wolfgang Koch a pu continuer, presque en murmurant – et c’était très émouvant et scéniquement si juste – mais toujours attentif au texte et au mot. Il a fini par retrouver peu à peu du volume pour chanter sans encombre, moins fortement peut-être, mais tellement poétiquement toute la scène finale sans accident aucun. Et de cet accident vocal, il a pu faire un moment de plus grande émotion encore, d’autant plus ressentie et partagée par la salle, plus tendue de peur que la voix de nouveau ne se brise. On reconnaît-là les grands.
L’accompagnement orchestral n’en a été que plus intense, transparent et fluide, mais en même temps sculpté et particulièrement vécu, et ainsi cette fin a été l’une des plus émouvantes, l'une des plus sensibles qui m’aient été données de vivre. Il me faut remonter à Boulez-Chéreau pour avoir ressenti dans un autre ordre d’idées, plus esthétique, pareille émotion en écoutant Boulez construire un final de cristal sur fond d'image impossible à oublier.

Pour toutes sortes de raisons que le lecteur comprendra, les sources d’émotion intense ont été nombreuses. On peut sans doute discuter l’approche résolument délicate de Petrenko, mais il avait les voix pour et il s’y est adapté, comme dans cette scène finale où les cartes ont été brutalement et si justement rebattues. Petrenko emmène "ailleurs", dans des paysages sonores inédits pour Wagner ; on peut aimer – c'est mon cas‑, on peut aussi regretter un Wagner plus « expressioniste », plus "grandiose" . L’interprétation évolue, et c’est la loi du genre. Voilà ce qu’est une soirée d’exception, où tout, bon comme moins bon, participe à rendre les choses mémorables.

______________________________________
24/07/2018 : SIEGFRIED
Comme un scherzo

Il fait très beau en ce 24 juillet. Et je me livre à un jeu amusant dans le SBahn (le métro régional), repérer les spectateurs qui vont à l’Opéra. Il y en a toujours quelques-uns, plutôt habillés et donc repérables. Munich est une salle « habillée » (à la différence des salles berlinoises, et de Paris, plus casual ), d’autant plus en période de Festival. À « Marienplatz », tous les futurs spectateurs sortent du train et c’est assez amusant de voir cette procession vers le temple… On a les amusements qu’on peut, je sais.
Le rituel d’avant spectacle est toujours le même, quelques « Suche Karte », mais moins que pour Walküre (il n’y a pas Kaufmann…), un rapide café, et il faut déjà aller en salle.
De Spinoza à Rousseau
Siegfried est sûrement le plus virtuose des quatre opéras mis en scène par Andreas Kriegenburg. C’est en tous cas dans Siegfried que les compositions humaines qui illustrent ce Ring prennent une importance que d’aucuns estiment envahissante et que je trouve au contraire très séduisante : forge, arbres, terre, rocher en flamme, dragon, les images se succèdent avec une inventivité rare et toujours une discrète ironie. Le conte se déroule, comme une projection de l’imaginaire enfantin de Siegfried, comme un album de Folon qui deviendrait humain. C’est vraiment de la belle ouvrage.
Le premier acte est à ce titre exceptionnel. Les ambiances se succèdent de manière très serrée, on passe d’une sorte de grotte (un drap tendu où Mime forge) à une forge « en dur », le paysage varie : arbres et rochers où défilent les images du passé (magnifique moment où Siegfried voit sa mère mourir et où elle lui tend une main qu’il essaie en vain d’attraper), herbe tendre, tournesols et petits nuages à l’arrivée du Wanderer, puis énormes machinerie de la forge, l’un des moments les plus séduisants avec tous les détails qui pris singulièrement semblent absurdes (le broyeur à papier) mais qui prennent sens par cette forge métaphorique et enfantine qui est construite en un éclair autour de Siegfried avec le moment le plus délirant quand Siegfried termine Notung en faisant des étincelles… de paillettes !
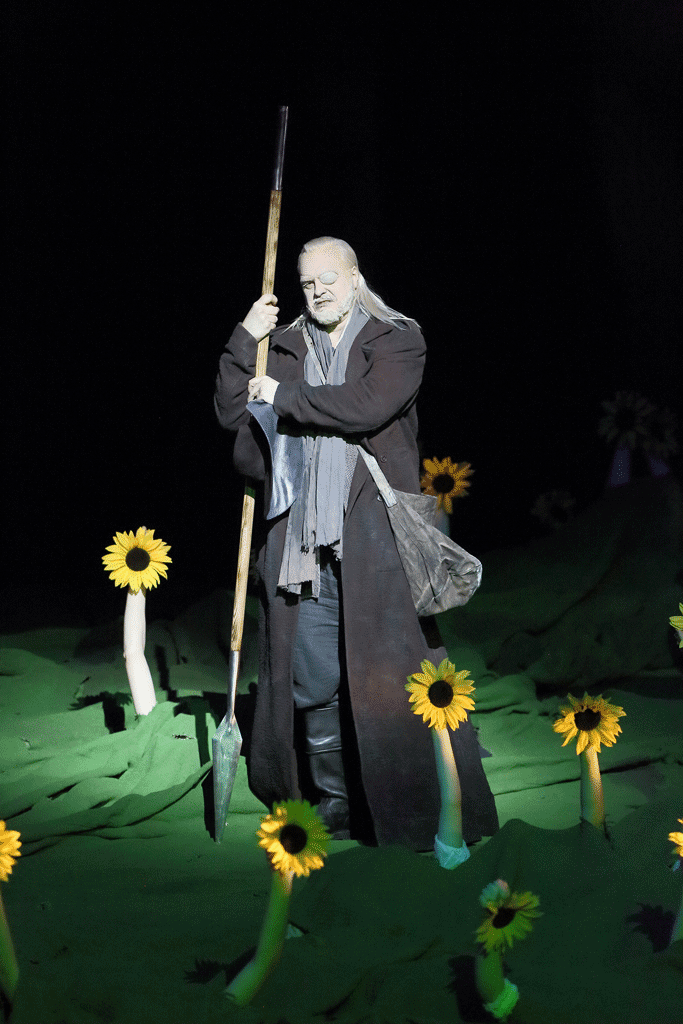
C’est bien le caractère de ce travail de revenir au récit, médiatisé par les images d’un album enfantin, et où l’humanité est outil souriant et primesautier. L’histoire raconte un drame, mais qui est toujours mis à distance par l’image. Et Siegfried convient encore plus à l’entreprise, parce que Wagner a voulu son Siegfried « innocent », – il le sera jusqu’au bout du drame – et étonné devant le monde. Le roman d’éducation de Siegfried a commencé par Mime, une éducation par l’ennemi, et une éducation ratée parce que Siegfried, confusément sent qu’en Mime quelque chose ne fonctionne pas. Mais Siegfried est un être libre, et donc incapable de former un concept de bien ou de mal, comme le dit Spinoza ((Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien ou du mal aussi longtemps qu’ils seraient libres)). En écoutant d’ailleurs tout le premier acte et les interrogations du jeune homme, on se rend compte que cette éducation est là aussi rousseauiste, par l’expérience autodidacte, par l’image, par le regard, par la nature, d’où d’ailleurs la manière dont il va forger Notung, pur exemple d’inventivité par l’expérience. Siegfried apprend à la fois de Mime dont il se méfie, et de la nature dont il se fie, et ce savoir empirique l’amène aux questions décisives sur ses origines. Tout ce premier acte d’ailleurs pose la question du savoir, le savoir universel d’un Wanderer, le savoir de Mime (partagé d’ailleurs par son frère Alberich, comme on le verra au deuxième acte), mais un savoir qui a ses limites (consultation d’Erda au troisième acte). La mise en scène d’Andreas Kriegenburg souligne cette parabole du Paradis à la Chute, une chute dès Rheingold, où Wotan apprend son futur échec à travers Erda. Et il va néanmoins persévérer, tout en sachant qu’il va perdre : « le héros tragique dispute à une fatalité virtuellement écrasante un destin qui n’appartient qu’à lui ».

De tout cela, de tout le savoir du monde, Siegfried se moque, et il l’apprendra à ses dépens, mais il apprend vite aussi. Il apprend notamment le désir, un désir animal qu’il va imposer à Brünnhilde au dernier acte où très intelligemment la mise en scène fait du lit l’enjeu unique, et non un quelconque amour romantique : coucher ou ne pas coucher, voilà la question. Siegfried comme roman d’apprentissage, et Brünnhilde comme instant de désapprentissage. Brünnhilde désapprend en transmettant à Siegfried les runes…on verra dans Götterdämmerung ce qu’il en fera…Ce Siegfried raconte l’histoire très lointaine des contes, celle des mythologies rêvées par l’enfance, avec des images presque surréalistes loin des valeurs du monde et Kriegenburg réussit à construire un monde vu par Siegfried, un monde vu par l’innocence dont les significations peuvent échapper, mais qui réussit à faire rêver.
La musique comme un piège enivrant
Musicalement, si nous restons à un niveau exceptionnel, les voix semblent légèrement sur la réserve, avec un Stefan Vinke un peu fatigué. On le perçoit au son très nasal de sa voix dès le début, un signe qui chez lui ne trompe pas. Le Wanderer (Wolfgang Koch) est très prudent, après son accident de Walküre, même l’Alberich somptueux de John Lundgren semble en sous-régime, et seul Wolfgang Ablinger-Sperrhacke chante pleinement Mime, avec ses habituelles qualités de diction et d'expression, mais aussi une voix bien projetée. Okka von der Damerau est une Erda puissante et intense : la voix a gagné en largeur et en présence et son apparition au milieu des corps qui semblent autant de vers de terre géants est une des images les plus réussies de la production.

Quant à Nina Stemme, elle résiste sans toujours triompher des pièces de cette partie redoutable qu’est la Brünnhilde de Siegfried, sans doute le moment le plus difficile du Ring, où tout est chanté à froid, et où en une quarantaine de minutes elle passe de la joie à l’angoisse, de l’exubérance à l’intériorité, de l’amour au désir, et au désir de mort. Tout cela demande une voix ductile, déjà chaude dès le réveil. Et Nina Stemme a souvent quelques hésitations vocales dans ce rôle, on l’a entendu assez souvent pour le constater. Ce soir, le réveil a été sublime et l’ensemble du duo est extraordinaire d’intensité.
Le Siegfried de Vinke est résolument héroïque, et la Brünnhilde de Stemme darde des aigus larges, chauds, somptueux. Nous sommes au sommet jusqu’aux dernières notes, fatales à l’un et à l’autre : Vinke épuisé (il y a de quoi) rate un peu sa sortie et Stemme lance son « Tod », en évitant le passage en fluidité et en reprenant trop sa respiration si bien que l'effet de l'aigu final retombe en devenant simple cri.
Petrenko, démiurge et sorcier
Qu’importe, car cela reste un très grand moment, et un moment soutenu à l’orchestre par un Petrenko se promenant une fois de plus sur les sommets.
Il a dirigé ce Siegfried comme un scherzo, vif, nerveux, contrasté. Les moments de discours comme toujours merveilleusement accompagnés (premier acte) : Petrenko exige beaucoup des chanteurs, mais les soutient en fosse de manière incroyable car il les écoute, ce qui n’est pas le cas de tous les chefs plus soucieux de leurs propres effets. Il les écoute et module les volumes et les interventions en fonction de ce qu’il perçoit d’une voix : c’est en même temps particulièrement intuitif. Mais nous ne sommes plus dans l’adagio chambriste de Die Walküre, nous sommes au cœur du jeu et de l’aventure, et la musique joue aussi son rôle d'illumination au sens rimbaldien du terme.
Il y a toujours danger à écouter Wagner et se laisser piéger par l’ivresse musicale, car derrière l’ivresse se cache la gueule de bois et le réveil en tragédie. Ainsi du duo final, lancé par Petrenko de manière sublime (le réveil « Heil dir Sonne » est un des moments les plus bouleversants de la soirée) : il sait être lyrique et faire chavirer par une musique qui à la fois nous emporte et nous emprisonne ; l’orchestre appuie dans les moments les plus lyriques (l’Idylle) et insiste avec tant d’urgence, tant de contraste, tant d’excès presque qu’il montre lui-même qu’il y a là quelque chose de factice, quelque chose qui ne fonctionne pas, du genre « trop beau pour être vrai ». Petrenko joue avec son orchestre pour faire parler cette musique, au-delà des paroles même, c'est pure sorcellerie évocatoire.
Et c’était aussi le cas au deuxième acte, où entre le combat verbal des deux larrons Alberich et Wanderer, avec cet Alberich éternellement jeune et ce Wotan éternellement vieux, l’un habité par l’espoir fou qui ne s’éteindra même pas au Crépuscule (il est le seul à survivre avec Gutrune), l’autre habité et par l’espoir et par la certitude que tout est irrémédiablement perdu. ainsi de sa tentative désespérée d’arrêter Siegfried, qui est tentative d’une part et test d’autre part : test de sa puissance perdue, définitivement. Et Petrenko dit tout cela dans la musique tantôt ensorceleuse, tantôt glacée, tantôt excessive et tantôt intérieure, en jouant le tout et son contraire, en se jouant des contrastes en les lissant par une fluidité incroyable, par une respiration haletante qui ne fatigue jamais, en faisant entendre des petites musiques instrumentales qui contredisent la mélodie dominante, en nous piégeant. Il nous ensorcèle par Les murmures de la forêt, autre élément de l’éducation de Siegfried, faite de ce sentiment de la nature à la fois très romantique et très rousseauiste, une nature païenne qui parle directement sans le medium de la parole et où tout est plein d’âme). Au contraire l’apparition du terrible dragon de contes de fées est accompagné d’une musique en crescendo, écho de l’effet à produire, un effet qui sur Siegfried n’est qu’un jouet de théâtre. Le spectateur est balloté de l’un à l’autre, d’une musique qui nous y fait croire et d’un spectacle qui distancie au maximum parce qu’il nous assomme d’effets scéniques surprenants. La musique nous dit « c’est impressionnant » et la vision nous « joli effet ». Le spectateur est déchiré entre croire ou ne pas croire, et c’est tout l’enjeu de ce Siegfried, savoir, ne pas savoir, croire, ne pas croire, aimer et désirer, désirer sans aimer, aimer à loisir ou aimer et mourir. Encore une soirée prodigieuse.
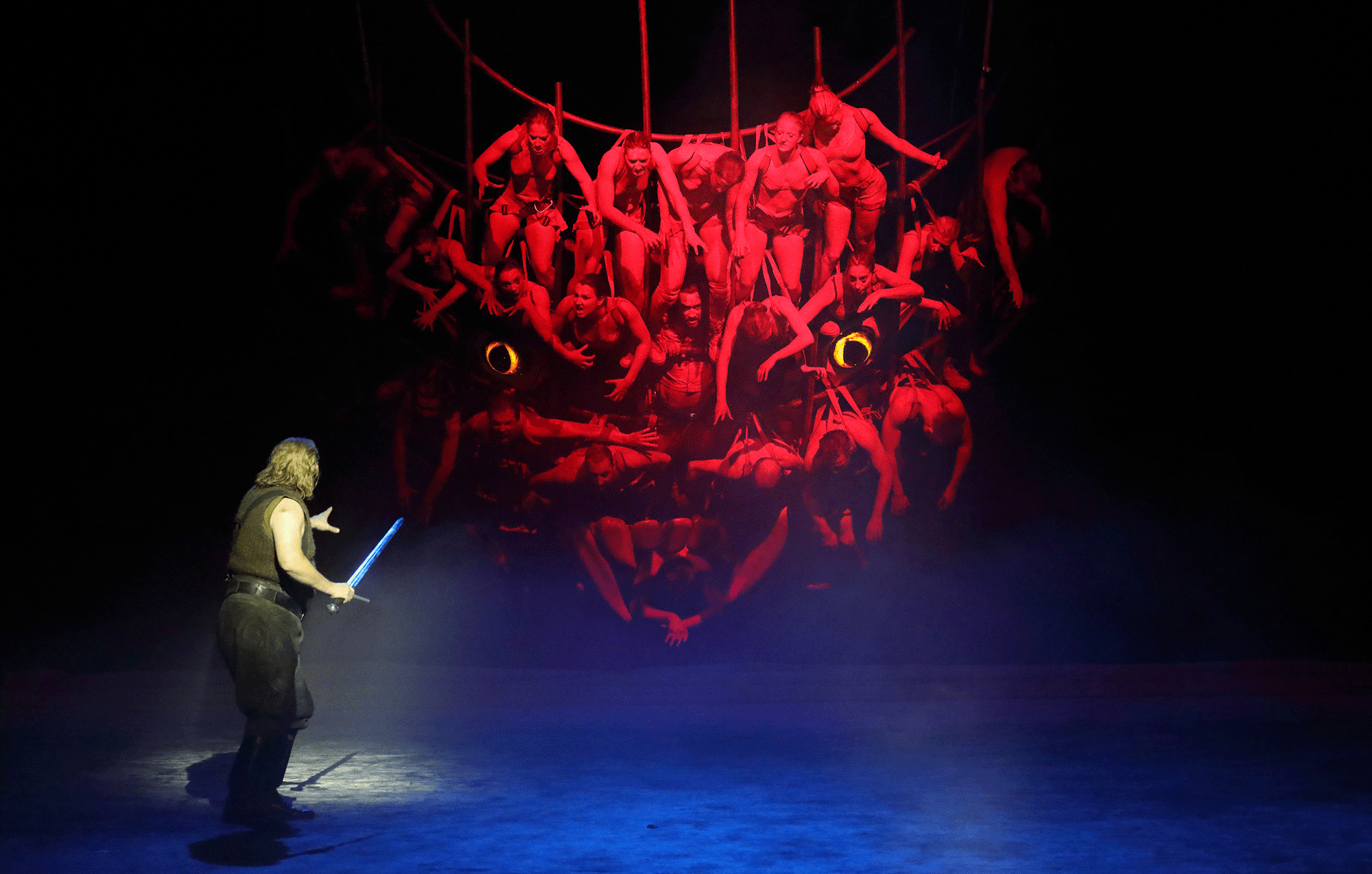
_______________________________________________________
27/07/2018 : GÖTTERDÄMMERUNG
Le dernier jour : l’Eden, et après ?…
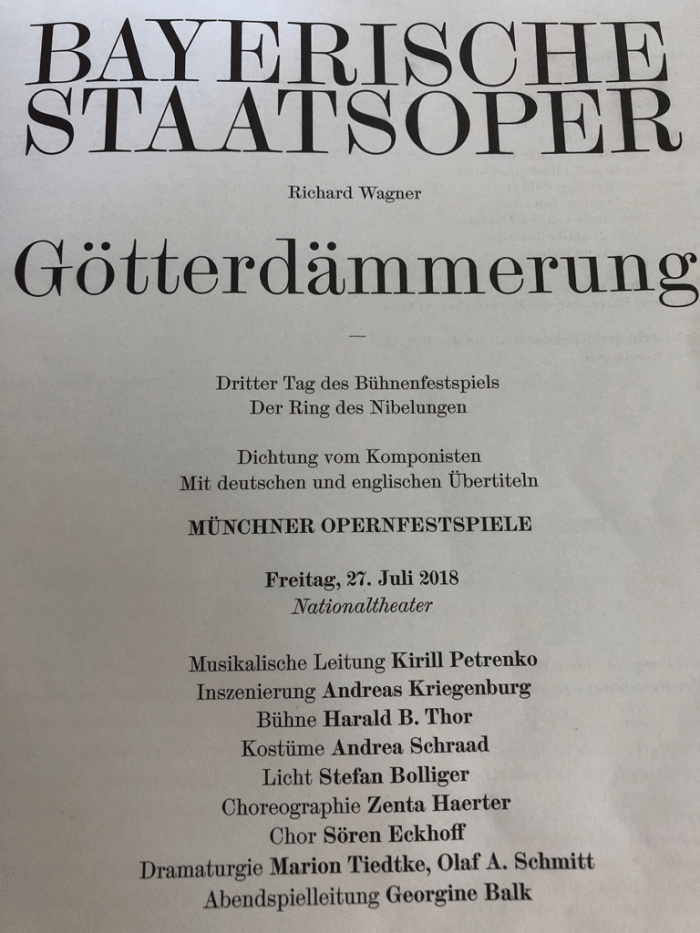
Le public est bigarré ce soir (ou cet après-midi, car tout commence à 16h). Il fait si chaud que plusieurs spectateurs sont en short ou bermuda et espadrilles : adieu habit, papillon, chemise, cravate… d’autres profitent d’un passage aux lieux d’aisance pour s’habiller en hâte, quitter l’habit estival pour l’habit festival, et d’autres enfin se rafraichissent avec la glace à la vanille au coulis (chaud) de framboises, une tradition de plusieurs décennies ici. Mais on sent l’excitation du dernier jour : les « Suche Karte » sont nombreux…
Le dernier soir du Ring est toujours en effet un moment nostalgique, car l’aventure se termine. Quand elle a donné l’occasion de vivre des moments exceptionnels, alors s’ajoute l’angoisse de la fin, plus que trois, deux, un acte… et lorsqu’on est en salle, le troisième acte est une lutte contre le chronomètre, tant on refuse l’idée de la fin. C’est ce qui se passe ici, dans cette écrasante chaleur d’été munichoise.
La mise en scène d’Andreas Kriegenburg fait de ce Götterdämmerung la fin de la parabole.
On est parti avec Rheingold d’un Rhin paradisiaque fait de corps forniquant innocemment, le Rhin final du voyage de Siegfried est en revanche noir, dernier avatar du conte qui a prévalu jusque-là. Déjà les Nornes évoluent dans un monde menacé par Fukushima et leur fil se rompt au milieu des victimes irradiées. En 2012, l’événement encore récente était très présent dans les esprits. Est-il chassé de notre oublieuse mémoire ? Pas vraiment. Le monde est une menace, sans grand espoir.
Le réveil auroral de Brünnhilde et Siegfried, ainsi que le départ de ce dernier sont les derniers soubresauts de la mythologie "d’avant", de celle des deux précédents jours et du prologue. Le voyage de Siegfried sur le Rhin se termine au contraire dans un brouhaha de population indifférente, uniformément grise, avec les serviettes en cuir des employés de bureau, et Siegfried qui dominait le Rhin est balloté par ce flot qu’il ne comprend pas, qu’il regarde et qui ne le regarde pas. Un monde sans échanges, sans regards, le monde d’aujourd’hui qui ne regarde que « Gewinn », projeté à l’envi, l’appât unique : le gain.
La chute chez les hommes
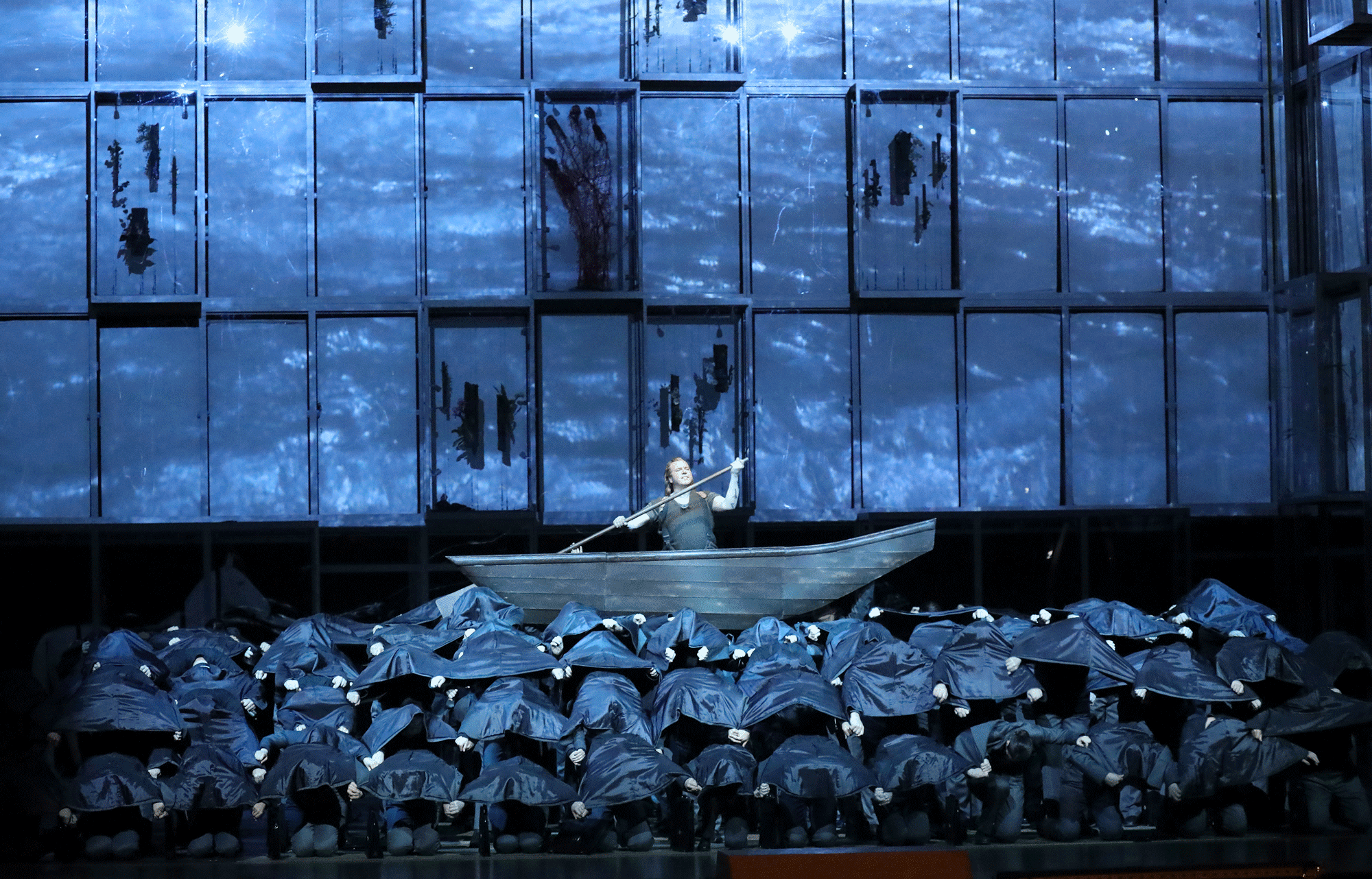
Siegfried va tomber chez les Gibichungen, souverains de ce monde-là, un monde de fashion, de mode, sex fashion et vidéo. Et Siegfried est cet « enfant sauvage » cet « étranger dans la ville » qu’on va pouvoir manœuvrer à plaisir. On était dans le conte et dans la tragédie mythologique, on tombe dans le film de série Z, dans ce que Boulez appelait la « ferblanterie », dans le monde des trafics et des médiocres : c’est le monde du Götterdämmerung dont Brünnhilde aussi va être l'instrument et la victime : Gunther joue au golf en essayant de tirer au but dans une femme de ménage jambes écartées, et Gutrune (Anna Gabler à l’extraordinaire présence et composition scénique) se balance sur un cheval de bois en forme de symbole de l’Euro.
Quant à Hagen, il use de prostituées et gère la petite maisonnée, un vaste hall de verre et de métal, rempli d’employés, d’ombres qui circulent de haut en bas et de cour à jardin, où à gauche traînent une armure et des costumes, et à droite un bar à cocktail. Siegfried a d’ailleurs du mal à comprendre l’usage de la paille pour boire et du cigare. Alberich au contraire au deuxième acte comprend tout de suite et en emporte pour la route…

Bien des choses intelligentes dans cette mise en scène, au-delà de l’image initiale de Fukushima peut-être un peu politiquement correcte (en 2012)… En 2018, Brünnhilde serait peut-être victime de #Metoo… Très juste au contraire la vision d’un monde livré à l’or et donc ignorant définitivement l’amour, où Siegfried est une sorte d’icône médiatique lors de son mariage avec Gutrune (tant de mobiles les prennent en photo) et où le peuple est manœuvré par une oligarchie au pouvoir. Dans ce monde ravagé en chute libre, Kriegenburg a peut-être donné son meilleur à la fin, où la scène est partagée entre Brünnhilde dans ses derniers feux, et Gutrune qui se dépatouille du cadavre de son frère, désespérée, essayant de le traîner et s’enroulant avec lui dans son pauvre voile de mariée. La pathétique et la magnifique.
Si Kupfer fixait la dernière image jadis sur Alberich (à Bayreuth) seul survivant du naufrage, Kriegenburg se fixe sur Gutrune, l’autre survivante dont on ne s’occupe jamais. Elle reste seule en scène, en larmes, errante, et arrivent du fond pour la dernière image ces êtres en blanc qui ouvraient Rheingold pour reformer autour d’elle la corolle initiale. Ainsi se ferme ce Götterdämmerung sur une note d’espoir : Gutrune retrouve l’humanité et la solidarité, et sur la note cyclique : tout peut recommencer, et l’humanité mythologique retrouvée est prête à retraverser l’aventure, comme un éternel recommencement. Magnifique image.
Ce travail résiste au temps : les images restent fortes, même si on les attend. Le propos est juste, les personnages très bien dessinés, le récit précis. C’est une production qui peut ou qui doit encore durer.
Une distribution superlative
Évidemment, Gesamtkunstwerk oblige, sans personnages forts sur scène et sans fosse superlative, les choses iraient peut-être autrement. Et toute la distribution, dans la conscience de la dernière représentation du Ring dirigé par Petrenko (qui fait saluer l’orchestre en scène, une rareté ici), se donne totalement à l’affaire.
Les Nornes (Okka von der Damerau, Jennifer Johnston et Anna Gabler) sont somptueuses : la voix de Okka von der Damerau impose sa largeur et son sens dramatique, et le moment est particulièrement fort, l’ensemble des trois n’est jamais sur-chanté, assez intériorisé quelquefois : c’est vraiment un chant sensible et intense.
Hanna Elisabeth Müller est moins exposée dans les Filles du Rhin (avec Rachael Wilson et Jennifer Johnston) et leur ensemble du troisième acte est plus homogène et a gagné en musicalité, leur chant s’impose en scène d’une manière nette dans cette scène très bien menée où Siegfried émerge des vapeurs de Morphée (lendemain de mariage, au milieu des corps endormis et enchevêtrés, bourrés d’alcool et de sexe).
Entre John Lundgren (Alberich) et Hagen (Hans-Peter König), il y a comme un décalage. Alberich est le père et Hagen le fils, mais le vieux, c’est Hagen, tombé dans le monde des hommes et donc du temps, tandis qu’Alberich reste dans ce monde sans fin de la mythologie, comme alimenté en permanence par le carburant de la vengeance et ne connaissant ni lassitude ni vieillissement. Lundgren est impressionnant dans son phrasé, dans son urgence, dans sa manière de se mouvoir.

Hans-Peter König n’a plus la voix d’antan et il compose un Hagen ad hoc : un personnage mûr, une sorte de patriarche politique et roublard, en costume trois pièces, qui roule dans la farine et Gunther et Gutrune et Siegfried et Brünnhilde. Entre Alberich et lui, il serait presque la figure paternelle. Cet Hagen est lui aussi empreint d’humanité : Wagner d’ailleurs lui donne un espace de regrets et presque d’amour (l’évocation de la mère). Au contraire des figures mythologiques, il est l’homme non d’une obsession, mais d’un calcul politique, tellement humain. Hans-Peter König, avec son timbre légèrement voilé, ses graves un peu problématiques, garde un aigu autoritaire et bien projeté comme dans l’appel aux compagnons du deuxième acte :
« Hoiho ! Hoiho hoho !
Ihr Gibichsmannen, machet euch auf ! »
où il reste impressionnant. Personnage puissant avec une présence scénique singulière, cet Hagen (qui reçoit une ovation triomphale) reste un exemple d'adaptation aux nécessités du moment, avec une rare justesse, et même une rare sensibilité.

On l’a souligné, Anna Gabler est une Gutrune irremplaçable. La voix est bien placée mais petite, elle n’a pas forcément le format d’une Gutrune (chanté souvent par des Sieglinde : il y a une homogénéité vocale entre Freia, Gutrune et Sieglinde), mais quelle présence, quels mouvements en scène avec ces robes à traîne, et ce corps toujours ondulant, qui semble intéressé à déambuler comme un mannequin mais pas vraiment à penser…Elle reste prodigieuse dans cette production.
Markus Eiche est plus à l’aise dans Gunther que dans le Donner un peu pâle de Rheingold. Timbre chaud, lumineux, phrasé impeccable, expressivité notable, couleur, diction : un modèle de musicalité, et un personnage remarquable exprimant faiblesse, veulerie et médiocrité. Typique d’un Götterdämmerung vu comme Menschendämmerung.

Okka von der Damerau était aussi Waltraute, dans une des scènes clefs de l’œuvre où Brünnhilde dit définitivement Adieu aux Dieux. Elle s’impose avec une voix homogène dans tout le registre et large, avec des aigus bien tenus et somptueux. La voix s’est étoffée, et elle est prête sans doute à d’autres rôles de mezzo qui requièrent puissance et présence. Elle fut simplement grandiose.
Stefan Vinke était sans doute plus à son aise dans le Siegfried de Götterdämmerung que dans celui de Siegfried, avec son côté brave type et « lou ravi » il est parfaitement le personnage voulu par Kriegenburg. Le duo initial avec Brünnhilde est puissant et juste, les aigus redoutables du deuxième acte sont négociés et passent de justesse, mais l’ensemble est notable et le troisième acte est très émouvant : il a une sorte de mélancolie déchirante, qui remplace sa joie de vivre, avec une sorte de sourire déçu dans la voix où il fait merveille. C’est un chanteur qui reste scéniquement assez plat, promenant un éternel sourire et pas toujours très engagé quand il faut vraiment jouer, mais cette mise en scène lui convient bien et tout son troisième acte est remarquable, et même sensible.
La Brünnhilde de l’époque
Nina Stemme était Brünnhilde, comme l’hiver dernier et comme en 2013. Même si je n’ai pas toujours défendu la chanteuse par le passé, force est de mettre chapeau bas. Certes, sa Brünnhilde du Götterdämmerung est toujours exceptionnelle, c’est celle qui lui convient le mieux et de très loin. Nous nous situons donc à un niveau habituellement tellement élevé qu’il est difficile de croire que cette fois, ce fut encore plus grand, encore plus intense, encore plus large, encore plus sauvage : ce fut géant. La voix était dans une forme fabuleuse. Stemme n’est pas une actrice au sens où le jeu ne l’aide pas. La voix suffit et entraîne le corps : la voix est telle qu’elle fait jeu. Les aigus hallucinants, l’homogénéité de l’ensemble du spectre, la largeur vocale, la clarté du texte (ce qui n’est pas toujours son fort), l’incroyable engagement font le reste et emportent cette Brünnhilde vers la légende. Il y a d’autres Brünnhilde superbes. J’en ai entendues des émouvantes (Behrens), des solides (Polaski), des bouleversantes (Jones). La Brünnhilde de Nina Stemme est impressionnante : elle cloue sur place et arrête toute discussion et comparaisons et rejoint ces légendes wagnériennes aux voix écrasantes, qui peuplent nos fantasmes. Stemme est définitive, avec son timbre chaleureux, avec sa projection exceptionnelle, avec sa puissance aujourd’hui unique, et avec ce zeste d’humanité qui la différencie d’autres voix similaires, plus fixes, moins ductiles. Elle met la salle à genoux, comme rarement.
Le génie de la fosse
Tous ces artistes ce soir-là exceptionnels, incandescents pour certains sont évidemment galvanisés par une direction musicale qui ne cesse de les solliciter et de les soutenir. Il serait injuste de ne pas inclure dans cette fête le choeur exceptionnel du deuxième acte, qui réussit à la fois à écraser par son volume et sa vigueur, mais aussi séduire par la manière de moduler et la variété des couleurs. Petrenko les suit, les aide à se surpasser et c’est un des moments écrasants de la soirée.
Entre le prologue d’une rare profondeur, d’une clarté et d’une intensité exceptionnels et l’aube qui suit, comme émergeant du silence avec un son contrôlé jusqu’à l’explosion, entre le voyage de Siegfried sur le Rhin, léger et dynamique, devenant bientôt dramatique lorsque Siegfried tombe parmi les hommes, dans une sorte de pantomime scénique où musique et scène vont de conserve et la scène incroyablement dramatique de Waltraute, faite de contrastes et d’éclat, de violence qui touche chaque mot, chaque phrase dite, il y a une variété d’approches inouïe et en même temps une cohérence stupéfiante. Il faut entendre aussi chaque pupitre de cet orchestre phénoménal : les bois et les cuivres, mais aussi les cordes (le final !). Malgré les moments les plus dramatiques, où Petrenko lance l’orchestre, il garde toujours une sorte de retenue ou de réserve. La scène finale n’est pas écrasante, elle distille une émotion indicible dans son art de retenir légèrement le son et de laisser tout entendre malgré tout. Il y a là tout le grand art de l’opéra, c’est à dire de ce moment où rien de manque, tout est en place et à sa place et tout prend sens.
On n’entend aucune scorie, on est complètement renversé par cette musique qu’on connaît, qu’on attend et qu’en même temps on redécouvre. Et le chef est partout, il donne tous les départs, d’un doigt, d’un regard, d’un sourire, d’un hochement de tête, sans jamais donner dans la complaisance et le beau son, restant toujours dans la justesse du théâtre et du drame.
Alors oui, le spectateur est heureux, comblé mais frustré aussi, parce que ce moment de bonheur intense, cet Éden musical va bientôt être un Éden perdu, dont il restera des traces dans la mémoire et dans le cœur, mais qu’on n’entendra plus « comme ça ». Il n’y a plus d’après…
Et voilà ce Journal d’un Ring achevé par ce sommet qu’on croyait inaccessible et qui pourtant a été atteint. Petrenko a dirigé une vaste symphonie dont Rheingold est l’andante, Walküre l’adagio, Siegfried le scherzo et Götterdämmerung l’incroyable final, faisant entendre une infinie palette de couleurs et l’expressivité des discours et des mots singuliers, faisant sienne une mise en scène qu’il n’avait pas créée et qu’il semble contribuer à chaque reprise à recréer.
La distribution dans l’ensemble exceptionnelle vit très humainement elle-aussi ses grands moments et ses moments un tout petit peu moins grands. C’est une distribution où sont réunies non forcément les plus grandes voix, mais surtout les voix les plus intelligentes, qui ont fait notamment du premier acte de Walküre un absolu, dans la nouveauté, la poésie et la profondeur. Et puis il y a eu ce Götterdämmerung superlatif qui a laissé le public assommé, au point que le lendemain à Bayreuth ceux qui y avaient été en parlaient encore, n’en étaient pas encore revenus.
Un regard rétrospectif montre quelle unité s’est construite autour de ce projet, et comment une production vue l’hiver dernier (un grand sommet aussi) peut se projeter encore plus haut, parce qu’elle est encore plus incroyable, encore plus vibrante. Chez Chéreau, orchestre de Boulez et images de la mise en scène l’emportaient sur des voix souvent moins satisfaisantes. Nous sautons quarante ans de Ring souvent remarquables pour arriver à celui-ci, musicalement le plus accompli de tous. Il est de bon ton de rappeler l’âge d’or du wagnérisme et les étourdissements du Neues Bayreuth des années cinquante. Voici le Ring de ce début de siècle, voici la référence installée. Et je crois pour longtemps.
Et maintenant, fermons ce journal de Munich pour parcourir les 200km qui nous séparent de Bayreuth. Les deux maisons wagnériennes historiques. Au-delà de la musique, il y a à Bayreuth un lieu, inouï, irremplaçable qui magnifie les œuvres y compris lorsqu’elles sont médiocrement montées, provoquant d’habituelles discussions passionnées.
Cette année, l’indiscutable était à Munich.


J ai eu la chance d assister à cette incroyable soirée depuis la loge au dessus de l orchestre. A la fin du troisième acte quand la voix de koch à commencé à sombrer petrenko ne l à pas lâché du regard comme pour lui insuffler toute son énergie. Il l a littéralement porté avec tout son amour de l humanité qui le caractérise. On pouvait presque penser que ce passage à vide était voulu, tellement tous ont su soit en atténuer les effets soit rendre ces derniers parts de la représentation
Bachler considère cette walkure comme la plus grande soirée de son mandat.
Nous étions tous à la fin soit comme le ravi de la crèche, soit un peu ivre ou étourdi de bonheur.