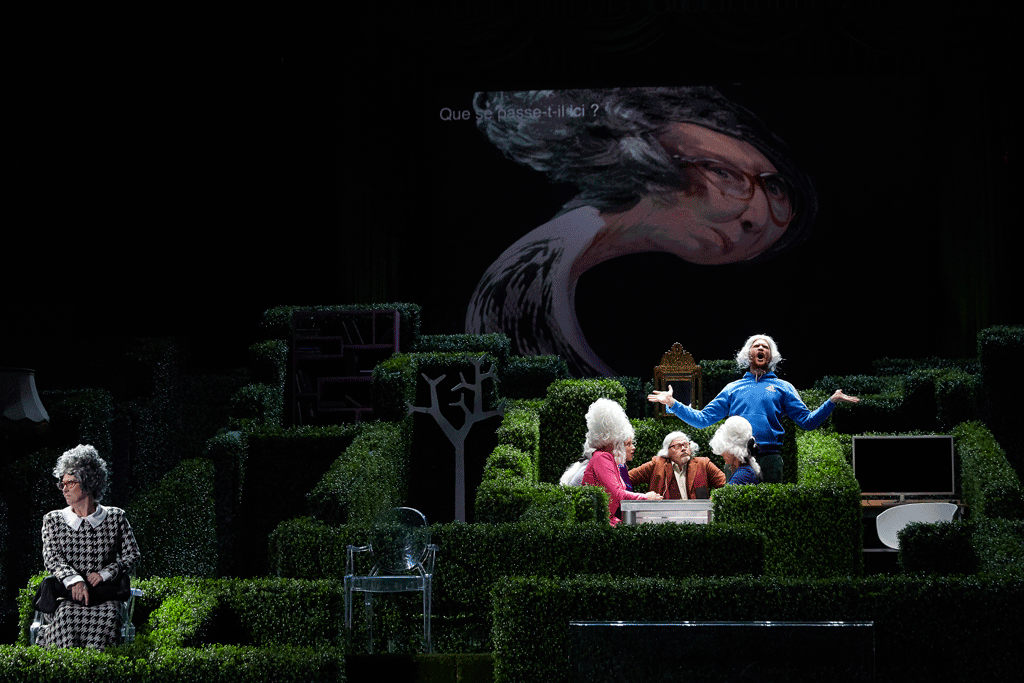
C’est à l’Opéra Confluence, espace transitionnel pendant la réhabilitation de l’Opéra Grand Avignon que le public s’est massivement rendu en cette fin de chaude après-midi avignonnaise pour assister à la représentation de Tartiufas. Pénétrant dans la vastitude et la fraîcheur du lieu, on est d’emblée frappé par le dispositif scénique visible depuis la salle. Sur un plan incliné, des allées bordées de buissons rappellent un jardin à la française avec son parcours labyrinthique, ses recoins, ses impasses. On devine au détour de ces allées, un écran d’ordinateur, un réfrigérateur, des chaises design transparentes, une lampe sur pied éteinte, une cage à oiseaux vide, une bibliothèque faite d’un dédale d’étagères chargées de livres, un miroir tourné vers la salle. Au dessus de ce réseau végétal agrémenté ça et là par ces éléments surgis d’un intérieur bourgeois, est suspendu un lustre de cristal. Comme une sorte de raffinement translucide dominant et presque dérisoire dans ce non-lieu fait d’enchevêtrements et d’objets rendus incongrus. Au lointain, un écran noir massif, écrasant.
Brusquement, l’écran s’allume et on voit par intermittence les coulisses, filmées sans son par le caméraman qui rejoindra le plateau dès l’entrée des comédiens. Ces derniers fument. L’un d’entre eux joue avec la caméra. C’est l’heure avant les projecteurs. L’heure avant les masques. Un préambule visuel s’achevant par une voix off qui s’élève et prévient de l’usage d’armes à feu et de lumières stroboscopiques pendant le spectacle pour le confort des spectateurs fragiles. Et d’achever en anglais : Have a good show. Thank you. Les rires jaillissent dans la salle et accompagnent dans la continuité l’entrée de Madame Pernelle, étonnante avec son sac à main en forme de chien. Les autres personnages de la famille se hissent derrière plusieurs haies, portant tous une perruque blanche très dix-septième. Le texte original en français est conservé dans les surtitres. Le metteur en scène affirme avoir voulu garder « les vers de Molière » qu’il considère comme « très puissants » et capable de proposer « un code de jeu ». Ainsi, puisant dans la tradition de la commedia dell’arte, il guide ses comédiens pour atteindre ce qu’il estime être « la source du jeu d’acteur ». Sur une musique électro-baroque jouée par le musicien Joris Sodeika à cour, continue pendant presque tout le spectacle,

Madame Pernelle s’agite. Sa voix résonne, son image relayée par l’écran se déforme : l’hystérie s’installe et ne quittera plus le plateau. Les comédiens regagnent les coulisses, suivis par la caméra. Ils se débarrassent de leurs perruques et échangent nerveusement au sujet de la classification de la pièce. Baroque ou post-baroque ? Rien n’est définitivement arrêté. Ces allers-retours seront fréquents au fil du spectacle et rappellent sans cesse au spectateur susceptible de laisser faiblir sa vigilance que tout ici n’est que théâtre, dans une folle mise en abyme où on s’égare quand même un peu parfois.
Mélangeant les langues – lithuanien, anglais et français, cultivant une oscillation permanente entre le vrai et le faux, rendant progressivement indistinctes la frontière entre le comédien et le personnage, entre mensonge et sincérité, entre tous les personnages, le jeu de dupes s’installe durablement et emporte le public. Non sans éclats de rire, tradition moliéresque oblige. Soulignons ici l’interprétation désopilante des comédiennes Nelé Savicenko – inénarrable Pernelle, mamie flingueuse qui tire des coups de feu, parce qu’elle est « sagittaire » et que son « rôle est tout petit » – et surtout Toma Vaškeviciute – époustouflante Elmire, femme étrangement fatale à la fois Marilyn pulpeuse et Merteuil manipulatrice, engoncée dans une robe bustier très près du corps, généreusement échancrée, d’un rouge outrancier assorti à sa bouche exagérément maquillée, elle n’est pas sans rappeler la version caricaturale et absurde de l’héroïne d’un soap opera américain.
Pourtant, dans cette mise en scène échevelée, il faut bien souligner la part d’ombre qui, bien qu’on l’identifie dans nombre de pièces de Molière et particulièrement dans le Tartuffe, prend ici des proportions tout à fait inattendues pour le spectateur propulsé loin du Grand Siècle et du parti dévot. C’est dans notre présent que résonne de manière angoissante cette adaptation ténébreuse. Sous le lustre de cristal, règnent surtout les images : celles qui sont reflétées par le miroir ; celles qui sont diffusées sur l’écran en provenance de la caméra ; celles du smartphone de Mariane faisant un selfie bouffon avec son père les montrant avec des têtes de chats ; celles du jeu vidéo de Damis ; celles qui évoquent toutes les émissions de télé-réalité ; celles qui servent le pouvoir et la domination sur autrui. Orgon – dynamique Salvijus Trepulis – régente sa maison et ceux qui y vivent. Pire, il s’adresse à nous directement dans un clip diffusé sur l’écran géant pour sa campagne électorale où tous les ressorts d’une rhétorique creuse et d’un storytelling aux accents étrangement familiers apparaissent. De veule et soumis à l’autorité exercée par le faux dévot dans la pièce originale de Molière, le voici rendu capable d’agir en authentique spin-doctor, alimentant soigneusement sa (fausse) page Facebook©, cherchant lui aussi à obtenir des « likes » pour asseoir son influence sur les autres – notons son entrée en salle plus qu’en scène, diffusée sur grand écran, comme à l’occasion d’un meeting politique. Evidemment Tartuffe s’inscrit lui aussi pleinement dans cette soif de pouvoir.
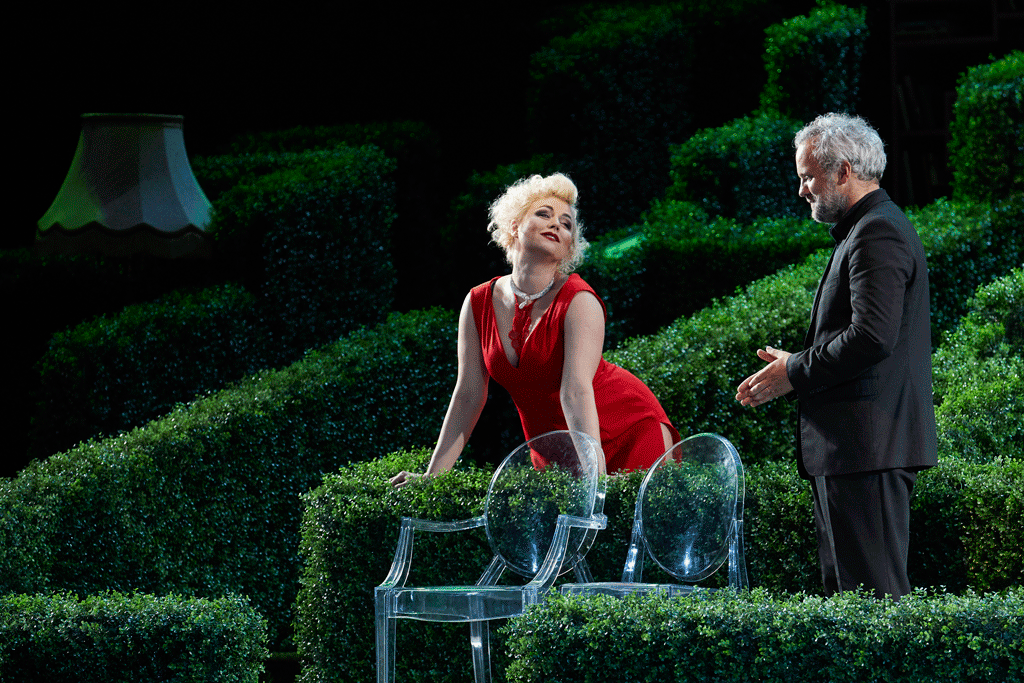
Pourtant, l’entrée du « scélérat » de Molière, au début de l’acte III, pieds nus, tout de noir vêtu, n’a rien de saisissant et la scène du mouchoir avec la néanmoins pétulante Rasa Samuolyte qui incarne Dorine, tombe un peu à plat. Il reste que le comédien Giedrius Savickas va progressivement porter le traître à son triomphe. Car c’est là, la lecture pessimiste que propose Oskaras Koršunovas à la fois du personnage et de la pièce : Tartuffe sort grand vainqueur de cette lutte d’influence. Pas de deus ex machina. Pas de justice du Prince ici. Certes, il est d’abord le jouet de la séduction d’une Elmire très offensive et provocante qui finit par prendre le dessus sur lui, nu comme un ver, captif de ses volontés alors qu’elle tient ses vêtements. On peut se demander si elle n’aurait pas eu raison de lui et de ses ambitions si Damis n’était pas bruyamment intervenu, rendant la stratégie de sa belle-mère inopérante. La mémorable scène de la table est ensuite revisitée : Orgon sous un banc transparent assiste à la scène entre Elmire et Tartuffe. Notons ici que si Stéphane Braunschweig osait montrer l’attirance homosexuelle du mari sur le point d’être cocufié dans cette scène par une accolade d’Orgon torse nu sur « le scélérat », le metteur en scène lithuanien affirme haut et fort ce désir de l’un sur l’autre. Les deux hommes s’embrassent fougueusement et ils ont une vraisemblablement une relation sexuelle avec Elmire en coulisses : la levée de leurs inhibitions est impudiquement montrée.
C’est alors qu’Orgon jette Tartuffe dehors, convaincu d’avoir été son jouet. La partie semble gagnée mais le traître se révèle le plus fort des deux. Comme un oiseau maléfique qui étend ses ailes sur le plateau, debout sur la table, dans une lumière rouge infernale, il va consacrer sa victoire sur ce micro-univers. Réduite à sa merci, la famille dans un simulacre d’élection à l’issue inévitable, se voit chassée, heurtant des obstacles imaginaires dans les allées du labyrinthe, tous réduits à l’état de pantins presque numérisés comme dans les images d’un jeu vidéo. La caméra les fait voir ensuite en train de quitter l’Opéra Confluence tandis que le maléfique Tartuffe exulte, bras tendu. Ayant déployé tous les moyens de propagande mis en œuvre par les mouvements populistes de notre monde actuel, on le découvre filmé, en pleine autopromotion se mêlant aux réjouissances qui ont suivi la récente victoire des Bleus contre l’équipe de la Croatie, dans les rues d’Avignon.
Rien ne peut plus l’arrêter de la même façon que rien n’arrête le spectacle théâtral. Et Tartuffe de conclure en assurant que « le spectateur ne se sent chez lui nulle part », que « le spectacle est partout ». Ce qui sonne finalement comme une terrible mise en garde pour nous.

