
Notons pour commencer que le générique offre une vue sur ce que l’on ne voit pas d’habitude. Les coulisses dans les instants qui précèdent l’entrée en scène. Les derniers ajustements sur un costume. Le dernier échauffement des comédiens. L’effervescence chaque soir, à la Comédie-Française comme ailleurs. La solennité de l’annonce tout de même : « Mesdemoiselles, Messieurs, place au théâtre ! » Nous sommes le 8 mars 2018 et le lever de rideau est imminent.
Alors que la pénombre s’étend, on perçoit le bruit d’un panneau de décor descendant des cintres. Les projecteurs sur le plateau permettent de découvrir la finesse de la scénographie pensée par Eric Ruf. Un talus avec des herbes folles, en partie coupées. Un paysage de campagne surplombé par un ciel aux vives nuances de bleu. Un extérieur qui prend d’emblée ses distances avec le texte dont la didascalie initiale indique que la scène est à la campagne dans la maison du Comte. Cette relocalisation intrigue. Et le metteur en scène s’en explique en signalant l’inspiration des peintures d’Hubert Robert où des constructions massives et occupant tout l’espace laissent de « petits personnages perdus dans un coin ». Il serait même possible de voir dans cette scénographie quelque chose de la peinture impressionniste où une Femme à l’ombrelle de Monet pourrait surgir à tout instant. Parce que c’est un lieu de lumière, un lieu de couleurs, vaste, aéré. Là où Marivaux préférait la fermeture confortable des murs d’une maison noble et provinciale, Clément Hervieu-Léger prend une autre direction : il cherche à installer ses comédiens dans une immensité et créer ainsi une « tension entre intimité des dialogues et ouverture de l’espace […] féconde pour le jeu ». Car ce lieu est autre. Il correspond à ce que Foucault appelle une hétérotopie. Un lieu qui n’est pas proprement situé. Un lieu de mise à l’écart où les rapports entre les êtres vont pouvoir pleinement s’altérer.
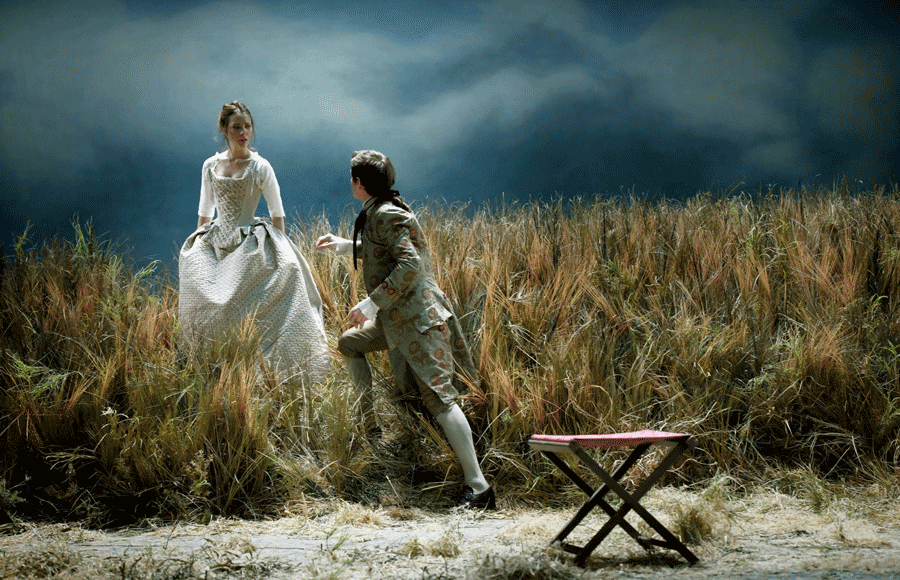
Hortense que joue Claire de la Rüe du Can, entre. Passant par le haut du talus, elle se déplace aisément et vient prendre place sur la scène avec du matériel à dessin. La fille du Comte semble vouloir s’adonner à une de ses occupations favorites. Marton, sa suivante fait son entrée à son tour. Cette fille, franche et gouailleuse que campe Adeline d’Hermy, vient chercher sa maîtresse qui en profite pour la questionner sur son futur époux, Rosimond. Dans un échange un peu tapageur pour une ouverture, la jeune suivante ne tarde pas à avouer que « tout son défaut, c’est d’être ridicule ». Hortense dénonce, elle, ses « si sottes façons » : c’est qu’il fait partie des « jeunes gens du bel air ». La jeunesse dorée. Déjà. Le milieu à la mode du moment. Déjà. Mais bien sûr, il est question d’amour – le marivaudage toujours. La jeune Hortense va s’employer à « corriger » les manières de son bien-aimé. Le mettant douloureusement à l’épreuve, elle va le pousser à avouer son amour pour elle. Toujours la cruauté du jeu avec l’Autre qui se dissimule derrière des faux-semblants. Pour atteindre à la vérité des sentiments, le marivaudage lutte contre toute forme de travestissement. Rosimond – joué par Loïc Corbery, captivant dans la dernière partie de la pièce est à ce propos un personnage travesti par essence. Les effets outranciers de son rôle social de petit-maître sont immédiatement révélés par son valet Frontin – très juste Christophe Montenez. Dans une scène de face-à-face annonçant celle des maîtres, Frontin se déchaîne avec Marton. Plein de pédanterie et de snobisme burlesque, il prône « une fidélité galante, badine », défend auprès de la suivante l’idée que son maître a « une vapeur d’amour » pour sa maîtresse et rien de plus car « on nous aime beaucoup mais nous n’aimons point » à Paris où ce serait l’« usage ». Le valet comme double imitant son maître. À corriger lui aussi donc – ce que Marton fera sans tarder.

Tout en gesticulations et en grimaces, Rosimond est effectivement en représentation permanente – subtile mise en abyme. Il fuit le réel, ne cesse de se dérober à tout engagement. À tout usage de la raison. L’arrivée de Dorimène – très juste aussi Florence Vialla – avec qui le jeune fat « a une petite affaire de cœur » et de Dorante joué par Clément Hervieu-Léger lui-même, vient resserrer le jeu cruel qui doit dévoiler l’amour qu’éprouve Rosimond pour Hortense. Aux autres comme à lui-même. Dans la tradition des comédies marivaudiennes, nous assistons à un surgissement : celui de la vérité des sentiments. Les masques doivent tomber, c’est l’usage. Et tout cela, au fil d’un cheminement psychologique anéantissant les entraves qui s’y opposent. Au rythme des impitoyables manipulations et mensonges de l’Autre qui aime. Au rythme sur scène, du ciel qui s’obscurcit pour finalement laisser apparaître les coulisses éclairées par des néons tubulaires. La vérité du lieu théâtral comme métaphore.

Rosimond se fourvoie, refuse d’admettre ce qu’il éprouve, chahute avec Dorante dans une culbute laissant deviner quelque pulsion homosexuelle entre eux, abandonne une lettre qui le confond avec Dorimène – comme un authentique acte manqué. Le petit-maître est violemment mis à mal et ce, jusqu’au moment de sa lyrique révélation où il est enfin « devenu raisonnable » tandis que Dorimène et Dorante sont abandonnés à leur dépit. Les figures tutélaires du Comte et de la Marquise – Didier Sandre et Dominique Blanc tout en élégance – viennent alors confirmer l’union de la jeune Hortense et du petit-maître désormais corrigé. Le noir se fait sur une note de piano brutale. Comme un sombre rappel de la peine éprouvée pour qu’éclate la vérité du cœur.
Cependant, on retiendra ici plus volontiers l’extraordinaire acuité de la satire sociale. Le titre est clairement annonciateur : les petits-maîtres sont de jeunes nobles, creux et présomptueux, aux manières affectées, enchaînant les aventures galantes avec des femmes pour lesquelles ils ont peu de considération en général. La pièce s’attaque – le mot n’est pas vain – à une catégorie sociale issue de l’aristocratie qui jouit de son aisance et de son désœuvrement, se félicitant d’être dans le vent et affichant de fait, sa supériorité sur ceux qu’ils déconsidèrent socialement, en particulier les provinciaux. Rosimond est parisien et il ne peut se faire aux règles de savoir-vivre de cette terre lointaine qu’il méconnaît et méprise. Sans doute l’insuccès de la pièce peut-il donc s’expliquer aussi par les réactions indignées d’un public qui s’est probablement trop reconnu sous les traits de cette aristocratie de capitale, rendue ridicule par ses travers amplifiés. Comme les faux dévots de Molière, dans le siècle précédent.
Et aujourd’hui ? Rien de bien nouveau dans nos rapports sociaux. On voit encore des « petits-maîtres », peut-être moins parisiens mais qui n’en demeurent pas moins condescendants et vaniteux à l’égard de ceux qu’ils prennent pour des péquenauds. Les stéréotypes ont la vie dure.
Si sa mise en scène demeure plutôt convenue dans son ensemble, le vrai tour de force de Clément Hervieu-Léger consiste bien en l’exhumation de cette comédie oubliée qu’il nous fait connaître près de trois cents ans après sa création. Si vivante dans l’examen de la société de son époque, des préjugés de chacun qu’elle souligne sans complaisance. Si vivante surtout par ce qu’elle dit par réverbération de notre présent à réenchanter encore.
