
Si Wagner avec un "excès de parodie sublime et malicieuse du même élément tragique" (selon l’expression de Nietzsche) réussit dans Parsifal à saturer l'œuvre de symboles – en mettant ensemble Sang et sang, Lance (le "mâle") et Coupe (la "femelle"), culpabilité et rédemption, eros et thanatos, magie noire et magie blanche, amour filial et amour incestueux, Catholicisme, Luthéranisme, bouddhisme (juste un trompe‑l'œil), paganisme celtique et une patine générale blasphématoire -, Graham Vick, responsable de la nouvelle mise en scène de Parsifal qui a ouvert la saison 2020 au Teatro Massimo de Palerme, rivalise avec Wagner lui-même, ajoutant à tout cela la seule couche symbolique qui manquait : une allusion, à travers la communauté des Chevaliers du Graal, aux guerres actuelles du Moyen-Orient. Ainsi, trois ans après la conclusion, toujours pour le Teatro Massimo du Ring des Nibelungen, qui avait déjà dépouillé la scène de ses coulisses, exposant l'espace vide du théâtre comme le cadre narratif adéquat pour une histoire contemporaine de tensions politiques et de terroristes à la bombe, Vick élimine à nouveau tous les éléments qui pourraient encore nous faire penser au théâtre comme une fiction, un espace artificiel, une illusion qui projette sur ou contre la réalité son propre univers d'invention et son ordre propre.

Qu'un classique soit toujours capable de dire un mot sur la contemporanéité n'est pas pour Vick seulement un concept de philosophie de l'art : pour le metteur en scène anglais, une telle hypothèse doit pouvoir être vérifiée de manière concrète, et ainsi Parsifal devient une histoire de soldats en première ligne dans quelque terrain chaud du Moyen-Orient, tous armés de mitrailleuses et porteur d'une idéologie impérialiste. La scène est donc constituée d'un seul grand praticable suspendu vers le public et recouvert d'un revêtement couleur "sable" – élément central, comme chacun sait, dans la fabula de Parsifal. Dans le désert qui constitue la toile de fond d'une action où les membres du Graal déambulent en gilet pare-balles, et où les "infidèles" sont exécutés sur le fond d'un tissu blanc qui s'ouvre et se ferme comme une sorte de rideau intérieur,

Kundry entre en scène non pas à cheval, mais à pied et en niqab noir, comme preuve de sa vocation de soumission aux Chevaliers et au maître-magicien ("servir, servir"). Klingsor – le seigneur des désirs interdits, le frère maléfique des nombreux esprits des prairies du monde des « Singspiel » allemands – est ici un combattant isolé au torse tatoué, peut-être un chef déchu ou un commandant tenu à distance en raison de ses méthodes peu orthodoxes, qui fume et s’ennuie en attendant le prochain massacre ; les filles-fleurs défilent d'abord en culotte et soutien-gorge, puis en paréos colorés séduisants, et n'apparaissent guère plus que le fantasme d'un soldat au front, plus imaginé et désiré que réel. Parsifal est plutôt l'un de ces jeunes bourgeois « squintern » qui partent dans des pays en guerre en pensant faire un peu de tourisme-vérité, pour avoir de l'émotion à bon marché, et qui se retrouvent ensuite impliqués à leur insu dans une guerre.
Le "chaste fol" de Wagner, ici drastiquement simplifié, est donc avant tout un fou qui se met à jouer à la guerre des autres, au risque de tout gâcher (l'"errance" pour laquelle les Chevaliers du Graal se retrouvent finalement infirmes et malades dans une sorte de sanctuaire de Lourdes) et puis, mais pas à cause de lui, il découvre qu'il a des super-pouvoirs qui lui permettent d'aider ses nouveaux amis. Quant aux « amis » comme tout groupe maintenu par le fanatisme religieux, les guerriers du Graal ont leur propre rite : ce qu'Amfortas décide finalement d'administrer, forcé par son vieux père Titurel (un hiérarque occidental en costume-cravate, pour nous culpabiliser un peu), est en fait un rite – calqué par Wagner sur celui de la messe catholique – où cependant, Vick opère une substitution. En fait, nous passons du code symbolique de la masse, où l'hôte se limite à symboliser le corps du Christ et le vin pour rappeler symboliquement son sang, à un code mimétique : Amfortas prélève en fait le sang du côté blessé et l'offre à boire dans une gamelle (la Coupe) aux soldats déployés en formation d'attaque ; les membres du Graal, se passant la gamelle avec le sang d'Amfortas et le buvant comme s'ils étaient autant de vampires de Transylvanie, ouvrent à leur tour les veines du bras en mélangeant leur propre sang avec celui du "rédempteur". Mystères de la soldatesque moderne.

À supposer que vous soyez prêt à renoncer à la fabuleuse histoire de Wagner pour vous mettre au diapason du reportage de guerre de Vick, tout irait bien : mettre à jour le cadre de l’action en obligeant le livret à parler d'un monde contemporain déjà si envahissant et médiatisé, inventer une dramaturgie parallèle (l'abstraction de l'intrigue le permet), renverser les présupposés éthiques du texte pour lesquels les bons deviennent ici assez méchants, prendre ses distances par rapport aux personnages envers lesquels on ne se sent pas d’affinités, voire forcer la suspension of disbelief déstabilisation du spectateur au-delà de la limite déjà ardue imposée par Wagner (le rite du Graal est "le matériau d'opérette par excellence") : le fait est que les éléments du drame imaginé par Vick ne forment pas un ensemble cohérent ni convaincant. Ce qui manque à ce Parsifal, par rapport à son Ring déjà discutable, ce sont les inventions à l'intérieur de l'invention, les seules cascades ingénieuses, les moindres détails de l'efficacité théâtrale – un exemple parmi d'autres : l'éclairage du bûcher de Brünnhilde – qui a rendu la Tétralogie précédente cohérente et parfois convaincante. Cette fois-ci, non seulement il n'y a pas d'idées mémorables, mais les idées manquent tout court.
Prenons la scène du baptême de Kundry. On pourrait mesurer le taux de créativité d'un metteur en scène à partir de scènes où il y a de l'eau : s'il y a vraiment de l'eau sur scène, et que les chanteurs doivent vraiment se mouiller, nous sommes certainement dans une impasse créative. En fait, dans son désert du Moyen-Orient, Vick prévoit que l'étang dont l'eau est utilisée pour baptiser Kundry apparaisse sous la forme d'un rectangle inondé qui émerge de la couleur sable du praticable. Kundry, Parsifal et Gurnemanz, engagés dans le rite du baptême, sont obligés de se vautrer maladroitement dans l'inconfortable parallélépipède s’éclaboussant maladroitement les uns les autres ; comme ces enfants qui jouent en s'accordant à dire : "alors on va faire comme si cette flaque était un lac… » ? Ici, les mécanismes théâtraux se bloquent de façon particulièrement voyante : en plus d'être laide à regarder – un aspect auquel Vick ne semble pas très sensible à cette occasion – cette scène représente une solution expressive maladroite et volontariste, clouée en-deçà du seuil au-delà duquel la "formalisation" est déclenchée. Mais ce n'est pas un cas isolé : en réalité dans ce Parsifal rien ne fonctionne correctement ; la couche de symboles d'actualisation imaginée par Vick ne se soude pas pour construire un contexte de sens uniforme, elle ne parvient pas à constituer un ensemble convaincant et clair ni pouvoir créer sa propre vérité.
Lumières et ombres dans la partie musicale. Le jeune chef d'orchestre israélien Omer Meir Wellber prépare l'orchestre de manière précise mais il part de prémisses interprétatives erronées : "en Italie, le phrasé est toujours à la première place, mais chez Wagner, c'est le rythme qui prime". Avant d'en venir au "rythme", il y a la conception générale de Wagner sur la dramaturgie, le son, la couleur, l'harmonie et le rôle des Leitmotive : si nombreux, si imbriqués et si lourds dans Parsifal qu'ils exigent une attention particulière et la plus grande capacité à doser les effets. La gestion précise des motifs conducteurs – qui concerne le discours global tant la partition en est remplie – s'avère insatisfaisante. Il ne s'agit pas, en effet, de simples thèmes musicaux qu'il faut bien sculpter et mettre en valeur : ce sont des graines de sens, voire dans Parsifal des formules sacrales, symboles du mystère raconté par le livret destiné à circuler sous la surface sonore comme des sentinelles de l'inexprimable et de l'inconcevable. Analysés comme Wellber le souhaite, ils sont surdéterminés et déconnectés du flux de la musique, et lorsque le chœur les chante, avec un phrasé qui ferme le moindre motif en soi, ils ressemblent aux leçons de solfège chanté de Pozzoli ((Célèbre auteur de méthode de solfège)). Même les préludes et les interludes orchestraux souffrent d'un phrasé fragmenté et restent plats d'un point de vue dynamique et agogique. Wellber revient trop souvent sur les motifs individuels, mais il semble peu intéressé par la façon dont leur imbrication donne vie aux très longs arcs phraséologiques, dont l'emprise devrait être garantie par l'identification des points culminants et la liaison hiérarchique des éléments. On est donc constamment en attente de ces merveilleux tournants musicaux de Wagner qui, dès qu'ils sont produits, se révèlent être le signifiant d'un nœud dramatique, magique, mythique : le caractère scolastique du phrasé de Wellber, sa prévisibilité, frustrent l'ambition de la musique de se déterminer aussi comme "autre qu'elle-même", un miracle pour lequel, comme l'a soutenu Thomas Mann, celle de Wagner n'est plus de la musique, c'est une "idée acoustique", une "idée faite de sons".
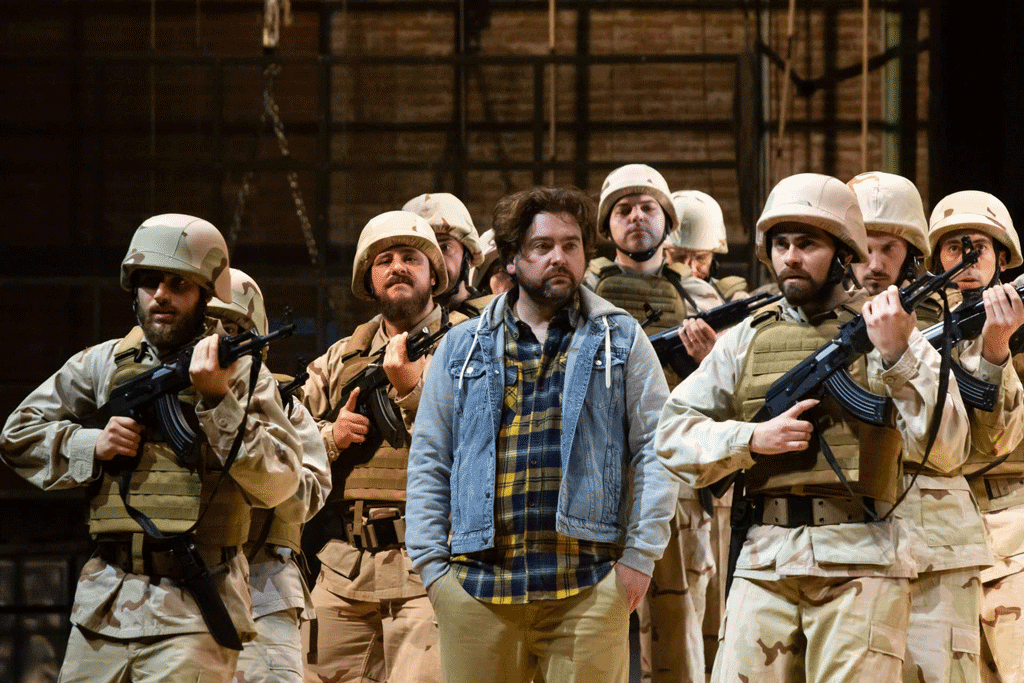
La distribution est honnête, réunissant des artistes internationaux. Julian Hubbard est un Parsifal fin, précis et intense, peut-être plus sensible aux aspects humains qu'aux aspects héroïques du personnage. Kundry est la française Catherine Hurnold, elle aussi correcte mais très éloignée du caractère sauvage et de la puissance archétypale de son personnage : elle fonctionne bien comme séductrice maternelle du héros, mais reste étrangère aux aspects démoniaques de la "Höllenrose", la "rose de l’enfer" telle que la définit Klingsor. John Relyea donne à Gurnemanz un timbre charnu et une précision appréciable dans la poursuite du récit – il est presque un historicus – dans ses pics dramatiques et ses abîmes insondables. Des trois voix masculines de Titurel (Alexei Tanovitski), Klingsor (Thomas Gazheli) et Amfortas (Tómas Tómasson), les deux premières semblent bien adaptées à leur personnage, surtout Tanovitski qui interprète bien la voix menaçante et sépulcrale de Titurel.

Tómasson rend son personnage avec une intention expressionniste qui exaspère ses traits douloureux, aboutissant pour quelques instants à une incandescence expressive inappropriée, confinant au Sprechgesang. Tout le monde, en tout cas, se soumet au chant sur une scène vide qui dilue les voix et les empêche d'être projetées de manière optimale vers le public : le chœur, qui devrait parfois chanter en coulisse, mais sans coulisses il doit chanter au-delà du mur du fond et doit même être amplifié. Succès final, applaudissements chaleureux du public pour l'orchestre et le chœur maison, quelques protestations amères pour Vick.

