On joue trop rarement la musique d'Alberto Ginastera. Elle peine à trouver sa place dans les programmes et dans les manuels d'histoire de la musique. Le chef Marko Letonja déclare à propos de l'écriture de Beatrix Cenci qu'elle semble bitonale, puis polytonale, jusqu’à devenir franchement dodécaphonique. Musique caméléon donc, avec des assemblages insolites de timbres et de styles. Des danses Renaissance, un chœur à l'antique, des chaloupements, des passages drus et violents avec une pulsation hétérogène qui ne cesse d'intriguer et accroche l'écoute.
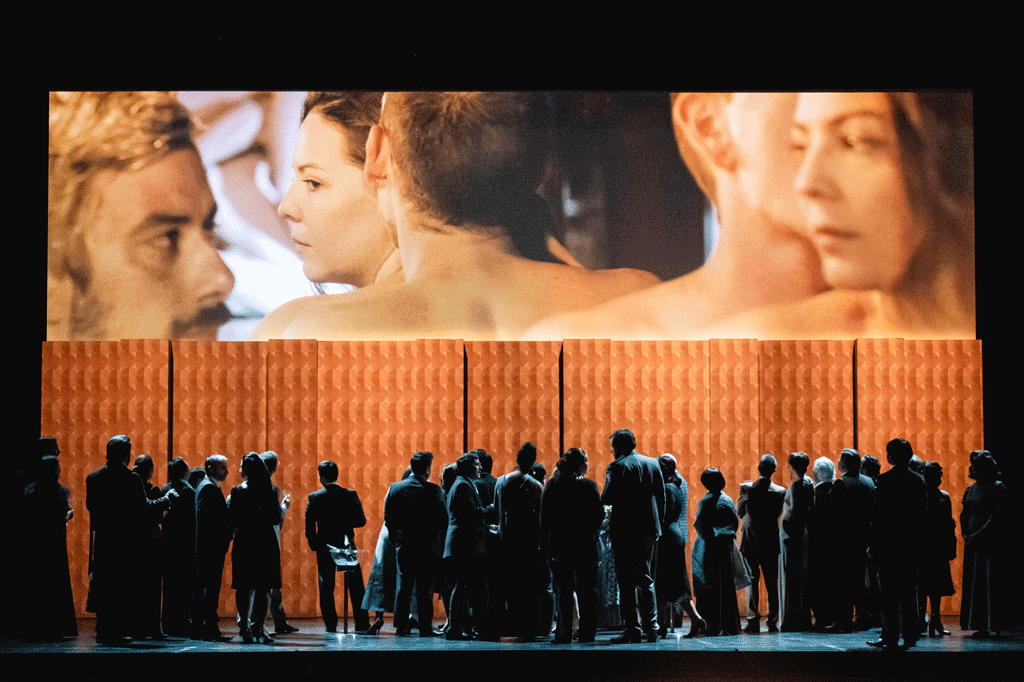
Le livret de William Shand et Alberto Girri croise les Chroniques italiennes de Stendhal avec The Cenci de Percy Shelley. L’œuvre est vaguement basée sur un événement réel qui s’est produit à Rome au cours de la Renaissance : dans un accès de colère et de violence, un comte viole sa propre fille. Par vengeance, elle le tue mais, découverte, elle est condamnée à mort. Au-delà de la véracité historique de ce fait divers, c'est le portrait de la jeune héroïne imaginé par Guido Reni qui sera à l'origine du projet d'Alberto Ginastera de composer son troisième et dernier opéra, après Don Rodrigo et Bomarzo. Antonin Artaud fit du destin de Beatrix, l'objet d'une adaptation titrée Les Cenci – créée en 1935, jouée dans des décors et des costumes de Balthus sur une musique de Roger Désormière. La postérité n'a – hélas – pas retenu les effets sonores diffusés en quadriphonie pendant la scène du meurtre du Comte (interprété par Artaud) censés exprimer par le vacarme et le fracas, les affres psychologiques du personnage. Il est resté de cette pièce (et Ginastera y fait allusion dans sa propre version), la thématique du Théâtre de la cruauté – objet du célèbre essai "Le Théâtre et son double" dans lequel Artaud décrit sa conception d'un art cherchant à faire surgir le "sauvage sous la peau", seule réponse possible à la souffrance d'exister.

Beatrix Cenci est née d'une proposition faite à Alberto Ginastera par Hobart Spalding, président de l’Opera Society of Washington, d’écrire un opéra pour célébrer l’inauguration du John F. Kennedy Center for the Performing Arts. La collaboration entre le poète argentin Alberto Girri et le dramaturge William Shand aboutit à un livret sans concessions, qui fait de Francesco Cenci un hideux portrait de père incestueux et meurtrier. Le schéma resserré des deux actes et quatorze scènes permet à Ginastera d'évoquer le meurtre des deux fils de Cenci, sa chute et la mise à mort de sa fille. Une dimension musicale expressivement classique enveloppe le drame d'une lumière qui sait jouer avec les frontières du vérisme et les trouvailles contemporaines – musique par trames superposées, bande enregistrée avec zébrures de flexatone…
Le metteur en scène argentin Mariano Pensotti met en rapport la psychose criminelle du Comte Cenci avec la folie d'un collectionneur d'œuvres d'art dont le point commun est de représenter sa fille Beatrix. On lit dès les premiers instants, la fascination perverse du père pour la beauté de sa fille dont le corps même sert de cible et porte les stigmates de cet amour criminel. Il dévoile au peuple sa dernière acquisition : une immense statue de Beatrix nue qui trône au milieu de la scène, exhibée aux regards de tous et déjà victime sacrifiée. Revêtue d'une combinaison de nylon couleur chair uniforme qui rappelle les poupées de celluloïd, la vraie Beatrix est montrée dans une fragilité qui se double d'un voyeurisme fétichiste lorsque sa mère procède à la toilette du matin en l'harnachant avec toute sorte d'accessoires soulignant son statut d'être subalterne et soumis. La démarche embarrassée par une jambe prisonnière d'une orthèse, elle porte un corset de cuir et une perruque, comme autant de signes qui témoigne – métaphoriquement ou non – des abus et des blessures qu'elle a subi dans le passé. Autour d'elle circulent statues et tableaux qui la représentent sous toutes les coutures et dans tous les styles de ce même XXe qui sert de cadre à l'action (Fernand Léger, Giorgio de Chirico, Maillol etc.). Deux immenses statues de molosses, également affublé d'attelles sur les pattes, apparaissent à l'occasion d'une énième giration du plateau. Le recours au principe de la tournette donne au château des Cenci un aspect obsessionnel et lancinant. Les espaces s'enchaînent les uns aux autres, les chambres succédant aux salons, avec un élément supplémentaire à chaque boucle. Un épais mur de pierres sanguinolentes vient boucher la vue latéralement et rythmer le regard en rompant avec la circularité précédente. Cette division haut-bas permet dans la scène du bal, la projection du court-métrage montrant la mort des deux frères. Cette mise en abyme très hamletienne offre une surprenante parenthèse cinématographique dans un style abstrait et onirique, avec des références explicites à l'art de Luis Buñuel. En choisissant deux acteurs jumeaux, le film joue sur la symétrie des destins avec une scène d'orgie où se croisent les regards dans des cadrages surprenants. La vision des deux cercueils posés sur la prairie précède le retour au monologue du Comte où il se réjouit devant des courtisans médusés de la mort de ses fils. L'apparition du corps démembré de Beatrix, dont les éléments pendent des cintres comme des morceaux de viande, ponctue la scène du viol – vrai seul moment où l'hyper-réalisme du jeu d'acteur rejoint la stylisation extrême du cadre, avec notamment les très beaux contrejours signés Alejandro le Roux. La scène finale perd en impact et en violence, montrant Beatrix passant de mains en mains sur ce qui semble être une chaîne de fabrication. Le chœur est vêtu de grands tabliers et bottes de sécurité, manipulant avec des gants hygiénique le corps assis en tailleur sur un plateau – corps désormais répudié et impur. Enfermée dans la même caisse qui contenait l'objet d'art que Francesco Cenci venait de recevoir, la boucle se referme et le peuple prolonge par son action complice, la cruauté familiale. Violée par son propre père, Beatrix subit l'outrage d'une mort vécue comme humiliation et injustices suprêmes :
Non, pas la mort ! J’ai peur de l’Enfer.
J’y retrouverai mon père en train de se débattre dans les flammes et de me regarder, implacablement, de ses yeux fixes et morts, à jamais !

Leticia de Altamirano sublime le rôle de Beatrix par une projection qui vitupère dans l'aigu, doublée d'une aisance scénique qui joue admirablement avec son profil de femme-enfant. Les contrastes sont vifs et brillants, découpant le personnage au scalpel sur un fond vif-argent. On placera au même niveau d'excellence la Lucrecia capiteuse chantée par la mezzo Ezgi Kutly et surtout le rôle travesti de Bernardo Cenci, confié à la surprenante Josy Santos qui fait oublier la dimension réduite de ses interventions. Gezim Myshketa doit se libérer d'une diction embarrassée dans les premières interventions, pour imposer un Francesco Cenci en lointain cousin de Barbe Bleue… Xavier Moreno fait d'Orsino, l'amant de Beatrix, un personnage falot dont l'héroïsme se dérobe au moment où elle est en danger. Le Chœur de l’Opéra national du Rhin, préparé par Alessandro Zuppardo, se plie aux exigences d'une écriture qui le campe tantôt en une présence monolithique, tantôt en miroitement de couleurs abstraites et disséminées. La direction solide et engagée de Marko Letonja avance tête baissée dans un maquis de notes et de gestes abrupts où semblent se croiser les hautes figures de Malipiero et Busoni, en passant par l'ombre tutélaire Berg, Stravinski, Dallapiccola, ou Schoenberg. Empruntant à son assistant José Miguel Esandi la comparaison avec la technique du montage cinématographique, Letonja offre à la matière sonore l'équivalent d'un cadrage en plans larges, remarquablement équilibrés dans l'impact et la densité.

