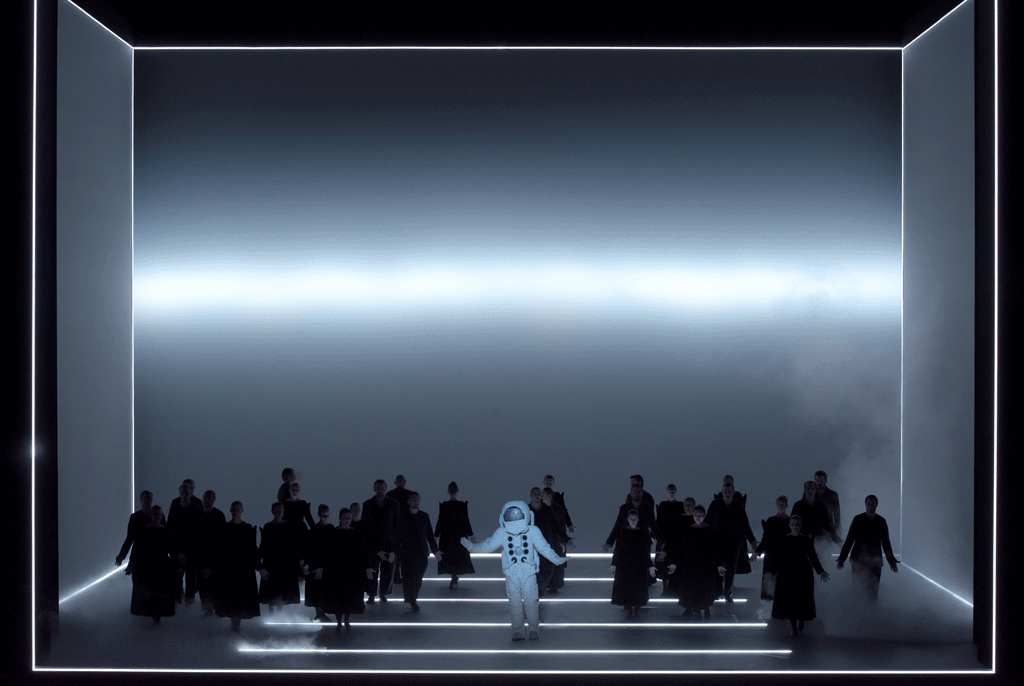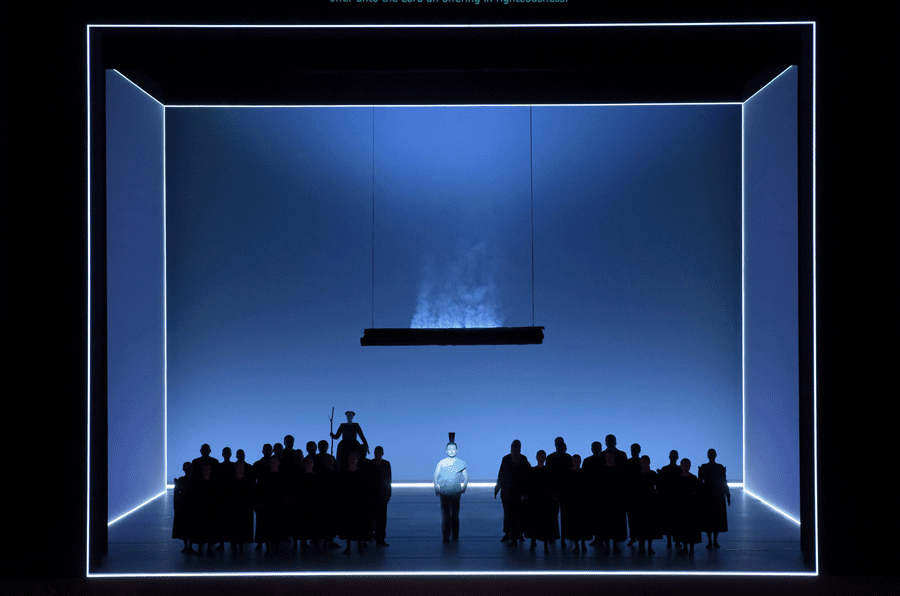 Paris sera toujours Paris, et Bob Wilson sera toujours Bob Wilson. On ne saurait reprocher à l’homme de théâtre américain d’être lui-même : c’est ce qu’il fait de mieux. Pas de véritable surprise à espérer d’un spectacle à l’autre, le public sait plus ou moins ce qui l’attend, tant l’univers esthétique élaboré depuis un demi-siècle par Mr Wilson travers immuablement les décennies. Même si les costumes, les maquillages ou les vidéos ne sont plus conçus par les mêmes individus, ils restent de stricte obédience ; l’identité wilsonienne transcende ces variations de personnes, et le style défini une fois pour toutes se réincarne sans peine. Chaque nouveauté est un exercice de bobwilsonisation, le piment résidant dans l’écart plus ou moins grand entre l’idée que l’on se fait préalablement d’une œuvre et la vision qu’en livrera le grand sorcier après l’avoir plongée dans sa marmite.
Paris sera toujours Paris, et Bob Wilson sera toujours Bob Wilson. On ne saurait reprocher à l’homme de théâtre américain d’être lui-même : c’est ce qu’il fait de mieux. Pas de véritable surprise à espérer d’un spectacle à l’autre, le public sait plus ou moins ce qui l’attend, tant l’univers esthétique élaboré depuis un demi-siècle par Mr Wilson travers immuablement les décennies. Même si les costumes, les maquillages ou les vidéos ne sont plus conçus par les mêmes individus, ils restent de stricte obédience ; l’identité wilsonienne transcende ces variations de personnes, et le style défini une fois pour toutes se réincarne sans peine. Chaque nouveauté est un exercice de bobwilsonisation, le piment résidant dans l’écart plus ou moins grand entre l’idée que l’on se fait préalablement d’une œuvre et la vision qu’en livrera le grand sorcier après l’avoir plongée dans sa marmite.
Pour cette rentrée, le Théâtre des Champs-Elysées rouvre ses portes avec un Messie de Haendel présenté en janvier à Salzbourg. Le mélomane parisien se souvient d’avoir vu en 2007, au Châtelet, une Passion selon saint Jean mise en scène par Robert Wilson. Même confrontation avec le récit des évangiles, à cela près que le texte de Charles Jennens est infiniment moins narratif, infiniment plus abstrait que le collage de citations bibliques et d’extraits poétiques que Bach a mis en musique. Pas de problème, puisque la narration n’est justement pas un aspect qui intéresse le metteur en scène texan. Il procède par juxtaposition d’images, par tableaux qui s’affranchissent sans scrupule de la lettre du livret. Pas de Christ, naissant ou en croix, pas de moutons ni d’agneaux, et c’est très bien ainsi. Se poserait même plutôt la question de la possibilité d’une transposition scénique pour cet oratorio : alors que les drames sacrés de Haendel, Samson, Theodora ou d’autres, semblent appeler la mise en scène tant l’action en est théâtrale, Le Messie résiste à l’illustration.
Non que l’entreprise n’ait jamais été tentée : dans un passé récent, on peut en citer deux exemples, dont une réussite admirable et un échec lamentable. En 2009, Claus Guth montrait à Vienne et à Nancy une production qui surmontait tous les écueils possibles, dans un de ces décors tournants et à transformation que bien d’autres lui ont repris par la suite. En 2012, à l’Opéra de Lyon, Deborah Warner se révélait incapable de proposer une vision cohérente, avec une mise en scène déchirée entre la tentation sulpicienne et l’actualisation la plus triviale.
Rien de tel à redouter de la part de Bob Wilson. Tout se déroule dans un cube gris bleuté, aux arêtes soulignées par des néons blancs ; le sol, également strié de néons, sera par moments noyés sous les fumigènes. Le chœur arbore des tenues intemporelles, chignon sévère et robe aux chevilles pour les dames, costume gris porté sans chemise pour les messieurs ; il apparaît parfois muni d’accessoires tels que branche, gobelet ou pliage. Quelques éléments de décor tomberont des cintres, arche monumentale, arbre desséché qui pivote sur lui-même ou, plus énigmatique, un corps sans tête, plus précisément un costume vide assis sur une chaise et tenant une langouste en laisse… Deux figurants interviennent : une exquise petite fille en robe blanche et aux cheveux coiffés en macarons, et un vieux monsieur à qui l’on a fait la tête de Charles Darwin à la fin de sa vie (faut-il y voir un pied de nez aux créationnistes ?).
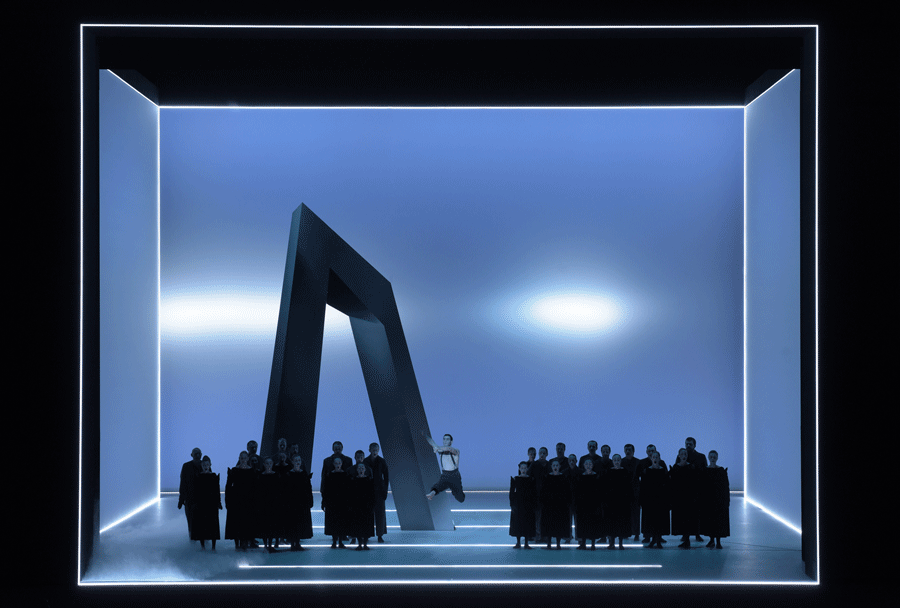
Un danseur est de presque tous les tableaux, sous des costumes variés, sorcier africain, cosmonaute, ou pantalon-torse nu : Alexis Fousekis n’en est pas à sa première collaboration avec Bob Wilson, puisqu’il avait participé à son Oedipus Rex. C’est à lui que revient la tâche d’ouvrir le spectacle, en indiquant d’emblée que l’on nous montrera la musique et rien d’autre : le corps blanchi, vêtu d’un pagne, le danseur ramasse deux grands rubans blancs avec lesquels il se met à tournoyer pendant l’Ouverture.
Les quatre solistes renvoient eux aussi à des univers tout à fait distincts, qui peuvent rappeler certains spectacles antérieurs de Bob Wilson. De Madame Butterfly, production qui ne cesse de revenir à l’affiche de l’Opéra Bastille depuis 1993, semble surgir la basse, crâne surmonté d’une sorte de nœud de cheveux exagérant le style classique japonais. José Coca Loza est néanmoins celui des quatre qui semble le moins à l’aise avec la méthode wilsonienne, et il paraît cantonné à un répertoire de gestes particulièrement limité. La voix tarde un peu à se chauffer, mais ses derniers airs révèleront un vrai timbre de basse. Issue du Couronnement de Poppée vu à Garnier en 2014 ou d’un autre Monteverdi wilsonisé, la mezzo porte vertugadin élisabéthain et une perruque d’un roux flamboyant que n’aurait pas renié la Reine Vierge. Découverte dans Polifemo de Bononcini, la Néerlandaise Helena Rasker possède un timbre des plus chaleureux, même si on aimerait parfois un peu plus de volume, et ses accents émouvants font merveille dans « He was despised ».
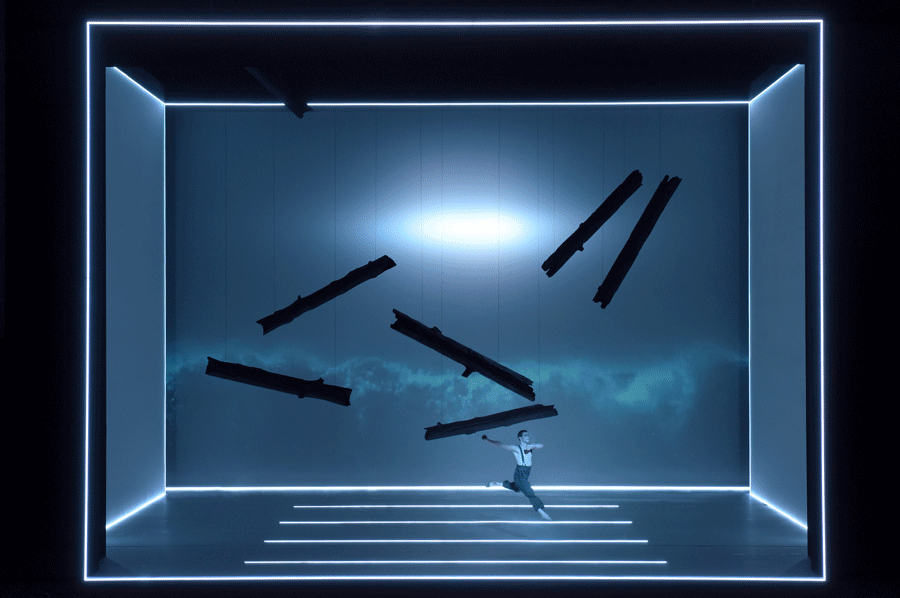
Ou plutôt, et il est temps d’y venir, dans « Er ward verschmähet », car ce n’est pas The Messiah qui est interprété, mais Der Messias. Et ce Messie-là a été interprétée à Salzbourg dans le cadre de la Mozartwoche, c’est bien parce qu’il s’agit de la partition telle que Wolfgang Amadeus l’a réécrite à la demande du comte van Swieten, avec traduction en allemand commandée à Klopstock et à C.D. Ebeling. Ces interventions, près d’un demi-siècle après la création dublinoise en 1742, transforment assez sensiblement la physionomie de l’œuvre. Les sonorités germaniques de la langue, superbement projetées par le Philharmonia Chor Wien, nous éloignent d’une certaine fluidité de l’anglais, « For unto us a child is born » acquiert un côté plus percussif, par exemple, d’où un certain dépaysement. L’orchestre, lui, devient plus touffu, plus fourni, avec un renforcement des bois, et des inflexions qui évoquent ici ou là tel air de telle messe de Mozart. Marc Minkowski et ses Musiciens du Louvre dirige avec gourmandise ce Händel mozartisé, en fin connaisseur du répertoire mozartien qu’il a eu le temps d’explorer à Salzbourg à l’époque où il y proposait Davide penitente ou le Requiem avec la complicité de Bartabas.

Pas de chevaux, cette fois, mais l’on retrouve un des solistes du Davide penitente de 2015 : Stanislas de Barbeyrac, appelé à remplacé Richard Croft, dans l’impossibilité de voyager. Sans surprise, le ténor français met ici en valeur toutes les qualités de phrasé et de nuances qui font de lui un des grands Tamino de notre époque, mais on admire l’aisance déconcertante avec laquelle il se plie dans le moule wilsonesque, comme s’il avait toujours interprété ce personnage de gommeux des années 1930 – souvenir de L’Opéra de quat’ sous monté pour le Berliner Ensemble ? – tout en mimiques coquines et petits pas de danse désinvoltes.
 Longue crinière blanche évoquant Madeleine Sologne dans L’Eternel Retour, robe blanche montante qu’on croirait sortie d’un portrait de sa sœur Marguerite par Khnopff ou tunique au chatoiement métallique, Elena Tsallagova prête toute la pureté de son chant limpide à l’ange annonciateur avec lequel elle se confond lors de son tout premier air. Elle aussi s’approprie sans effort apparent la gestique imposée par la mise en scène, mimant le geste du rameur pour traverser la scène en barque ou versant sans regarder l’eau d’un broc dans un verre qu’elle se vide ensuite sur l’arrière du crâne. Autant d’images par lesquelles Bob Wilson ne nous raconte rien, mais nous montre un peu de son univers intérieur, ce qui est loin d’être une mauvaise façon de faire du théâtre.
Longue crinière blanche évoquant Madeleine Sologne dans L’Eternel Retour, robe blanche montante qu’on croirait sortie d’un portrait de sa sœur Marguerite par Khnopff ou tunique au chatoiement métallique, Elena Tsallagova prête toute la pureté de son chant limpide à l’ange annonciateur avec lequel elle se confond lors de son tout premier air. Elle aussi s’approprie sans effort apparent la gestique imposée par la mise en scène, mimant le geste du rameur pour traverser la scène en barque ou versant sans regarder l’eau d’un broc dans un verre qu’elle se vide ensuite sur l’arrière du crâne. Autant d’images par lesquelles Bob Wilson ne nous raconte rien, mais nous montre un peu de son univers intérieur, ce qui est loin d’être une mauvaise façon de faire du théâtre.