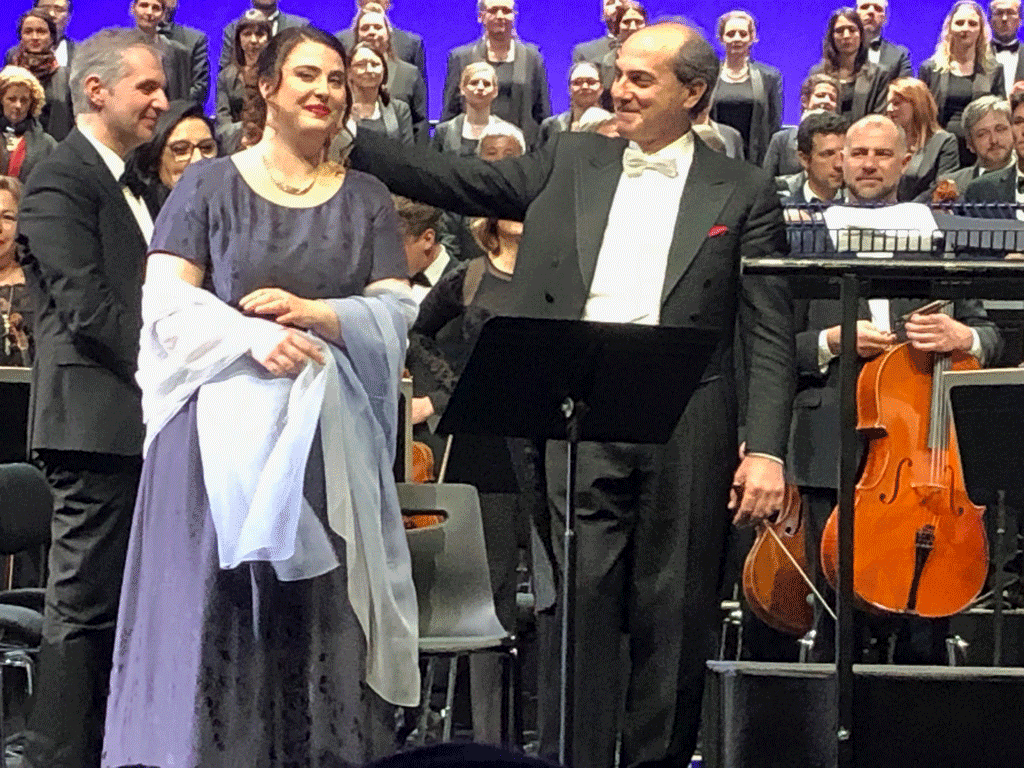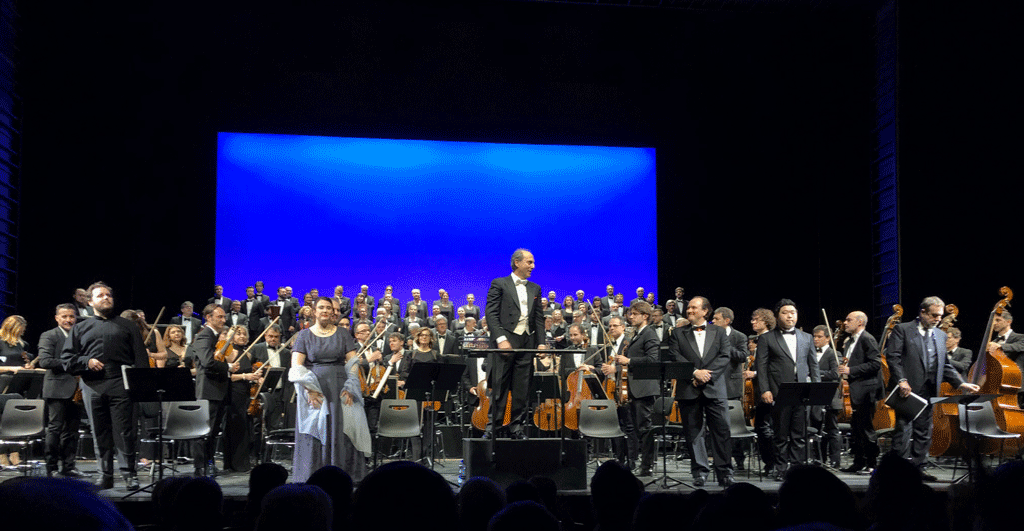
Le soprano aime le ténor, mais est l’épouse du baryton, son ennemi de toujours. Voilà pour faire simple l’histoire de Il Pirata qui applique un schéma bien connu des opéras romantiques et verdiens.
Pour faire plus détaillé, le livret de Felice Romani pour Il Pirata est tiré d’un mélodrame de Isidore Justin Severin Taylor Bertram ou le pirate créé à Paris en 1822, lui-même tiré d’une tragédie de l’irlandais Charles Maturin Bertram ; or The Castle of St. Aldobrand (1816) traduite par Charles Nodier et Isidore Justin Severin Taylor en 1821 (Bertram, ou le Château de St Aldobrand). Comme le plus souvent, les opéras belcantistes trouvent leurs sources dans les multiples drames et tragédies publiées et représentées à Paris durant ces années-là.
Sicile, XIIIe siècle : Dans la guerre qui oppose Manfred et Charles d’Anjou, Gualtiero, comte Montaldo, est chassé de ses terres par Ernesto, duc de Caldora, et devient un pirate redouté. Il laisse son aimée, Imogene, mais celle-ci, pour sauver son père, accepte d’épouser Ernesto, dont elle a un fils.
Un jour, une tempête survient qui jette Gualtiero sur les rivages de Sicile…
Tout cela finira mal : Gualtiero qui a tué Ernesto en duel est condamné à mort, et Imogene devient folle (la folie dans le bel canto étant souvent le magnifique prétexte à acrobaties vocales finales étourdissantes).
C’est toute l’histoire du Pirata, peu représenté aujourd’hui. On se demande quel type de mise en scène une telle histoire supporterait. C’est d’ailleurs le lot de nombreuses œuvres de l’époque qui ne supportent la scène que si les voix et les personnalités scéniques sont au rendez-vous.
C’est donc une bonne idée que de proposer Il Pirata dans les manifestations qui marquent la réouverture du Grand Théâtre de Genève. Marquée par le Ring de Wagner, cette réouverture laisse ainsi place au répertoire italien : la communauté italienne de Genève semblait d’ailleurs s’être donné rendez-vous place de Neuve en ce dimanche après-midi, avec des hurlements joyeux du type « Viva Italia » ou « Sei grande » sans compter les innombrables « Brava ».
C’est une autre bonne idée que d’en proposer une version concertante, la qualité de l’exécution n’a pas fait regretter une mise en scène qui n’aurait peut-être pas allégé le propos.
Sans doute parce que l’OSR était pris par la préparation du Ring, le Grand théâtre a préféré appeler un orchestre italien, un de ces orchestres régionaux qui se battent vaillamment pour défendre la tradition et le répertoire italiens dans les territoires. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, dont le chef principal est Hubert Soudant, parcourt la région des Marches, riche de nombreux (et très beaux) théâtres, pour des opéras ou des concerts symphoniques. Il possède donc ce répertoire dans ses gènes et a montré que l’Italie, plus réputée internationalement pour ses chefs et ses solistes que pour ses orchestres a de belles réserves orchestrales, avec des pupitres notables (ici notamment la flûte très sollicitée). En grande formation symphonique, la Filarmonica Marchigiana a montré un certain raffinement, une capacité à épouser de manière très lyrique et sans jamais écraser par le volume les subtilités de la mélodie bellinienne. Il est vrai que le chef expert qu’est Daniele Callegari a beaucoup travaillé le volume (une exécution concertante risquant toujours de déséquilibrer le rapport voix-orchestre) ainsi que les raffinements de la partition, mettant au jour les qualités singulières du jeune Bellini (il a 26 ans en 1827) qui cherche à affirmer une personnalité qui le distingue de la tradition rossinienne, en pleine gloire à cette époque. Callegari est un chef très attentif aux voix, qui les soutient et qui sait prévenir les éventuelles faiblesses, ou les moments à risque, et qui constitue une véritable sécurité pour les chanteurs. Mais pas seulement : c’est un Bellini énergique et vif, mais aussi lyrique et mélancolique qu’il présente ici, dans une œuvre charnière qui ouvre vers un nouveau style tout en citant la manière de Rossini. Si l’ouverture montre une libération par rapport à la tradition du grand aîné (il n’y a néanmoins que 9 ans de différence entre les deux compositeurs), la fameuse « stretta » finale de l’ouverture renvoie évidemment à l’univers rossinien, ainsi que le final du premier acte qui la reprend, mais le final du second acte annonce clairement les schémas belcantistes qu’on voit chez Donizetti et Bellini avec l’air et la cabalette pyrotechniques qui ferment l’opéra sur l ‘héroïne. D’ailleurs, le second acte par son amertume et sa noirceur annonce typiquement le Bellini du futur.
Sans doute aussi parce que le chœur dans le Ring a peu à faire, celui du Grand Théâtre dirigé par l’excellent Alan Woodbridge a pu se préparer suffisamment pour offrir une prestation de très haut niveau, tant par le volume, que le phrasé, la clarté du texte et la couleur. Le début puissant en particulier rappelle celui d'Otello de Verdi (c'est la même situation d'un navire en difficulté et du peuple qui le contemple inquiet et impuissant) et affirme immédiatement la tempête comme élément à la fois romantique, et métaphorique de ce qui va survenir.
Ainsi donc les forces en scène, orchestre et chœur, ont défendu ce répertoire avec une qualité exceptionnelle, mais il faut dire aussi que la distribution réunie était de celles qu’on pourrait voir sans problème dans les théâtres historiques les plus réputés pour le belcanto, la Scala de Milan, la Fenice de Venise, et bien entendu le San Carlo de Naples.
Il y a dans l’opéra deux rôles de complément, interprétés par des chanteurs de qualité à peine sortis de formation, Adele chantée par Alexandra Dobos-Rodriguez est la suivante d’Imogene, elle a peu à chanter mais on note notamment au début de l’acte II une belle ligne de chant et une belle homogénéité . Le rôle n’est pas si facile parce que la voix doit la plupart du temps chanter en même temps que le chœur et exige une projection solide pour s’en distinguer.
Kim Hun est Itulbo, le compagnon de Gualtiero : la voix de ténor est claire, affirmée, et sa présence vocale est soutenue par une belle diction, même si le chant est peu expressif et encore un peu appliqué.

Roberto Scandiuzzi est Goffredo, l’ermite qui au premier acte reconnaît Gualtiero sauvé des eaux. C’est un Goffredo de luxe, au regard de la grande carrière d’une des basses italiennes les plus réputées : si l’aigu est un peu voilé et si la voix a un peu perdu de son bronze, il s’affirme par le phrasé, par la couleur d’un chant affirmé et d’un grave encore bien présent et sonore. Dans l’enregistrement EMI de Caballé, Goffredo est le jeune Ruggero Raimondi. Ici, offrir ce rôle à une voix qui a l’essentiel de la carrière derrière elle est conforme à la couleur du rôle et Scandiuzzi est au rendez-vous.

Franco Vassallo est un des bons barytons italiens, habitué du Grand Théâtre où on l’a vu dans I Puritani, dans Macbeth, dans Rigoletto et qu’on reverra dans Anckarström du Ballo in maschera en mai prochain. Il a une personnalité vocale affirmée, aux aigus triomphants, notamment dans son premier air (si, vincemmo) bien projetés, bien tenus, et c’est incontestablement la voix du méchant. Il est peut-être un peu claironnant pour mon goût et surtout montre quelques problèmes de grave plutôt engorgé et de justesse dès qu’il y a des agilités et dans les cadences. C’est dommage, mais peut-être le rôle ne lui convient-il plus, notamment stylistiquement. La prestation reste cependant très honorable.

Pour Michael Spyres, c’était une double première, à Genève, où ce chanteur de référence est manifestement peu connu et dans le rôle de Gualtiero. Son parcours est essentiellement consacré aux rôles de ténor de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe, (avec quelques incursions avant et après), qui réclament des agilités, des aigus voire des suraigus et une ornementation. Sa voix assez mâle dans le registre central se développe au suraigu qu’il réussit à dominer et qui en fait aujourd’hui un artiste de grand niveau. Comme tous les chanteurs américains, il a un phrasé impeccable, une diction sans reproche. C’est aussi un artiste ouvert qui s’essaie aussi dans des rôles où on ne le verrait pas forcément comme Florestan de Fidelio.
Héros byronien par excellence, Gualtiero, un rôle créé par Rubini, exige à la fois un chant vaillant, des centres affirmés, une homogénéité dans la ligne et surtout une capacité peu commune à monter à l’aigu et au suraigu (aucun ténor au disque ne répond à ces exigences dans Gualtiero).
Le caractère de ce chant est d’abord dans l’intelligence de ménager ses forces. Michael Spyres qui aborde le rôle semble prudent au départ et les suraigus sont assurés mais tendus, peu à peu la voix se chauffe et l’air final et la cabalette (« Ma non fia sempre odiata la mia memoria ») sont un exemple de contrôle, et de technique et d'expression. Gualtiero est un des rôles du bel canto les plus exposés, qui rompt aussi avec la tradition de l’époque. Michael Spyres réussit à s’emparer du rôle avec cran et obtient un triomphe mérité. Avis aux programmateurs de Meyerbeer et du bel canto (pour un Fernand de La Favorite) et du Verdi français ( pour un Henri des Vêpres Siciliennes). Exceptionnel.

C’est Roberta Mantegna, appelée à remplacer Marina Rebeka défaillante (comme elle a remplacé un soir entre le premier et le deuxième acte à la Scala une Sonya Yoncheva sujette à une chute de tension), qui emporte la mise en ce dimanche et qui non seulement recueille un triomphe évidemment justifié, mais montre une maîtrise et un contrôle du chant rares pour un soprano à peine trentenaire et encore débutant (on en entend parler depuis un peu plus de deux ans). Comme souvent en Italie, dès qu’un soprano de qualité apparaît, il est assailli pour toutes sortes de rôles en peu de temps : songeons que Roberta Mantegna a déjà chanté Norma (!), Maria Stuarda, la Contessa (Nozze di Figaro), Micaela, Gulnara (Il Corsaro) Amalia (I Masnadieri), Imogene (Il Pirata), Léonore (Le Trouvère – version française à Parme dont nous avons rendu compte dans ces lignes), Mimi (La Bohème) et qu’elle aborde Aida au printemps prochain à Venise. On a vu tant et tant de sopranos doués tenir cinq ans puis disparaître qu’on ne peut que craindre pour la suite de la carrière de cette jeune et belle artiste.
La technique est totalement maîtrisée, la voix est d’une rare homogénéité, la base en est large, dans tous les registres, ce qui en fait un pur lirico spinto évidemment fait pour Verdi et notamment le jeune Verdi. Mais la prestation en Imogene montre aussi une maîtrise des agilités et des cadences, une facilité dans la montée à l’aigu (où l’on sent qu'elle a encore des réserves) qui font se demander si Aida est vraiment nécessaire alors que tant de rôles de bel canto sont actuellement sans titulaires fiables. On disait il y a quelques dizaines d’années que le baume pour la voix, c’était Mozart : elle peut être une Donna Anna ou une Fiordiligi d’exception, elle peut chanter les sopranos rossiniens du Rossini serio et bien des rôles de bel canto jusqu’au jeune Verdi ou même Meyerbeer. Pourquoi aller pour l’instant au-delà ? Sa technique de chant, sa manière d’aborder les notes, la couleur de la voix montrent qu’elle aura peu de rivales dans le répertoire classique et romantique. Il lui manque peut-être un soupçon de fluidité dans les agilités, un soupçon de vie intérieure dans l’interprétation pour s’imposer parmi les très grandes. Une magnifique prestation néanmoins qui laisse espérer une grande carrière, si elle sait résister au chant des sirènes.
Un triomphe comme on n’en a pas vu depuis longtemps au Grand Théâtre, et qui remplit de joie. Quand le niveau est là, le public sait le reconnaître.