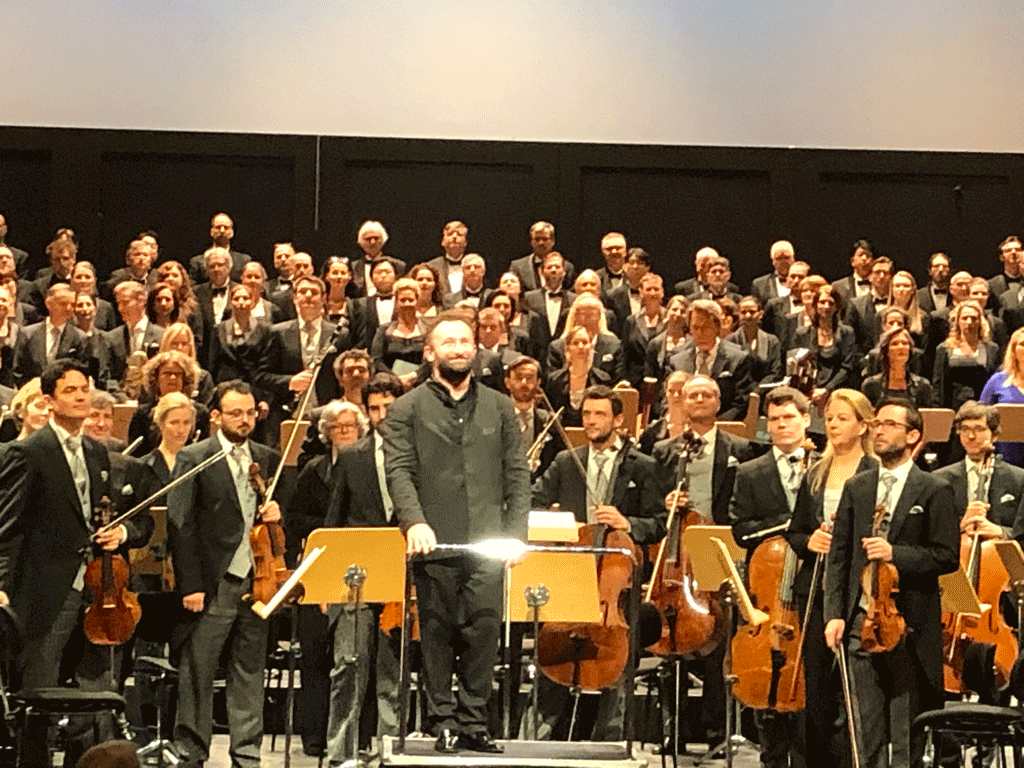
Kirill Petrenko
Dans le paysage des dix chefs de référence aujourd’hui que le mensuel espagnol Platea Magazine a classés il y quelques semaines, Kirill Petrenko est singulier : il dirige une trentaine de représentations annuelles à l’opéra et donne au mieux une dizaine de concerts. Pour le reste, il travaille les partitions. Nikolaus Bachler, l’intendant de la Bayerische Staatsoper, dans une interview qu’il nous avait accordée il y a quelques années avait souligné qu’il étonnait tout le personnel de l’opéra par sa présence au quotidien dans la maison, même pendant les périodes où il ne dirigeait pas.
Les Berliner Philharmoniker en 2015 savaient quel personnage ils élisaient : ils savaient sa réserve face à la communication, sa distance par rapport aux enregistrements. Ils l’ont élu en toute connaissance de cause, même s'il ne les avait dirigés que pour trois concerts, comme le rappellent perfidement certains "connaisseurs".
Depuis son élection en 2015, il prépare ses saisons, en dirigeant çà et là des concerts et des œuvres qu’on a vues ou qu’on va voir dans les programmes de l’orchestre berlinois. C’est un chef d’opéra hors pair, qui fait à peu près l’unanimité dans les œuvres qu’il a dirigées, jusqu’à Lucia di Lammermoor, avec une réserve sur Mozart (La Clemenza di Tito) qu’il aborde très prudemment. Du point de vue symphonique, il a une affinité nette pour le post-romantisme et notamment Gustav Mahler, on l’a entendu dans Brahms où il a un peu clivé le public et du côté du romantisme on l’a entendu dans Mendelssohn où il a totalement convaincu. Les détracteurs disent qu’il a peu de répertoire symphonique, mais c’est aussi ignorer sa formation viennoise et les différents postes occupés. Petrenko a une carrière en marge des très grandes institutions musicales et aime retrouver des orchestres avec lesquels il a tissé des liens, indépendamment de leur célébrité. C’est ainsi qu’il aime diriger le Symphonieorchester Vorarlberg, son orchestre des origines, voire les orchestres italiens comme celui de la RAI avec lequel il entretient une relation régulière depuis des années (dès 2001, il remplace à Turin le défunt Giuseppe Sinopoli pour une exécution concertante de Der Rosenkavalier et depuis il est invité régulièrement).
Il aborde cette année Beethoven en concert et à l’opéra dont on vient de voir à Munich un Fidelio stratosphérique, un titre prévu aussi avec les Berlinois au Festival de Baden-Baden 2020, il a déjà dirigé la Symphonie n°7, on va entendre cette année à Rome la Neuvième (les 4, 5 et 6 avril) par l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia et à Turin l’Eroica les 26 et 27 avril prochains avec l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI . À titre de comparaison, Claudio Abbado a attendu les années 80 (il avait 47 ans en 1980, comme Petrenko aujourd'hui) pour insérer régulièrement Beethoven dans ses programmes. Jusque là et pendant les vingt premières années d'exercice, il dirigeait un concerto par ci par là et surtout la Symphonie n°7, sa symphonie fétiche.
La Missa Solemnis, une question en suspens dans l'histoire de la musique
C’est la Missa Solemnis en ré majeur op.123 qui est au programme, une œuvre qui a été l’un des piliers des programmations d’Herbert von Karajan, mais qui se fait plus rare aujourd’hui. Une œuvre que Furtwängler estimait si complexe qu’il arrêta de la diriger en 1930 et qui ne l’a jamais enregistrée, une œuvre que Claudio Abbado n’a jamais exécutée ni enregistrée,
La dernière exécution entendue, de très haut niveau, est celle que Christian Thielemann a offert en avril 2016 au Festival de Pâques avec Krassimira Stoyanova, Christa Mayer, Daniel Behle, Georg Zeppenfeld.
La Missa Solemnis de Beethoven est difficilement classable, par la difficulté d’exécution, tant vocale d’instrumentale, par des dimensions telles (elle dure 1h20 là où une messe n’excède rarement les 45 minutes) qu’elle peut difficilement trouver place dans une église, et de fait, elle a été créée lors d’un concert à Saint Petersbourg. Beethoven y travaille de 1819 (un an après la publication de la messe en si de Bach) à 1823. Avec Bach et les messes de Haydn dont la Missa in tempore belli (1796), un des modèles en est la Missa Solemnis de Cherubini en ré mineur, de 1811, dédiée au Prince Esterházy, une œuvre que Beethoven connaissait de longue date, lui qui tenait Cherubini comme le maître absolu de la musique sacrée du temps
La question est d’abord le rapport de Beethoven à la transcendance et la question de sa croyance. L’espace démesuré consacré dans la messe au Gloria, et surtout au Credo que Beethoven a mis tant de temps à composer montre la difficulté à se penser face au Divin et à la mort. La question est donc celle de la place du religieux, et en même temps une sorte de volonté débordante d’affirmer le religieux (la Missa solemnis est destinée à l’intronisation de l’archiduc Rodolphe comme évêque d’Olmütz). Les dimensions hors normes et le contenu de l’œuvre en font un monument à la musique avec toutes ses contradictions : oeuvre religieuse impossible à jouer à l'église, œuvre où le doute s'affiche trop pour les uns, et où la foi (ou le désir de foi) s'affiche trop pour les autres. C'est un chef d'œuvre impossible qu'Adorno appelle le chef d'oeuvre "aliéné" ((Alienated masterpiece, The Missa Solemnis (1959) )).
Kirill Petrenko la programme donc en concert, et il affirme ainsi non seulement sa volonté de l’affronter, mais aussi de lui donner une couleur qui surprend par son côté incisif, et son absence de rondeur ou de complaisance dans la grandeur.
Kirill Petrenko n’est jamais un chef qui atténue les aspérités, il les exalte au contraire en créant des contrastes violents et accentuant les effets (c’est patent dans son Fidelio). Il aborde la Missa Solemnis par le contraste et par une relative sécheresse. Aucune note n’est oubliée, mais aucune note n’est appuyée de manière complaisante. C’est un agencement très scrupuleux, et particulièrement savant, à la fois une lecture éclairée par la musique ancienne (du XVe, souligne Adorno et de la Renaissance), en rupture avec le Beethoven des premières années du siècle qui pose le débat autour d’une œuvre dont il est difficile de donner le sens, magnification du doute ? de la foi ? de l’homme en Dieu ? . En programmant successivement, Fidelio, puis la Missa Solemnis, puis la Neuvième, il y a peut-être une intention dictée par l’aventure illuministe (Et Beethoven en appelait à Kant)(( Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt : Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. / Deux choses remplissent mon esprit d’une admiration et d’un respect incessants, aussi souvent et obstinément que ma pensée s’y consacre : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Critique de la Raison pratique, 1788, ch.34 Conclusion)) de l’homme dans le monde, et face « au ciel étoilé » et de l’homme face à l’éventuelle création. Il est clair que le débat autour de la Missa Solemnis n’est pas clos, et notamment autour d’un essai déjà cité de Theodor W.Adorno « Alienated masterpiece, The Missa Solemnis (1959) » auquel Charles Rosen répond notamment dans « The classical Style ».((Traduit en français : Le style classique : Haydn, Mozart, Beethoven, Coll.Tel, Gallimard, Paris, 2000)) . Ce n’est pas le lieu d’entrer dans le débat intellectuel autour de cette pièce, mais il est clairement contenu dans la Missa Solemnis telle qu’elle est livrée par Kirill Petrenko et il faut donc l’avoir en tête pour saisir la manière dont il envisage son interprétation.
Nous sommes à l’opposé d’un Karajan ou même d’un Thielemann à la grandeur colorée des basiliques baroques, propice à élever l’âme et à la respiration de la transcendance, à la majesté et au son moins acéré. Nous sommes incontestablement sur la terre, dans un débat humain sur Dieu, sur l’après, sur la mort, nous sommes dans une « Passion » beethovénienne, en cinq stations. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei à la rigueur presque protestante, sinon orthodoxe.
Les solistes
Dans la disposition qu’il a privilégiée, Petrenko place les solistes avec le chœur, au fond, à cour. Les solistes dans la Missa Solemnis n’ont pas de parties solistes, et leurs interventions doivent à peine surnager de celles du chœur, d’où l’impression de voix plus pâles que les distributions habituelles des disques. Mais il y a là aussi une volonté de Petrenko : aujourd’hui, n’importe quel chanteur de renom serait disponible pour une telle œuvre avec un tel chef. Petrenko choisit des solistes qu’il connaît, (Marlis Petersen fut sa Lulu et sera sa Salomé, Benjamin Bruns son David des Meistersinger, Okka von der Damerau et Tareq Nazmi font partie de la troupe de Munich) avec lesquels il peut travailler dans le détail le texte et les inflexions. La question des solistes est celle de la fusion sonore et celle de moments de caractérisation et de relief et surtout leur disponibilité à se fondre dans un collectif et à travailler chaque détail.

Marlis Petersen ne pousse jamais sa voix, mais montre un très grand contrôle des variations et des aigus, assez époustouflant, Okka von der Damerau prête son mezzo charnu et clair, toujours juste, Benjamin Bruns est très clair dans la diction et dans la ciselure du texte, et Tareq Nazmi montre une fois de plus un beau grave, dont le timbre chaleureux fusionne parfaitement avec les autres, mais qui sait aussi se détacher notamment vers la fin. C’est tout un jeu très subtil où la voix doit se distinguer, mais aussi devenir presque anonyme, une parmi d’autres, pour éviter dans une pièce aussi terrible pour les voix (notamment la partie de soprano) qu'on ne verse dans une sorte d’histrionisme, mais au contraire qu’on se dilue dans une entreprise globale.
Kyrie
Dans le Kyrie initial, malgré les cuivres et les timbales, il n’y a dans l’accord initial qu’une entrée non solennelle et assez retenue, qui n'est pas sans rappeler le Mozart de la Zauberflöte. Cet accord initial, dit donc assez l’ambiguïté de l’entrée en Dieu et l’appel à la pitié. Beethoven y écrit en marge : « Vom Herzen ! Möge es wieder zu Herzen gehen » ((Venu du cœur ! Puisse-t-il retourner au cœur !)), comme s’il s’agissait du mouvement circulaire qui retournait à l’homme mais aussi d'une sorte de programme autobiographique. On entend dès le début par l’attaque retenue l’ambiguïté immédiate de l’œuvre, et cette circularité frappe dans l’intervention du quatuor, au crescendo limité.
La distribution de l’orchestre en grande formation symphonique (voir le nombre de cordes) montre que Petrenko ne se plie pas aux pratiques actuelles en matière d’interprétation beethovénienne, mais recherche plutôt une couleur sonore proche d’aujourd’hui, faisant de Beethoven un précurseur de la modernité. Qu’un Klemperer à la pointe de la modernité musicale dans les années 20 ou 30, le créateur d’œuvres de Schreker, ou d’hindemith, soit si souvent revenu à la Missa Solemnis est peut-être aussi un indice.
Comme souvent dans ses exécutions symphoniques, Petrenko laisse de très longs silences entre les mouvements ou entre les parties, comme pour éviter une solution de continuité et pour marquer la notion de station presque indépendante de ce qui précède et d’unité dramaturgique de chaque moment, mais aussi pour permettre à l'auditeur de rentrer en soi. Il y a une démarche méditative que Petrenko n'oublie jamais dans ses concerts.
Gloria
Ainsi du Gloria qui démontre un sens rare de la dramaturgie de l’œuvre, avec des contrastes presque immédiats entre le « Gloria in excelsis Deo » qui explose triomphant, avec toute les forces en présence (mais sans l’intervention des solistes) pour que la suite soit ensuite murmurée « et in terra pax hominibus », en des contrastes violents qui vont se répéter, allant de l’affirmation de la gloire divine à l’imploration de la pitié (« miserere nobis » ), on passe d’une explosion sonore à un son peine perceptible. À partir de Quoniam tu solus Sanctus, nous sommes emportés de manière étourdissante, les voix solistes sont particulièrement sollicitées au niveau de la dynamique en un tourbillon (magnifique Marlis Petersen) qui rappelle par sa couleur le final de Fidelio, mais qui sonne aussi dramatique avec un Amen brutal et un arrêt presque sur image qui suspend. Un Gloria en point d’interrogation en quelque sorte, prodigieusement virtuose.
Petrenko ici ne cesse de pratiquer la rupture, d’aller de la puissance sonore à l’à peine perceptible, du cri au murmure, comme dans un désordre structurel des âmes en un dérèglement raisonné des sens. Ici le grandiose naît du drame. Simplement prodigieux.
Credo
Le Credo est le pivot de la pièce, par sa longueur, par son insistance, il a incité la plupart des commentateurs à monter un Beethoven en proie au doute et à la difficulté de prononcer la parole « Credo » (je crois). La question est ici de lutter pour croire.

L’ensemble de ce moment est particulièrement contrasté, avec de nombreuses variations de nuances et de tempo, peu d’intervention du quatuor vocal sauf dans l’incarnation « et incarnatus » avec le jeu des voix à la manière des Polyphonies de la Renaissance, des interventions de la flûte en dialogue, comme si deux dimensions, humaine et divine s’accompagnaient puis des interventions particulièrement tranchantes et acérées de l’orchestre, et une recherche harmonique dans le morceau suivant « Crucifixus » qui confine au sublime par le jeu sur « passus » qui évoque la souffrance du Christ et dont chaque voix s’empare presque in pectore avec un chœur d’hommes en sourdine exceptionnel. C’est un des moments les plus forts de la soirée, immédiatement rompu par l’intervention a capella du chœur « Et resurrexit » et puis par le mouvement d’ascension (allegro molto) et la longue fugue finale confiée à un chœur déchainé, d’une folle énergie soutenu par un orchestre étourdissant, puis freiné par un brusque ralentissement au moment de « credo in unam sanctam.. », des voix de femmes notamment en crescendo, moment parmi les plus étonnants et inédits du point de vue de l’agencement des sons et du lien voix et orchestre : il faut noter la fluidité des interventions solistes (la flûte) et l’éblouissement de la partie finale, qui cloue littéralement sur place, avant l’intervention des solistes sur « et vitam venturi » (Marlis Petersen encore vraiment excellente) et de la flûte en un final qui s’éteint en decrescendo à la Cherubini. Sublime.
Il y a une sensibilité peu connue de Kirill Petrenko à la musique ancienne et à la musique baroque qu’on connaît peu parce qu’on le suit depuis une dizaine d’années et qu’il n’en a pas dirigée, on l’entend la manière de gérer les timbales, la manière sèche de conduire certaines phrases d’orchestre, même s’il n’est pas un chef « philologique ». Il refuse tout élément qui gauchirait cette impression de parole directe, non médiatisée par un jeu sur la couleur ou un legato excessif. C’est un monument brut, fait de doute et de confiance, fait de sentiments contradictoires, où l’auditeur est ballotté comme ces âmes à la recherche de salut.
Sanctus

Changement total de perspective au Sanctus, précédé d’un autre très long silence qui devrait inviter à la concentration et au repos après ces orages.
Le Sanctus est indiqué « Mit Andacht » (avec dévotion) et commence par une introduction orchestrale très retenue en discret crescendo avec des cuivres discrets en soutien, avant l’intervention des solistes qui cette fois prennent à eux seuls la voix et entrent successivement, particulièrement intériorisés voire angoissés, (magnifique Okka von der Damerau) avec une brutale rupture de construction, une anacoluthe musicale en quelque sorte dans l’allegro pesante où entre le chœur fugué (« pieni sunt coeli ») particulièrement difficile pour les voix féminines très sollicitées à l’aigu avant le passage brutal au lent Praeludium.
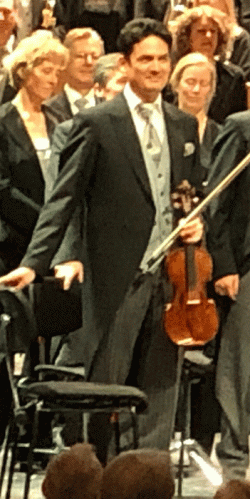
C’est paradoxalement à la fois brutal et imperceptible tant l’auditeur est happé subitement par ce mouvement lent aux cordes, puis aux flûtes qui prépare la magnifique intervention du violon solo aérien de David Schultheiß, à la fois légère et mélancolique, une intrusion de pure émotion au milieu de ces sentiments qui bouleversent et écrasent l’auditeur. Après l’angoisse initiale du Sanctus et l’explosion du Osanna qui précède.
Ce violon provoque l’émotion, mais n’a rien de sentimental, c’est un peu comme l’évocation de ces anges musiciens du paradis, comme on les voit dans la peinture vénitienne de la Renaissance, comme si le Saint Esprit se faisait entendre un moment. La courte évocation d’une Pentecôte dont l’apôtre serait l’auditeur se poursuit pendant tout le Benedictus avec un dialogue tellement sensible du violon et de l’orchestre qu’on penserait à un concerto pour violon (particulièrement difficile à jouer ici) où les voix interviennent une dernière fois (Tareq Nazmi y montre grande sensibilité et Marlis Patersen une fois de plus étonne par la sûreté de sa ligne de chant). Ce Sanctus et notamment son moment final est un moment totalement suspendu d’une poésie incommensurable, tantôt d’une intimité qui force l’auditeur à rentrer en lui, tantôt d’une respiration élargie à l’épique, avec un violon séraphique qui accompagne ce Benedictus jusqu’au bout quand les voix s’éteignent.
Agnus Dei
La courte introduction orchestrale assez sombre et inquiétante prélude à l’intervention de la basse, ici remarquable également, l’appel à la pitié (miserere nobis) prend alors une couleur sépulcrale qui marque un dialogue angoissé avec le Divin, comme au seuil de la mort. Un Dieu qui semble tout à coup écraser et inspirer la crainte, l’inquiétude, le Dieu presque Pantocrator des orthodoxes. Les quatre solistes sont ici exceptionnels parce que leur voix justement jamais n’envahit l’espace, mais dialogue avec le collectif choral, soutenu par un orchestre discret (quels bois magnifiques !) et d’une rare légèreté laissant les voix s’imposer et s’affirmer de manière angoissante.

L’angoisse des temps troublés qui viennent de passer et qui attendent sans doute se marque par les trompettes (rappel de Haydn et de sa Missa in tempore belli) qui ouvrent l’allegro assai qui précède le presto final, mais des trompettes ici discrètes comme un rappel lointain des inquiétudes et des troubles humains. Les solistes interviennent de manière plus tendue (Benjamin Bruns ici particulièrement clair) en crescendo d’une grande tension qui joue en même temps sur les contrastes entre le volume du chœur et des solistes et d’un orchestre plutôt léger (dialogue des pupitres, bois, cordes, cuivres) qui va en crescendo et devient presque sec et brutal (timbale discrète et menaçante) en une agitation qui n'a rien de grandiose avec une intervention finale qui ne se termine pas par un point d’orgue où la musique envahirait l'espace pour donner l'impression d'un accueil en Dieu spectaculaire, mais tout en retenue, par une suspension, comme si la musique s’effaçait, comme si on restait au bord de l’inconnu.
On l’aura compris, même s’il est vain de vouloir fouiller dans chaque détail, il reste que chaque seconde de la partition a été pesée et travaillée, que chaque intervention soliste a été volontairement calibrée, que chaque moment choral a été l’objet d’une recherche patiente des équilibres. Le chœur préparé par Sören Eckhoff se montre ici à la hauteur du défi, surtout d’ailleurs du côté des voix d’hommes, très sollicitées dans les moments de retenue et en sourdine, les voix féminines ont eu quelque moment d’imprécision qui se résoudront sans doute lors des deux concerts suivants. Quant à l’orchestre, il se montre une fois de plus l’une des meilleures phalanges, en fosse comme sur scène, où il démontre suivre chaque geste du chef, sans scorie, sans aucune bavure, dans un mouvement de confiance presque fusionnel par la magie du geste multiple et précis du chef, qui est partout.
Enfin, Kirill Petrenko affronte ce monument en produisant une interprétation plus tranchante, sans concession au sentimentalisme ni au "grandiose pour le grandiose", sans chaleur ni rondeur, mais sans froideur non plus, avec un soin tout particulier donné à l'interrogation, par le jeu des variations de tempo, de couleur, de tonalité, par le jeu des contrastes de volume et de rythmes, par le jeu beethovénien d’une recherche formelle qui mime sans doute une recherche spîrituelle qui semble encore aujourd’hui sans réponse, infinie. Petrenko propose ici un travail totalement nouveau stupéfiant par certains côtés et surtout complètement ouvert. Il reste à voir comment il y répondra dans les temps à venir. Ce n’est que le début de l’exploration. Wait and see. Quel concert…!
