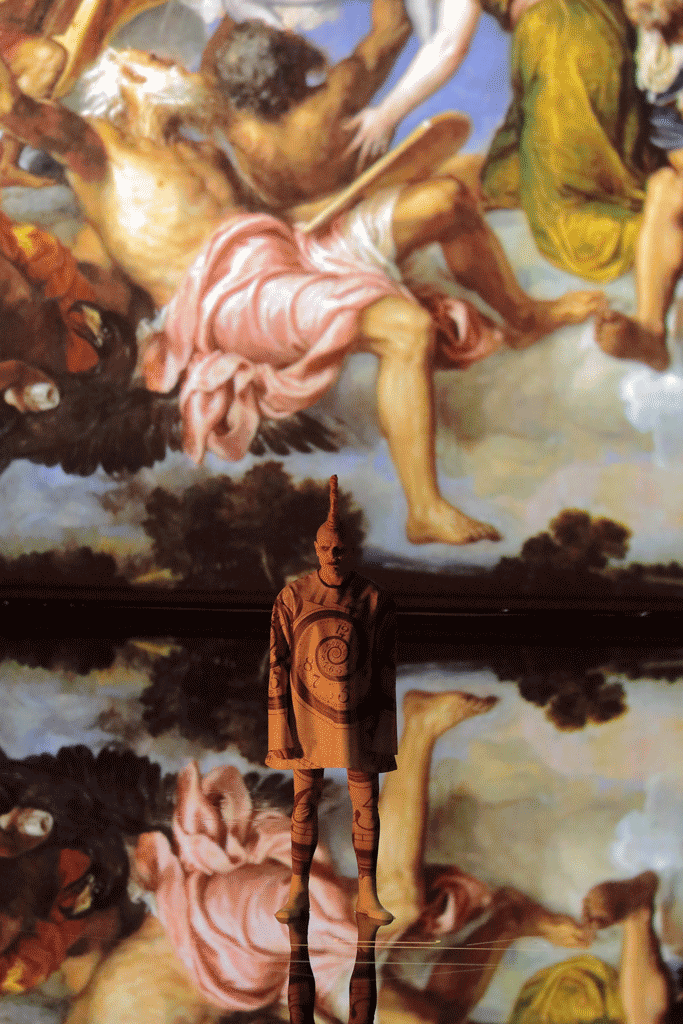
Pour tenter de comprendre les intentions d’Ernst Krenek écrivant Karl V., il faut d’abord partir du titre et du sous-titre : Le titre Karl V. (ne jamais oublier le « . », qui marque l’ordinal en allemand, et signifie Charles Quint (Carlo quinto= Charles le cinquième). Le sous-titre en est « Bühnenwerk mit Musik » soit « Drame musical, littéralement Œuvre scénique avec musique » et non « Opéra ».
Aujourd’hui on rangerait donc cette œuvre du côté du théâtre musical. Nous sommes dans une forme qui n’est pas dramaturgiquement définie, quelque chose comme un Mystère au sens médiéval du terme qui nous raconterait l’histoire de l'agonie de l’Empereur Charles Quint ou plutôt sa Passion où sont revues les différentes stations de sa vie .
Un peu d'histoire d'Europe
Charles Quint a sans doute plus ou moins disparu des leçons d’histoire en France : dans l’historiographie du roman national, il est le méchant qui fait prisonnier notre beau et gentil François 1er après la bataille de Pavie. Mais le français est sa langue maternelle : il est le petit fils de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, dont il porte le prénom.
Dans les leçons de l’histoire européenne, il est le très catholique – il se retirera au monastère de Yuste (bien connu pour ceux qui connaissent Don Carlos de Schiller ou de Verdi) – qui cherche à unifier l'Europe sous l'autorité de la Croix mais qui laisse quand même ses lansquenets luthériens mettre à sac la ville de Rome en 1527, car cet Empereur aux territoires infinis règne aussi bien sur des états catholiques que sur des protestants, et tout cela est bien compliqué…
François 1er, notre beau roi qui fit construire les châteaux de la Loire et notamment ce rêve éveillé qu’est Chambord, chercha toujours à encadrer, limiter et contraindre le pouvoir de Charles Quint car la France prise en étau entre l’Espagne et le Saint Empire Romain Germanique a besoin d’un peu d’air. Il faut donc aussi prendre en étau Charles Quint en s’alliant avec l’Empire Ottoman aux désirs et prétentions européennes. Au XVIe, l’Empire ottoman s’étend jusqu’aux frontières de l’Autriche et possède la Hongrie et Budapest (qui a de beaux restes ottomans) et une alliance Roi de France-Sultan coince à son tour Charles Quint entre deux puissances. Le tropisme ottoman de la France va durer le temps suffisant pour justifier dans notre histoire racontée aux collégiens le silence relatif sur la bataille de Lépante (1571) ou sur le siège de Vienne de 1683 où un héros célébré dans toute la chrétienté, Jean Sobieski le polonais, repousse de Vienne les vilains turcs.
Pour l’historiographie allemande, Charles Quint est l’Empereur qui doit se coltiner la Réforme protestante, et notamment Martin Luther (il a 17 ans et il n’est pas encore Empereur lorsqu’en 1517 Luther placarde ses 95 thèses à Wittenberg qui marquent le début de la Réforme.). Charles Quint qui veut unifier l'Europe sous la Croix doit donc à la fois contenir la Réforme protestante qui gagne tous les territoires du centre et nord de l’Allemagne et certains princes électeurs, contenir les prétentions ottomanes à l’Est et françaises à l’Ouest. Les luttes entre Charles Quint et François 1er se règlent en Italie, d’où les infinies guerres d’Italie, où le Pape (notamment Clément VII) cherche à jouer l’un contre l’autre au gré de ses intérêts. Pendant qu’on se bat en Italie, l’Espagne de Charles Quint conquiert l’Amérique du Sud et surtout ses sources d’or qui semblent infinies.
Tels sont les enjeux de l’œuvre, écrite entre 1931 et 1933, dans une Europe troublée où la reconstitution d’un « Lebensraum » germanique, d’un Reich qui s’étende sur toute l’Europe est d’actualité : elle a été composée au moment de l’accession d’Hitler au pouvoir en Allemagne, mais est créée à Prague en 1938, l’année de l’Anschluss, de Munich et peu avant l’annexion de la Bohème suite à l’affaire des Sudètes. Elle est d’ailleurs interdite en 1934 en Allemagne, comme musique dégénérée, et Clemens Krauss qui la commissionna refusa de la créer à Vienne, sans doute pour éviter des remous politiques, bien que Krenek ne soit pas juif et se tienne éloigné de toute activité politique. Karl V. arrive donc au mauvais moment.
La thématique du sens du pouvoir et de sa vanité est donc au centre de l’œuvre, à une époque où les théories brechtiennes commencent à intéresser l’univers théâtral germanique. Le regard sur le pouvoir et sur la société sont des éléments qui le traversent, intéressent le théâtre épique, à la vision éloignée d’une dramaturgie de la mimésis. Karl V. raconte en fait l'impuissance du pouvoir le plus important soit-il à aller contre les grands mouvements de l'histoire, que ce soit la Réforme ou les transformations du monde induites notamment par Copernic.
Or la pièce de Krenek place Charles Quint, le tout puissant Empereur, face à sa vie et ses échecs successifs et chaque personnage lui glisse dans l’oreille : « Tu as failli ». De là à affirmer que tout pouvoir excessif est condamné à son propre échec, il n’y a qu’un pas.
Un travail sur la vanité du pouvoir et la petitesse humaine
Alors, compte tenu de l’ensemble de ces enjeux (il y aussi des enjeux musicaux que nous aborderons plus loin), la mise en scène de Carlus Padrissa et de la Fura dels Baus pourrait apparaître pompeuse, pleine d’effets au demeurant très réussis, gigantesque et inutilement tape à l’œil. En réalité elle travaille au rapport entre le Cosmos, l’univers et la petitesse de l’homme, concept typiquement pascalien, et porté aussi par la Réforme, qui affirme dans ce contexte la relativité du pouvoir, notamment quand il se croit absolu, d’où le traitement sarcastique des trois souverains, Charles Quint, François 1er, Soliman qui sont des figures de marionnettes, et où Charles Quint a un costume (costumes de Lita Cabellut) qui rappelle – et ce ne peut être un hasard – celui du père Ubu d’Alfred Jarry, dont l’Ubu Roi paru en 1896 est satire du pouvoir, précurseur du surréalisme, un mouvement que Krenek connaît bien..

Charles Quint en père Ubu, et tout à coup on comprend tout du sens donné à l’œuvre par Carlus Padrissa. On nous montre l’agonie d’un Ubu Roi, qui a joué et perdu, avec ses copains de bac à sable Franz I. et Soliman, tout aussi ridicules et impuissants.

Les images grandioses qui défilent doivent être mises à distance par les personnages qui sont des figures caricaturales au milieu de références historiques et artistiques précises, mais en même temps de références esthétiques. C’est un monde de bandes dessinées, d’univers de l’enfance, d’univers du jeu vidéo qui est là présenté, qui patauge au sens propre dans l’univers où le sol est une pataugeoire, un univers élémentaire fait d’eau de feu et d’air.
Dans le contexte évoqué plus haut, cette conception est particulièrement bienvenue. Le XVIe est fait de réflexions sur l’Univers qui vont révolutionner la vision du monde, Copernic est parfaitement contemporain de Charles Quint et ces planètes qui tournent en système, ce monde qui se meut et dont les formes deviennent meubles, ces découvertes qui élargissent la vision du monde et relativisent le rôle de l’homme, c’est tout le sens des décors impressionnants tout en mouvement, qui surtout ramènent les conflits à des guerres picrocholines entre souverains-caricatures, car Rabelais est aussi contemporain de Charles Quint et François 1er, et la guerre des hommes est toujours picrocholine face à l’univers et au Cosmos.

On sait que Charles Quint demanda à voir plusieurs tableaux du Titien, dont « Le jugement dernier » appelé aussi depuis Philippe II « La Gloire », aujourd’hui au Prado. Dans ce tableau, Charles Quint présente à Dieu et Jésus placés par le peintre au même niveau. Charles Quint y est présenté dans un simple suaire, un homme corrompu par le péché venant implorer miséricorde, sans autre attribut du pouvoir que la couronne qu’il présente aux juges, comme un simple objet débarrassé de toute sa symbolique. C’est bien la petitesse de l’homme qui est ici soulignée y compris le plus puissant de la terre. Charles Quint tint à ce que le tableau l’accompagnât jusqu’à la fin. Ce n’est donc pas un hasard si le tableau (qui peu à peu s’anime d’ailleurs), d’une incroyable dynamique, soit représenté en fond de scène dans les premiers moments.
Krenek, à partir d’une histoire vraie, figure ainsi les derniers moments de Charles Quint, confronté et à sa vie et à la vision par Titien du jugement qui va marquer sa rencontre avec Dieu.
La question est posée : que signifie ce tableau pour un administrateur du pouvoir, le plus puissant des administrateurs, sinon que seul l’attachement à Dieu peut sauver l'homme le plus puissant. D’où le moment de doute, le moment tragique qui va envahir Charles Quint.
Pleine de sens aussi l’évocation maternelle par l’apparition en scène de la mère en Pietà de Michel Ange. Le chef d’œuvre aujourd’hui au Vatican est consigné en 1499, et Charles naît en 1500.
La mater dolorosa qui porte son fils descendu de croix est à rapprocher et de la situation de Charles Quint, au bord de l’issue fatale, qui est porté par sa mère qu’il évoque dès les premiers moments, en lien aussi avec le tableau de Titien où la Vierge, en troisième personnage de la trinité miséricordieuse à laquelle Charles en appelle, a déjà sans doute intercédé en sa faveur.
L’utilisation de l’art dans sa fonction ici pleinement médiatrice à une époque où les arts deviennent des instruments symboliques du pouvoir prend ici pleinement sens. La relation à Titien de Charles Quint est à l’origine de l’œuvre, au point que semblent se confondre la vision de Titien et l’âme de l’Empereur.
Signification cosmique aussi les mouvements aériens de l'Opernballett du Bayerische Staatsoper, mimétiques du Big Bang, masse compacte qui explose en autant d’individus-planètes distribué(e)s autour d’un axe ou sur un cercle, mimétique aussi de la place de l’homme dans l’univers, infiniment petit ou infiniment grand : nous sommes dans des problématiques que Blaise Pascal développera un siècle après Charles Quint, mais qui travaillent le siècle et déterminent aussi les évolutions de l’église et du christianisme.

Ce face à face avec Dieu qui est l’exigence de Charles Quint agonisant, c’est aussi l’exigence de Luther, seul personnage qui semble solide (excellent Michael Kraus) face aux trois souverains ubuesques et qui semble poser de nouvelles relations entre les hommes, en niant les privilèges du pouvoir et affirmant l'égalité des hommes entre eux. La Réforme est aussi une vision nouvelle des relations sociales.

La question de ce spectacle, au moins de sa première partie, est peut-être ailleurs. Ce qui fait problème, c’est la dramaturgie générale qui est succession d’apparitions, oniriques, déformées, rêvées, fantasmées, de visions délirantes, comme autant de successions de tableaux, accompagnées d’une musique souvent lancinante et répétitive, et qui peuvent faire « décrocher » le spectateur. Les visions et les tableaux multiples, mutants, étonnants de la Fura dels Baus, ne peuvent se substituer à un drame qui n’est que drame intérieur et manque de cette énergie qui fait drame sur une scène.

C’est paradoxal, mais la deuxième partie, pourtant moins spectaculaire et encore plus intérieure est musicalement et théâtralement plus tendue, et capte plus l’attention. Charles Quint, étendu comme un gisant, dans une ambiance nocturne éclairée au flambeau qui n’est pas sans rappeler d’ailleurs l’impression qu’on a dans l’étouffante crypte royale de l’Escurial, le fameux Panteón de los Reyes, où se succèdent les apparitions délirantes qui assaillent l’Empereur. Cette impression est renforcée par une musique qui rappelle par sa couleur certains moments du Wozzeck de Berg dont l’influence est marquée dans toute l’œuvre (au moment où Krenek compose, il est en train de travailler à Lulu, mais en particulier dans cette deuxième partie. La structure dramaturgique du Wozzeck, faite d’une succession de scènes qui sont autant de stations de la « Passion » du personnage se rapproche évidemment de la structure de la pièce de Krenek. Quant à la couleur musicale, elle est marquée par le dodécaphonisme qui est la marque de l’ensemble de l’œuvre.
Le sens de cette deuxième partie est assez clair et se rapproche du sens donné à son tableau par Titien. Seul compte se rapprocher de Dieu, même si l’œuvre accomplie est discutée, inachevée, contradictoire même. Charles Quint devra mettre fin aux hostilités et finalement accorder la liberté d’exercice du culte réformé en 1555 (Paix d’Augsburg, « Une région une religion »).
Dans sa volonté d’imposer un monde unique (on dirait aujourd’hui global…) gouverné par la Croix (catholique) Charles Quint échoue parce que le monde est comme cette pomme pourrie de l’intérieur que sa mère Jeanne la Folle lui a offert (au début du drame) et qu’il n’a pas réussi à remettre unifié à Dieu (signification du tableau de Titien).
C’est le début des « nationalismes » encouragés par le protestantisme et la situation évidemment rappelle notre actualité : le chœur chante „Wir aber wollen Deutsche sein, nicht Weltbürger“ ((Mais nous voulons être allemands, pas citoyens du monde)) . Écrit en 1933 en Allemagne, cela a du poids, mais cela a du poids aussi en 2019 au moment de Pegida. L’œuvre politique de Charles a échoué.
Ses paroles finales „ Immer weiter ! Zu Gott ! Das ist der Augenblick ! Jesus !“((« Toujours plus loin ! Vers Dieu ! C’est le moment ! Jésus ! »)). Sont une illustration exacte du mouvement du tableau, décidément la clé du sens de l’œuvre.
Voilà un spectacle à la fois complexe et étrangement simple. La vision spectaculaire de Carlus Padrissa et de la Fura dels Baus est illustrative, au sens où elle illustre l’imaginaire de l’Empereur, très fidèle à l’histoire et au tableau de Titien, tout comme de drame de Krenek, conforme jusque dans les détails à ce qu’on sait des derniers moments de l’Empereur en 1558. Elle essaie en même temps d’éclairer et d’expliquer les échecs de Charles Quint dont les efforts vont à rebours de l’évolution d’un monde multiple, où l’unification est un leurre totalitaire. Cela devient en quelque sorte la lutte d’un seul contre un univers qui tourne sans lui. Le surpuissant Empereur est impuissant, et n’a plus qu’à se réfugier dans la miséricorde divine, comme n’importe quel homme ordinaire. Le Pouvoir n’empêche rien, ni le destin de s’accomplir, ni la mort de faire son œuvre, ni le monde de tourner. La « ronde des heures » finale, qui figure les différents moments de sa vie, mais aussi sa passion pour les horloges illustre cette aporie d’un monde qui tourne sans qu’on ait la possibilité d’avoir prise sur lui. Tout absolutisme est relatif.

Cette illustration au sens fort, empreinte du didactisme contenu dans l’œuvre elle-même, est aussi musicalement comme une épreuve, au sens où la répétition des motifs, l’absence d’intrigue, la succession de scènes construites sur le même modèle qui vont de l’espoir à la défaite, où tout victoire est victoire à la Pyrrhus fait de ce drame une œuvre difficile, qui nécessite une singulière préparation historique, dans une mise en scène foisonnante d’images multiples qui séduisent, dont le sens est clair, mais qui finissent par lasser un peu.
L’idée de faire de François 1er une sorte de double, et d’Eleonore la sœur de Charles une victime sacrificielle des tractations multiples entre François 1er et Charles Quint (elle est le prix à payer du traité de Cambrai) est historiquement plein de sens : elle ne cesse de souligner dans l’œuvre sa souffrance à la Cour de France : le roi François 1er lui préfère sa maîtresse, et elle doit quitter la cour à la mort du roi en 1547) mais elle revient auprès de son frère Charles pour ses derniers moments..
Carlus Padrissa, en étonnant, voire stupéfiant le spectateur (les premières scènes sont extraordinaires) sans toujours réussir à le captiver, donne néanmoins une lecture intéressante à l’œuvre en la replaçant dans divers contextes historiques sans jamais en altérer le sens, mais la question d’une musique difficile et pas toujours passionnante se pose.

Une musique qui se découvre à la fois lancinante et passionnante
À l’audition, il y a une vraie différence entre première et seconde partie. La première partie reste assez lancinante, sans beaucoup d’accroche pour le spectateur à qui tout peut sembler sans nerf, et surtout sans variété : la répétition du motif de l’échec qui scande l’ensemble ne marque pas non plus dans la musique des moments qui seraient dramatiquement plus sensibles. C’est l’impression d’une musique complexe mais sans relief qui prédomine, malgré l’exécution absolument impeccable de l’orchestre et l’extrême précision de la direction d’Erik Nielsen, qui reste maître jusqu’au détail de cette énorme machine. C’est sans doute le chef qui est la véritable découverte de la soirée. Directeur de l’orchestre de Bilbao, où il est très apprécié, et directeur musical du Theater Basel, dont le répertoire est traditionnellement très ouvert, Erik Nielsen dirige le grand répertoire de Verdi à Mozart et Strauss, avec tout de même une prédilection pour le XXe : les présences récentes de Debussy, Britten, Stravinsky, Dukas montrent un intérêt pour ce premier XXe dont Karl V. est issu. Sa lecture est analytique, claire, mais aussi attentive à garder une tension à une œuvre tendue par le sujet et moins par la dramaturgie.
Cette tension, on la perçoit d’autant mieux dans la deuxième partie où l’écho musical avec Berg et notamment Wozzeck est plus net. On peut penser que le fait de confier le rôle de Karl V. à un baryton n’y est pas étranger. D’autant que le chef de la création, Karl Rankl, a étudié auprès de Schönberg et Webern, et travaillé auprès de Klemperer au Kroll-Oper de Berlin, c’est à dire auprès de musiciens qui marquent définitivement les avancées de la musique de l’époque. Il y a quelque chose d’un oratorio dodécaphonique dans cette deuxième partie avec ses interventions des fantômes divers et du chœur, des voix parlées dans une ambiance particulièrement sombre qui a perdu un peu du fourmillement et des tableaux successifs de la première partie, quelque chose de l’unité réclamée par Charles Quint lui-même, cette unité du mouvement vers Dieu d’autant plus urgent qu’il est au bord du saut.
En effet il s’agit bien d’une forme hybride, protéiforme, et la mise en scène de Padrissa le souligne, avec des paroles chantées, des rôles parlés comme celui du confesseur Juan de Regla (le jeune acteur Janus Torp), des pantomimes, avec aussi un appel à d’autres genres comme le cinéma. Elle offre ainsi une sorte de totalité désordonnée, comme une œuvre baroque qui fourmillerait de détails et qui garderait néanmoins son unité, une œuvre chargée dans la tradition du baroque espagnol à l’opposé de L’Escurial hiératique de Philippe II.
Karl V. est la représentation d’une mort baroque dans le style du baroque espagnol.
Et c’est un spectacle à la fois pesant comme les cathédrales baroques d'Espagne, mais exécuté, dirigé et mis en scène avec un soin et une justesse d’esprit qu’il faut souligner. Le spectacle fascine, provoque l’admiration et l’étonnement, mais force le spectateur à garder sa distance : pas question de catharsis en voyant se bagarrer les souverains, ou intervenir les différentes reines, mère, sœur, épouse ; en ce sens nous sommes à l’opposé de la tragédie aristotélicienne, et bien plus proches de Brecht : peu d’émotion, peu d’empathie, mais de la réflexion.

La distribution en effet est elle aussi dans son ensemble et notamment dans ses premiers rôles de très grande qualité, dominée de manière écrasante par Bo Skovhus, qui embrasse avec cran un rôle impossible, d'une grande exigence, où il a dû apprendre un texte complexe, qu’il ne reprendra pas souvent sans doute, et d’être sans cesse en scène puisque la Passion de son personnage réclame une présence continue. Son costume ubuesque en fait aussi une figure distanciée, regardée de manière sarcastique. Les cercles de l’univers et du Zodiaque inscrits sur sa tunique, son maquillage blanc clownesque, sont un rappel d’Alfred Jarry. On pourrait même dire que les effets spéciaux d’Ubu Roi de Jean Christophe Averty en 1965 anticipaient les choix de Padrissa. Le timbre légèrement voilé de Skovhus convient à merveille à cet Empereur agonisant, sa capacité à épouser le texte, et à le sculpter font le reste, la voix porte solidement, même si aigus et graves peuvent quelquefois être moins dominés mais l’ensemble reste totalement exceptionnel. Grandiose incarnation, sans doute l’une des plus notables de sa carrière.

Le jeune acteur (encore en formation) Janus Torp n’a peut-être pas le poids voulu face au monstre sacré pour être le confesseur Juan de Regla, en même temps, son physique assez grêle, sa voix légère sont un contrepoint marquant, dans la mesure où chaque interrogation est une piqûre d’insecte douloureuse : le choix de Charles Quint d’un tel confesseur, une sorte d’anonyme est avisé : il s’agit de trouver un personnage qui ne fasse pas partie de la cour et qui pourra exercer une liberté que les autres n’ont peut-être pas dans le chemin de Charles vers Dieu. En ce sens ce prêtre malingre et (presque) inexistant va conquérir sa place, et l’acteur convient assez bien.
Eleonore (Gun-Brit Barkmin) est l’autre personnage qui va accompagner Charles jusqu’au bout. C’est historiquement juste et c’est théâtralement avec Juan de Regla le seul personnage qui soit présent tout au long du drame. La voix de soprano forte, coupante et glaciale de la chanteuse allemande convient pour s’imposer sur la scène, mais les suraigus sont désagréablement fixes et métalliques.
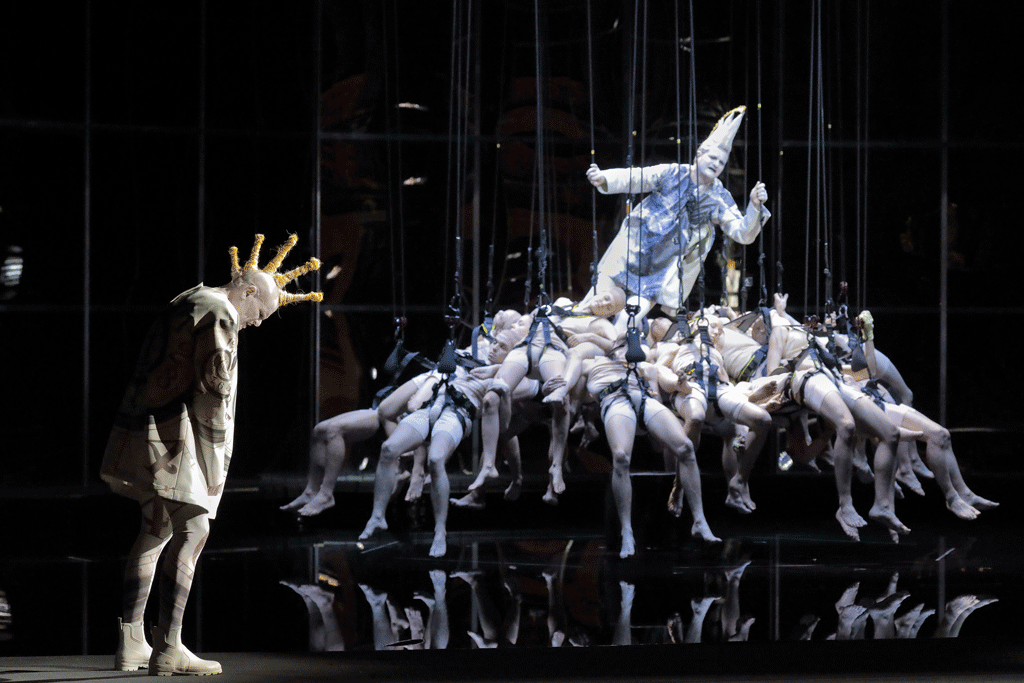
Face à eux, des personnages épisodiques et quelquefois marquants, un Franz I. (François 1er) de caractère en la personne de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, à la fois ridicule double de Charles Quint, en version ténor avec mais avec sa manière singulière et inimitable de dire le texte et d’imposer un personnage corrompu, assoiffé de pouvoir et de femmes, une sorte d’opposé point par point à la vision de Charles, et pourtant son double et son antithèse. Un Soliman écrasé par son turban géant (Peter Lobert, comme toujours impeccable, même si le rôle est très épisodique et surtout visuel…) en basse : ainsi les trois souverains sont caractérisés par les trois voix différentes de ténor, baryton et basse.

Des femmes à forte personnalité qui entourent Charles Quint on notera qu’Okka von der Damerau est Juana (Jeanne la folle) sa mère, avec son mezzo charnu et ses aigus légèrement tirés, qu’Anne Schwanewilms est Isabella, son épouse, dans un rôle qui lui convient parfaitement, belle ligne de chant, belle projection voix en grande forme, ce qui situe l’ensemble à un très grand niveau d’exécution.
Michael Kraus est Luther, au discours si affirmé, à la voix pleine d’autorité, intervenant sur scène et en salle, celui autour duquel les particularismes locaux s’affirment par choix religieux, la voix est magnifiquement projetée, jeune, et fait contraste avec celle de Charles et ce timbre charnu s’oppose bien au timbre un peu voilé de Bo Skovhus. Ici Luther est celui qui s’oppose à la vision globale et unifiée de Charles il est aussi celui qui va vers l’assemblée des peuples : non sans raison Padrissa le fait intervenir en salle, c’est le tribun face à celui qui représente le pouvoir isolé. Que de références actuelles…
Toute la troupe est parfaitement en place, Scott Mc Allister un très bon Francisco Borgia le jésuite, et Dean Power, Kevin Conners, chacun interprétant plusieurs rôles, sans oublier les esprits chantés par Mirjam Mesak, Anais Mejías, Natalia Kutateladze, Noa Beinart et évidemment la voix que Mechtild Grossmann, grande vedette de la série culte allemande « Tatort » ((Scène de crime)) prête au Pape Clément VII, à un Cardinal, à Alba à un capitaine protestant et à Maurice de Saxe.
Ajoutons la somptueuse prestation du chœur préparé par Stellario Fagone, impressionnant notamment dans la deuxième partie et celle de l’Opernballett virevoltant au-dessus de la scène ou dansant dans la pataugeoire et de tous les figurants.
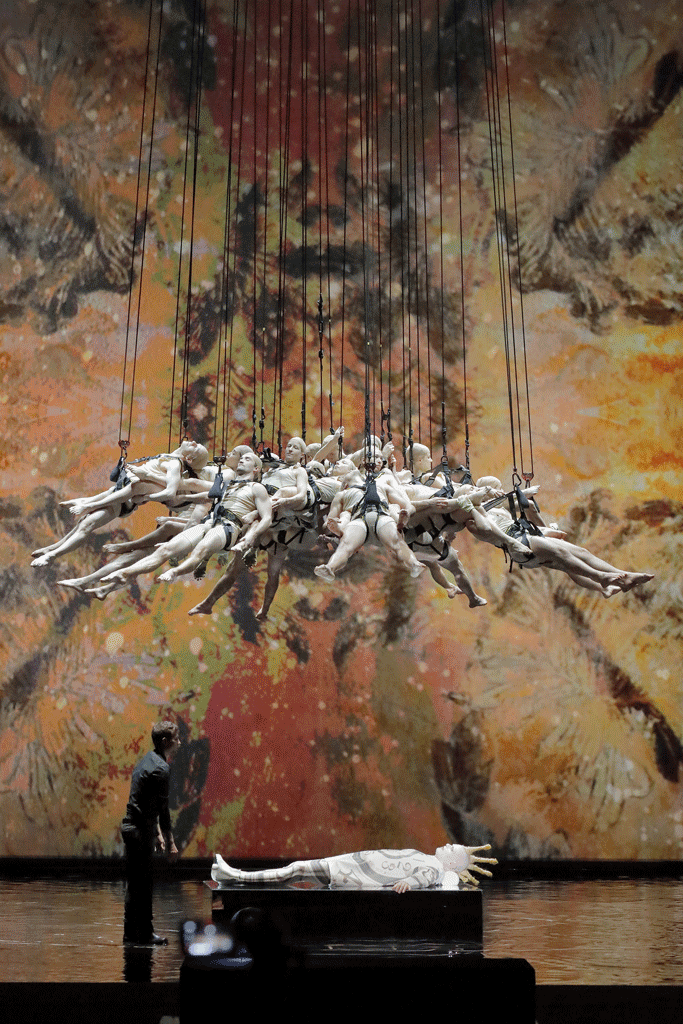
Un spectacle parfaitement préparé et exécuté, qui « en met plein les yeux », musicalement remarquable, à tous niveaux, signe de l’excellence jamais mise en défaut de la maison. Mais un spectacle à qui il manque cependant… un peu de théâtre. Il y manque le drame et sa virulence parce que les yeux ne peuvent tout embrasser si le drame n’est pas généré par le visuel. C’est plein d’idées, plein d’allusions au monde d’alors, à notre monde, mais on ne se sent pas toujours impliqué, c’est un festival débordant de signes et qui laisse tout de même froid. ce qui manque, et c'est paradoxal après ce qui vient d'être dit, c'est une mise en scène qui aille plus loin que l'image.
Très gros succès néanmoins. Il faut voir ce spectacle qui sera repris la saison prochaine, ne serait-ce que pour connaître cette œuvre étonnante.

Votre critique est parfaitement logique et articulée, mais pour une fois je n y adhère absolument pas.
Pour moi Karl V. est un drame de la solitude et de la relation d un homme mourant avec le rôle de la femme et de la religion dans sa vie.
Un drame intimiste, un huis clos dans le tout petit monastère de Yuste.
Nous avons eu droit a un spectacle très bling bling, parfaitement en ligne avec le théâtre du soleil, aucune émotion, aucune angoisse, du naratif et du décoratif et à la longue à mourir d' ennui, malgré une musique vraiment intéressante.
Quand au jeune acteur, soi disant nouvelle star du berliner ensemble il a réussi à chacune de ses interventions à couler le spectacle par l anonymat de son interprétation.
Pour la première fois à Munich je suis sorti du staatoper de marbre.