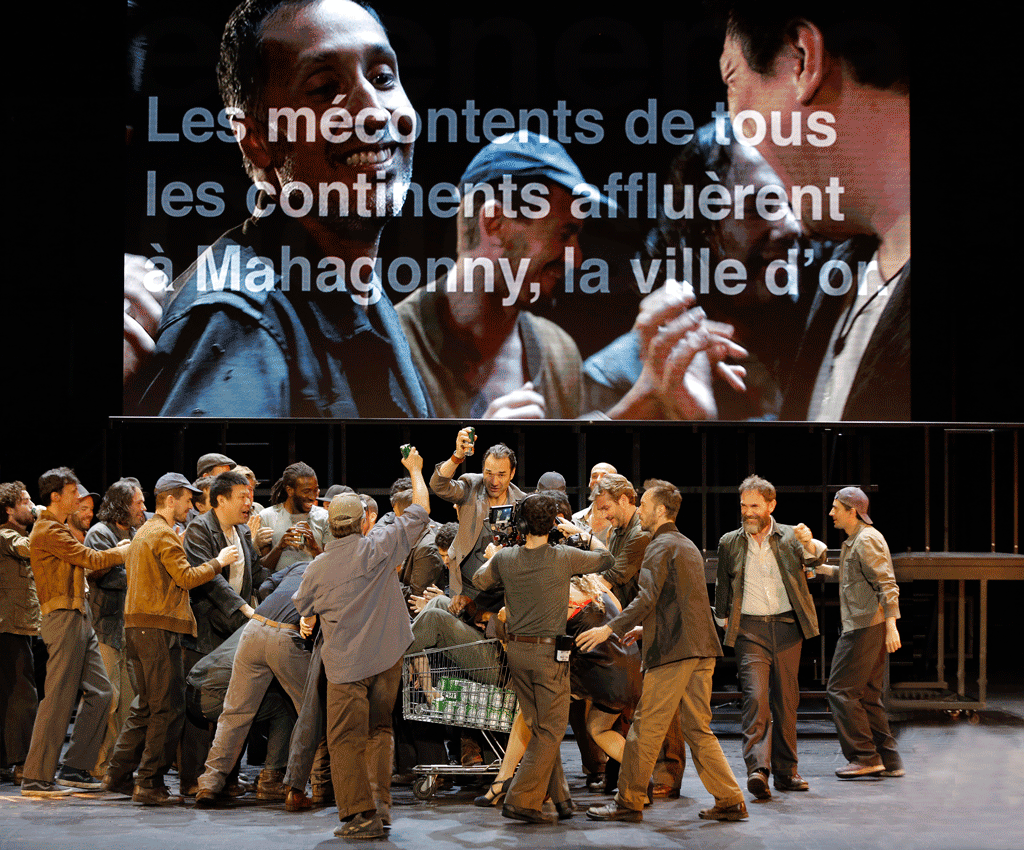
On l’a déjà écrit ((voir Blog du Wanderer : http://wanderer.blog.lemonde.fr/2016/07/14/opera-vlaanderen-2015–2016-anvers-aufstieg-und-fall-der-stadt-mahagonny-de-kurt-weill-et-bertolt-brecht-le-24-juin-2016-dir-mus-dmitri-jurowski-ms-en-scene-claixto-bieito/)), le théâtre musical brechtien résiste quelquefois à la scène, les échecs de L’opéra de quat’sous sont légion, et ceux de Mahagonny, dans sa forme opératique (on compte plus de réussites du « petit Mahagonny »), plus rares, restent assez nombreux.
Et pourtant, la parabole de l’histoire de cette cité née d’une utopie qui finit par s’écrabouiller dans la réalité du monde vu par Brecht est un mets de choix pour un metteur en scène, car la pièce est un chef d’œuvre idéologique, démonstratif à souhait et sa structure en stations suggère la Bible, dont la référence explicite (de Kurt Weill lui-même) est Sodome et Gomorrhe, le modèle évident, sauf que ce n’est pas une catastrophe extérieure qui va la détruire (en effet, l’ouragan qui la menace l’évite) mais ses habitants même par la destruction de toutes les valeurs de l’humanité.
On peut voir deux écueils pour un metteur en scène :
- d’une part la lourdeur de l’œuvre et sa longueur : il est difficile de tenir la distance, d’autant que la deuxième partie, encore plus démonstrative, finit par être singulièrement répétitive,
- d’autre part la démonstration même et la dramaturgie : l’œuvre s’offre comme parabolique, elle se prend au premier degré et elle se suffit à elle-même. Il est difficile dans ces conditions aux metteurs en scène d’aujourd’hui, d’aller derrière les yeux parce que l’équation est simple : devant les yeux = derrière les yeux. Le metteur en scène est pratiquement condamné à illustrer l’histoire.
Ainsi, cette histoire de ville surgie dans le désert, structurée en 20 scènes dont les titres sont donnés par Brecht lui-même, impose un canevas précis dont il est difficile de se libérer (sc1 : Fondation de la ville de Mahagonny, sc2 Rapidement, dans les semaines qui suivirent, surgit une ville, et les premiers « requins » vinrent s’y installer et ainsi de suite jusqu’aux sc. 19 : Exécution et mort de Jimmy Mahoney et 20 : Jeu de Dieu à Mahagonny.

Partant de ce que Weill lui-même disait, « ‘Mahagonny’ est un nom inventé pour une ville inventée dans une Amérique inventée », Ivo van Hove va faire en sorte de rendre cette histoire virtuelle en utilisant les trucages de cinéma et jouant à la manière d’un Castorf sur le visible et l’invisible, sur le plan général et sur les gros plan, et sur les images incrustées (donc le fond vert) comme celles déjà utilisées par Tcherniakov dans la Fiancée du Tsar (à la Scala et à la Staatsoper Berlin).
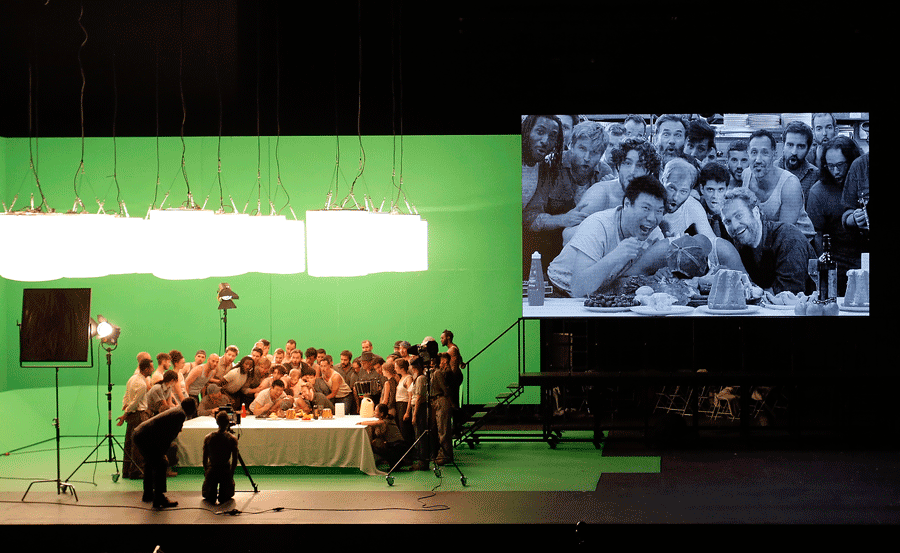
Évidemment, cela produit des scènes de tournage et un résultat différent à l'écran (scènes dans un restaurant, ou personnages à la besogne avec une prostituée) non sans humour, non sans effets immédiats et scéniques, mais sans aller beaucoup plus loin. Il en résulte un travail répétitif, sans grand intérêt ni grande dynamique, et au total assez creux et ennuyeux.
Car en dehors de ces effets visuels amusants, où l’on semble tourner cette histoire comme une sorte de série TV un peu moralisante, et donc où les personnages sont des acteurs du film qui jouent, il n’y a rien qui puisse accrocher l’œil.
Les personnages eux-mêmes d’arrivent pas à émerger de l’œuvre, et ont du mal à sortir de l’anonymat du groupe, sauf peut-être Karita Mattila à la sculpturale crinière blonde, parfaitement adaptée à Léocadia Begbick, qui en impose plus par sa présence physique que par ce qu’on lui fait faire.
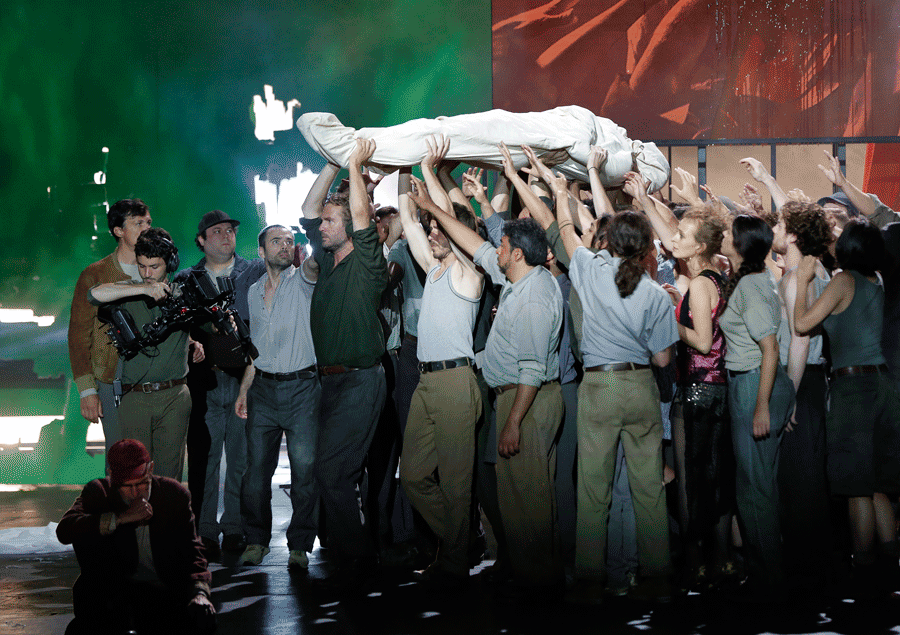
Dans cette œuvre écrite comme une passion avec ses stations, la mort de Jim Mahoney prend une place notable, une mort christique, un sacrifice, dont les funérailles rappellent les images qu’on garde de la mort de Gandhi, en un tableau assez réussi (un des moments les plus sensibles de la soirée).
Certes, Mahagonny est une ville mirage, où tout est illusion et pourquoi pas imaginer Mahagonny elle-même comme mirage vidéo, mais une fois tout cela exprimé et compris, il ne reste plus grand chose à voir ni à faire.
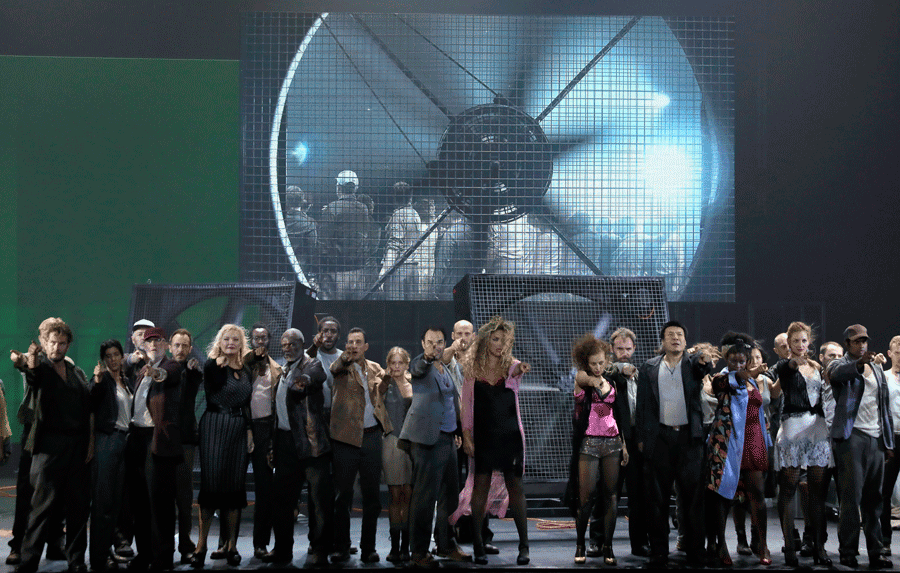
Nous sommes désormais habitués aux caméras en scène qui naviguent parmi les personnages qu’on voit en gros plan, parmi les groupes qui boivent et forniquent, parmi les visages angoissés par la tempête qui arrive (figurée par d’immenses ventilateurs), mais d’autres ont fait de même (voir Castorf à l’acte II de Götterdämmerung) avec autant sinon plus de sens. Quand un effet visuel devient système, il finit par tomber à plat. Ivo van Hove a donc raté son coup. Et c’est dommage. Même si Pierre Audi voulait sans doute rendre hommage à son ex-voisin amsterdamois, qui anime l’International Theater Amsterdam, on a beaucoup vu Ivo van Hove ces derniers temps en France et un festival comme Aix aurait pu aussi sortir des sentiers battus et rebattus.
Du côté musical, les choses sont là aussi plus contrastées, malgré l’attente suscitée par la présence en fosse du Philharmonia et d’Esa Pekka Salonen. Certes, l’orchestre est magnifiquement dirigé dans les moindres détails, mais en une approche plus symphonique, et peut-être plus auto-centrée qu’attendu. Il est vrai qu’il y a si peu à prendre du plateau que retourner à la partition est sans doute ce qu’il y a de mieux à faire. Il reste qu’on a un peu l’impression d’un travail autonome, qui s’intéresse aux effets plus qu’au drame. Certes Weill et Brecht ont écrit un opéra, et pas une pièce de chambre, avec les effets épiques voulus pour l’opéra, mais avec "Alabama Song", sans doute aussi le monde de la comédie musicale se profile-t-il. Il reste que tout cela laisse un peu froid, même si la performance est de qualité.
La sensation vient du chœur Pygmalion, dirigé par Richard Wilberforce, qui démontre sa ductilité, son sens de l’adaptation et du spectacle, avec une qualité constante et une force en scène qui suscite l’admiration : passer de Mozart à Weill, avec une qualité constante, un engagement de tous les instants et une telle science de l’interprétation fait de ce chœur sans doute l’un des meilleurs protagonistes de cette édition 2019 du festival.
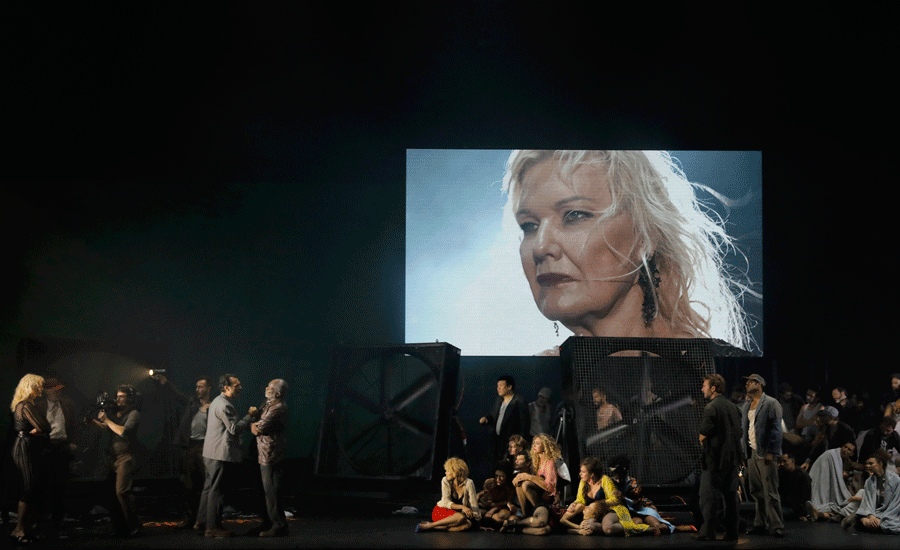
Le plateau réuni est assez contrasté : si Karita Mattila s’impose, c’est plus par le personnage et par ce qu’elle fait de sa voix que par des qualités vocales intrinsèques, désormais à l’automne de sa carrière. Elle domine le plateau par sa personnalité et son allure irremplaçable. Sir Willard White (Dreieinigkeitmoses : Moïse la Trinité) lui aussi est à l’aise et « fait le job » efficacement, comme souvent, tout comme Alan Oke , Fattu der Prokurist (fondé de pouvoir), qui composent le trio des fondateurs. Mais ils doivent s’en remettre à eux-mêmes, faute de direction d’acteurs.

C’est sur les deux « jeunes » héros que les choses sont moins frappantes, faute de réglage clair des mouvements, de structuration du plateau. Annette Dasch est une Jenny d’une grande beauté en scène, mais qui fait toujours les mêmes gestes, et qui joue excessivement avec sa belle chevelure. Du point de vue vocal, elle a toujours les mêmes qualités de phrasé et de diction, mais la voix n’a pas le relief suffisant pour dominer le flot sonore, et se laisse couvrir. Même problème pour Nikolai Schukoff, qu’on a connu acteur plus inspiré, et dont le chant un peu engorgé, la tendance à s’époumoner sans réussir à s’imposer (il a toujours des problèmes à l’aigu) finissent par emporter le personnage à qui il manque le relief voulu, scénique et vocal. Intéressant en revanche Sean Panikkar dans Jack O’Brien et Tobby Higgins, et comme toujours Thomas Oliemans dans le rôle de Joe.
Une occasion manquée : Mahagonny a tendu ses pièges, comme la trame le raconte, mais dans la réalité aussi d’une œuvre difficile à appréhender. C’était peut-être une fausse bonne idée que de le proposer en édition inaugurale d’un mandat. Oubliable.
