
Le Venusberg comme road-movie
Wagner voulait revenir à Tannhäuser ; quelques jours avant sa mort, on lui prêtait même l’intention de tout remettre sur le métier. Et c’est sans doute l’œuvre sur laquelle il a le plus de repentirs, avec notamment la révision drastique du premier acte pour Paris (1860). Traditionnellement, c’est la version de Dresde qui est représentée à Bayreuth, avec son premier acte plus rude et sa Vénus moins développée, et c’est la version de Dresde que le metteur en scène Tobias Kratzer préfère pour corroborer sa vision, fondée notamment sur le Wagner révolutionnaire ami de Bakounine qui intervint dans la révolution de 1848, ce qui lui coûta son poste.
La problématique de Tannhäuser est connue, et c’est notamment celle que développe Wagner autour de l’artiste qu'on connaît aussi aussi dans Die Meistersinger von Nürnberg, c'est à dire celui de l’artiste novateur, isolé, qui se dresse contre le conformisme et installe une nouvelle vision de l’art. On peut évidemment ensuite habiller l’histoire d’oripeaux religieux, moraux, ou romantiques mais le religieux dans Tannhäuser n’est là que pour souligner l’opposition de deux visions de la société, l’une conforme à des règles et organisée de manière fermée (la société de la Wartburg, mais ce pourrait être aussi la Nuremberg des Maîtres Chanteurs) et des êtres libres et singuliers, qui la menacent par leur art, ou leur attitude, leur liberté. Le pape n'est là que comme frein social, pour empêcher la société de libérer ses moeurs. Et bien sûr l'amour pur d'Elisabeth contre l'amour physique de Venus est une opposition théâtrale bien connue et un topos (voir Carmen et Micaela) . Kratzer choisit dans cette offre large de cibler une problématique permanente chez Wagner, qu'il a éprouvée dans sa chair, celle de l'artiste non reconnu et rejeté.
Wagner et la révolution
Kratzer va donc s’appuyer sur les textes de Wagner ou de Bakounine son ami sur la révolution, pour affirmer une vision de l’art qui ne peut aller sans révolution, l’artiste, révolutionnaire en soi, ne peut être que menace de l’ordre ambiant. Ainsi Bakounine écrit-il « La passion pour la destruction est aussi une passion créative »((La Réaction en Allemagne, 1842)). Ainsi, détruire l’ordre, c’est créer.
Le Wagner qui crée Tannhäuser en 1845, puis qui participera à la révolution de 1848 à Dresde, est un Wagner errant, qui a fui Riga, qui a couru le cachet à Paris, qui bouge tout le temps poussé par la nécessité. Il est cet artiste en marge.

Ainsi Kratzer part-il de cette instabilité de Wagner, un Wagner toujours en mouvement, pour commencer sa mise en scène dans une sorte de road-movie de marginaux, d’artistes qui posent leur opposition au monde en le bousculant et en se plaçant non seulement dans la marginalité mais dans l’illégalité. Comme naguère l’artiste Marina Abramović parcourut les routes d’Allemagne avec un Citröen Type H aménagé pour des performances, la Venus de Kratzer et sa petite équipe (le nain Oskar, l'enfant du Tambour de Günter Grass qui refuse de grandir, la drag queen Le Gâteau Chocolat et Tannhäuser en clown McDo ou clown raté) parcourt les routes (en emportant avec eux tout de même une reproduction de La Naissance de Vénus de Botticelli) au volant d'un Citroën surmonté d'un lapin (cf Joseph Beuys…et Schlingensief) , volant des Burger King, écrasant un policier par-ci, ou croisant une usine de « Biogas » ((Le méthane)) qui ferme (allusion à la précédente mise en scène de Sebastian Baumgarten). Le Venusberg de Kratzer, c’est cette itinérance qui conduit la petite troupe devant une maison sortie d’un film de Walt Disney, avec ses nains, où la drag queen en Blanche Neige arbore les couleurs allemandes (merci Castorf…) pendant que Vénus et Tannhäuser règlent leurs comptes. Univers déglingué d’un art en marge, avec les représentants particulièrement emblématiques de la marginalité vue de Bayreuth assez gentils au total, même si meurtriers sur les bords, mais il faut bien faire un peu peur…
Réglons immédiatement son compte à Le Gâteau Chocolat, drag queen anglo-nigérienne, performant dans le parc à l’entracte (sous les frondaisons du digne et honoré Festspielhaus) avec le nain Oskar, qui sont la menace vivante que les spectateurs vont visiter à l’entracte, comme pour s’encanailler et vivre l’art des marges opposé à l’art officiel (un peu comme les héros du Tannhäuser de Baumgarten, descendaient chez Venus dès qu’ils le pouvaient, Elisabeth comprise) et c’est encore plus le cas en ce jour d’inauguration truffé de cars de police, en présence de la Chancelière Merkel, mais aussi de l’ex-chancelier Schröder et de tout ce que l’Allemagne compte d’officiels, de VIP, de vedettes.
Car Kratzer a voulu Le Gateau Chocolat, la drag queen d'origine nigérienne , pour évoquer à sa manière un autre public de Bayreuth qui accueillit de manière plutôt contrastée Grace Bumbry, Vénus noire du Festival en 1961 et 1962 sous la baguette de Sawallisch et dans la mise en scène de Wieland Wagner.
De Bayreuth à Kratzer, de Kratzer à Bayreuth
C’est en effet un caractère habituel du théâtre de Kratzer que de travailler par allusions sur l’histoire des représentations et des mises en scène : on se souvient de ses Meistersinger von Nürnberg à Karlsruhe, qui posait la question de la réception de l’œuvre et de l’histoire de ses mises en scène.
Ici la question est élargie à celle de l’art officiel et fossilisé face à l’art « libre » représenté par le Venusberg dont le Motto est une phrase de Richard Wagner extraite de La Révolution « Libre de vouloir, libre d’agir, libre de jouir » (les hippies diront « Jouissons sans entraves »…). Robert Carsen dans sa mise en scène parisienne avait de loin esquissé le propos. Ici, il est développé dans le cadre de Bayreuth, la Mecque wagnérienne, se substituant à la Wartburg avec ses pèlerins montant sur la colline en costume de soirée. Les pèlerins de l’art se substituent à ceux de la religion, montant sur la colline sacrée, avec en arrière fond un Festspielhaus où flotte le drapeau du Festival (décors et costumes de Rainer Sellmaier, le compère habituel de Kratzer). Après tout, c’est Lavignac qui l’affirmait, dont on se souvient de la première page ((« on va à Bayreuth comme on veut…mais le vrai pèlerin devrait y aller à genoux » in Le voyage artistique à Bayreuth, 1897)). Pendant les deux premiers actes, Tobias Kratzer va jouer Bayreuth, réel ou fantasmé, avec une distance souvent ironique et souriante qui met en joie les spectateurs. Et au troisième, c’est la fin, la désolation, une sorte de domaine de Graal en déshérence (un monde à la David Bösch ou à la Sclingensief), qui rappelle le troisième acte du Parsifal de Chriostoph Schlingensief, non par l’esthétique mais par le propos (le cimetière de l’art, Friedhof der Künste) arbres morts, et à la place du Festspielhaus, une immense pub fêtant Le Gateau Chocolat arborant une montre de prix : les marginaux du premier acte se sont insérés dans le consumérisme ambiant, plus besoin dans ce cas de Citroën H, abandonné dans une manière de cimetière de voitures.
Voilà quelques éléments de l’histoire que veut raconter Tobias Kratzer. Il met alors en scène deux histoires, celle qui se déroule en scène et celle qui est soit rêvée (premier et troisième acte) soit réelle (deuxième acte).
Acte I : Bayreuth comme Wartburg
Le premier acte est bi-face : d’un côté la marginalité du Venusberg, avec cette camionnette de performers qui circule dans les montagnes boisées, de la Thuringe à la Suisse franconienne et aux Fichtelgebirge si caractéristiques de paysages romantiques, qui entourent Bayreuth : univers déglingué, avec Venus au volant et Tannhäuser en clown à ses côtés, on s’arrête devant la cabane de Blanche Neige avec ses nains, comme sortie de Walt Disney, après avoir volé des repas au Burger King qu’on va déguster devant la cabane : univers américanisé dont Kratzer fait clin d’œil, ce Venusberg marginal fait flèche de tout bois, mange des Burger King, mélange les thématiques, et Tannhäuser dans son désir implicite d’ordre n’en peut visiblement plus de cette errance – le vigile écrasé est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Comme Wagner en son temps passé de Paris à Riga puis à Dresde et Lucerne ou Zürich, il aspire au repos et à « Wahnfried » : « Hier wo mein Wähnen Frieden fand »((Ici où mon agitation a trouvé la paix)). Et Kratzer ne fait pas que suivre le livret : il nous dit aussi que la marginalité a une fin, que le désir d'ordre ou de paix ("luxe calme et volupté") est aussi inhérent à ce type de parcours. Il nous indique clairement que Venus a, dès le début, définitivement perdu.
Le clown marginal se retrouve donc projeté dans le parc de Bayreuth, près du petit lac que les spectateurs connaissent bien, et il est retrouvé par ses anciens compagnons, tee shirt noir et carte d’accès en collier, comme tous les « Mitwirkende » ((collaborateurs)) du Festival. La nouvelle Wartburg, c’est Bayreuth, le lieu de pèlerinage wagnérien par excellence, dont l’accès est barré par la police (une barrière elle aussi bien connue des spectateurs barre la route), dans le parc, deux statues en plastique de Wagner de Ottmar Hörl qui firent florès il y a quelques années, et ainsi Wagner de marginal est devenu officiel, honoré, sacralisé : Kratzer pose cruellement cette évolution, qui fait du révolutionnaire Wagner une icône de l’art désormais fossile.
Mais Venus a poursuivi Tannhäuser : alors que tous gagnent le Festspielhaus, le camion Citroën fait irruption à jardin, renversant la barrière posée par la police. Rideau.
Ainsi pose-t-il l’action du deuxième acte.
Ainsi aussi, pendant l’entracte entre acte I et II, entend-on du fond du parc des chants, des délires bruyants autour d’extraits de Tannhäuser, et tous les spectateurs qui se promènent (les entractes durent une heure à Bayreuth), mais aussi les promeneurs non festivaliers, sont attirés par le bruit et assistent au bord du petit lac à la performance délirante qui « menace » l’art officiel, et qui mobilise l’attention. Tapi en bas de la colline, le petit groupe d’artistes marginaux (barque en plastique gonflable, installation sonore d’un autre âge) attend la reprise en divertissant le public en frac. et le tout venant : Bayreuth dans la rue. Réalité/fiction, nous sommes dedans et dehors, nous construisons nous aussi la représentation, nous sommes nous aussi la représentation. Mais dans un petit cercle d'initiés qui ne sont menacés que pour se faire peur à peu de frais.
Acte II : La représentation fossile
Commence l’acte II…
Nous nous trouvons dans le Festspielhaus, le décor de Tannhäuser est posé, en dessous, le théâtre avec la salle de la Wartburg, très réaliste, où va se dérouler la représentation telle qu’on la rêve avant le Neues Bayreuth, comme les vieilles photos de productions surannées, dans une esthétique d’avant Wieland, et au-dessus, à l’écran la réalité, les coulisses, les techniciens, Katharina Wagner, soit tout ce qui fabrique la représentation, montrant les chanteurs devant et derrière la scène, dans ce Bayreuth où la représentation est aussi traditionnelle que possible, montrant une Wartburg plus vraie que nature, insérée dans un cadre qui ravit les nostalgiques d’un Wagner « fidèle au livret » (sic), mais aussi nous disant ce qu'est la société étouffante et aristocratique de la Wartburg que le Regietheater nous montre dans ce théâtre depuis la fameuse production de Götz Friedrich (de 1972 à 1978.)
Kratzer nous dit cet étouffement, il nous dit que Wagner le musicien de l’avenir a été rattrapé par l’officiel, le conforme et qu’il est fossilisé par Bayreuth. Il nous montre aussi la représentation, en direct sur l’écran vue des coulisses, et en direct sur scène, les entrées, les sorties, les solistes et le chœur qui attendent d’entrer, dans un jeu réalité/fiction où sont montrés les sentiments des chanteurs (Wolfram/Markus Eiche désespéré de l’amour d’Elisabeth pour Tannhäuser, mais sans doute aussi de la chanteuse pour le ténor…), la tension des techniciens, la précision du travail. Kratzer montre la mécanique de la représentation en direct, la mise en scène insérée dans un cadre lumineux, comme le cadre d'une carte postale, aussi passéiste que possible dans son bel ordonnancement géométrique, avec le chœur disposé sur les gradins, en tribune, sur les bancs autour du podium où doit se dérouler le concours le « Sängerkrieg ».
Mais nous savons depuis le final du premier acte que Venus veille dans l’ombre, elle est arrivée avec son camion, tapie au fond du parc, et elle a déjà capté l’attention du public ; elle sait ce qui se déroule dans le théâtre. Suspense…

Elle va donc, telle l’expédition punitive de Telramund et de ses compagnons interrompant le bel ordonnancement des noces de cour de Lohengrin, monter avec ses deux compères Oskar et le Gateau Chocolat vers le Festspielhaus, pendant que se déroule le chœur de la cour de la Wartburg, et l’on assiste à cette image désopilante de la représentation compassée du Wagner officiel, pendant que les artistes réussissent à pénétrer le théâtre par une échelle retrouvée au pied de la balustrade de façade, y grimpent, et accrochent au balcon un calicot noir où est inscrit le fameux motto de Wagner « Frei im wollen, frei im thun, frei im geniessen » ((« Libre de vouloir, libre d’agir, libre de jouir »)), se mettant ainsi sous la « protection » du Wagner révolutionnaire pour attaquer le Wagner conforme qu’on joue à l’intérieur. Un moment de pur bonheur où la salle croule sous les rires, notamment quand Oskar et La Gâteau Chocolat parcourent les couloirs du Festspielhaus et la galerie de portraits des chefs dans le long couloir qui lie la "cantine" et les coulisses, la drag queen s’arrêtant plus particulièrement sur celui de Christian Thielemann, et Oskar l'enfant-qui-ne-veut-pas-grandir effrayé devant celui de James Levine, et enfin quand Venus assomme une choriste pour lui emprunter son costume et pénètre sur scène en s’installant au premier rang du chœur, toujours en décalage, toujours renfrognée, qui n’arrive pas à obéir à la mise en scène, et forcée d'être malgré elle dans l'ensemble des quatre jeunes pages.
Mais fini de rire…Kratzer sait alléger une ambiance, il sait aussi revenir au drame et à la tension : il en joue parfaitement, comme se sera le cas au troisième acte. Kratzer joue évidemment sur plusieurs niveau : celui du théâtre où cette Venus (magnifiquement jouée par (Elena Zhidkova) et ses compères n'ont rien d'effrayant, ce sont des méchants de contes pour enfants plus qu'une menace instituionnelle . Personne n'est dupe : une manière de nous dire aussi quelque chose de nos vanités.
On comprend alors ce qui va se passer : en un triangle chœur (Venus), podium (concours) et Tannhäuser en coulisse concentré avant d’intervenir, on sent monter en lui la volonté de rupture par rapport aux vers de Wolfram, et ainsi se joue la double postulation du chanteur et du rôle, comme si la présence de Venus arrivée dans le chœur déterminait aussi les pensées de Tannhäuser.

Alors quand Tannhäuser intervient, créant le désordre que l’on sait, Venus et ses acolytes envahissent la scène, affolant le chœur, le désordre et l’horreur provoquée par Tannhäuser évoquant le Venusberg, sont matérialisés sur scène par la présence de Venus d’Oskar et de Le Gateau Chocolat. Alors dans les coulisses on s’agite, le régisseur appelle Katharina Wagner qui à l’écran appelle la police (rires, évidemment). Et on voit alors la scène agitée du théâtre pendant que la police monte sur la colline, arrive sur l’esplanade et s’arrête, interdite devant l’échelle métallique et surtout le calicot "Frei im wollen, frei im thun, frei im geniessen" avec des regards interrogateurs et interdits dont la perplexité fait crouler la salle. Mais ils pénètrent dans le théâtre et interviennent dans la cérémonie déjà bien ruinée, où Venus essaie de reconquérir Tannhäuser, en l’entraînant hors du cadre lumineux qui délimite la scène, de retour dans son monde, Tannhäuser reconquis s’en va dans une étreinte érotique violente sous les yeux de l’assistance et d’Elisabeth. Mais bientôt Tannhäuser rentre dans le cadre, et après un long échange de regards avec Elisabeth, s’écrit « Nach Rom » et est emporté menotté par les policiers.

Restent en scène Venus, assise, vaincue, Oskar, assis et songeur, Le Gâteau Chocolat, qui vient de recouvrir la harpe du drapeau LGBT. C’en est fini. Rideau.
Acte III : La désolation
Le troisième acte s’ouvre sur le décor du parc du premier acte, mais désolé, devenu cimetière de voiture où gît entre autres la camionnette Citroën , désarticulée, occupée par Oskar devenu SDF qui se retire derrière le camion pour un gros besoin (il déchire le papier nécessaire sous les gloussements du public). Tout est fini en effet, et dans ce paysage d’après qui pourrait être signé David Bösch, errent Elisabeth et Wolfram. Les pèlerins reviennent, pas si triomphants, devenus un groupe de pauvres errants comme ayant fait un nouveau vœu de pauvreté. Ils reviennent sur des lieux qui furent lieux de gloire, et dont ils débarrassent les débris (ou emportent les rares traces).
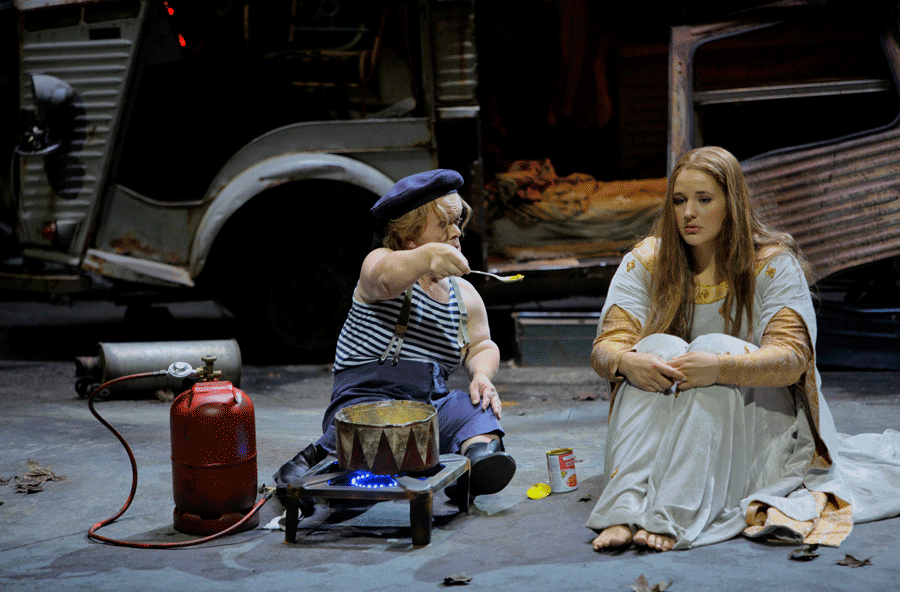
Plus d’espoir, plus de Bayreuth, rien que des déchets de ce qui fut. L’air d’Elisabeth (Er kehret nicht zurück!) où Elisabeth abandonne ses atours désormais inutiles pour se retrouver en combinaison, est suivi d’une étrange pantomime sur la musique si douce et nostalgique de Wagner, Wolfram revêtit les habits de clown de Tannhäuser au premier acte et la perruque rousse et se voit attiré dans le camion par Elisabeth, il retire la perruque, Elisabeth la lui remet et ils copulent dans le camion en ruine chacun dans des rêves et ses fantasmes pendant que le nain Oskar s’en va dans la nuit…
C’est après ce (presque) simulacre d’amour (La chair est d’une infinie tristesse) que Wolfram entame « O du, mein holder Abendstern » qui prend évidemment un sens encore plus déchirant, avec le goût amer de ce qui n’a pu réussir à exister ni fleurir. Arrive portant deux sacs plastique tel un SDF Tannhäuser, pendant que tourne le plateau, laissant voir une affiche gigantesque de Le Gâteau Chocolat faisant la pub pour une montre de prix, à la place du Bayreuth triomphant du premier acte. Le marginal s’est accommodé de la société et de la consommation, l’art s’est assagi, devenu l’art putassier. Venus a disparu, Oskar est SDF et Le Gâteau Chocolat profite du système, restent Tannhäuser et Wolfram perdus et Tannhäuser dans son désir de repartir avec Venus, mais quelle Venus ? Seule avec un Venusberg qui perdu tout sens.

L’évocation d’Elisabeth fait naître une scène lacérante : on découvre le cadavre d’Elisabeth dans sa combinaison désormais ensanglantée dans le camion, là-même où elle s’est unie à Wolfram. Le sang abondant suggère le suicide, mais aussi le sang de la défloration, un sang séché, qui a perdu toute force vitale comme si s’unir à Wolfram avait été en soi un suicide. Wolfram et Tannhäuser soulèvent son corps et Tannhäuser la soutient, comme une pietà d’un autre genre, pendant que sur l’écran défile ce qui aurait pu être, ou ce qui a été jadis, dont il ne reste que des images, un Citroën H avec un Tannhäuser conducteur aux yeux de clown et une Elisabeth blottie sur son épaule. Scène finale d’un film « romantique » avec soleil couchant et grands espaces, à l’américaine. Le bonheur, c’est dans les films. Rideau.
Tobias Kratzer raconte l’histoire de Tannhäuser en interpellant tout ce qui peut l’alimenter, et sa connaissance du théâtre lui permet des allusions qui sont autant de signes de rattachement à une école théâtrale, à un monde intellectuel précis : le lapin de plastique sur le Citroën H, c’est sans doute un rappel de Josef Beuys et de Schlingensief et son Parsifal-performance, les flammes dans lesquelles Tannhäuser à la toute fin déchire la partition et la brûle, c’est pour le spectateur de Bayreuth la fin sans fin de Götterdämmerung de Frank Castorf avec ce baril qui brûle presque inutilement les partitions que jette Tannhäuser, le Citröen H en ruine c’est aussi un peu la roulotte de Brünnhilde, avec son siège camping devant (ici également) : Wagner en road-movie, en road-théâtre.
Mais il reste fidèle à l’œuvre, en sachant exprimer le drame humain, la question Wagner, le plongeon dans l’histoire de l’œuvre et de son contexte, le regard sur l’art et la révolution, qui ne peut naître que d’une société en rupture, et la mort et la désolation d’un art détruit, qu’il soit marginal ou officiel, ou merchandisé (on pense au tableau des sponsors du festival devant lequel le team de Bayreuth a fait sa conférence de presse, comme après les matchs de foot). L’histoire de Wagner qui commence en road-movie et évolue en institution et finit en désolation, une histoire dont d'ailleurs fait partie Kratzer lui-même, crachant un peu dans la soupe, tout à fait consciemment et cherchant à être aussi prémonitoire, voire discrètement menaçant : ainsi peut finir l’art. Il est très proche de Schlingensief et de sa vision, mais en moins radical, en moins féroce, comme s'il nous invitait à ne pas trop y croire : il y a là quelque chose d'enfantin, qui d'une certaine façon nous protègerait : d'où l'importance d'Oskar l'enfant, observateur de ces mutations.
C’est une histoire qui commence dans le sarcasme, le sourire, et qui finit dans la désolation. Il n’y a plus rien puisqu'on ne peut s'opposer à rien : il n’y a plus de danger, le danger est en soi.
Parle la déesse révolutionnaire : « Je suis l’éternel rajeunisseur, l’éternel créateur de vie. Là où je ne suis pas il y a la mort »
Richard Wagner, La révolution (1849)
Une direction musicale absente
Pour parfaire l’ensemble il eût fallu une direction musicale complice, ironique, qui entrât dans la mise en scène. Las, il n’en est rien : la direction de Valery Gergiev est concentrée sur elle-même (il a dirigé Tannhäuser au Marinski début juillet) et on sent bien que la communication ne s’est pas faite avec Tobias Kratzer. Ce dernier l’a d’ailleurs clairement laissé entendre lors de la conférence de presse. Le chef, habitué des équilibres instables, dirigeait le 22 Die Frau ohne Schatten à Verbier et le 23 la générale de Tannhäuser à Bayreuth, funambule entre la Suisse, Bayreuth, Vladivostok et le Japon puis Boccanegra à Salzbourg. Le temps juste nécessaire pour ne préserver que le strict minimum des répétitions, et notamment s’habituer au son et à la fosse de Bayreuth.
Et le résultat s’en ressent : le Tannhäuser qui vient de la fosse est contrasté, tantôt magnifique (ouverture et préludes du II et surtout du III, particulièrement soigné) tantôt moins tenu,(final du premier acte assez relâché et désordre, tout comme celui du deuxième acte, qui nuit d'ailleurs au chœur ) moins tendu, plus conforme et surtout sans grand lien avec le plateau. Il y a des moments d’une rare mollesse, au tempo ralenti qui ne correspond pas tout à fait au rythme de la mise en scène, d’autres sont un peu plus tendus, mais jamais vraiment en phase et à dire vrai, pas vraiment passionnants.
De plus, les équilibres sont mal calculés, les cordes très présentes, mais bois et cuivres lointains et moins concernés, et la conduite du chœur est peu ferme ce qui nuit gravement notamment au chœur final, alors qu’on connaît la puissance du chœur de Bayreuth dans cette œuvre. L’impression est que le plateau n’est dirigé que par à‑coups. Gageons que les choses s’amélioreront au fur et à mesure des représentations à Bayreuth qui après la deuxième du 28 juillet, reprennent le 13 août (tournée au Japon et à Vladivostok du 31 juillet au 4 août, puis répétitions à Salzbourg) pour naviguer ensuite entre les représentations de Boccanegra à Salzbourg à partir du 15 août…
On ne s’interrogera pas sur le sens du Werkstatt Bayreuth dans ce cas précis, mais l’administration du Festival savait ce qu’il en serait et que le travail exigé à Bayreuth ne serait pas mené. Le résultat, de sérieuses huées le jour de la première. Et une prestation loin d’être convaincante, plutôt approximative dans ce lieu, et pour un chef qui reste l’un des majeurs de notre époque, ce qui ne le grandit pas.
Comme on l’a dit, le chœur de Bayreuth est dans Tannhäuser incomparable, il reste d’une grande qualité, mais ce qu’on entendra dans les deux représentations suivantes (Lohengrin et Die Meistersinger von Nürnberg) n’a rien à voir en matière de rendu. Des moments manquant de nerf, des flottements dans la relation plateau-fosse, un son moins puissant.
Une distribution au rendez-vous, avec une Elisabeth d'exception et un Tannhäuser toujours au sommet
C’est du côté des chanteurs que les choses sont plus convaincantes : la distribution rassemble des habitués de Bayreuth, quant à Stephen Gould, le Tannhäuser du jour, il le chantait déjà en 2004 avec Thielemann en fosse et dans la production Arlaud. Stephen Gould a tendance au premier acte à abuser des forte, et ne semble pas bien rentrer dans le spectacle, mais dès le deuxième acte, les choses s’arrangent pour nous offrir un troisième acte anthologique, bouleversant, avec une expressivité, un sens des mots, un phrasé exceptionnels. Grandiose, voire unique. Gould reste l'un des très grands chanteurs wagnériens de ce temps.
Markus Eiche est un Wolfram de référence, à des années lumières d’un Gerhaher, mais qui chante moins « Lied » et plus « théâtre ». On connaît sa musicalité, son élégance dans la manière de phraser et de colorer les mots, on connaît aussi son beau timbre chaud. Il offre un Wolfram vivant, très engagé dans le jeu, très humain, très présent et moins éthéré que d’autres. Sa composition au troisième acte est superbe, émouvante, bouleversante même face aussi bien à l’Elisabeth de Lise Davidsens que du Tannhäuser de Stephen Gould.
Déception en revanche pour le Landgrave de Stephen Milling, la voix ne sort pas, les aigus pas convaincants à la limite de la justesse et surtout un chant indifférent, inexpressif, peu concerné.
Venus devait être Ekaterina Gubanova, mais un accident l’éloigne de la scène au moins jusqu’au 13 août. Elle est remplacée par Elena Zhidkova, dont le sens de la scène et l’engagement donnent à cette Venus l’allure exacte demandée. Elle est très présente, très vive, à l’allure à la fois décidée et sans vraie vulgarité. Elle n’est pas une Venus vaporeuse de Venusberg romantique. La mise en scène l’installe plus comme une meneuse d’hommes que comme une séductrice. Elle séduit par son énergie, par son esprit de décision, par sa manière de commander : elle obéit mot pour mot au Motto qu’elle arbore et affirme une liberté saine et au total plutôt sympathique. La voix est affirmée, claire, expressive, puissante, même si certains aigus sont un tantinet métalliques : elle est convaincante et elle triomphe, c’est mérité.
Les rôles de complément sont très bien tenus, d’abord par Katharina Konradi dans le rôle du pâtre, avec une voix fraîche, poétique, très bien menée et les poètes Wakther von der Vogelweide (Daniel Behle toujours précis), Biterolf (Kay Stiefermann, toujours correct), Heinrich der Schreiber (Jorge Rodriguez-Norton) et le Reinmar von Zweter de Wilhelm Schwinghammer.
Mais last but not least, Lise Davidsen se révèle immédiatement une Elisabeth de très grande lignée. On l’avait remarquée dans la Primadonna de l’Ariane à Naxos aixoise (2018) , elle irradie ici avec une voix puissante, et un timbre frais et clair qui rend parfaitement le côté juvénile du personnage, la ligne est parfaite, l’homogénéité du grave à l’aigu sans faille aucune et impressionnante : elle a tout d’une grande, d’une future immense même. C’est une révélation (attendue il est vrai), et cette voix, dans cette salle, rappelle déjà des légendes du lieu. À elle seule elle vaut le déplacement, il y a longtemps qu’on n’a pas eu d’Elisabeth de ce niveau : très différente d’Harteros avec Castellucci, qui travaillait la couleur et la diction, plus que la puissance, Lise Davidsen impose d’emblée le personnage (« Dich teure Halle » phénoménal) avec une puissance qui irradie le plateau. Son troisième acte est bouleversant, grâce aussi à la mise en scène qui en fait cette jeune fille déçue puis désespérée, avec une pointe de naïveté. C’est magistral. Il ne faudra pas la manquer dans ses prochaines apparitions, elle passe des petits rôles aux grands rôles du répertoire : elle fera à Londres en mars 2020 une Leonore de Fidelio avec Pappano et Tobias Kratzer…en attendant sa Sieglinde à Bayreuth l'an prochain.
Au total, malgré les hésitations du chef et une prestation décidément en dessous de sa réputation, il s’agit vraiment d’un spectacle de très haut niveau, très fidèle au livret, qui démontre une réflexion d’ensemble approfondie et particulièrement cultivée. Dans la ligne de ses Meistersinger von Nürnberg et aussi de son stupéfiant Götterdämmerung à Karlsruhe, Tobias Kratzer démontre qu’on peut défendre l’opéra, avec humour, distance, mais aussi fidélité, en serrant d’une manière rigoureuse au texte, à l’histoire des représentations et des contextes, dans une fidélité à Wagner qui va jusqu’à aimer ses contradictions. Voilà un spectacle qui rend heureux de venir à Bayreuth.


Bingo ! Que pouvait écrire d'autre le thuriféraire du Sieur Castorf ?!! Amen ! Amen ! Amen ! Notre Guy Cherqui national adore les histoires sur de la musique de Wagner… Ce qui, soit dit en passant, n'a aucun rapport avec les oeuvres de Richard Wagner… Ce qu'il y a d'ailleurs d’extraordinaire chez M. Cherqui, c'est qu'il semblerait que la musique n'a rien à dire, ne dise rien, ne soit là que comme "accompagnement" d'une action dramatique reformulée par le metteur en scène… Bref, dans cette perspective, Richard Wagner n'est guère plus qu'une compositeur de musique de film !
Marrant les commentaires d’exégèse. J’attends de voir le DVD de mes copains new yorkais mais la description de Wanderer fait irrésistiblement penser à Ariane à Naxos ou même à Totestadt. Est on si loin de la Comedia del Arte ou même Shakespeare ? Passionnant.
Une philosophie de pacotille, c'est ce qui émane de l'article de Cherqui qui ne va as cracher dans la soupe.…. Quant à Kratzer, c'est du n'importe quoi. Il est à la mode d'aujourd'hui dans ce Tannhaüser abominable. On peut dire que Bayreuth devient un Disneyland de vulgarité.
Chère Madame Je vous renvoie au lien ci-dessous :
Texte sur Boulez-Chéreau
Vous y verrez une photo des protestations contre le Ring Boulez-Chéreau en 1976 où un panneau s’interrogeait déjà sur “Disneyland sur la colline verte”. Donc Bayreuth ne devient pas un Disneyland, le Festival l’est depuis 43 ans… A moins que les protestataires ne se soient, déjà à l’époque, trompés…il vaudrait mieux changer d’argumentaire. Très cordialement Guy Cherqui
Ah oui ! J'avais oublié que M. Chéreau, paix à son âme ! était désormais intouchable… Les critiques construites et argumentées, notamment du Pr Uwe Faerber, à l'époque, étaient et demeurent tout à fait fondées, dans la mesure où elles prenaient racine dans une connaissance parfaite de la partition. – Ce qui n'était précisément pas le cas de M. Chéreau qui, de son propre aveu ne savait pas même lire une partition… Trop fort pour un metteur en scène d'opéra ! Bayreuth a connu après Chéreau des mises en scène respectueuses des oeuvres et de leur auteur, sans sombrer dans un plat académisme convenu, si vous voulez… Il y eut outre les belles productions des Maîtres Chanteurs et de Parsifal par Wolfgang Wagner, Lohengrin de Werner Herzoz, Tristan und Isolde de Ponnelle, Le Ring de Sir Peter Hall, Lohengrin, de nouveau de Philippe Arlaud… Il n'y a que depuis la prise de pouvoir de K. Wagner que Bayreuth est devenu intergralement un Karnaval, qui présente des productions qui relèvent du récit fantaisiste sur de la musique de Richard Wagner…
Philippe Arlaud a mis en scène Tannhäuser, pas Lohengrin.
GC
Avez vous vraiment lu l article du wanderer ?
Les commentaires sur le chef d orchestre et les chanteurs sont nombreux et détaillés.
Avez-vous assisté à la représentation ?
Les deux avis ci-dessus semblent des réactions pavloviennes à la modernité sans aucun lien avec ce spectacle précis.
Je vous conseille aussi de lire ou relire les critiques du wanderer sur les mises en scène de koski ou kriekenburg soit pour le ring soit pour les meistersinger pour avoir un autre point de vue de cherqui sur Wagner.
Kein Recht an ihm
schwörst du schwatzend dir zu !
Autrement dit : Tes bavardages ne prouvent pas ton droit à la possession ! (citation du Rheingold)
Je serais curieux de savoir ce que c'est que "la modernité", lorsqu'il est question de porter des oeuvres sur scène…? Vous savez, un très grand metteur en scène, qui inspira d'ailleurs énormément Wieland et Wolfgang Wagner, Gustav Gründgens disait, à propos de l'art de la mise en scène :
« Mettre en scène une œuvre, c’est s’en imprégner dans l’esprit de son auteur. […] Représentez la volonté de l’auteur, non la vôtre. […] Un metteur en scène n’a pas d’opinion à avoir sur une œuvre, mais il doit mettre en scène et réaliser celle de l’auteur. S’il y réussit, ce ne sera déjà pas si mal. »
Merci pour votre analyse toujours très respectueuse du travail des artistes et très documentée, M.Cherqui. Pour les lecteurs qui n'ont pas eu la chance de voir le spectacle et veulent juger par eux-même, voici un lien (valable jusqu'au 13 octobre 2019) pour la retransmission de la soirée par la chaine 3sat :
https://www.3sat.de/kultur/festspielsommer/bayreuther-festspiele-2019–100.html
Excusez-moi, Monsieur Cherqui. « Tannhauser », c’est quand même autre chose qu’une visite guidée des coulisses du Festspielhaus , sous la conduite d’un clown (le rôle-titre ), d’une nymphomane (Vénus), d’un transsexuel et d’un nain, aussi sympathiques soient-ils par ailleurs. Vous pouvez enrober cela dans toute la philosophie que vous voulez, le Tannhauser de Kratzer, ce n’est pas le pur bonheur de l’intelligence, mais le grand malheur des intellectuels ( tous ceux que Katharina engage depuis dix ans). Sachant que le dramaturge de ce Tannhauser reprendra du service pour le Ring de l’an prochain, nous ne sommes pas prêts de nous rencontrer sur la Colinne.
Cordialement
Un copier-Collet de votre saillie déjà balancée sur Forum Opera n’est pas franchement très subtil permettez moi de le dire, critiquer ainsi un spectacle sans l’avoir vu n’est pas un signe de prudence ni de sagesse. Et qu’est-ce qui vous permet ainsi d’affirmer que « ce n’est pas du Wagner » ? En quoi votre imaginaire serait-il plus pertinent que celui des artistes qui nous permettent d’assister a un tel spectacle ? A part sans doute votre ressentiment à l’endroit de Katharina… il semble d’ailleurs que son contrat sera bientôt reconduit, pour ma part je m’en réjouis.
Moi j’ai été à la représentation du 13 août, celle qui n’a pas été dirigée par Gergiev. J’ai adoré cette mise-en-scène ! Beaucoup d’humour au début (la salle s’est tordue de rire quand elle s’est reconnue aux les pèlerins du premier acte) et une fin vraiment poignante, désespérée. Je n’en pourrais pas faire une analyse aussi fine et détaillée que M. Cherqui et j’avoue n’avoir pas compris le troisième acte sur le coup.
J’avais presque envie d’écouter la musique séparément de cette mise en scène si inventive, histoire de déguster cette merveilleuse acoustique et superbe orchestre dirigé par le magicien Thielemann. Mais bon, c’était mon premier pèlerinage à Bayreuth, beaucoup d’émotions.
Quant aux chanteurs, le niveau était vraiment exceptionnel, et Lise Davidsen est promise à un avenir radieux, si elle ne brûle pas les étapes.
Nous avons assisté en famille à la représentation du 21 août et avons également adoré cette mise en scène ! Pas mal de critiques ont injustement éreinté cette remarquable version, et nous étions un peu inquiets avant la représentation ; heureusement, la lecture du blog du wanderer allait dans un tout autre sens, et nous avait largement rassurés avant notre voyage ; après coup, nous ne pouvons qu’admirer la pertinence de son analyse !
Matériel et méthode :
Malheureusement les fées du Kartenbüro ne m’ont pas comblé de billets pour Tannhäuser cette année. Donc j’ai écouté la retransmission France Musique du 25/07/2019 et j’ai regardé un enregistrement de la représentation (je n’insiste pas…) en attendant le DVD officiel. Pour écrire je n’ai pas relu la critique de Wanderer depuis sa parution pour essayer d’avoir une vision personnelle.
Résultats :
1- Sur le plan musical. Disons que j’ai d’abord été enthousiasmé par Stephen Gould. C’est une voix franche, claire, nuancée, dramatique, mais pas celle d’un heldentenor et barytonante. En bref bien chantant et bien disant. L’acteur n’est évidemment pas Vogt ou Kaufmann mais il assure honnêtement le job. Elena Zhidkova est remarquable, très soprano, plus que mezzo, une vraie présence. A la première écoute Stephen Milling ne m’avait pas enthousiasmé mais finalement c’est une voix plus baryton-basse que basse, très humaine, très nuancée dans un rôle qui peut être un peu tonitruant. Lise Davidsen est remarquable et je n’ajouterai rien aux dithyrambes qui ont été écrites, juste que l’actrice est intéressante (cf la suite) ce qui n’était pas évident. A la première écoute je n’avais pas beaucoup aimé Martin Eiche que j’avais trouvé plébéien. En fait je me ravise. Clairement ce n’est pas un Wolfram « chanteur de Lied » (DFD, Hermann Prey). c’est un Wolfram franc, direct, baryton simple et bien chantant (un peu Eberhart Waechter). Walter (Daniel Behle) est excellent, pas caricatural comme certains illustres devanciers (Gerhardt Stolze) mais on apprécié ses qualités dans d’autres ouvrages. Biterolf (Kay Stieferman) pas mémorable. Quant à la direction de Valery Gerguiev, elle est d’abord très inégale : des moments délicats, poétiques et des tunnels de placidité. J’ajoute que je n’aime pas (musicalement) la version choisie de la bacchanale. Par contre les chœurs sont comme toujours somptueux, j’envie Eberhart Friedrich (comme ses prédécesseurs) qui, lors de pratiquement chaque représentation de chaque festival, reçoit un accueil unanime !
2- Maintenant la scénographie de Tobias Kratzer (et collaborateurs). Disons que j’appréhendais, mais l’enthousiasme de Wanderer (que je n’ai pas relu) donnait un ambitus favorable. Bon, j’ai beaucoup aimé. Est-ce Tannhäuser ? Si on s’en tient au « classique » certainement pas, mais tout Tannhäuser y est. Rien de moins, pas « rien de plus » puisqu’il y a plus. D’abord c’est une mise en scène absolument virtuose (surtout le premier acte) sur le plan technique. Après, que nous raconte-t-elle ?
a. Au premier acte des marginaux loufdingues, sortis de Fellini, et curieusement je verrais Tannhäuser dans le rôle de Gelsomina et Venus dans celui de Zampano. Est à dire qu’Elisabeth est « le fou » ? non quoique elle meure dans le sang… comment au fait ? je dirais simplement ici que le Gâteau Chocolat et le nain Oskar s’intègrent bien dans cette ambiance clownesque (je reviendrai sur eux à l’acte III). Mais… meurtrière et finalement sinistre. Tiens clown/meurtre : ça ne rappelle pas Pagliacci ? il n’empêche que le « gentil » Tannhäuser est fasciné par Vénus. Et la joyeuse compagnie (ça ne vous rappelle pas la troupe italienne d’Ariane à Naxos ?) va se rendre à la Wartburg, le temple du chant (« The Voice », somme toute), Bayreuth, évidemment ! la deuxième partie de l’Acte I est finalement classique avec les spectateurs en chasseurs, cela est assez sage. la barrière de police sur la route c’est trop top ! Par contre j’insiste sur la gifle donnée à Tannhäuser par Elisabeth : geste très bourgeois envers un fiancé infidèle, ou un gosse mal élevé. En fait, cela place Elisabeth dans la situation d’une jeune femme conventionnelle et un peu guindée qui va ensuite évoluer (est-elle amoureuse de Tannhäuser ? ou simplement vexée ? je crois que c’est une femme amoureuse et malheureuse, cf la suite).
b. L’acte II, de par sa disposition spatiale et son traitement scénique, va se faire juxtaposer et se croiser deux actions. D’abord sur l’estrade éclairée par en dessous le concours de chant, très classique et littéral. Cela rejoint la tradition. Et de l’autre, avec la vidéo (située au-dessus du cadre scénique), plusieurs actions se développent et toutes aboutissent sur la scène principale. La première est une sorte de « making of » de l’action principale, en particulier l’entrée en scène d’Elisabeth. La seconde est plus ectopique et hilarante : c’est l’arrivée de la joyeuse compagnie conduite par Vénus qui escalade le balcon légendaire, rentre dans la salle. N’est-ce pas « une nuit à l’opéra » ? Ensuite c’est le tumulte causé par la joyeuse compagnie qui conduit Katarina Wagner à appeler la police, qui se mobilise comme dans un vieux film muet : coté course poursuite cela fait penser à Buster Keaton dans « Fiancées en folie ». Mais tout cela se finit avec l’arrivée des pèlerins très classique, mais un rapport Elisabeth/Tannhäuser très fort : désespérance, rupture apparente.
c. L’acte III change de voilure. Bon, c’est vrai que c’est glauque et en pleine déglingue. Ce qui est frappant c’est le rôle du nain Oskar. Jusqu’à présent il n’avait pas vraiment d’individualité dans la joyeuse compagnie, ici il prend une dimension humaine. Très frappant l’épisode de la tambouille sur le réchaud à gaz : il fait manger Elisabeth, il prend soin d’elle. Elisabeth va apparaitre défaite, triste, déprimée. je l’interprète comme la défaite de son amour pour Tannhäuser, qui n’a ici rien de bourgeois, mais au contraire est profond. Elle chante alors sa prière qui est un chant de tristesse et de désespoir (à mettre en parallèle avec le chant de la Comtesse dans les Noces (début de l’acte 3). Elle rêvait et elle est désespérée. Ici se situe l’échange qui devient sexuel avec Wolfram. J’aurais tendance à le considérer de manière positive : Wolfram prend l’apparence de Tannhäuser (sans doute est-ce son fantasme ?), Elisabeth qui lui enlève son postiche roux et le remet est parfaitement consciente de qui il est et dans un sourire éclatant elle « s’offre » (à ?) Tannhäuser, en fait réalise son propre fantasme. Ensuite Wolfram, dans le chant à l’étoile » déchirant, est très perplexe ; quelles sont ses pensées à ce moment lui qui aime Elisabeth ? Elles sont poignantes. Elisabeth se retire derrière la camionnette et le nain Oskar lui caresse le visage et fait preuve d’empathie…. Le plateau tourne et l’on verra in fine Elisabeth ensanglantée, morte. S’est-elle suicidée ou le nain Oskar l’a‑t‑il tuée. J’ai repassé la scène plusieurs fois et je suis incapable de trancher mais l’impression est que le nain Oskar n’est jamais dans la possibilité de la tuer ; alors plutôt un suicide ? Toujours est-il que pendant que le plateau a tourné se déroule le « retour de Rome ». Deux actions sont particulièrement évidentes : la première est simplement le retour de Vénus à la plus grande joie de Tannhäuser, sauf qu’ensuite Vénus reste purement observatrice jusqu’à la fin. La seconde est que si Tannhäuser ne revient certainement pas de Rome, il a en main un grand volume « Wagner » (partitions apparemment, textes ?), Wolfram va caresser le volume et en prendre grand soin, Tannhäuser va consciencieusement le détruire. Puis il va découvrir Elisabeth ensanglantée, morte dans le tube Citroën et faire le même geste que le nain Oskar, en lui caressant les cheveux. Et tout cela finit sur l’écran video, un peu comme cela a commencé Gelsomina/Tannhäuser conduit le Citroën avec…. le « fou »/Elisabeth. Zampano/Vénus a quitté le terrain et n’a été que spectateur à la fin. Pour finir un commentaire sur le Gâteau Chocolat : finalement il n’apporte que sa présence loufoque (qui est inverse de la taille du nain Oskar), nécessaire à l’existence de la joyeuse compagnie, mais en aucun cas il n’a la présence humaine et le rôle majeur du nain Oskar (il disparait d’ailleurs sauf en placard publicitaire à l’Acte III).
d. Conclusion provisoire. Tout commence dans la comedia del arte qui infiltre l’opera seria wagnérien pour finir par le fantasme des amants éternels Tannhäuser/Apollon/Tristan et Elisabeth/Ariane/Isolde sous le sourire complice de Zerbinetta/Vénus. Et foin de Wagner et de ses théories ! Prima la Parola ? Prima la Musica ? NON : prima la Regia !
Discussion :
La revue de la littérature se limite à celle de langue française et finalement à l’analyse de Wanderer. Et c’est niveau universitaire ! Donc je reprends maintenant le texte de fin juillet. En fait je ne discute pas de l’interprétation car cela reste très personnel. Passons à la mise en scène.
En examinant l’interprétation de Wanderer sur le rôle subversif de l’artiste et son chapitre « Wagner et la révolution », il est clair que je ne le perçois pas du tout ainsi. J’aurais tendance à situer cette interprétation dans le cadre historique du style de l’opéra. Wagner était un grand Gluckiste, donc on est dans le cadre l’opera seria. Peut-être Wagner était-il un joyeux drille, mais son œuvre c’est du lourd. Cette mise en scène introduit, certes artificiellement, une dimension clownesque (opera buffa, ou comedia del arte) mais qui à mon avis marche parfaitement. Mais le chemin du clown au tragique est toujours court : c’est ce qui se passe ici entre l’acte I (ou il y a des prémices) et l’acte III. Wanderer insiste donc sur le rôle subversif de l’artiste et bien sûr cela bouscule l’ordre (artistique) établi, mais sans avoir de conséquence positive et pérenne car tout finit dans le retour à l’ordre et la désolation. Néanmoins il reconnait que le metteur en scène sait exprimer le drame humain.
Conclusion :
Bien entendu je partage certaines observations, toujours détaillées et argumentées de Wanderer. Mais, à mon avis, cette représentation est un remarquable travail de déconstruction de l’histoire et de reconstruction, autour de la mise en scène, de la symbiose du drame wagnérien avec la comedia del arte d’une part et c’est d’autre part une remarquable direction d’acteurs pour exprimer les rapports humains et montrer le drame humain des personnages dans cette œuvre. C’est très réussi et cela est rarement mis en exergue dans beaucoup de mises en scène conventionnelles.