
Simon Stone connaît sa Traviata ; il connaît également les attentes que peuvent susciter ce monument d'émotions lacrymales. L'amateur attend des interprètes capables de s'élever à la hauteur du mythe élevé par Piave et Verdi autour de l'ouvrage d'Alexandre Dumas fils. Son angle d'attaque considère que la transfiguration de Violetta doit passer par des éléments liés à une traduction contemporaine du mythe. Ce faisant, il donne à la demi-mondaine les atours d'une star des réseaux sociaux qui vit dans un univers virtuel où le nombre de followers et d'émoticones compte davantage que la recherche d'un protecteur. La Violetta de Simon Stone est une "dévoyée" bien banale, dans la mesure où la marchandisation et l'exhibitionnisme via internet et les réseaux dits sociaux touchent des millions d'individus. On fait le deuil d'une hiérarchie sociale, très présente dans le livret de Dumas – Piave, mais également chez Balzac, qui séparait la grisette de la courtisane et soulignait le besoin de gravir rapidement les degrés vers la fortune et la reconnaissance. En usant et abusant des références à l'influence d'internet, on sous-entend au passage la permutation qui s'opère dans le livret entre les figures de la Sainte et de la Putain. Si internet légalise une forme de prostitution morale au point d'en faire un marqueur social et l'apanage d'une jeunesse connectée, la transformation de Violetta en vedette de ce monde virtuel peine à convaincre du fait même que lesdits réseaux sociaux élèvent tous les participants au rang de vedettes.
Écartée également, cette tuberculose à la fois maladie sociale et attribut romantique par excellence. On ne compte plus les personnages littéraires dont le destin trouvera dans la phtisie une dimension délibérément tragique. Toutes ces héroïnes sont en général des femmes : Valérie de la Comtesse de Krüdener, Malvina de Sophie Cottin, Désirée dans Fromont jeune et Risler aîné d'Alphonse Daudet, Mimi et Francine de la Vie de Bohême de Murger, Madeleine du Lys de la Vallée ou Madame Chauverel, cette Femme singulière de Jules Romain… Curieusement, Marguerite Gautier partage avec Hans Castorp(( Le héros de La Montagne magique de Thomas Mann)) l'idée que la maladie consistant à s'épuiser à respirer, est symptomatique d'un mal que propage une société en contaminant ses éléments. Le choix de transformer en cancer une phtisie sans doute trop historiquement et thématiquement connotée, permet à Simon Stone de plonger son personnage dans une modernité sinistre qui rend la mort anonyme et fait de la pathologie une forme de fatalité contemporaine. On pourra simplement regretter le caractère improbable d'une Pretty Yende, déjà si peu actrice, troquant les robes en lamé contre un pyjama en pilou, mais toujours pimpante et apprêtée, jusque sur son lit l'hôpital.
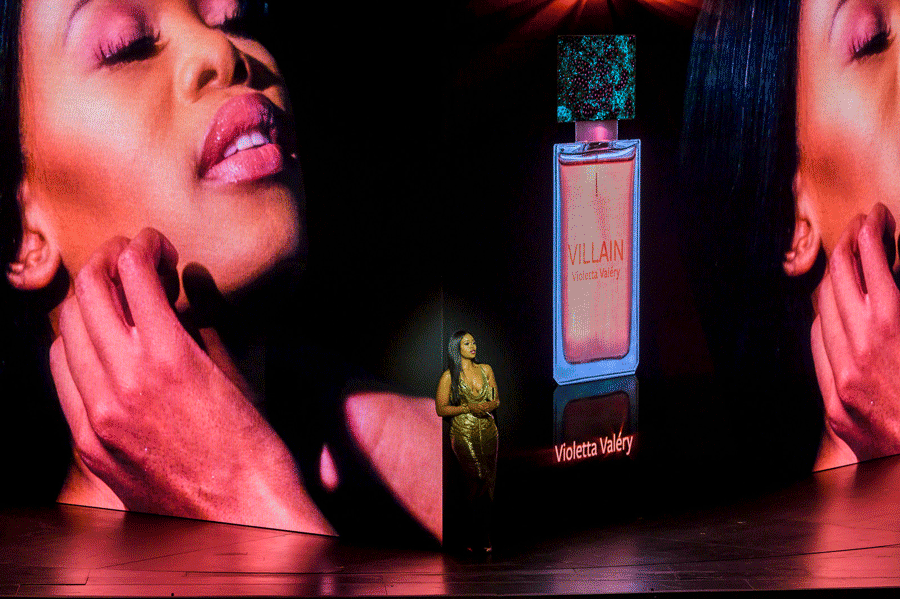
Ni mythique, ni vraiment dévoyée, Violetta version Stone se contente de mettre sa plastique au service d'un peu original beauty.com qui commercialise son parfum "Villain"… On se contentera donc d'un décor – tournette censé illustrer l'univers hyperconnecté, avec ces écrans géants qui reproduisent tantôt ce que lisent les protagonistes sur leurs smartphones, tantôt des images et vidéos qu'on dirait sorties d'un mélo sirupeux. Ce décor (bruyamment) rotatif se présente sous la forme de deux pans en L qui laissent voir des projections sur leurs faces extérieures, et une surface d'un blanc éclatant à l'intérieur. Cette dichotomie est très étonnante, dans la mesure où elle crée un décalage entre le délirant (les vidéos, les néons multicolores…) et la neutralité des "intérieurs". La rotation se double de changements de décors très virtuose – décors réduits à quelques éléments sur fond blanc.
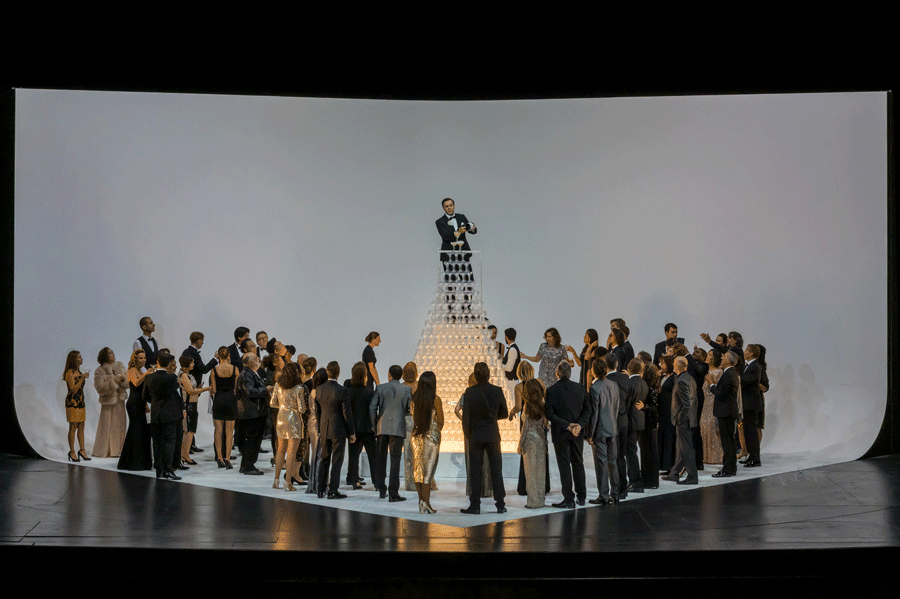
Violetta et Alfredo sont deux jeunes gens qui accompagnent leur promotion sociale à coups de clics et selfies. Le téléphone portable est présent dans chaque scène de l'opéra, jusque dans l'agonie finale au moment où Alfredo tente de joindre une infirmière… Pour l'heure, on fait sauter (avec quelques difficultés) les bouchons et le Brindisi se répand du haut d'une immense fontaine à champagne. L'amour naît pourtant dans l'arrière-cour de cette salle des fêtes, au milieu des poubelles de tri et des caisses de bière. Direction la rue de Rivoli toute proche, avec ce Sempre libera qui désigne le vélo rouge en libre service (merci la Mairie de Paris) et la statue de Jeanne d'Arc sur la place des Pyramides.
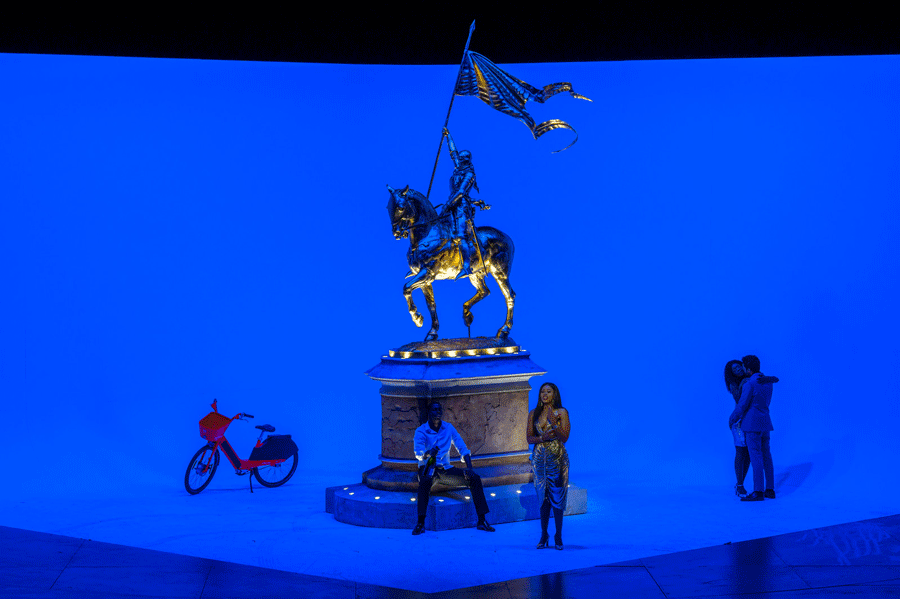
L'image de la "dévoyée" chantant devant la pucelle d'Orléans a de quoi séduire. À la pluie d'aigus et de couleurs, répond le bras turgescent et vengeur de la statue équestre d'Emmanuel Frémiet. "Votre cancer a récidivé" annonce crûment le SMS de la si mal nommée mutuelle médicale Humanis. Mais Violetta n'en a que faire… La fin de la scène est plus laborieuse, la fuite des amoureux se ponctuant par quelques girations dispensables montrant Paris by night, les boutiques de kebabs, les Uberbisous, les SMS qu'on échange (toujours étrangement rédigés dans une orthographe impeccable)… une amourette bien anecdotique en somme.

Le gros plan sur les yeux de Violetta sert de transition vers un étonnant deuxième acte à la campagne. De' miei bollenti spiriti lance Alfredo, tout en écrasant des grappes de raisin dans une comporte en bois – une sorte de retour à la terre du noceur qui vidait ses coupes de champagne ? Violetta n'est pas en reste non plus. Elle porte des bottes en caoutchouc, mime le geste de traire une (vraie) vache qui rappellera à certains le veau d'or de Moses und Aron sur la scène de Bastille. On notera également l'allusion à la petite paysanne de Domrémy, faisant le trajet inverse de Paris à la Lorraine. Tout ceci est bien gentillet mais l'idylle aux champs est interrompue par un Germont père en austère complet velours, sacoche hors d'âge. Tout dans cette démarche inspire la bourgeoisie provinciale, l'homme qui a ses habitudes et ses valeurs.

La sœur d'Alfredo devait épouser un prince saoudien mais les gros titres façon breaking news annoncent que les fiançailles sont rompues… la faute à ce diable d'Alfredo qui s'est entiché d'une embarrassante courtisane. Il y a de la nostalgie et de la tristesse dans le spectacle de cette petite chapelle rustique qui sert de décor au duo Germont – Violetta. Adieu veau, vache, cochons, couvées… il faut prendre un Uber et rentrer à Paris. On lit dans l'excitation des néons entre boîte de nuit et Kâmasûtra, les prémices de la colère sourde qui agite Alfredo. Celui-ci gagne sa partie de poker en ligne tandis que s'agitent des convives dont les accoutrements traduisent une volonté assez improbable de dénoncer à tous crins la laideur et l'imbécilité morales. Le chœur des bohémiennes et des toréadors manque d'originalité dans la symbolique qu'ils déploie, en faisant ressurgir involontairement l'image de cette pauvre vache plantée au centre du décor quelques minutes auparavant…

Le dernier acte nous transporte entre les murs pâles et tristes d'une unité en soins palliatifs, Violetta y côtoie d'autres patients dont le goutte-à-goutte fait écho aux pizzicatos des cordes égrenant les instants qu'il leur reste à vivre. On est ici très loin de l'hyperconnection futile et délétère. Les images qui défilent encore montrent les images du bonheur enfui, les selfies innocents avec sur un coin de table, La Douleur de Duras… La dame a troqué ses camélias contre des roses plus ordinaires mais qui, projetées sur grand écran, sont montrées dans un grand brasier virtuel qui les consume. Le décor pivote une dernière fois, présentant au centre de la scène, l'interstice d'une porte au-delà de laquelle on distingue une grande clarté parcourue de vapeurs immaculées. C'est sur cette très don juanesque image que se referme Traviata, tandis que Germont retient pudiquement son fils sur le seuil et que s'éteignent les derniers accords de la fosse.
La salle fait un triomphe retentissant à Pretty Yende, qui assure le rôle-titre avec des moyens qui vont du spectaculaire (on sent le feu et la pyrotechnie belcantiste qui ne demandent qu'à éclater au grand jour) au juste convenable (cette manière d'égaliser l'expression sans détacher les éléments qui mettent en valeur l'évolution du caractère). La soprano sud-africaine n'est jamais véritablement prise en défaut et domine les enjeux techniques avec un brio qui n'a rien de fabriqué. Reste une absence flagrante de théâtre et cette irrésistible impression qu'au-delà des notes il manque décidément la chair et le drame (avec quelle placidité elle réagit à la lecture de la lettre au III…). Il faut tout le talent de Michele Mariotti pour faire éclore l'attention au texte et bouleverser l'auditeur, comme en témoigne le ralenti qui marque l'aveu du sacrifice de Violetta face à Germont (Dite alla giovine si bella e pura…). Cette scène est assurément le sommet vocal de cette soirée, avec un Ludovic Tézier absolument impérial au moment de ramener son fils à la raison dans Di Provenza il mar… Le baryton connaît l'art de faire sourdre l'émotion sans une once d'effet mal ajusté. L'Alfredo de Benjamin Bernheim trouve autour de cette voix majestueuse une façon de s'agréger et de gagner en intensité. Sa prestation au I peine à convaincre, tant il use et abuse du côté chien fou, volontiers grand dadais affectueux et naïf. À l'abattage dégingandé, on ajoutera une manière de phraser si peu italienne qu'elle finit par aligner des voyelles excessivement ouvertes, si peu en accord avec les lignes invariablement doucereuses de Pretty Yende. Les lignes d'Addio del passato n'ont ni le volume ni la longueur qui contraignent le temps musical à s'interrompre. Chemin faisant, la fougue d'Alfredo laisse place à une expression enfin domestiquée (Parigi, o cara).
Les seconds rôles sont relativement bien distribués, quoique peu mis en valeur par la scénographie. La Flora de Catherine Trottmann et le Douphol de Christian Helmer assurent les premiers plans, avec une sensualité remarquable et une belle présence. Marion Lebègue est une Annina élégante et racée, Julien Dran, un Gastone particulièrement inspiré. Marc Labonnette signe un Marquis pétulant tandis que le Docteur Grenvil trouve en Thomas Dear un interprète de grande qualité.
On le disait plus haut, la soirée tient en équilibre sur la baguette de Michele Mariotti, véritable maître de la dramaturgie et des émotions. On aura rarement entendu – qui plus est dans une acoustique comme Garnier qui ne pardonne pas le moindre écart – une précision rythmique et un dosage des timbres aussi millimétré. Le plateau trouve dans une telle fosse des ressources et une assurance qui font avancer le drame. Mariotti comble avec intelligence et finesse, les attentes que la scénographie de Simon Stone n'aura pas suffi à offrir visuellement, notamment dans le ressac expressif du premier acte ou le basculement de l'idylle en drame au II. L'agonie de Violetta est âpre de ton, avec des cordes une raucité d'accent qui accompagne le désespoir et l'angoisse des ultimes moments. Souhaitons le meilleur à ce déjà grand nom de la direction d'opéra…


Viens de voir cette Traviata au cinéma. Pas de quoi s'enthousiasmer ni se scandaliser. Le concept de Stone est intéressant, mais il ne sais pas très bien quoi en faire.. Et la direction d'acteurs est inexistante, et comme aucun des trois principaux chanteurs n'est vraiment comédien, on s'ennuie un peu et on n'est pas vraiment ému. Heureusement que le niveau musical est remarquable, tant par le chef que les chanteurs. Une soirée agréable qui sera vite oubliée..
Ps : merci Castorf pour les kebab..